L'ARTICLE DU MOIS : LA DISCRÈTE GRANDEUR DU VÉRISME
L'ENSEIGNEMENT MUSICAL : UNE HISTOIRE DE LUTHERIE...
À RESERVER SUR L'AGENDA
8 / 12

Pour la troisième
année consécutive, au Théâtre de l’Athénée-Louis Jouvet, l'association 1001
Notes présente ses projets de soutien aux jeunes artistes en les invitant à
se produire dans le cadre des schèmes “L’Envol” et “Le Maitre et l'Élève” et à
présenter leurs projets discographiques. Au programme, trois formations
musicales pour vivre une soirée placée sous le signe de la jeunesse, de
l’ouverture musicale et du talent, avec comme invitée d’honneur la pianiste
Vanessa Wagner. La première partie s'ouvrira sur le projet “L’Envol”, avec Hermine Horiot, violoncelle,
et Ferenc Vizi, piano. Ils interpréteront des
extraits de leur prochain album, « Romances
Oubliées » (Collection 1001 Notes, sortie en janvier 2015) : la Sonatine en Sol Mineur op.100 d'Antonin Dvořák et 3
Romances op. 94 de Robert
Schumann. La seconde partie, “ Le
Maitre et l'Élève”, permettra d'entendre les pianistes Vanessa Wagner, Thibault
Lebrun et David Ianni. Ce dernier jouera d'abord deux
pièces de sa composition, Obsculta op. 97 et Sept Valses op. 77. Puis Thibault Lebrun et Vanessa Wagner
donneront la 2ème Ballade et Cantique d'Amour de Franz Liszt, et
une Danse slave de Dvořák, en prélude à leur disque, « l'Aube », qui
doit être enregistré en février prochain.
Théâtre de Athénée-Louis Jouvet, le 8
décembre 2014, à 20H
Réservations et renseignements
: Square de l'Opéra Louis Jouvet, 7 rue Boudreau, 75009 Paris ; par tel : 01 53
05 19 19 ; en ligne : www.athenee-theatre.com
14 / 12
Cédric Tiberghien, chambriste à Strasbourg

DR
Artiste en résidence de la
présente saison de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, Cédric Tiberghien
donnera une matinée de musique de chambre à la Cité de la musique de
Strasbourg. Ce pianiste est considéré parmi les plus talentueux et originaux de
la jeune génération. Lauréat de nombreux concours internationaux, Premier Prix du Concours Long Thibault en
1998, il mène depuis lors une carrière enviable au concert et au disque (ses
interprétations de pièces solo de Karol Szymanowski et des concertos de
Théodore Dubois, parues chez Hyperion, ou de musique
de chambre avec la violoniste Alina Ibragimova, font référence). Ce dernier domaine reste un
des jardins secrets de cet artiste qui cultive le « juste équilibre entre la
clarté technique et l'indispensable humanité dans l'interprétation ».
Autrement dit l'inspiration ! Il jouera avec les solistes de l'OPL, dont la toute nouvelle premier violon super soliste Charlotte Juillard, fondatrice du Quatuor Zaïde.
Au programme : le Quatuor pour piano et cordes K. 478 de Mozart et le Quintette
« La truite » D 667 de Schubert, « deux sommets du bonheur musical
viennois », remarque-t-il. En effet !
Auditorium de la cité de la
musique et de la danse, 1, place Dauphine, 67076 Strasbourg, le 14 décembre
2014, à 17H
Réservations : par tel : 03 88 43 68 00 ; en ligne :
wwww.conservatoire.strasbourg.eu
15 / 12
Marie-Josèphe Jude joue Chopin en Arles

DR
La pianiste Marie-Josèphe Jude,
formée au CNSMD de Paris, finaliste du Concours Clara Haskil, et professeure au conservatoire de Lyon, aime les défis.
Après avoir, entre autres, joué et enregistré l'intégrale des œuvres
pianistiques de Brahms, elle livre sa vision des Nocturnes de Chopin. Ce
genre dont on doit l'invention à l'anglais John Field, Chopin lui donne une
âme. Au fil de 21 pièces, écrites entre 1827 et 1846, emplies de tendresse, méditations bercées par
la douce mélodie de la phrase. La mélancolie, le « zal »
polonais, l'épanchement retenu ou l'effusion passionnée caractérisent les
arabesques du piano, qui n'hésite pas à se faire grave, confidence du cœur,
rêves et élans infinis. Le concert sera l'occasion de présenter le nouveau CD
de ces pièces que la pianiste a enregistrées pour le label Lyrinx.
Chapelle du Méjan, à Arles, le 15
décembre 2014, à 18H30.
Renseignements (entrée libre) :
par tel : 04 90 49 56 78 ; en ligne : www.lemejan.com
19 / 12 – 1 / 2
La Belle au bois dormant de... Respighi

DR
Ottorino Respighi (1879-1936), auteur des fameux poèmes symphoniques immortalisant la
ville de Rome, a aussi composé pour la scène d'opéra. Le conte musical en trois
actes La Bella Dormente nel bosco (La belle au bois dormant) d'après Charles Perrault, a d'abord été
conçu (1922) pour un théâtre de marionnettes, avant que Respighi ne l'adapte
(1933) un en opéra pour enfants et les autres. L'humour parodique avec lequel
le sujet est traité, comprenant des allusions aussi bien à Wagner qu'à Debussy,
est soutenu par une orchestration virtuose convoquant un effectif réduit et
original de vents, sept cordes, piano et clavecin. La musique est vive et
chatoyante. La production de l'opéra studio de l'Opéra national du Rhin sera
mise en scène par Valentina Carrasco et dirigée par
Vincent Monteil. Elle viendra immédiatement après à Paris, à l'Athénée,
l'orchestre y étant l'ensemble Le Balcon. Une découverte à n'en pas
douter.
OnR, à Colmar, le 19
décembre 2014, à 20H ; à Strasbourg, les 3, 7, 9 Janvier 2015, à 20 H et le 4/1
à 15H ; à Mulhouse, les 31/ 1, à 20H et
1er /2 à 15H.
Théâtre
de l'Athénée, Paris, les 17 (15H et 20H), 20 (19H), 21 et 22 janvier 2015, à 20
H.
Réservation : A Colmar, Théâtre municipal,
3 rue Unterlinden, 68000 Colmar ; par tel : 03 89 20
29 02 ; en ligne : theatre@ville-colmar.com ;
A Strasbourg/Opéra, 19 place Broglie, BP
80320, 67008 Strasbourg cedex ; par tel. : 825 84 14 84 ; en ligne : caisse@onr.fr
A Mulhouse/La Filature, 20 allée Nathan
Katz 68090 Mulhouse cedex ; par tel. : 03 89 36 28 28 ; en ligne : billetterie@lafilature.org
Théâtre
de l'Athénée, Voir ci-dessus.
21, 23, 25, 28, 30 /12 – 1er /1
La Chauve-Souris à l'Opéra Comique

Die Fledermaus est plus qu'une
opérette. C'est un des chefs d'œuvre de la musique viennoise. A Vienne, on la
donne depuis toujours au Staatsoper, généralement
pour les fêtes de fin d'année. Normal, puisqu'elle est tirée du
« Réveillon », un vaudeville irrésistible du tandem Meilhac et
Halévy. Cette histoire de bal masqué pour mettre en scène une petite vengeance
personnelle à la risée de tous, est aussi française que viennoise, car son
origine vient d'une pièce autrichienne, « La prison » (1851), dans
laquelle ont puisé les deux français. Et si l'on remarque qu'Offenbach lui-même
la créa sur les bords du Danube, en 1874, la boucle est bouclée ! A l'Opéra
Comique, en cette fin d'année 2014, on en jouera la version française, donnée
pour la première fois à Paris en 1877, mais dans une nouvelle mouture de Pascal
Paul-Harang, soigneusement travaillée, annonce-t-on.
Aux commandes de ses Musiciens du Louvre Grenoble, Marc Minkowski officiera,
qui connaît son affaire pour l'avoir dirigée à Salzbourg lors d'une mémorable
production marquant la fin du mandat de Gérard Mortier. Il ne tarit pas de
compliments sur une pièce aux « références mozartiennes », qui
« sur les plans dramaturgique et vocal, se site dans le sillage des
Mozart-Da Ponte ». La régie d'Ivan Alexandre sera sans doute plus sage
ici, encore que... Car sous le divertissement et la désinvolture de la valse,
se niche une sévère satire de mœurs, peut-être encore d'actualité. En tout cas la plateau vocal se promet d'être explosif, avec Stéphane Degout et Sabine Devieilhe, entre
autres. Une manière originale d'inaugurer scéniquement la saison du
tricentenaire de la maison Favart et de conclure l'année sur une note optimiste
!
Opéra Comique, les 21, 25, 28 décembre
2014 à 15H, les 23 et 30 /12 à 20H, et
le 1er janvier 2015 à 15H.
Location : Billetterie, 1 place Boieldieu,
75002 Paris ; par tel. : 0825 01 01 23 ; en ligne : opera-comique.com
26 / 12 – 8 / 2
Idomeneo ci, Idomeneo là

L'Opera seria de Mozart Idomeneo, Re di Creta revient
décidément en force sur les scènes hexagonales, à Montpellier puis à Lyon et à
Lille, et dans des productions différentes ! La production montpelliéraine sera
mise en scène par Jean-Yves Courrégelongue et dirigée
par Sébastien Rouland. On pourra voir celle de
l'Opéra de Lyon, en janvier, dans la régie de Martin Kusej,
sûrement surprenante, et sous la direction de Gérard Korsten.
Et, quasi simultanément, celle de l'Opéra de Lille, confiée à l'acteur
Jean-Yves Ruf pour la régie, avec Emmanuelle Haim au pupitre. Seul point commun : dans les trois cas, le
personnage d'Idamante sera chanté par une mezzo, sans
doute pour rappeler qu'il le fut, lors de la création munichoise (1781), par un
castrat. Mozart imposera un ténor lors de la reprise à Vienne, peu après.
Abondance de biens pour une œuvre qui si elle n'est plus à découvrir, mérite
d'être approfondie. Le génie dramaturgique de Mozart s'y affirme pour dépasser
les archaïsmes du genre de l'opera seria immortalisé par Gluck. Un souffle dramatique parcourt
la pièce dans les ensembles, d'une belle audace, les chœurs vibrants, et des
arias déjà dégagées de la convention, à l'aune des grands thèmes véhiculés,
voire de la dimension politique de l'œuvre.

Opéra de Montpellier, les 26 décembre 2014,
2, 6, 8 janvier 2015 à 20H et les 28/12 et 4/1 à 15H.
Opéra de Lyon, les 23, 27, 29, 31 janvier,
2, 4 , 8 février 2015, à 20H, et 25/1 à 16H
Opéra
de Lille, les 27, 29 janvier, 3, 6 février 2015 à 20H, et le 1er/2 à 16H
Réservations : A Montpellier, Opéra
Comédie, 11, Bd Victor Hugo 34000 Montpellier ; par tel : 04 67 60 19 99 ; en ligne : www.opera-orchestre-montpellier fr
A Lyon : Place de la Comédie, BP 12 19,
690023 Lyon ; par tel.: 04 69 85 54 54 ; en ligne : www.opera-lyon.com
A Lille, Opéra : 2 rue des
Bons-Enfants, 59001 Lille cedex ; par tel. : 03 62 21 21 21 ; en ligne :
www.opera-lille.fr
12 & 23 / 1
Poursuite du cycle « Vu du Front » aux Invalides

Maurice
Maréchal et le violoncelle « Le Poilu » / DR
En parallèle à l'exposition « Vu du
Front. Représenter la Grande guerre » au Musée des Invalides, le cycle de
concerts dédiés proposera encore, en janvier, deux soirées rares. Le 12, le duo
Contraste (Cyrille Dubois, ténor, et Tristan Raës,
piano) réhabilitera des auteurs et des répertoires injustement méconnus : le
cycle de mélodies de Lili Boulanger « Clairières dans le ciel », les
« Sept petites images du Japon » de Georges Migot, les
« Odelettes » de Joseph-Guy Ropartz, des pièces de Jean de la Presle,
dont « Heureux ceux qui sont morts », enfin des mélodies de Pierre Vellones : « Lettre du Front » et « Aux gonces qui se débinent ». L'ultime séance, le 23
janvier, sera l'occasion d'un hommage au violoncelliste Maurice Maréchal
(1892-1964), créateur d'œuvres de Debussy et d'André Caplet. Il a rapporté dans
ses carnets de guerre de précieuses informations sur le quotidien des
tranchées, transcendé par la musique qu'il jouait sur un instrument de fortune,
« le Poilu », confectionné, en juin 1915, dans le bois d'une caisse
de munitions, et conservé au Musée de la Cité de la musique à Paris. Le
celliste Alain Meunier et la pianiste Anne le Bozec interprèteront l'Élégie de Fauré, la Sonate op. 38 de Brahms, la Sonate
N° 1 de Debussy, et d'Arthur Honegger, sa Sonate pour violoncelle composée en
1920.
Grand
Salon de l'Hôtel de Invalides, le 12 et
le 23 janvier 2015 à 20H.
Réservations
: par tel.: 01 44 42 32 72 ; en ligne : culture@musee-armee.fr
13 & 14 / 1
Karina Gauvin chante les héroïnes haendéliennes

DR
Comme sa compatriote Marie-
Nicole Lemieux, la canadienne Karina Gauvin montre d'immenses talents vocaux et
scéniques dans le répertoire baroque. Dans Haendel en particulier. On a déjà
apprécié une Armida (Rinaldo) passionnée et
féroce à Glyndebourne, l'été dernier, et Paris l'a
découverte dans Ezio et Giulio
Cesare au Théâtre de Champs-Elysées. Les héroïnes haendéliennes seront au
centre de son premier récital à la Salle Gaveau. Elle y interprétera des
extraits de Rodelinda (« Ombre piante, urne funeste »), de Rinaldo (« Furie terribili »), de Jules César, d'Alcina (« o mio cor »), et d'Ariodante (« Doppo notte »). Elle sera
accompagnée par le Cercle de l'Harmonie, dirigé par son premier violon Julien
Chauvin. Ils donneront encore des pages orchestrales, ouverture d'opéra et
extraits de concertos grossos et de la Water music.
Ce même programme sera joué, la veille, à la MC2 de Grenoble.
Auditorium de la MC2 de Grenoble, le 13
janvier 2015, à 20H30, et Salle Gaveau, Paris, le 14/1, à 20H30.
Réservations : MC2, 4 rue Paul Claudel,
38000 Grenoble ; par tel. : 04 76 00 79 00 ; en ligne
: billetterie@mc2grenoble.fr
Salle Gaveau, 45-47, rue de la Boétie, 75008 Paris ; par tel.: 01
49 53 05 07 ; en ligne : www.sallegaveau.com
Jean-Pierre Robert.
2, 4, 9,
16, 18 / 12
Musique
au Musée d'Orsay

Pieter Wispelwey© Fritz de Beer
Trop souvent on pense Orsay comme le Musée
de la peinture des impressionnistes. Ses collections sont plus larges et tous
les mouvements du XIX ème siècle en peinture, en
sculpture, en design, et même en photo sont représentés. Les expositions
temporaires sont intéressantes, quoique il faille oublier celle actuelle sur
« Sade, attaquer le Soleil », qui n’est pas si éblouissante qu’on
l'aurait pensé ; seuls les textes choisis sont valables, le reste est une
vague illustration de ce théâtre de la cruauté. Mais on oublie qu’à l’auditorium
du musée sont proposés des concerts magnifiques tout au long de l’année, en
parallèle avec les expositions. Du 13 novembre 2014 au 10 février 2015, par
exemple, un premier cycle, « Back To Bach », est consacré au retour
au XIXème de Jean-Sébastien Bach. De Chopin à Gounod, en passant par
Mendelssohn, Saint-Saëns, Franck, les musiciens de ce siècle n’ont eu de cesse
de faire aimer la musique du Cantor, en la jouant, la transposant, la
paraphrasant. Ils ont fait de Bach un « auteur contemporain ». Des avants
concerts, qui correspondent à cet art du pastiche, sont proposés par les
conservateurs du Musée. Ainsi on verra des œuvres de la collection du Musée à
côté de celles plus anciennes qui ont directement inspirées les artistes. Pas
de Manet sans Titien, Pas de Monet sans Turner, Pas de Rodin sans Michel-Ange.
Toute l’année, le thème « A la manière de », pastiches, hommages,
réinventions, sera le fil rouge des concerts et des expositions. Après
« Back To Bach », suivront : « Suites françaises » et le
rapport à la musique baroque, puis « Drôles de dames », en hommage
aux interprètes qui ont donné leurs lettres de noblesse à la mélodie et au
Lied, enfin « Modernités Italiennes », en miroir avec une exposition
d’art décoratif italien. Les concerts ont lieu soit à 12h30 soit à 20h et les
artistes qui s’y produisent sont d’exception.
Au mois de décembre on peut ainsi écouter
des œuvres très originales à partir du répertoire de J-S. Bach :
Le 2, le duo de pianistes serbes, Lidija et Sanja Bizjak, dans un programme Bach/Max Reger, en particulier
des transcriptions des Concertos Brandebourgeois pour piano à quatre mains.
Le 4, en deux séances consécutives, le
célèbre violoncelliste hollandais Pieter Wispelwey dans l’intégrale des Suites pour violoncelle de Bach, son cheval de bataille.
Il les a enregistrées plus d’une fois.
Le 9, Le pianiste italien, Maurizio Baglini dans un programme Bach/Busoni dont il a réalisé un
CD;
Le 16, le jeune pianiste français, Adam
Laloum, lauréat du concours Clara Haskil de Vevey, dans un programme Bach et
Schumann.
Le 18, La mezzo allemande Janina Baechle, accompagnée au
piano par Marcelo Amaral, dans un récital Mendelssohn et Bach.
Une
manière de découvrir des musiciens de talents.
Renseignements et réservations : par tel :
01 40 49 48 14 ; en ligne : www.musée-orsay.fr
Stéphane Loison
x
x
La Semaine Mozart à Salzbourg

Mozart, Schubert, mais aussi
Elliott Carter seront au menu de la prochaine Mozartwoche salzbourgeoise. Loin de la presse et du vedettariat du festival d'été, la
Semaine Mozart décline tout autant l'excellence. Mais en empruntant des chemins
différents. Son directeur artistique Marc Minkowski, depuis trois saisons déjà,
a su imprimer sa marque. Comme il le dit lors d'un déjeuner de presse à son
domicile parisien, entre deux représentations d'Idomeneo au Royal Opera de Londres : « les nombreuses facettes
de Mozart ne peuvent être mises en lumière que sous les éclairages les plus
divers ». Par exemple, dans une approche en miroir, avec un classique,
Schubert, et un moderne, Carter. Après Lucio Silla, en 2013, et Orfeo ed Euridiceen 2014, la production scénique de cette
nouvelle édition sera consacrée à une rareté, pour ne pas dire une première
absolue : représenter la cantate Davide penitente K 469 de Mozart (largement inspirée de la Messe en Ut) dans une chorégraphie
équestre due à Bartabas et son Académie Équestre de
Versailles. Cet « oratorio équestre » sera donné dans la Felsenreitschule, salle mythique à Salzbourg du manège des
rochers, lieu prédestiné s'il en est pour donner un lustre particulier à cette
entreprise pour le moins originale. Tous ceux qui l'ont pratiqué savent qu'il
ouvre l'imagination. C'est une gageure de faire revenir ici ces chevaux qui
firent les beaux jours de ce manège, il y a deux siècles, et de leur assigner
le premier rôle avec leurs écuyers (22, 25 et 31/1).
Côté concerts, l'intégrale des
symphonies de Schubert sera dirigée par sept chefs différents : Nikolaus Harnoncourt et les Viennois (Symphonies Nos 6 et
7, le 24/1), Andras Schiff et sa Cappella Andrea Barca ( N° 5, les 24 & 25/1), Juraj Valcuha et la Camerata Salzburg (N° 3, le 26/1), Marc Minkowski et les Musiciens du Louvre- Grenoble
(N° 8, « La Grande », le 27/1), Andrès Orozso-Estrada et les Viennois
(N° 1, le 28/1), Pablo Heras-Casado et la Camerata (N° 2, le 31/1), et Laurence Equilbey et Insula Orchestra (N° 4, le 1/2). Ces divers concerts seront complétés par
des pièces de Mozart bien sûr, mais aussi de Beethoven. A noter que celui de
Minkowski, le 27 janvier, sera l'occasion d'entendre le violon de Mozart, sous
l'archet de Thibault Noally, et son Hammerklavier, joué par Francesco Corti, le continuiste des Musiciens du Louvre. Ces deux fabuleux
instruments seront extraits de leur vitrine des musées salzbourgeois, à la grande
fierté du maestro ! La violoniste Isabelle Faust jouera les cinq concertos de
violon de Mozart en un même concert avec Il Giardino Armonico et Giovanni Antonini (29/1). Une version concertante de l'opéra Alfonso und Estrella D 732 enrichira le panorama schubertien,
avec une belle distribution sous la houlette du chef Antonello Manacorda (23/1). Eliott Carter sera honoré par un
florilège significatif de ses œuvres, dont sa symphonie N° 1, mais aussi
« Sound Fieds », et son concerto pour
flûte. Un de ses plus fidèles interprètes, Pierre-Laurent Aimard,
dirigera et jouera « Instances » pour orchestre de chambre, et « Epigrams » pour piano, violon et violoncelle (1er/2).
D'autres pièces chambristes de
Carter seront jouées par le pianiste français avec les solistes de l'Orchestre
de chambre d'Europe (29/1). C'est que la musique de chambre est également à l'honneur
durant ce festival. Ainsi, le Hagen Quartett jouera
l'intégrale des Quatuors de Mozart et le Quintette pour clarinette (23,24, 30
et 31/1). L'interprétation des sonates pour piano sera partagée entre Fazil Say, sur instrument moderne, et Kristian Bezuidenhout, sur Hammerklavier (25, 26, 28 et 29/1). Mitsuko Uchida quant à elle, outre une séance solennelle durant laquelle lui sera remise la
Médaille d'or de la Fondation Mozarteum (27/1),
donnera un récital consacré à trois sonates de Mozart et les Quatre impromptus
de Schubert (26/1). Elle participera encore à une matinée avec Veronika Eberle, violon, et
Marie-Elisabeth Hecker, autour de trios de Mozart et
de Schubert (30/1). Il y aura aussi du chant avec Christiane Karg, Diana Damrau, Christine
Schäfer... Enfin, un projet cher au cœur de Marc Minkowski se poursuivra :
l'Orchestre des jeunes (Kinderorchester) montrera
qu'avec un vrai enthousiasme, et un bon guide, des musiciens en herbe, entre 7
et 12 ans, peuvent faire de l'excellente musique. Un rendez-vous hivernal à
marquer d'une pierre blanche !

Matthias
Schulz & Marc Minkowski / DR
Du
22 janvier au 1er février 2015.
Renseignements
et réservations : Kartenbüro der Sitftung Mozarteum Salzburg,
Mozart Wohnhaus, Theatergasse 2,
A- 5020 Salzburg ; par tel .: 00 43 662 87 31 54 ; par
Fax : 43 662 87 44 54 ; en ligne : tickets@mozarteum.at ou www.mozarteum.at
Jean-Pierre Robert.
***
L'ARTICLE DU MOIS
LA
DISCRÈTE GRANDEUR DU VÉRISME
Au XIXe siècle, alors que le scientisme et
le positivisme nourrissent la nouvelle objectivité, c’est au théâtre lyrique
que la fascination pour le vrai exerce sa plus rude influence. À partir de Macbeth (1847), l’attention portée à la caractérisation des personnages hisse ainsi
Giuseppe Verdi au rang de grand dramaturge, cependant qu’à l’extrémité
orientale de l’Europe, l’opéra russe se plie dès 1862 aux préceptes du Groupe
des Cinq. Loin de faiblir, cette dévotion pour la vérité culminera au
crépuscule du siècle avec le naturalisme français et surtout avec le vérisme
italien. Tribune littéraire des vaincus de la vie
(vinti della
vita) sous la plume de Giovanni Verga
(1840-1922), le mouvement gagnera les scènes lyriques dès la retentissante
création romaine de Cavalleria rusticana, le 17 mai 1890.
Une pièce en quatre actes
L’une des originalités du répertoire
lyrique vériste, c’est qu’il est moins caractérisé par ses auteurs que par
quatre opéras célèbres, chacun dû à un compositeur dont il demeure, pour la
postérité, le seul chef-d’œuvre : Cavalleria rusticana(1890) de Pietro Mascagni (1863-1945), I Pagliacci (1892) de Ruggero Leoncavallo (1858-1919), Andrea Chénier (1896) d’Umberto Giordano (1867-1948)
et Adriana Lecouvreur (1902) de Francesco Cilea (1866-1950).
Décourageant toute tentative de synthèse
trop schématique, le poids écrasant de ces quatre partitions ne constitue pas
la moindre difficulté dans l’étude du vérisme. Un vérisme dont on ne sait trop
s’il serait un style ayant créé certaines formes et formules originales, ou un
simple moment de l’histoire lyrique, caractérisé par le refus du symbolisme, de
l’impressionnisme, et par la volonté d’échapper au modèle verdien, quitte à
solliciter l’exemple subversif de Carmen. À y bien regarder, la vraie
difficulté de définir le vérisme ne tient-elle pas à ce qu’il ne se soucie
nullement d’inventer un vocabulaire d’une réelle originalité ? Ou encore
au caractère incertain de son esthétique, à mi-chemin entre expressionnisme et
bel canto ? Incertitude qui explique en grande partie les nombreux échos
véristes qu’il est possible de discerner, hors d’Italie, dans presque tous les
foyers lyriques du temps, de la France à l’Allemagne, de la Russie aux tout
jeunes États-Unis ? Autre motif de perplexité, ce même vérisme relève-t-il
avant tout, dans son versant théâtral, de la musique ou de la
littérature ? Des deux mouvements influant le plus fortement sur le destin
opératique du deuxième XIXe siècle, la Scapigliatura (“échevellement”, par extension vie de bohème) des Praga, Tarchetti et Boito, et le
vérisme des Capuana, De Roberto et Verga, c’est ce dernier qui, après 1890, impose dans sa version lyrique de
nombreux caractères, plus théâtraux que musicaux : syllabisme, discours
continu, contrastes violents, refus de la veine comique, simplicité mélodique,
transformation ou suppression de l’air isolé, grandiloquence du finale,
écriture verticale, cadre quotidien de l’action, intrigue routinière, etc.
Puis, ce faisceau d’interrogations ne souligne-t-il pas, en creux, la force des
liens qui uniraient le style vériste aux derniers feux du romantisme
lyrique ? Enfin, la durée du vérisme dépasse-t-elle la décennie autour de
laquelle tournent les XIXe et XXe siècles, de Cavalleria rusticana (1890) à Adriana Lecouvreur (1902), lors même que les quatre musiciens cités plus haut survivront longtemps
à leur chef-d’œuvre, un quart de siècle pour Leoncavallo, un demi-siècle pour
les trois autres ? En miroir enfin, l’intégration forcée de tous les
ouvrages lyriques italiens du temps à la sphère vériste ne relève-t-elle pas
d’un abus complaisant ?
Paradoxalement, la tentative de définir le
vérisme en tant que style montre avant tout le caractère inopérant d’une
analyse qui userait des seuls outils de la stylistique en tant que mode
d’appréhension scientifique d’un style donné, de ses procédés comme de ses
effets, non de son histoire ou de celle de ses formules. L’univers vériste
exige un déchiffrement bien plus large que celui des seules partitions.
L’attitude morale du compositeur vériste face au monde et l’engagement
artistique de l’interprète vériste sont ainsi à prendre en compte aussi bien
que les formants esthétiques et techniques, mais également la réception
particulière du public dont la posture change en profondeur selon qu’il assiste
à une représentation d’I Pagliacci ou d’Aïda.
Voire d’Il Tabarro ou de Madama Butterfly, deux ouvrages pourtant dus à la même
plume !
Un vérisme mal entendu
Les ennemis du vérisme musical, au premier
rang desquels un Claude Debussy ulcéré par ce “broiement” de la musique,
insistent sur sa prédilection pour une violence sanglante qui, au passage,
casserait les voix de ses interprètes. De ce point de vue, révélatrice est
l’attitude des adversaires de Puccini qui réduisent sa production à la seule Tosca,
et Tosca à la seule scène de torture (d’ailleurs invisible) du deuxième
acte. Ne voit-on pourtant pas que le répertoire vériste est bien moins sanglant
que la tragédie verdienne ? Il est symptomatique, à ce sujet, que le
mépris à l’endroit du vérisme s’accompagne d’une dévotion surprenante à
l’endroit d’un théâtre russe (Boris Godounov, Eugène Onéguine) qui n’épargne pourtant guère ses
protagonistes. Non plus d’ailleurs que la Carmen de Bizet (1875),
première héroïne du théâtre lyrique à payer de sa vie son refus du magistère
masculin. Faut-il ici rappeler le célèbre mot tenu par le compositeur
français : « Je vous déclare que si vous supprimez l’adultère, le
fanatisme, le crime, l’erreur, le surnaturel, il n’y a plus moyen d’écrire une
note » ? Affirmation que n’eût désavouée aucun compositeur vériste,
surtout quand les victimes de ces passions appartiennent à l’univers policé
d’une aristocratie décadente plutôt qu’aux bas-fonds sordides d’une paysannerie
dégénérée. Si le temps des Lumières avait multiplié les traités du bonheur, le
XIXe siècle s’est plutôt attaché à donner au malheur les seuls traits de la
malédiction sociale. Aussi, dans les quatre actes de la dramaturgie vériste (Cavalleria rusticana, I Pagliacci, Andrea Chénier, Adriana
Lecouvreur), entendrons-nous la vaine protestation de Turiddu ou de Canio contre leur misère morale, avant
d’écouter le poète Chénier et la comédienne Lecouvreur élargir cette complainte
à l’universel.

Pietro Mascagni en
1903 / DR
L’irruption triomphale de Mascagni
Né le 7 décembre 1863 à Livourne, Pietro
Mascagni s’inscrit en 1876, à l’Institut musical de sa ville. Si ses premières
œuvres voient le jour dès 1878, c’est avec la cantate In Filanda qu’il fait son entrée dans la carrière, en 1881. Admis au Conservatoire de
Milan l’année suivante, il s’y lie avec Puccini ; si ces études lui sont
d’un indiscutable profit, le jeune artiste éprouve les plus grandes difficultés
à se plier à la discipline scolaire, d’où son départ en 1885, avant la fin de
son cursus complet, pour mener la vie aléatoire de directeur d’une petite
troupe d’opérette ! Établi avec sa compagne, Argenide,
dans la cité de Cerignola, il y est nommé maestro di suono et canto par la municipalité en mars 1887. C’est en
juillet 1888 que le destin frappe à sa porte, sous forme de l’annonce du
concours lancé par l’éditeur Sonzogno pour l’écriture
d’un opéra en un acte. Choisissant pour argument un sombre récit de Verga, Cavalleria rusticana, le jeune
homme demande à ses amis Targioni-Tozzetti et Menacci un livret dont la concision se révèlera
d’une redoutable efficacité scénique. La musique est écrite en quelques
semaines, le manuscrit expédié au jury (qui en a 72 autres à dépouiller !).
Élue devant Labilia de Spinelli et Rudello de Ferroni, Cavalleria rusticana triomphe le 17 mai 1890, devant le public en délire du théâtre Costanzi à Rome. Foudroyant à l’échelon local, le succès se
propage à une vitesse stupéfiante sur toutes les scènes du monde.
Il eût alors été audacieux de prévoir que
ce premier triomphe serait aussi le dernier ! Certes, Mascagni connaîtra
une grande carrière de chef d’orchestre, multipliera les partitions lyriques de
grande qualité (L’amico Fritz, I Rantzau, Guglielmo Ratcliff, Silvano, Zanetto, Iris). Mais, au contraire d’un
Puccini, dont le succès mondial va croissant, il voit faiblir sa faveur à
partir des Maschere, dont la création décevante en 1901,
précède les faibles succès d’Amica, Isabeau, Parisina, Lodoletta, Si, Il piccolo Marat, Pinotta, Nerone. En 1940, le cinquantenaire de Cavalleria rusticana est célébré avec faste, l’œuvre connaissant son
premier enregistrement discographique, sous la direction du compositeur. Le 2
août 1945, c’est dans une mélancolique solitude que s’éteint Pietro Mascagni, à
l’hôtel Plaza de Rome. Avec sa disparition s’ouvre l’ère
d’un interminable malentendu, la musicologie réduisant désormais sa production
à la seule Cavalleria rusticana, de surcroît systématiquement
associée aux Pagliacci de Leoncavallo !
Cavalleria Rusticana, la force des passions élémentaires
[Création : 17 mai 1890 au Teatro Costanzi à Rome, avec Roberto Stagno (Turiddu), Guadenzio Salassa (Alfio), Gemma Bellincioni (Santuzza), Leopoldo Mugnoni (direction)]
Rien de plus élémentaire que l’argument de
cet acte brutal, plein de bruit et de fureur, mais aussi d’amour et de
tendresse, de joies promises et d’espérances perdues. Amours impossibles,
jalousies équivoques, vengeances sanglantes, mensonges dégradants… le tout sur
fond de misère morale et de pauvreté matérielle, dans un cadre dont la
rusticité ne s’encombre d’aucun effet bucolique, en un temps moderne qui est
resté celui des Anciens ! De tout cela, l’opéra de Mascagni rend compte de
multiples façons, mais toujours en puisant directement au vivier de la nouvelle
de Verga, chronique brutale qui développe en quelques pages une trame
rudimentaire.
Au début, donc, du récit de Verga, un jeune
paysan, Turiddu Macca, fils
de Nunzia, aspirant soldat et point de mire de toutes
les filles du village. Puis l’attrayante Lola, mariée au rustaud Alfio « par la volonté de Dieu » ! Enfin, la
pauvre Santa qui, probablement enceinte, nourrit de faibles illusions quant à
la sincérité d’un Turiddu au discours plein de
« belles choses ». Mais
aussi, ce qui apparaîtra beaucoup moins dans l’opéra, l’obsession de la
richesse, le mépris à l’endroit du propriétaire « riche comme un
porc » ! Puis le jeu cruel de la jalousie, Turiddu éveillant avec habileté le dépit d’une Lola outrée par ses assiduités auprès de
Santa. Sans compter le poids de la religion, avec pour corollaire l’importance
de la confession à la veille de Pâques. Ainsi, tout est prêt pour le
déroulement de la tragédie quand Santa, ivre d’amertume et de désespoir,
apprend à Alfio qu’en son absence, sa belle épouse a
ouvert sa porte à l’avenant Turiddu. Défi entre les
deux hommes, refus du verre tendu, morsure à l’oreille… c’est tout le rituel
paysan du meurtre commandé par l’infortune conjugale qui se déroule alors.
Avant l’échéance, Turiddu fait ses adieux à sa mère,
lui demandant « un dernier baiser avant son départ du lendemain » (Datemi un bel bacio come
allora, perché domattina andrò lontano). Puis la scène finale, le duel dont l’épilogue est placé sous le signe de
la traîtrise, Alfio aveuglant son adversaire par
projection dans ses yeux d’une poignée de poussière et le frappant de telle
façon à l’estomac et à la gorge que l’afflux de sang ne permet même pas au
mourant de formuler un ultime Ah, mamma mia !
Lorsque le jeune Mascagni s’empare de cette
trame, il sait que tout doit se faire dans l’urgence. Sans appui, sans
librettiste attitré, il se retrouve, du fait même de cette pression, en
position de concurrencer des candidats mieux armés. Peut-être même pressent-il
là l’occasion de libérer cette juvénile énergie que les épreuves n’ont pas
encore altérée. La brièveté de l’œuvre et la rudesse de son sujet ne peuvent
que servir une invention mélodique encore intacte et une science orchestrale
toute fraîche. C’est dans cette dynamique que doit être comprise la genèse de Cavalleria rusticana,
son succès mondial, l’adhésion consensuelle de la critique et du public sous
toutes les latitudes (sauf en France, où le fanatisme wagnérien frappe de
nullité tout ce qui s’inscrit, peu ou prou, sous le signe du bel canto).
Pour les premiers auditeurs de Cavalleria rusticana,
la moindre surprise ne fut pas la forme inhabituelle d’une ouverture
rhapsodique, singulier triptyque évoquant les heures précoces de la journée
dans une campagne incertaine, animé par la voix puissante de Turiddu en coulisses : « O Lola ch’ai di latti la cammisa, si bianca e russa comu la cirasa… » (Ô Lola,
dont la chemise est couleur de lait, te voilà blanche et rouge comme la
cerise…). Paroles dénuées de toute complexité psychologique, chantant les
sensuels attraits de la belle Lola, mystérieuses pour des oreilles italiennes
habituées à une compréhension parfaite et immédiate du texte depuis la première
maturité de Verdi ; quelques mesures suffisent de la sorte à Mascagni pour
opérer le choix d’un vérisme en accord avec la tonalité triviale du drame de
Verga. Même rusticité pour le décor : une place de village bornée par
l’église au fond à droite, par l’auberge et par la maison de Mamma Lucia à gauche. Ainsi est d’emblée fermé l’espace du
drame. Et pour mieux marquer la prégnance de cette place aux péripéties
catastrophiques, Mascagni commence par la frapper d’un silence d’autant plus
significatif que tout ce qui l’entoure bruit de sons destinés à l’envahir,
tintements des cloches et chœurs villageois se mêlant progressivement, depuis
les coulisses, pour donner une réalité rustique au centre du bourg. Il y a,
dans tout cela, une adéquation rare à l’évocation de la campagne. Les femmes
chantent les attraits de la nature, les hommes chantent les attraits de la
femme…
Comme assombrie par le passage soudain de
froides nuées, l’atmosphère change du tout au tout avec le départ des paysans
et le thème de la détresse de Santuzza, venue
chercher un impossible réconfort auprès de Lucia, mère de l’inconstant Turiddu. Aucun préliminaire ici, l’esthétique vériste
sollicitant le plus court chemin, le plus fort aussi. La vie commande. Même
l’église reste impuissante à rompre la malédiction des passions humaines. Rien
de plus poignant, par exemple, que la prière de Santuzza,
isolée au cœur de la liesse indifférente. Sans se préoccuper de complexité
psychologique, l’esthétique vériste délivre un message de vérité humaine en
sollicitant les seules ressources de la musique. C’est ainsi que, dans la scène
confrontant Turridu à Santuzza,
héros pitoyables d’une histoire sans grandeur et sans intérêt, la brutalité
vériste joue à plein, prélude inéluctable à un épisode sanglant. La querelle
monte par degrés jusqu’à l’imprécation, aux insultes hurlées et à la
malédiction de Santuzza : « A te la mala Pasqua, spergiuro ! » (À toi la
Mauvaise Pâque, parjure !). L’intensité de ce dialogue à proprement parler
délirant sollicite souvent toute l’attention de l’auditeur et ne lui permet pas, au moins dans un premier
temps, de mesurer toute l’ingéniosité de Mascagni, qui reprend nombre de thèmes
déjà entendus, comme pour signifier que le cercle de la malédiction se referme
et qu’il n’est d’autre issue désormais que fatale. Le tout au sein d’un immense
crescendo qui finit par noyer la logique mélodique et le discours stéréotypé,
haché, fragment littéraire le plus faible du livret mais support de l’épisode
dramatique le plus réussi ! Après le célébrissime intermède instrumental,
popularisé par des exécutions sans nombre en concert, par les bandes sonores du
cinéma, par l’animation musicale de la publicité, partout bissé, morceau de
bravoure de tout chef soucieux d’un succès assuré, on se dirige vers la scène
la plus gaie de l’opéra, animée par une chanson à boire. La stupéfiante
capacité de Mascagni à transformer le climat d’une scène fait ici encore
merveille. Tout se joue en deux répliques. La première marque le refus du verre
de vin tendu par Turiddu à Alfio :
« Grazie, ma il vostro vino io non lo accetto… » (Merci, mais
votre vin je ne l’accepte pas) ; la deuxième, encore plus laconique
revient à Turiddu qui prend moins acte du refus de
son rival que de tout ce que ce refus sous-entend : « A piacer vostro » (Comme il vous
plaira). La fin est foudroyante. Santuzza se jette
dans les bras de Lucia cependant qu’une agitation fébrile gagne tous les
paysans. Puis le hurlement inhumain qui signe l’arrêt de mort de Turiddu et les ultimes convulsions de l’orchestre qui ferme
le drame par trois accords puissants. Cette rapidité de l’épilogue est le plus
sûr facteur de sa réussite, lors même qu’il est peut-être simplement le fruit
du manque de temps ! Un manque de temps qui ne sera plus jamais le fait
d’un Mascagni parvenu à la gloire et n’ayant donc plus jamais – peut-être pour
son malheur – à travailler dans l’urgence.
Ruggero Leoncavallo, sur les traces de Mascagni
Né le 23 avril 1857, à Naples, Ruggero Leoncavallo perfectionne son talent de pianiste au conservatoire San Pietro a Majella de Naples, de 1866
à 1874. Connaissant son premier vrai succès avec la création de La Nuit de
mai en 1886, il passe contrat avec le grand éditeur italien, Ricordi pour une trilogie, Crepusculum, I Medici, Savonarola et Cesare Borgia. Survient alors le
choc de Cavalleria rusticana, en 1890. Certain de ses
dispositions pour ce genre et soucieux d’imposer son nom au plus vite, notre
compositeur propose le livret d’I Pagliacci à l’éditeur de Cavalleria, Sonzogno, qui lui passe commande de la musique. En 1891, le
musicien se retire à Vacallo, en Suisse italienne où
il achève, en cinq mois, le livret et la partition.
La création d’I Pagliacci au Teatro dal Verme de Milan sous la direction de Toscanini,
le 28 mai 1892, marque ainsi le début, tardif mais triomphal, de la carrière de
Leoncavallo. Le succès s’étend à toutes les scènes du monde, mais à l’instar de
Mascagni, le compositeur ne retrouvera jamais une telle faveur. Accablé par la
chute de sa Bohème à la Fenice de Venise, le 6
mai 1897, conscient de la supériorité de Puccini, Leoncavallo tente encore
d’imposer son nom avec Zazà, Der Roland von Berlin, Gli Zingari, Goffredo Mameli, Maia, Edipo
Re,
dont les succès occasionnels ne l’abusent pas. Plus encore que Mascagni, il
restera l’homme d’un seul opéra, ses Pagliacci lui ayant ainsi
offert tout à la fois l’immortalité et une fin de vie placée sous le signe
d’une mélancolique amertume. Peut-être le plus sûr symptôme de cet échec est-il
à découvrir dans la multiplication des opérettes dès 1910 (Malbruck, La Reginetta delle rose, Are you there ?, La Candidata, Prestami tua moglie, A chi la giarrettiera ?, Il primo bacio, La
Maschera nuda). Le plus troublant, à la lecture de ces partitions, est leur
flagrante absence d'intérêt, le maître d'I Pagliacci ayant renoncé à des
hardiesses harmoniques et à ces audaces mélodiques qui lui avaient valu un
prestige international. C'est à Montecatini Terme qu'il s'éteint, le 9 août
1919, laissant inachevée la partition d'un drame, Tormenta.
I Pagliacci,
le fait divers hissé au rang d’épopée
[Création : 21 mai 1892, Teatro dal Verme,
Milan, avec Adelina Stehle (Nedda), Fiorello Giraud (Canio), Victor Maurel
(Tonio), Mario Ancona (Silvio), Francesco Daddi (Peppe),
Arturo Toscanini (direction)]

Frontispice
de la partition pour piano seul de « Paillasse », 1893, Choudens Éditeur
L’appariement systématique de Cavalleria rusticana et d’I Pagliacci ne doit pas conduire à considérer les deux œuvres comme les volets d’un
diptyque voulu par les compositeurs, par leur éditeur ou par les directeurs de
salles. Cependant, plutôt qu’ignorer cette union des deux opéras, n’est-il pas
plus gratifiant de vérifier en quoi chacun sert l’esthétique vériste ?
D’autant plus que ce qui les rapproche est loin d’être négligeable :
reposant tous deux sur un argument tiré d’un fait divers sanglant, ils se
signalent par leur brièveté, leur violence psychologique, l’exacerbation des
passions, la liaison fusionnelle de l’amour et de la mort, la simplicité de la
trame dramatique, la contraignante unité de lieu, de temps et d’action, la
concordance des thèmes avec les unités structurelles, la désinvolture de
modulations soumises aux seules nécessités expressives, l’omniprésence d’un
orchestre rutilant et éloquent, mais aussi le refus d’un exotisme complaisant
ou d’un populisme dégradant. Par ailleurs, à énoncer ces caractères du vérisme
musical, n’apparaît-il pas, une fois encore, que Carmen en reste le seul
véritable aîné ?
Un fait divers de 1865, jugé par son père,
a été présenté par Leoncavallo comme le support de l’argument d’I Pagliacci.
Pourtant, les commentateurs ne se font jamais faute de relever que la trame de
l’opéra ne renvoie en rien à ce drame domestique. En revanche, deux ouvrages
dramatiques présentent de troublantes analogies avec le livret du maître
italien. Le premier, Un drama
nuevo, dû au dramaturge Manuel Tamayo y Baus et créé
en 1867 à Madrid, développe une sombre histoire d’adultère tout en introduisant
le principe du théâtre dans le théâtre. Deuxième ouvrage précurseur, La
Femme de Tabarin, revient à Catulle Mendès et sa création parisienne, en
1887, n’a pu échapper à notre compositeur. Découvrant le livret de Leoncavallo,
Catulle Mendès prendra aussitôt feu et flamme, criant au plagiat et ouvrant une
procédure judiciaire. Finalement, les choses s’arrangeront entre les deux
hommes, l’écrivain français retirant sa plainte et le compositeur arguant de sa
bonne foi. Il y reviendra même, sept ans après la création de son chef-d’œuvre,
ayant à cœur de se justifier auprès du public français : « La
vérité est que j’ignorais complètement l’œuvre de l’écrivain que j’admire tant
et que j’avais fait le plan de mon ouvrage d’après un fait réellement arrivé en
Calabre et jugé par mon père lorsqu’il siégeait au tribunal de Cosenza. »
(Le Figaro, 9 juin 1899). Dont acte.
Le vérisme pose toujours problème lorsqu’il s’agit de tracer, dans son
univers, la frontière entre le musical et le verbal. Rien de plus instructif,
en ce sens, que l’étude des premières mesures d’I Pagliacci, réservées à l’orchestre. L’atmosphère y est à la
foire, plutôt à la parade, cette parade qui était le genre choisi par Catulle
Mendès pour caractériser son Tabarin. Le premier thème cherche
délibérément à capter l’attention d’un public ambulant ; puis, l’effet
d’annonce produit, la musique change du tout au tout, évoluant dans une
atmosphère plus mélancolique et enchaînant sans hiatus les trois thèmes qui
construiront la trame de la pièce. Le premier n’est autre que le sinistre
« Ridi
Pagliaccio », climax du grand air « Vesti la giubba » sous forme du rire dément hurlé par un Canio, parvenu au paroxysme de la fureur. Changement radical
avec le thème de l’amour unissant Nedda à Silvio.
Traditionnellement, c’est aux cordes accompagnées par la harpe qu’il est
confié, délicat et lyrique dans cette atmosphère de désordre joyeux et
survolté. Complétant cette mosaïque de motifs qui, aisés à mémoriser, formeront
un support immédiat à toutes les expressions de la passion, le troisième thème
revient à Canio, dont il peint la sombre jalousie,
chantée par les violoncelles. Retour de la gaîté bruyante des premières
mesures, quelques échappées aux divers pupitres de l’orchestre, et le bossu
Tonio peut enfin se glisser devant le rideau pour lancer son adresse au public.
Procédé de cabotin ou manifeste esthétique ? Toute l’ambiguïté de ce
prologue tient à ce que son concepteur n’a pas été Leoncavallo, mais le ténor
Victor Maurel qui, au double titre d’ami et d’admirateur a tenu absolument à
assurer la création de l’opéra. C’est donc à Tonio qu’il revient de présenter
la pièce, d’abord sur le ton de l’humilité (« Si può ? » - On
peut ?), puis avec une assurance croissante pour rappeler que l’œuvre ne
recourra pas à l’artifice des fausses larmes, l’auteur ayant cherché au
contraire à dépeindre une tranche de vie (« L’autore ha cercato invece pingervi uno squarcio di vita »), à montrer
comment s’aiment vraiment les êtres humains (« come s’amano gli esseri umani ») et quels tristes
fruits peut produire la haine (« Vedrete de
l’odio i tristi frutti »). Car l’auteur est lui-même un homme
(« E un uomo »)
qui écrit au nom et au profit des autres hommes, à qui il revient donc de
peindre les passions sans les idéaliser, de façon à tendre au public un miroir
dans lequel il puisse se reconnaître. Aussi ce public devient-il protagoniste
de l’opéra, ce qui se passe sur scène et ce qu’il vit dans sa multiple
complexité n’étant plus séparé que par une très
imprécise frontière. Il y a là un curieux paradoxe, cette « tranche de
vie » étant ouverte par le procédé de l’allégorie, hérité de la commedia
dell’arte ; la mise en abyme touche ici à son point de perfection.
Musicalement et dramatiquement, la première
scène constitue une réussite de l’esthétique vériste. D’une grande simplicité
structurelle, elle est divisée en trois volets d’égale importance, qui
permettent à l’auteur de fournir toutes les données initiales de son drame au
public. Aussi n’est-il pas indifférent que le chœur, c’est-à-dire le peuple,
ait la voix prépondérante. La foule est en joie, elle a enfilé ses habits de
fête ; pour s’amuser, elle n’a nul besoin d’une musique trop savante et se
préoccupe peu des étranges dissonances de la trompette glissant des fa et do bécarres dans la tonalité supposée de si mineur ! Le
retour des bateleurs est célébré dans la liesse, au son des cuivres et de la
grosse caisse. Les motifs, très brefs, courent à travers les pupitres comme les
paysans courent sur la place, pressés de découvrir l’estrade. Pour accentuer
l’impression de désordre, le compositeur use du trémolo et des mouvements
contraires, étoffant sa phalange au fur et à mesure que la foule grossit. Si le
vérisme musical avait à justifier son existence devant l’histoire, cette seule
introduction au drame de Leoncavallo constituerait la plus éloquente de ses
plaidoiries.
Ce sont ces éléments qui expliquent
pourquoi, au long du second acte, l’auditeur éprouve une déroutante impression
de déjà entendu, lors même que l’action continue de progresser inexorablement,
sans répit, sans retour, sans remède. Au contraire de ce qui est déjà sensible
chez Puccini, les motifs musicaux ne relèvent pas de la réminiscence,
c’est-à-dire d’une mémoire qui alimenterait le présent, mais attestent la
triste permanence, l’irréfutabilité d’une condition humaine dont la réalité ne
se découvre que dans l’affrontement tragique de l’absolu. C’est pour mener à
bien sa démonstration vériste de l’absurdité existentielle que Leoncavallo
évite l’introduction d’éléments nouveaux dans la deuxième partie de son opéra.
Les tournures mélodiques sont aisées à reconstituer à partir du matériau
thématique du premier acte, les trompettes et la percussion persistent dans
leurs désaccords, l’écho des cloches perdure, la foule continue de
s’impatienter… Sur les tréteaux, les acteurs développent les principes théoriques
énoncés au long du prologue ayant ouvert l’opéra. Contrairement à ce que disait Canio dans sa première adresse la vie est comme le
théâtre… et vice-versa ! Il s’agit de donner à la fiction un tel caractère
de vérité que sa fusion avec le contingent ne tombe pas dans la confusion des
genres : le public de la salle doit conserver jusqu’au bout la conscience
de l’artifice scénique, sans que cela nuise à son engagement dans le processus
dramatique. Et tant pis s’il est amené, par instants, à s’interroger sur le
sens de l’action ; Leoncavallo, excellent connaisseur des Lettres
françaises ne peut-il se réclamer de l’illustre et prestigieux précédent de L’illusion
comique, gageure insurpassée en matière de mise en abyme ?
Le plus frappant dans le finale d’I Pagliacci reste le principe de divergence qui conduit d’un côté le triste Canio à la folie solitaire du meurtre, de l’autre tous les
protagonistes de la scène et leur public à la conscience du drame collectif.
C’est le rire, innocent et pour cela même encore plus cruel, de la foule qui
met le comble à l’exaspération de Canio, objet d’une
farce dont il est seul à comprendre le mécanisme. Lorsque Taddeo atteste la pureté de la jeune femme, l’explosion de rage du jaloux furieux
n’est-elle pas dirigée vers la foule ? Et lorsque Nedda tente de le ramener à la raison en lui rappelant son statut de Paillasse,
n’est-ce pas à tous les échos qu’il dispense sa plainte hallucinée : « No ! Pagliaccio non son. Se il viso è pallido, è di vergogna, e smania
di vendetta ! » (Non, je ne suis
pas Paillasse. Si mon visage est blanc, c’est de fureur et de volonté de
vengeance) ? Puis, ultime trait vériste, impensable chez Verdi, voire chez
Puccini, c’est dans son discours haletant que le public prend connaissance d’un
élément décisif, l’infortune de Nedda, orpheline
qu’il a recueillie et dont il exige la propriété exclusive. Rien de plus
significatif que les réactions de la foule qui passe de l’enthousiasme à la
peur tandis que le chant devient cri, soutenu par un orchestre tempétueux
distribuant des accords de plus en plus dissonants. Pourtant, à l’image de sa
lumineuse aînée Carmen, Nedda ne faiblit pas et
l’orchestre chante pour elle le thème de l’amour jusqu’au moment où, orchestre
et foule hurlant de concert, elle tombe sous les coups de Canio.
Altérée par les ultimes échos du rire de Paillasse, scellée par la fatalité
d’un perpétuel recommencement, « la commedia è finita ». Parvenu à ce pic, le vérisme devra se
transformer pour survivre, tâche à laquelle s’affronteront victorieusement
Umberto Giordano puis Francesco Cilea.

Umberto
Giordano par Gaetano Esposito / DR
La « gentilhommerie citadine »
d’Umberto Giordano
Né le 28 août 1867, à Foggia, Umberto
Menotti Maria Giordano entre au conservatoire San Pietro a Majella de Naples en 1882 et s’y fait remarquer pour
son ouvrage lyrique, Marina, destiné au concours Sonzogno de 1888. Classée en sixième position, la partition de Giordano est remarquée
par Sonzogno, qui lui propose le sujet d’un nouvel
opéra, Mala vita,
histoire d’un ouvrier phtisique s’engageant à sauver une prostituée de la ruine
morale, pour peu que la Vierge accepte de le guérir lui-même ! Créé le 21
février 1892, au Teatro Argentina de Rome, l’ouvrage
associe d’emblée le nom de Giordano à ceux d’un Mascagni, déjà glorieux, et
d’un Leoncavallo, appelé à le devenir dès le 28 mai suivant, avec la création
d’I Pagliacci. Pourtant, Giordano semble hésiter à
s’engager franchement sur la voie vériste et son deuxième opéra, Regina Diaz,
incline résolument du côté bel cantiste et
romantique. C’est l’échec. Déconcerté dans un premier temps, Giordano
s’enthousiasme alors pour un livret de Luigi Illica, Andrea
Chénier, et se rend à Milan, où Sonzogno accepte
de lui donner une dernière chance. En janvier 1896, la partition est
achevée ; à la suite de plusieurs défections d’interprètes, c’est à
l’intervention énergique de Pietro Mascagni auprès de Sonzogno que Giordano doit la création de son chef-d’œuvre, le 28 mars 1896, à la Scala. Création qui reste dans les annales de
la maison comme l’un des plus grands triomphes de son histoire.
Conscient de vivre un moment exceptionnel,
Giordano met aussitôt en musique une pièce de Victorien Sardou, Fedora.
Créée le 17 novembre 1898, l’ouvrage chute en dépit de la présence du tout
jeune Caruso. Le reste de la vie du compositeur restera placé sous le signe
ambigu d’une réputation fondée sur cet Andrea Chénier qui est à Giordano
ce que Cavalleria rusticana est à Mascagni, I Pagliacci à Leoncavallo, ce qu’Adriana Lecouvreur sera à Cilea !
Notre musicien écrira encore sept opéras, accueillis sans hostilité et sans
enthousiasme : Siberia, Marcella, Mese mariano, Madame Sans-Gêne, Giove a Pompei, La cena delle beffe, Il re. Vivant une
maturité heureuse, jouissant paisiblement du succès jamais démenti d’Andrea
Chénier, c’est à Milan qu’il disparaît, le 12 novembre 1948.
Andrea Chénier, le vérisme face à
l’histoire
[Création : 28 mars 1896 à la Scala de
Milan, avec Giuseppe Borgatti (Chénier), Mario Sammarco (Gérard), Evelina Carrera (Maddalena), Rodolfo Ferrari (direction)]
Pas d’ouverture ici, ni même de prologue,
l’entrée dans l’action est immédiate, et le premier intervenant, loin de
figurer parmi les protagonistes du drame n’est autre que le pontifiant
majordome organisant l’ameublement de la pièce de réception. La musique bondit
dans tous les sens, distribuée aux pupitres véloces des cordes. Le contraste
n’en est que plus saisissant avec la rupture d’atmosphère provoquée par le
soliloque de Gérard, fils d’un vieux serviteur ayant donné toute sa vie à ses
maîtres (« Son sessant’anni, O vecchio, che
tu servi ! » - Il y a soixante
ans, ô vieillard, que tu sers !). Et pourtant l’essentiel est
ailleurs ; la vraie plainte de Gérard, c’est en récitatif que Giordano,
partisan d’un vérisme qui fuit les atermoiements, la livre au public : « E, quasi non bastasse la tua vita a renderne infinita eternamente l’orrenda
sofferenza, hai dato l’esistenza dei figli tuoi. Hai figliato dei servi ! »
- Et comme si ta vie ne suffisait pas à en rendre infinie, et à jamais,
l’horrible souffrance, tu as aussi donné la vie de tes enfants. Tu as engendré
des serviteurs !). Là est donc la vraie souffrance, la marque ineffaçable
de l’arbitraire, la plainte immémoriale des vinti della vita.
Aussi le spectateur recevra-t-il, un peu plus tard, le discours du poète
Chénier, comme le miroir consolant de si sombres perspectives.
Cependant, l’action ici n’a plus pour cadre la terrible campagne sicilienne de Cavalleria non plus que les tristes tréteaux d’I Pagliacci. C’est ainsi que l’héroïne de la pièce,
Maddalena de Coigny, apparaît au jour finissant, mélancolique et incertaine,
accompagnée par les timbres des bois soutenus par la harpe : « Il giorno intorno già s’inserra lentamente ! » - Alentour,
le jour décline lentement). Il aura ainsi suffi de quelques pages – mosaïque de
fragments contrastés autant qu’expressifs – pour fournir au public toutes les
données liminaires du drame à venir. Là est le génie du vérisme, qui chante
toutes les passions et sait passer, le temps d’une scène, des troubles intimes
de l’amour au tumultes publics de la politique. Des
lèvres de l’abbé, les aristocrates apprennent ainsi la faiblesse du roi, la
réunion des États généraux, la conciliation avec le Tiers-État, toutes
perspectives de nature à les épouvanter. La musique le dit à sa façon, évoluant
comme une sorte de lugubre marche à l’échafaud, en sonorités sourdes venues du
registre grave des bois sur le tissu neutre des cordes. Seul le vérisme pouvait
autoriser une introduction si dramatique du fait social dans une réunion
divertissante de personnes de qualité ! Mais seul aussi le vérisme
autorise une nouvelle transition, abrupte, vers la désinvolture de la fête qui
chasse ces sombres pensées.

Enrico
Caruso, créateur du rôle de Maurice de Saxe,
photographié en 1910
Sommet de la partition, le grand air de
Chénier « Un di all’azzurro spazio … » (Un jour,
dans l’espace céleste…) est l’un des plus célèbres de toute l’histoire lyrique.
Jamais Giordano n’avait fait preuve d’une telle inspiration lyrique, jamais il
ne la retrouvera. Menant de main de maître un flux mélodique aux inflexions
aussi mouvantes mais aussi fermes que celles du papillon dans le soleil, il
permet à son héros de chanter la beauté du monde, les immensités du ciel et du
firmament, l’amour infini, mais aussi la dureté du clergé, la plainte du
peuple, l’indifférence de la classe patricienne. Avant de revenir, pour l’envoi
terminal, aux élans de l’amour : « Udite ! Non conoscete amor ! » (Écoutez ! vous ne
connaissez pas l’amour !). Tout le reste de l’opéra sera placé sous le
signe de la vie, signe qui impose la fuite de Maddalena, les excuses de sa
mère, la plainte des miséreux, la rumeur des chants révolutionnaires, l’empire
de l’amour, la grâce des Merveilleuses, la pureté de Robespierre… Bien plus
loin dans la partition, le duo de Maddalena et Chénier sera de facture
étrangement rhapsodique, comme si les tourments intérieurs et extérieurs se
télescopaient pour désarticuler le discours et mettre à nu les terreurs
secrètes des deux protagonistes. Si le dernier acte d’Andrea Chénier enfin, est considéré comme le plus faible de l’opéra, il faut relever que
Giordano s’est habilement extrait du piège mélodramatique dans lequel aurait pu
l’enfermer le livret d’Illica. Les précédents de Cavalleria rusticana et d’I Pagliacci avaient
prouvé l’efficacité d’un dénouement rapidement mené. Aussi ne trouverons-nous
dans ce finale que deux occurrences dignes d’intérêt, la lecture de ses
derniers vers par Chénier et le duo amoureux de Maddalena et du poète, parvenus
au seuil de l’éternité. Pourtant, le quatrième et dernier grand air du poète, « Come un bel dì di maggio… » (Comme un beau jour de
mai…), trempé à la meilleure encre du compositeur, s’éloigne du modèle vériste
par son refus du pathétique, du cri, du sanglot, de l’outrance, du portando,
de la note de tête… Sans doute Giordano a-t-il conscience de l’inadaptation de
cette esthétique pour clore la légende historique du poète martyr. C’est au nom
de cette même exigence qu’il épure son écriture orchestrale, ôtant toute
prérogative aux cordes. Tout étant en place pour le duo terminal, Giordano
élargit la palette des expressions vocales, suivant les moindres frémissements
ou tressaillements de ses deux héros, usant des ruptures de tempo et d’intensité,
des dérèglements contrôlés de la syncope, du retard et du trémolo. La passion
atteint un tel point d’exacerbation que plus rien n’en brisera l’élan, ni les
lugubres roulements du tambour annonçant l’exécution, ni l’irruption de la
charrette des condamnés. La mort n’est qu’un seuil, le prélude à la fusion des
amants pour l’éternité, d’où leur ultime invocation à l’instant de monter sur
la charrette fatale : « Viva la morte insiem ! » (Vive la mort ensemble !), en
rupture définitive avec un vérisme qui avait pourtant si brillamment coloré les
deux premiers actes de l’opéra.
Francesco Cilea (1866-1950) au crépuscule du vérisme
Né le 23 juillet 1866, dans la petite cité
de Palmi, Francesco Cilea prend conscience de sa vocation musicale à la suite d’une audition de Norma de Bellini. En 1879, il entre à San Pietro a Majella, y étudie le piano, puis la composition avec Paolo Serrao. En 1889, il quitte le conservatoire, déjà auteur d’un
opéra, Gina, qu’il a fait représenter le 9 février précédent. La partition
en est d’une qualité suffisante pour inciter l’éditeur Sonzogno à promettre au jeune auteur un contrat pour un opéra. En dépit de son caractère
vériste, ce deuxième opéra, La Tilda, créé en 1892 à Florence, rencontre
un faible succès. Même résultat pour L’Arlesiana, d’après le drame
d’Alphonse Daudet dont Marenco a tiré un livret en
quatre actes. Si le jeune Caruso se taille un brillant succès dans le lamento
de Federico, l’accueil global de l’ouvrage est négatif. Bon connaisseur de la
littérature française, Cilea choisit alors une pièce
de Scribe et Legouvé, Adrienne Lecouvreur. Il
y travaille avec ardeur, convaincu qu’il s’agit de sa dernière chance pour
s’imposer dans le concert vériste où brillent déjà les noms de Mascagni,
Leoncavallo et Giordano. Colautti développe en quatre actes une action cohérente et
émouvante qui propose un large ambitus d’expressions au compositeur. Pour ce
dernier, le triomphe de la création, le 6 novembre 1902 au Teatro Lirico de Milan, constitue une apothéose, mais marque
aussi la reconnaissance d’un effort permanent pour allier la spontanéité du
grand lyrisme italien aux raffinements d’une harmonie et d’une orchestration
puisées aux meilleurs modèles français. Partout acclamé, l’opéra gagne une
audience nationale (de 1903 à 1905 : Naples, Bologne, Turin, Gênes), puis
internationale (Buenos-Aires en 1903, Londres en 1904, New York en 1907).
Désormais assuré de sa tranquillité
matérielle et de sa reconnaissance artistique, Cilea peut se consacrer à l’écriture d’un autre opéra, fondé sur une pièce de
Victorien Sardou, Gloria. Créé le 15 avril 1907 à la Scala, sous la
direction de Toscanini, l’opéra connaît une chute si brutale que le compositeur
renonce à jamais à la carrière lyrique ! Nombre de projets recensés par
ses biographes ne seront attestés que par des ébauches de livrets (Il ritorno dell’amore, La Rosa di Pompei, Malena…) ; ainsi l’opéra Il matrimonio selvaggio, mis en chantier en 1909, restera-t-il à un tel état
d’inachèvement que Cilea ne le nommera pas dans ses Souvenirs !
Directeur des conservatoires de Palerme et de Naples, il prend sa retraite en
1935, se retire dans la cité de Varazze (Ligurie) qui le nomme citoyen
d’honneur, s’y éteint le 20 novembre 1950.
Adriana Lecouvreur ou l’épuisement de la
veine vériste
[Création : 6 novembre 1902 au Teatro Lirico à Milan, avec
Angelica Pandolfini (Adriana), Enrico Caruso (Maurizio), Edvige Ghibaudo (la Principessa),
Giuseppe de Luca (Michonnet), Cleofonte Campanini (direction)]
Au moment où Debussy sollicite Maeterlinck
pour son Pelléas (créé un peu plus de six mois
avant Adriana), où Richard Strauss se tourne vers Oscar Wilde pour sa Salomé,
le choix d’un théâtre réaliste, aux effets scéniques bruts, à la clarté
structurelle schématique et à la substance littéraire anémique, est révélateur
des ambitions de Cilea qui, ne disposant pas d’un
recul suffisant, persiste dans la voie qui a si bien assuré le succès de ses
compatriotes sans s’aviser que Mascagni, Leoncavallo et Giordano ont échoué à
renouveler leur triomphe initial. Pourtant, ce choix n’est pas privé de tout
discernement. L’histoire d’Adrienne Lecouvreur, comédienne admirée de Voltaire,
adorée du public, aimée de Maurice de Saxe, empoisonnée, privée de sépulture
chrétienne, avait déjà inspiré plusieurs auteurs. Et les plus grandes actrices
(Sarah Bernhardt, Joan Crawford, Yvonne Printemps, Valentina Cortese) se plairont à faire revivre son personnage sur
écran, au XXe siècle. C’est que rien ne semble manquer à ce destin foudroyé, ni
le souffle du génie, ni l’exaltation de l’amour, ni le drame de l’assassinat,
ni la malédiction de l’excommunication, ni même le goût du péché ! Le
comique y côtoie la tragédie, les rivalités amoureuses y sont doublées par de
féroces antagonismes professionnels, l’héroïsme et la veulerie s’y affrontent.
Surtout, à l’exemple d’I Pagliacci, le théâtre y
investit le théâtre, pour une mise en abyme d’une profondeur parfois troublante
(monologue de Michonnet au premier acte, récit de
Phèdre au troisième). Enfin, si la même passion semble brûler dans le cœur des
protagonistes féminines, c’est en revanche un gouffre
qui sépare le bon et attentif Michonnet de l’épique
et farouche Maurice de Saxe, deux hommes aux destins discordants, mais croisés.
Donc, un argument qui s’inscrira sans hiatus
dans l’univers vériste. Mais la musique ? Que lui restera-t-il de
l’esthétique ouverte douze ans plus tôt par le chef-d’œuvre de Mascagni ?
En premier lieu, un matériau mélodique d’autant plus simple à mémoriser que les
motifs en seront systématiquement répétés, sans être nécessairement associés à
l’action. Ensuite un strict respect de la carrure qui, gouvernant la
segmentation des phrases, gardera le public d’effets propres à le distraire de
la marche de l’action. Enfin, une écriture légère mais souvent étincelante,
propre à séduire sans embarrasser. De tels critères relèvent cependant plus de
la tradition bel cantiste que du vérisme. D’autant
plus que tous les autres choix du compositeur restent conventionnels : les
deux rôles principaux sont confiés au couple traditionnel soprano/ténor,
l’œuvre est divisée en pezzi chiusi qui n’apparaissent
pas sur la partition, mais dont la réalité a été maintes fois démontrée par la
fortune des grands airs d’Adriana (« Io son l’umile ancella », « Poveri fiori », « L’anima ho stanca », « Acerba
voluttà »)
au concert. Le ballet, enfin, est conservé, concession d’autant plus
regrettable qu’il constitue la page la plus faible de l’opéra. En réalité, s’il
reste un seul élément proprement vériste dans l’opéra de Cilea,
c’est ce pathos, par instants excessif, qui colore les épisodes les plus
dramatiques.
Ni prologue, ni sicilienne pour l’ouverture
de l’opéra ! L’orchestre babille, sollicite tous les pupitres en entrées
contrastées, bientôt suivi par les joyeux protagonistes de la première scène,
galants comédiens et jolies soubrettes assaillant le malheureux Michonnet, qui se plaint de ces assauts répétés dans la
pure tradition bouffe : « Michonnet, su ! Michonnet, giù… » (Michonnet ci ! Michonnet là !). Que nous sommes loin
ici des rusticités du premier vérisme ! Cilea reprend l’esthétique vériste là où Giordano l’a laissée. Et Adriana ?
Avant même son apparition, tout le monde parle d’elle, même l’orchestre !
Cette première mise en abyme spécule sur l’ambiguïté d’un rôle double par
essence, celui de la cantatrice comédienne. Et pour que l’illusion joue à
plein, ce ne sont point des notes, mais des mots qu’elle fait d’abord entendre,
ceux de Racine, mirage parfait, en langue italienne, de l’illusion
tragique : « Del sultano Amuratte
m’arrendo all’imper ! » (Du Sultan Amurat, je
reconnais l’empire !). Par un trait de génie, c’est au sortir de cette
récitation, d’ailleurs erronée, que la cantatrice prend le pas sur la
comédienne, pour entamer son premier air, le plus célèbre de toute la
partition : « Io son l’umile ancella
del Genio creator »
(Je suis l’humble servante du Génie créateur). La question peut se poser de
l’héritage vériste dans cet air d’une suprême délicatesse, d’une grande beauté,
d’une noblesse d’expression sensible dès les premières notes. Sans doute
l’ornementation, toute d’inflexions et broderies, demande-t-elle à l’interprète
une large gamme expressive et un arsenal infini de nuances, mais une telle
exigence était déjà le fait du dernier Verdi. Du vérisme, la vraie marque
resterait donc, subjective, le subtil et perpétuel aller et retour de la
sincérité artistique animant équitablement la comédienne et la chanteuse.
Rompant avec l’usage, conservé tout au long
du XIXe siècle, Cilea termine son premier acte sans
avoir présenté l’une des quatre figures essentielles du drame, la princesse de
Bouillon. Puccini ira encore plus loin, dans Turandot,
en excluant le rôle-titre de la première moitié de l’œuvre, hors son apparition
muette au premier acte. Ce retard dans la présentation d’une impitoyable rivale
est d’une rare efficacité théâtrale, Adriana Lecouvreur contant moins
l’histoire des amours passionnées de l’héroïne et du comte de Saxe que celle de
la jalousie mortelle entre la belle comédienne et la sévère princesse. Par
ailleurs, à la sinistre atmosphère fermant le second acte répondra, selon la
logique toute vériste de l’aléa réaliste, le climat à nouveau festif de l’acte
suivant, ouvert sur le décor d’une salle somptueusement décorée. L’illusion ne
durera guère et la plaisante activité mondaine ne cachera qu’un temps les
tourments de la princesse, rongée par une jalousie d’une irrationnelle
férocité. Fureur extrême, qui va jusqu’au blasphème, mais aussi souffrance
atroce, avivée par le souvenir du temps heureux des amours défendues. En ce
sens, la princesse quitte le piédestal aristocratique pour redevenir sœur de Santuzza ou de Nedda, un être
fragile que ses passions égarent et qui, par là même, se découvre une grandeur
inconnue. Dans les dernières pages enfin, la scène finale creusera la mise en
abyme, Adriana se dédoublant entre comédienne fictive et cantatrice feinte,
spectatrice de sa propre disparition tout en refusant une mort scénique qui
devient la sublimation de son rôle, dans l’irréalité d’une musique séraphique.
Le quatrième et dernier acte d’Adriana Lecouvreur peut sans inconvénient
être considéré comme le véritable épilogue du vérisme. En tant que moteur
esthétique et dramaturgique, le vérisme aura ainsi, en une douzaine d’années,
de Cavalleria à Adriana, épuisé
l’essentiel de son impulsion novatrice. Ce qui n’en réduit ni l’importance
historique, ni la fécondité inventive.
En marge du noyau vériste
Si l’attention portée aux quatre grandes partitions lyriques précédentes
mène à un certain nombre de conclusions, parentes dans leur énoncé théorique et
convergentes dans leur effet dramatique, le vérisme a suscité bien d’autres
ouvrages, à l’image d’A Santa Lucia de Tasca ou de La Martire de Samara, qui n’ont quasiment plus d’existence que
documentaire ! Par ailleurs, c’est à l’occasion d’enregistrements inédits
ou de programmations courageuses que le public a encore l’occasion de découvrir
les noms de compositeurs ayant œuvré dans l’orbe vériste, Franco Alfano, Gaetano Coronaro, Pietro Floridia, Spiro Samara, Nicola Spinelli…
D’une tout autre dimension est évidemment
le problème posé par Giacomo Puccini, peu de compositeurs ayant connu, de leur
vivant, une gloire mondiale comparable à la sienne. Le lieu n’est pas ici de
retracer cette carrière, mais de chercher ce qui, dans plusieurs de ses
partitions, ressortit au génie vériste. Dans la production du maître de
Lucques, il est admis que l’influence du vérisme jouera surtout pour Il Tabarro,
premier volet du célèbre Triptyque. Mais nous lui devrons aussi la scène de
l’embarquement des prostituées dans Manon Lescaut,
les tableaux de rue de La Bohème, la partie de poker de La Fanciulla del West, etc. Dans La Bohème, par exemple,
la vérité psychologique, la sûreté de l’instinct scénique et la fécondité de
l’invention mélodique sont soulignées par l’obstination des motifs attachés aux
personnages et aux situations, ce qui confère une cohérence magistrale à la
trame dramatique. En quelque sorte, Puccini ne rapatrie du vérisme que ce qui
sert directement son propre génie. Ce qui explique que sa musique dépasse le
cadre strict de la nouvelle esthétique et que, déroutant le public qui avait
acclamé Cavalleria, elle s’inscrive néanmoins au sommet de la
tradition lyrique. Pour sa part, Tosca se présente comme l’intéressant
point de rencontre de deux genres très divers : le drame vériste et le
mélodrame romantique. Le vérisme se découvre surtout dans les touches réalistes
qui parsèment l’œuvre : le travail pictural de Cavaradossi,
le panier de provisions du sacristain, le repas de Scarpia,
les cloches de Rome. Les personnages sont conditionnés par ce parti pris ; Scarpia offre l’eau bénite à Tosca, se joint au chœur
du Te Deum, meurt en convulsions sur scène, poignardé par Tosca,
laquelle dispose ensuite les candélabres autour de son cadavre, place un
crucifix sur sa poitrine. Quant au mélodrame, nous lui devons aussi bien la
fuite du prisonnier que les scènes de torture ou l’exécution finale et la
poursuite, prélude au suicide de Tosca. Dans les partitions suivantes du grand
compositeur, les marques du vérisme persistent. La Fanciulla del West (1910) retrouve ainsi d’évidents accents
véristes, notamment à l’occasion du saisissant coup de théâtre de l’acte 2,
lorsque Rance accepte de jouer aux cartes la vie du bandit et l’amour de Minnie, même si la noirceur du shérif et la pureté de ses
deux victimes assure le triomphe artificiel de la vertu. Puis ce sera le temps
du Triptyque (Il Tabarro, Suor Angelica, Gianni Schicchi) dont seul le premier volet
peut encore être rattaché au vérisme, aucun personnage n’échappant à la
puissance de cette “tranche de vie”. Avec ses touches réalistes et sa profonde
humanité, la montée de la tension et l’inéluctabilité du drame, Il Tabarro apparaît comme un chef-d’œuvre du courant vériste, mais non comme un manifeste.
Ainsi se clôt la connivence de Giacomo Puccini avec un mouvement vériste dont
il reste tout à la fois le plus glorieux représentant et le moins zélé
sectateur.

Affiche originale de la création de La Fanciulla del West
Le vérisme au-delà de l’Italie
Si l’on s’en tient aux éléments permettant de tracer les contours véristes,
assez peu de musiciens ou d’œuvres pourront s’en réclamer hors d’Italie. En
Allemagne, par exemple, l’opéra d’Eugen d’Albert, Tiefland (1903), figure parmi les rares ouvrages présentant de
réelles analogies avec les modèles italiens, tout en penchant bien plus du côté
de Catalani que de celui de Mascagni. Une autre pièce
germanique, Der Evangelimann du compositeur Wilhelm Kienzl qui connut en son
temps un réel succès, est apparentée par plus d’un trait au vérisme italien.
Créée en 1895 à Berlin, cette sombre tragédie mêle la vie monastique aux
désordres amoureux, l’incendie au meurtre, le péché au pardon final ! Des
opéras de Leos Janáček enfin, bien des pans peuvent être placés sous le sceau du vérisme. Dans Jenufa, récit du meurtre
d’un enfant en terre paysanne, c’est au prix du sacrifice de toute virtuosité
vocale que la sombre atmosphère de l’opéra suinte de tous ses éléments, marquée
par l’intérêt le plus sordide, la lâcheté la plus abjecte, la sottise la plus
épaisse. Cheminant entre les abîmes du mélodrame et de la caricature, l’œuvre
fait chanceler les notions du bien et du mal, piliers indécis de cette fresque
dont les échos ont traversé sans rien céder de leur affreuse mélancolie, le
siècle le plus tumultueux de l’histoire. Cependant, dans Jenufa,
le vérisme n’est qu’une clef parcimonieusement utilisée. Qui colorera aussi, de
façon très retenue, nombre de partitions théâtrales du XXe siècle, dues à des
auteurs aussi différents que Falla, Berg, Prokofiev, Bartók, Chostakovitch,
Britten, etc.
En France, le naturalisme
La confusion entre vérisme italien et naturalisme français est trop
répandue pour ne pas être fondée sur de réelles affinités, les deux mouvements
cherchant à extraire du réel l’essence de la création poétique. La carrière de
Charpentier est marquée par le succès de son premier opéra, Louise (1900), créé la même année que Tosca, avec un succès immédiat à peu près
égal, mais une destinée posthume bien différente ; les deux protagonistes,
une jeune couturière et un poète désargenté, y viennent du peuple de Paris.
Mais nous sommes loin de Mimi, et la belle Louise témoigne d’une rare modernité
par sa revendication d’un bonheur et d’un plaisir la contraignant à déserter le
foyer familial. La vie de bohème, donc, synonyme de liberté mais aussi de
misère matérielle et d’incertitude, le choix de la vraie vie contre
l’aliénation d’un quotidien laborieux ! En dépit des sarcasmes dont
l’accablera Debussy, la musique évoque avec bonheur toute la palette des
sentiments animant les personnages, mais aussi le cadre pittoresque de leur
épopée populaire. Alfred Bruneau reste le plus fécond des compositeurs
naturalistes ; ayant fait créer son premier opéra, Kérim,
dès l’âge de trente ans, il rencontre l’année suivante Zola, l’écrivain lui
fournissant plusieurs livrets. C’est de 1891 (entre Cavalleria rusticana et I Pagliacci)
que date la première œuvre marquante d’Alfred Bruneau, Le Rêve, dont
l’argument est fourni par la trame du livre homonyme de Zola, adapté par Louis
Gallet. L’histoire est celle d’une pitoyable enfant, la bien nommée Angélique,
trouvée sous la statue d’un porche de cathédrale, enfant qui grandit, qui rêve
d’amour, qui touche aux rivages du bonheur mais qui, victime des noirceurs de
l’évêque Jean d’Hautecœur, meurt dans les bras de son
bien-aimé ! Tout ici n’est que candeur contre noirceur, ferveur contre
trivialité, virginité contre dépravation. De telle sorte que cet opéra n’est
jamais que l’avant-courrier d’un naturalisme dont il affadit tous les
paramètres. Suivront L’Attaque du moulin, Messidor, L’Ouragan, L’Enfant Roi, toutes pièces aujourd’hui bien oubliées. Quant aux
Canteloube, Dupont, Erlanger ou Leroux, en dépit de la réussite de quelques
pages, Le Mas, La Glu, Le Juif polonais ou Le Chemineau,
il faut bien convenir qu’ils n’ont jamais réussi à occuper une place
significative dans l’histoire du théâtre musical.
Quelle place pour le vérisme dans
l’histoire ?
En conclusion, il n’est pas très difficile
de déterminer un certain nombre de traits communs à toutes les partitions
véristes ; la vraie difficulté est de découvrir en quoi ces traits communs
sont spécifiques du seul vérisme. L’organisation de la matière sonore
peut-elle, par exemple, sans trahir le livret, s’en émanciper pour dispenser de
pures émotions musicales ne renvoyant qu’à elle-même tout en étant, pour une
part, tributaire de l’argument ? Plus précisément, l’émotion esthétique
générée par les traits véristes du discours d’un Mascagni ou d’un Leoncavallo
provient-elle de leur seul génie musical ou est-elle, au moins en partie,
conditionnée par les didascalies des œuvres ? Dans ces conditions, il
reste malaisé de faire du seul goût pour le réel, pour l’ordinaire, une
dimension décisive du vérisme. Quant à l’ensanglantement des livrets d’opéras
véristes, il serait difficile, après Donizetti et Verdi, voire Gounod ou Bizet,
de le faire passer pour une grande nouveauté ! Alors la plongée au plus
profond des campagnes, au cœur des bourgs reculés, dans les salons
révolutionnaires, à l’abri des coulisses ? Quoi de plus simple que d’en
trouver de multiples exemples dans le répertoire romantique ? Mieux
encore, la langue de Pelléas, désenflée par la
volonté de Debussy, n’établira-t-elle pas une indiscutable parenté dans la
recherche du vrai chez le musicien français et chez ces véristes qu’il
haïssait ? Confrontés au même dilemme que leurs confrères écrivains ou
peintres, les compositeurs véristes ont-ils pour volonté d’exploiter la veine
dramatique d’une vérité quotidienne ou d’user de la simple évocation du réel
comme prétexte à une complaisante escapade lyrique ? C’est à l’évidence le
premier terme de cette alternative qui l’emporte, les musiciens cherchant la
restitution d’une atmosphère réaliste sans misérabilisme, pittoresque sans
exotisme, propre à captiver le spectateur, et non la mise à l’étude d’un
matériau musical vaguement folklorique. Force reste de reconnaître qu’il est
impossible de distinguer chez les grands compositeurs véristes ce que nous
pourrions nommer, à défaut de mieux, les traces d’un principe innovant. Les
partitions des quatre grands opéras véristes sont l’œuvre de techniciens
avertis, formés dans les meilleurs conservatoires d’Italie, qui ne cherchent
pas la rupture avec la tradition lyrique, au rebours d’un Debussy, voire d’un
Richard Strauss ou d’un Puccini. Pourtant, indiscutablement, cette langue est
neuve, sinon dans les mots, au moins dans l’accent. Destiné au peuple, l’opéra
vériste ne ressortit pas à l’art populaire ; c’est, à l’inverse, une
pratique savante qui a permis à Mascagni, à Leoncavallo, à Giordano ou à Cilea, de toucher un public universel, un public qui n’a
nul besoin d’initiation solfégique pour adhérer à
cette esthétique, et qui n’y adhérerait pas si le matériau et sa façon étaient
aussi rudimentaires que le prétendent ses adversaires. Dans une Italie asservie
depuis si longtemps par les odieux héritiers de Metternich, affamée au point de
lancer ses plus vigoureux enfants à l’assaut du Nouveau Monde, majoritairement
illettrée, sous-développée, la marque première du vérisme ne serait-elle autre,
en dernière analyse, que cette grandeur discrète dont se parent les plus
misérables comme les plus aristocratiques de ses protagonistes ?
Gérard Denizeau.
L'ENSEIGNEMENT MUSICAL : UNE HISTOIRE DE LUTHERIE
Une
Histoire de Lutherie... Une
histoire de lutherie rare, originale, audacieuse, en même temps qu'une belle
aventure humaine que l'histoire de « Raphaël », le violoncelle de
Giverny. C'est en effet lors du dernier festival de Musique de Chambre de
Giverny (2014) que fut initiée, puis réalisée la construction d'un violoncelle
dont la particularité fut d'être construit de façon collégiale par une équipe
de neuf luthiers confirmés, réunis et dirigés par Frank Ravatin,
un des grands noms de la lutherie mondiale actuelle, qui releva le défi de
fabriquer en deux semaines de résidence à Giverny, un violoncelle présenté et
joué lors du dernier concert du festival par Michel Strauss. Une expérience
unique en matière de lutherie mais surtout un moment de solidarité, de partage
et d'amitié. Cet Entretien
avec Frank Ravatin, luthier réputé, diplômé de
Crémone, lauréat de plusieurs concours internationaux, nous
en dit plus. Frank Ravatin,
comment cet étonnant projet a-t-il pris forme ? Merci de l'intérêt sincère
que vous portez à notre aventure, je suis ravi de vous apporter le maximum de
réponses à vos questions et ferai de mon mieux. Rien de plus difficile pour un
petit artisan, un Gépetto, que de parler de soi.
Quand Michel Strauss et son épouse Masha Belloussova
m'ont fait le plaisir d'une visite au printemps 2013, au lendemain de la
disparition tragique de leur cher ami Raphaël Drouin, pianiste de leur festival
de Giverny, on a commencé à parler... Michel me demanda si je ne connaissais
pas un riche Américain, Chinois, Australien, ou autre, prêt à faire un don pour
leur beau festival. Je n'en connaissais pas, mais j'ai immédiatement lancé un
projet un peu fou. "Je vous réunis
une équipe de luthiers, et nous vous faisons un violoncelle en 12 jours,
pendant le festival de Giverny, il sera vendu au profit du festival ".
L'idée partie, les semaines passant, je me suis demandé comment j'allais faire
pour trouver suffisamment de bénévoles, chefs d'entreprises, luthiers
compétents pour mener à bien cette construction. J'ai donc fait une petite
annonce, discrète, dans le bulletin des luthiers et archetiers d'art de France
(une centaine de membres) en Janvier 2014."
Cherche luthiers pour produire un violoncelle au festival de Giverny ».
A ma grande surprise, j'ai eu huit réponses immédiates et enthousiastes : Jean Seyral, de Bayonne , Nicolas
Perrin, Francesco Coquoz, Jean-Michel Desplanches de Paris, Maurice Beaufort de Besançon, Pascal
Lavigne de Grenoble, Pascal Douillard du Puy-en
Velay, et Frédéric Samzun de Lorient. Du gros
calibre, rien que du bon, d'excellents professionnels. Restait à trouver un
atelier, c'est Delphine Debord, coordinatrice du
festival qui nous l'a dégotté, un magnifique atelier de peintres. A Giverny,
ça ne manque pas ! Et vogue la galère.
Nous avons travaillé, durement, sérieusement, certains d'entre nous étaient à
l'établi encore le soir à 11 heures ! Nous avons fait du mieux que nous
savions. Au delà de faire un violoncelle, ça a été un lieu d'échange, chacun
amenant son expérience, sa conception d'un instrument de musique, on n'était
pas toujours d'accord, mais les discussions ont toujours été animées et
enrichissantes. Giverny fut une histoire de partage. Cela restera, dans la
profession, un grand moment.
Combien
de temps pour construire un violoncelle ? Quel bois utilisez-vous ? Quelles sont les différentes
étapes de la fabrication ? Quelle particularité de chaque étape ?
Certaines vous paraissent-elles plus importantes ? Plus
délicates ? Un luthier seul, comme
moi, a besoin de trois semaines pour
faire un cello en blanc. Uniquement pour le travail
du bois. Cela dépend aussi de la rapidité de chacun, cela peut être quatre,
cinq semaines. A Mirecourt, les ouvriers
étaient extrêmement rapides, il leur fallait une semaine seulement. Mais faire
un instrument, cela n'est pas uniquement technique, ce n'est pas que le geste
qui conduit au résultat. Faire un instrument c'est s'arrêter, réfléchir,
établir la relation entre la matière, le travail et le son. Beaucoup de
réflexion, de doutes, d'interrogations. Sentir un matériau, c'est l'évaluer,
dans sa densité, dans son élasticité, dans sa résistance. Tous les sens sont en
éveil, le toucher, le nez, la vision. Je
vous explique… La genèse du cello commence par l'achat du bois. C'est ce que je
préfère. La table, en épicéa. Le reste en érable. La raison de ces essences est
simple, logique. Tous les instruments de musique, de la guitare, au piano, au
clavecin, au violon, ont une table en épicéa. C'est le bois qui conduit le
mieux le son, car il est extrêmement rigide dans sa longueur, capable de faire
face aux tensions énormes, en même temps que très souple dans sa largeur.
L'érable résiste très bien aux efforts, que devront supporter le fond, les
éclisses, le manche. Il ne se déforme pas, tout comme le frêne qui est plus
poreux, moins adapté pour la lutherie. Donc, je me rends, quand c'est la
saison, en avril ou mai, dans des scieries en Italie ou en Autriche. Pourquoi ?
Parce qu'il y a une toute petite vallée, qui s'appelle "le valle di Fiemme ", en Italie où, déjà les Amati, Stradivari, Guarneri, et
tutti quanti allaient chercher leurs bois. Et c'est beau, c'est religieux comme
endroit. Là, avec un peu de chance, je peux tomber sur des arbres magnifiques.
On lit un bois comme un livre, quand il est ouvert, sa croissance, le climat
dans lequel il a poussé, hivers plus ou moins froids, étés plus ou moins
chauds, tout est clair. Richesse ou pauvreté du terrain, chaque arbre vous
offre trois cents ans, parfois cinq cents ans d'histoire. C'est merveilleux, le
vivant ! J'achète, je sélectionne du bois frais, à peine coupé, je le laisse à
la scierie pendant un an, puis je me le fais transporter à l'atelier. Là, grand
moment, car il s'est passé un an, je n'ai pas mémoire de tout, et j'ai des
découvertes, des déconvenues, aussi. Je le mets en séchage pour dix ans. Un
grenier ouvert, froid l'hiver, chaud l'été. Quel bonheur, ça sent bon, c'est
comme pénétrer dans une cave de vigneron. Revenons à notre cello de Giverny. La première étape consiste à faire la
couronne d'éclisses, (les côtés de l'instrument). Ce n'est pas le plus
passionnant, il y a en tout 24 pièces de bois, entre les tasseaux (6), les
éclisses (6), les contre-éclisses (12), à plier, ajuster et coller. Cela prend
deux jours. En même temps, on prépare les joints de table et fond, en deux
parties chacun. Le contour des éclisses y sera reporté, les lignes extérieures sciées,
et ensuite vient un véritable travail de sculpture. Car le galbe, les voûtes
sont taillés dans la masse. C'est l'étape essentielle pour un violoncelle.
L'architecture doit être parfaite pour pouvoir supporter les tensions, et une
voûte bien faite offrira à l'instrument toutes les chances de bien vieillir et
de servir longtemps. Viennent ensuite la finition des bords, la pose des
filets. Les filets : ces fines bandes noires et blanches qui entourent
l'instrument. Deux brins d'ébène, un brin d'érable au milieu. Ils sont
incrustés, collés dans la table et le fond, et font un véritable cerclage,
comme un cerclage de tonneau, afin de stopper des cassures en cas de choc donné
sur les bords. Ensuite, les épaisseurs, dont les voûtes intérieures sont
faites. Chaque bois reçoit des épaisseurs différentes en fonction de sa
consistance, son poids, sa flexibilité, et aussi en fonction du musicien qui a
commandé. On comprend logiquement qu'un violoncelliste qui joue avec une grosse
pression d'archet puisse avoir besoin d'un instrument plus résistant, donc plus
épais. Ensuite le coffre est fermé, fond et table sont collés sur les éclisses.
Pendant ce temps, la tête et le manche sont sculptés à partir d'une pièce
d'érable et reçoivent la touche en
ébène. Le manche sera enclavé sur le coffre. Restent deux ou trois jours de
finition correspondant au montage, qui comprennent le chevalet, la pique, la
pose de l'âme et le violoncelle est terminé en blanc. Frank Ravatin,
il y a dans vos propos, une technicité certaine, mais aussi une forme de
respect pour l'instrument, une poésie au sens étymologique du mot. Qu'est ce
que l'âme du violoncelle ? L'âme, est un cylindre en
épicéa qui relie la table et le fond, du côté des aigus. Du côté des basses, il
y a un renfort appelé barre d'harmonie. C'est à ce stade qu'il a été joué à
Giverny. On fait tout un mystère de cette fameuse âme, un peu trop, à mon goût.
Elle porte ce nom car c'est la dernière pièce mise dans l'instrument avant le
montage. C'est aussi la seule pièce que l'on peut bouger pour les réglages de
sonorité. Qu'en est-il du rôle du
vernis ? Et notamment de la légende de Stradivarius ? Mythe ou
réalité ? J'ai ramené le violoncelle
dans mon atelier, l'ai laissé au soleil plusieurs semaines, se reposer, prendre
une belle couleur, et je suis actuellement en train de le vernir. C'est un
processus long qui fait intervenir, pour ma part, 5 vernis d'essences
différentes, de nombreuses couches délicatement passées au pinceau, des heures
de séchage, de finitions. Je fabrique mes vernis moi-même, en compagnie de mon
ami et confrère Jean Seyral, ainsi que les couleurs
qui y seront mêlées. Vous me questionnez sur le vernis, vaste sujet, vaste
mythe. D'abord, tous les luthiers de Crémone utilisaient le même vernis, il est
probable qu'ils ne le fabriquaient pas eux-mêmes. Faire un vernis demande
quelques connaissances scientifiques, maîtriser des réactions chimiques
acide-base, qui n'étaient pas à la portée des artisans de l'époque. Cela
demande de l'énergie, faire chauffer de l'huile à 250 degrés n'était pas si
simple à l'époque. Aucune chance d'y arriver avec quelques bûches de saule, ou
de bois de la plaine du Pô. Combien de violons de « Strad »
ont encore un peu de vernis ? Très peu. Il était extrêmement fragile, c'est
probablement pour ça que « Strad » lui-même
l'a abandonné à la fin de sa longue vie. Ce mythe a été établi par des
commerçants aux 19 ème et 20 ème
siècles, qui ont imaginé un secret disparu, et ont pu surenchérir en
argumentant que le passé ne se reproduirait plus, que la tradition était morte.
Beaucoup d'études scientifiques ont révélé ce que ces vernis contenaient, on en
connaît la recette de base. Il y a juste une chose à rajouter. La technique
d'application change tout. Là encore, l'expérience. Quand j'étais à l'école de
lutherie de Crémone, nous avions un cours de vernis. Neuf joyeux apprentis
luthiers dans la classe, un pot de vernis commun. Chacun y trempait son
pinceau, et au bout de deux mois, 9 vernis différents. Pas les mêmes couleurs,
pas les mêmes transparences, pas les mêmes épaisseurs. Donc… Qu'est
ce qui peut expliquer que deux instruments fabriqués de façon identique sonnent
différemment ? Quel est le rôle de l'interprète ? De sa façon de jouer ? Un instrument est il
spécifiquement construit pour un interprète particulier ? Quelles sont les
variables adaptables ? Quelle est la part de mystère
inexplicable ? D'inconnu ? Un luthier fabricant doit
avoir beaucoup de cordes à son arc. C'est avant tout un sculpteur, mais aussi
un peintre, et enfin un acousticien. Je ne connais pas de métier qui fasse
travailler autant de sens, la vue, la toucher, l'ouïe, l'odorat. Chaque
instrument est unique, même s'il m'arrive d'en faire plusieurs tirés des mêmes
arbres. Dans un même tronc, les densités peuvent varier incroyablement. A moi
de m'adapter. C'est en cela que notre travail rejoint celui du vigneron. Nous
avons un terroir bien précis, des plantes, à nous d'exploiter le meilleur de ce
que nous offre la nature. Il m'est arrivé et il m'arrivera encore de rater des
instruments, pas parce que le matériau est mauvais, mais parce que j'aurai fait
des erreurs de jugement successives. La relation entre la
fabrication d'un instrument et le musicien auquel il est destiné est complexe.
J'ai la chance de ne travailler que sur commande, donc d'établir une relation
étroite avec le musicien. Déjà, s'ils passent commande, c'est qu'ils ont déjà
essayé un de mes violoncelles auprès de leurs confrères. Donc, à priori, ça correspond
à leur attente. Ensuite, je cherche à m'adapter à leur jeu, à entrer dans les
problèmes relatifs à l'anatomie : on peut varier les longueurs de corde
vibrante (plus courte), si la main est petite, travailler sur les largeurs, sur
les longueurs de modèles. Le mystère qui fait qu'un instrument sera meilleur
qu'un autre ? Je ne sais pas. Je cherche, toujours. Je sais que je vais tomber,
à chaque fois, dans une moyenne de qualité sonore, en choisissant bien mes
bois, les travaillant au mieux, mais je dois dire qu'il y a aussi une part de
chance. Et le rôle du musicien est essentiel. On comprend aisément qu'un
violoncelliste qui « rentre dans la corde », va chercher le son, va
ouvrir le cello plus rapidement qu'un autre qui
« savonne », caresse sans pression. Je dis toujours aux musiciens
« j'ai fait 50% du boulot, le reste
t'appartient ». Quel
est le rôle de l'archet, son importance, est-il indissociable du
violoncelle ? L'archet est aussi
important, c'est un instrument de musique à part entière. Le même cello joué par le même musicien, avec deux archets
différents pourra être transformé. L'archet, c'est le pneu de la voiture :
montez une Ferrari avec des pneus de 2CV, vous allez dans le décor illico.
Chaque musicien trouve un mariage à trois entre sa main, son violoncelle et son
archet. Lorsque je fais un violon ou un violoncelle, et que l'on me dit, je
veux aussi changer d'archet, je conseille un peu de patience. « Apprends à connaitre ton nouvel instrument,
ensuite, tu te choisiras un archet. Prends du temps ! » Pourquoi avoir appelé ce
violoncelle de Giverny « Raphaël » ? Le cello
de Giverny va s'appeler « Raphaël », en mémoire de Raphaël Drouin,
pianiste, et grande figure du festival, comme une pensée, un hommage.
Frank, quel avenir
voyez-vous pour la lutherie artisanale ? L'avenir de la lutherie
artisanale ? Je ne le connais pas. Il y a évidemment la production de masse
chinoise, toujours meilleure, qui a le mérite de proposer des instruments avec
d'excellents rapports qualité-prix. Mais je pense, j'espère qu'un bon artisan
sera toujours irremplaçable. Une usine à violons ne peut être à l'écoute, au
contact d'un grand musicien. Vous pouvez, maintenant, acheter des peintures au super
marché. Oh! bien faites, techniquement irréprochables, mais elles n'ont pas
d'âme. Je vous parlais d'âme du violon ou du violoncelle, la seule qui compte,
le véritable secret c'est la réunion d'un artisan et d'un artiste musicien,
c'est la transmission, l'échange, l'âme commune. Offrir, proposer une voix à un
instrumentiste restera, j'espère, le plus bel échange, le plus beau cadeau du
monde. Exercer le métier de luthier, c'est accepter une bonne dose de solitude.
Je ne parle pas de ceux qui ont des boutiques, rue de Rome, qui ont un brassage
certain. Je parle des quelques
fabricants, des travailleurs silencieux, les Gépettos,
qui donnent un semblant de vie à des bouts de bois. Gépetto
attendait le passage de la fée miraculeuse pour animer ses marionnettes,
accompagné de son chat et de son poisson rouge. Même attente pour le faiseur de
violons, de violoncelles, souvent isolé, qui travaille sur commande. Le
dialogue ? Avec des morceaux de bois, peu de réponse, mais quand l'instrument
est terminé, quand l'instrumentiste l'attrape et le fait vibrer, quand la voix
s'élève, c'est un miracle ! Je suis Gépetto,
j'ai un chat, voire deux, malheureusement ils ont bouffé le poisson rouge, un
matin... Merci beaucoup Franck. Un
mot pour conclure ? Tout le monde a appris au
contact des autres, et j'ai juste une chose à déclarer : le violoncelle est
beau, très beau, Michel l'a joué en blanc, non verni, lors du concert de
clôture du festival. Il sonne très bien. Nous en sommes tous fiers. Nous avons
trouvé dans ce festival beaucoup de chaleur, des musiciens exceptionnels, nous
avons eu droit, le soir, à l'atelier, pendant le travail, à des concerts privés
d'interprètes uniques. Je suis en train de le vernir, tenter de lui donner un
bel habit de sortie, ça devrait aller, il sera fini à la fin du mois d'octobre.
Et nous souhaitons tous, les luthiers, Michel et Masha, qu'il atterrisse dans
les mains d'un musicien qui saura en apprécier les qualités. Pas de doutes là-dessus…
Propos recueillis par
Patrice Imbaud.

L'âme
du violoncelle / DR

Frank
Ravatin, ses amis luthiers et Masha Belloussova / DR
***
Laurence
Sterne mis en musique par David Owen Norris : STERNE, was the MAN
Après avoir
consacré, il y a plusieurs mois, un article au compositeur britannique David
Owen Norris, je reviens vers lui aussitôt rentré du Royaume-Uni où j'étais
l'auditeur invité et privilégié, le dimanche 19 octobre dernier, d'un concert
consacré à son exégèse musicale du dernier sermon(1),
fulgurant, de Laurence Sterne (1713-1768), écrivain de l'époque géorgienne,
homme d'église anglais et l'un des esprits les plus originaux de son siècle(2).
Cet événement musical étonnant, dans sa version révisée du 5 février 2014, se
passait en l'intime et chaleureuse St Michael Church de Winchester, dans le
Hampshire, la belle cité où s'est éteinte l'émouvante Jane Austen (1775-1817)(3).
Le texte de Sterne
– The Case of Hezekiah(4)
and the Messengers (« Le cas d'Ézéchias et des
messagers ») – particulièrement développé, renvoie au Deuxième Livre des
Rois 20. Le contexte y est à la fois symbolique et historique. La complexité du
personnage d'Ézéchias (« Force de Yahvé ») – atteint d'un mal tenu
pour mortel – a inspiré Sterne en profondeur. Cette Voice from the Pulpit a été
prononcée à l'ambassade britannique de Paris, le 25 mars 1764, devant Son
Excellence le comte de Hertford. Le philosophe David Hume (1711-1776) et
Diderot (1713-1784) étaient dans l'assistance. L'esprit de ce sermon a quelque
peu choqué d'aucuns malgré le fait que Sterne soutenait l'idée que, en
définitive, « l'homme est fondamentalement bon ». Pour autant, il est
évident que son discours atteste d'une grande finesse psychologique surmontant
les bons sentiments.

Laurence
Sterne / DR
L'œuvre de Norris –
commande du Laurence Sterne Trust – a été
créée à la Cathédrale d'York le 14 octobre 2013(5)
afin de commémorer le trois centième anniversaire de la naissance de Laurence
Sterne à Clonmel, County Tipperary, en Irlande du Sud. La partition est
d'ailleurs dédiée à Patrick Wildgust, le conservateur
de Shandy Hall (Yorkshire), là même où Sterne a vécu
entre 1760 et 1768. De nos jours, il est plus essentiellement connu pour The
Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman (1760/66) (6) –
piquante satire des mœurs anglaises – et A Sentimental Journey
Through France and Italy,
by Mr Yorick (1767/68) (7), chef-d'œuvre d'humour et de mélancolie. Pourtant, en son
temps, celui qui était traité de « Rabelais anglais » bénéficiait
d'une solide réputation autant pour ses prédications que pour ses romans.
Jamais on n'avait ouï prêcher de la sorte tant sa verve était intarissable.
Thomas Gray (1716-1771) (8) a dit de lui :
« On le voit souvent prêt à jeter sa perruque à la face du public. »
Humoriste, il était pourvu d'une « imagination de feu et d'un cœur
sensible », toujours selon Gray.
En
tant que compositeur, pianiste, organiste, professeur, musicologue, homme de
radio et de télévision, David Owen Norris – à l'instar de Sterne – est sans
aucun doute l'une des personnalités les plus stimulantes et caractéristiques
(au sens que lui donnait Parry(9))
de la musique anglaise de tous les temps.
Sa
partition – intelligente, roborative, unique – est conçue pour un récitant, en
l'occurrence, un acteur qui joue le rôle de Sterne. Il s'agissait, à
Winchester, de Christopher Benjamin, remarquable interprète, entre autres, de
Falstaff(10) au Shakespeare's
Globe de Londres. Un grand talent, une simplicité, celle qui convient aux
véritables artistes. Le ténor rayonnant de Mark Wilde, un chœur de boys
– qui regroupait les Quiristers(11) de Winchester College, les Trebles(12)
du St Michael's Choir et ceux de la Pilgrim's School – le grand
violiste Richard Boothby(13), le jeune Alexander Toal à la
trompette naturelle, un quatuor à cordes formé par les violonistes Jessica Lawless et Hannah Preston, l'altiste John Hinchliffe, la violoncelliste Hatty
Goody constituaient un ensemble aussi rare que
merveilleux. David Owen Norris était au square piano(14), un Collard & Collard de 1845 au son tellement spécifique. L'ensemble
était dirigé avec énergie par Nicholas Wilks, Master
of Music de Winchester College. Tous ces interprètes
sont excellents. Il était si émouvant d'être auditeur au sein de cette intime
église St Michael, dans ce beau et historique quartier de Winchester, témoin
d'un dynamisme, d'une joie de vivre et d'une espérance qui font du bien. Les
enfants du chœur, en particulier, attestent à la fois d'une haute qualité par
la maîtrise d'une partition aussi simple que complexe dans son déroulement, et
d'une concentration sans contrainte tout à fait exceptionnelle. Ayant assisté
également à la répétition qui a précédé le concert, je garde en moi
l'impression d'un rêve.

David Owen Norris / DR
La
partition de Norris est formée de quinze numéros qui s'articulent à partir de
la prédication, laissant une large place au texte prononcé. Les diverses mises
en perspectives instrumentales attestent du souci exégétique du compositeur,
précisément grand connaisseur de la musique de Johann Sebastian
Bach. Il adhère à l'esprit si particulier de Sterne, lui-même en relation à un
écrit biblique extraordinaire sur le plan symbolique et moral. La musique de
Norris est remarquable par son ton, sa diversité, la qualité de ses mélodies
soutenues par de beaux et vigoureux rythmes et de splendides verticalités
sonores. Il faudrait de nombreuses pages pour analyser une musique et une parole
si riches de signification où tension et détente alternent de manière
remarquable.
Un
magnifique Ré Majeur, entonné à la trompette naturelle, introduit
l'auditeur dans un monde sonore et poétique étonnant. L'acmé de l'œuvre, selon
moi, se situe aux numéros 6 – Prayer – pour
ténor et viole de gambe, et 9 – Virtues
& Vices – pour le chœur, la viole de gambe, le square piano et
le quatuor. La prière témoigne émotivement de la
religiosité d'Ézéchias. Le bel Ut Majeur du n°9 met en évidence la
viole qui s'exprime par un ostinato typique de la pensée musicale de Norris.
Les voix entrent discrètement à la cinquième mesure sur les mots We are a strange compound (« Nous sommes un étrange
composé »). L'interpénétration entre la musique et le texte est
spécialement valorisée.
Introduite
par un touchant prélude au quatuor à cordes, la conclusion jubilatoire se
réfère à l'épitaphe inscrite sur la tombe de Sterne, actuellement placée à
l'intérieur du porche de l'église de Coxwold, dans le
Yorkshire. Les chanteurs sont accompagnés par les instruments que Sterne
connaissait et aimait : la viole de gambe, le square piano, la cavalry trumpet et
le quatuor à cordes. Tel un péan, le chœur, soutenu par les instruments,
entonne un hymne à la gloire de Sterne(15).
Le
public, attentif, a montré son enthousiasme pour cette musique sincère de David
Owen Norris, créateur avisé nourri par une pensée et une imagination
indispensables à nos esprits.
James Lyon.
(1) The
Sermons of Mr Yorick.
(2) Aux côtés de
Samuel Richardson (1689-1761), Henry Fielding (1707-1754) et Tobias George Smollett (1721-1771).
(3) Auteur, entre autres, de Pride
and Prejudice (1813 – « Orgueil et
Préjugés »).
(4) Douzième roi de Juda au temps de l'agression
assyrienne ( ? 727-698 av. J.-C.). Réformateur proche du prophète Ésaïe, il a régné pendant vingt-neuf ans, restauré le
Temple de Jérusalem et rétabli le culte de Yahvé.
(5) Avec d'autres interprètes pour la plupart.
(6) « Vie et opinions de Tristram
Shandy ».
(7) « Voyage sentimental en France et en Italie ».
(8) Auteur de Elegy
Written in a Country Churchyard
(1750 – « Élégie écrite dans un cimetière de campagne »).
(9) Sir Charles Hubert Hastings Parry
(1848-1918), compositeur, professeur et historien de la musique. Il a été le
second directeur du Royal College of Music
(1895/1918).
(10) Merry
Wives of Windsor (« Les Joyeuses Commères de Windsor »).
(11) Choristes.
(12) Soprani.
(13) du consort
de violes Fretwork dont l'esprit est
certainement, dans les répertoires qu'il pratique, le plus idéal et le plus
abouti.
(14) Forme rectangulaire
de piano conçue à Londres au XVIIIe siècle.
(15) « STERNE
a été L'HOMME qui, à grands pas, a fait tomber de tous côtés les exubérantes
folies » (STERNE, was THE MAN, who with gigantic
stride Mowed down luxuriant
follies, far and wide.)
Un maître du Lied

Matthias Goerne & Christoph Eschenbach
/ DR
Chaque concert de Matthias Goerne est décidément un moment choisi. On se souvient de
ses Schubert à Salzbourg et récemment à Aix, ou encore de cette incursion chez
Chostakovitch aux Champs-Elysées. Une apparente bonhomie et une réserve
naturelle cachent un rare professionnalisme, une empathie pour l'univers du
Lied, digne de son maître Dietrich Fischer-Dieskau. Avec une simplicité
désarmante, mais cette autorité du dedans qui impose le silence quasi absolu
parmi l'auditoire. Car l'auditeur ne peut s'y tromper : une
tel degré de concentration force le respect. Autre signe, qui le rapproche de
l'illustre prédécesseur : le choix du partenaire pianiste, méticuleusement conçu. Avec Christoph Eschenbach l'entente est évidente, et dans Schumann en
particulier. Trois grands cycles de l'année 1840, si faste chez le musicien,
composaient le programme où planait une atmosphère recueillie. Frauenliebe und -leben
(L'Amour et la vie d'une femme) op. 42, de 1843, généralement distribué à une
voix féminine, acquiert avec Goerne une épaisseur
troublante, que le piano peu disert d'Eschenbach
achève de raréfier. Il n'est nullement hors de propos que ces poèmes, conçus
pour dessiner les étapes d'une vie de femme aimée et aimante, soient chantés
par une voix d'homme, surtout aussi chargée d'émotion que celle du baryton
allemand. Les confidences du cœur sont épanchées comme s'il s'agissait d'un
récitant. Et Goerne, de son art de sculpter la
phrase, et au-delà même, du mot, nous entraîne dans une sorte d'extase
intérieure. Eschenbach est tout autant d'une rare
discrétion. Donner immédiatement après, quasiment sans interruption, les Dichterliebe (les Amours du poète), op. 48, au
demeurant composés avant, montre combien ces deux cycles sont complémentaires.
Après Adelbert von Chamisso
nous voici transportés dans la poésie de Heinrich
Heine, pour une longue variation, seize mélodies, sur le thème de l'amour
perdu, magnifiée par une poétique liant inextricablement voix et piano. Le
nuancier sonore de Goerne est infini, découvrant
rarement la pleine puissance (« Iche grolle nicht » / Je ne gronde pas), distillant des inflexions
à vous tirer les larmes (« Ich hab' in Traum geweinet »
/ J'ai pleuré en rêve), tandis que les postludes pianistiques d'Eschenbach sont magiques de pudeur, comme celui qui conclut
le cycle. Si Goerne paraît s'extérioriser par une
gestuelle presque scénique, elle ressort presque de l'évidence, menant
l'auditeur par la main dans la perfection des images et l'abysse des émotions.
Ils poursuivent en seconde partie avec les Zwölf
Gedichte von Justinius Kerner (Douze poèmes de Justinius
Kerner), op. 35. Cet ensemble, composé aussi en 1840, mais après les deux
autres, se situe après le mariage tant désiré, et différé, avec Clara Wieck. Il est aussi sombre pourtant, un « étrange chef
d'œuvre de déréliction », selon Brigitte François-Sappey.
Cette « suite de chants », comme la définit Schumann, est écrite sur des textes de Kerner, poète et médecin, passionné
d'occultisme. Là encore, Goerne éblouit par sa
retenue intérieure et cette gestuelle expressive qui le situe à certains
moments comme en apesanteur. Pour exprimer une foule de sentiments, voyageur
égaré dans une nature agitée (« Lust des Sturmnacht » / Joie d'une nuit de tempête), en proie à
la vigueur de rythmes farouches (« Wanderlust »/Chanson
de marche), et surtout la bouleversante douleur enfouie (« Stille Tränen »/ Larmes
silencieuses) ou les ineffables paroles du souvenir des temps heureux de
« Alte Laute »
(Vieux airs). Ce dernier Lied se referme sur un fil de voix et un piano qui
s'enfonce dans le silence. La salle, hypnotisée, retient son souffle avant de
laisser éclater une immense ovation, combien méritée à cette paire qui lui
a livré des moments d'exception.
Les fabuleuses sonorités du Chicago Symphony
Orchestra

Riccardo Muti dirige le Chicago Symphony
Orchestra / DR
Avant dernière étape de leur tournée
européenne, l'Orchestre Symphonique de Chicago et Riccardo Muti
faisaient étape à la salle Pleyel. Leur concert dominical réunissait
Tchaïkovski, Stravinsky et Schumann. Un constat s'impose quelle que soit
l'œuvre jouée : la fabuleuse sonorité d'une phalange qui passe pour la
meilleure outre- atlantique et se compare favorablement aux grands orchestres
européens : finesse digne des Viennois, en particulier dans les cordes,
homogénéité comparable à Berlin, éloquence des vents, de la classe du Concertgebouw. Et un sens de l'ensemble à couper le
souffle. Les trois pièces jouées permettent de juger de ces qualités, même si
les interprétations du chef italien restent parfois ancrées dans une certaine
tradition. La Fantaisie symphonique La Tempête, op. 18, de Tchaïkovski
s'inspire de Shakespeare, comme l'Ouverture-fantaisie Roméo et Juliette.
Le morceau, telle une petite symphonie, déroule plusieurs parties. L'élément
marin y occupe une place prépondérante dont la première section et l'épilogue,
décrivant un milieu ondoyant empli de mystère. La tempête proprement dite, fort
cuivrée, n'arrive qu'en troisième position, orage plus fantastique que
réellement menaçant. L'histoire du magicien Prospero
et de sa fille Miranda sur l'île magique où échoue le navire de Ferrando, trace les autres épisodes, plus lyriques.
L'apparition du monstre Caliban donne lieu à un court
scherzo agité. Muti nous fait découvrir combien cette
musique, finalement peu jouée, a d'attrait. Dans la suite de l'Oiseau de feu,
de 1919, il convoque la légende et ses effets de coloris. Cette deuxième Suite,
qui se concentre sur les moments clés du ballet, se veut démonstrative, plus
tournée vers Rimski-Korsakov qu'annonçant la modernité. Muti
joue le jeu à fond, poussant à leur paroxysme les contrastes de dynamique : de
l'extrêmement lent (introduction, berceuse) au forte somptueux (danse
infernale, finale). La Troisième symphonie de Schumann, dite Rhénane, connaît
une vision hyper romantique, très liée, où l'on ne rencontrera pas une once
d'anguleux. La flexibilité de l'orchestre et les couleurs des solos sont à leur
meilleur, qui ne cherchent pas le brillant flatteur de
certains orchestres nord-américains. Muti se délecte
des mélodies et rythmes rustiques, dans l'ample premier mouvement, où le beau
son s'enivre lui-même. Comment ne pas citer André Tubeuf,
à propos du maestro « c'est enivrés de leur propre son que les orchestres
se jettent, si l'on peut dire, dans ses bras » (Hommages. Portraits de
musiciens. Actes Sud ; voir ci infra). Le scherzo « modéré »
n'est pas sans rappeler les harmonies de Mendelssohn. Le Feierlich
est résolument grandiose, au fort climat de légende, et le finale allant, sans
précipitation, sera plus aristocratique que populaire. Une approche
foncièrement différente de la recherche historiquement informée d'un Rattle dans ses récentes exécutions, ou plus encore des
aspérités assumées d'un Harnoncourt. Tout ici est superbe et à cet aune, le résultat
est séduisant, emportant l'adhésion du public. En bis, l'Ouverture du Nabucco
de Verdi nous grise de tinta italienne on ne peut plus démonstrative
dans son hyper articulation et sa pulsation inextinguible.
Symphonies à deux clavecins

Skip Sempé
& Pierre Hantaï / DR
Dans le cadre intime de la salle Érard à
Paris, l'espace de deux concerts, le claveciniste Skip Sempé fêtait Rameau. Le
premier avait pour invité Pierre Hantaï et présentait un programme, déjà
peaufiné en 2011 pour la Cité de la musique et le disque (label Mirare : MIR 164), de pièces jouées à deux clavecins. Le
schéma peut surprendre, mais est conforme à une tradition française remontant à
Lully, pratiquée par François Couperin. Elle se perpétuera avec Claude Balbastre qui « accommodera » au clavecin des
pièces de l'auteur des Indes Galantes. Rameau lui-même en appelait à
l'arrangement pour clavecin des pièces symphoniques de ses opéras. Au
demeurant, ses Pièces de clavecin en concerts ont été écrites pour
clavecin et violon. Les jouer à deux
clavecins n'est donc pas déraisonnable. Les « Symphonies à deux
clavecins » imaginées par Sempé et Hantaï ne sont donc pas dépourvues de
bases historiques et de parfaite justification. Il s'agit en fait de pièces
instrumentales tirées des ouvrages lyriques de Rameau, à partir des Indes
Galantes et de ses airs et danses, les deux instruments fonctionnant comme
deux voix, l'une de dessus, l'autre de basse, donnant à ces pages tout leur
climat orchestral. Les deux dialoguent ou jouent à l'unisson, ou encore chacun
en soliste, l'autre assurant l'accompagnement. Le concert donnait à entendre,
en quatre parties, une succession de morceaux empruntés majoritairement aux
Indes Galantes, renforcée de pièces tirées d'autres tragédies lyriques ou
opéras ballets, tels que Les Fêtes d'Hébé, Platée, Les
Paladins, Dardanus, et Pygmalion,
elles-mêmes entrecoupées de quelques unes des Pièces de clavecin en concert.
Leur juxtaposition est aussi originale que savante, les enchaînements agréables
du point de vue harmonique, ménageant même des effets de surprise. Au-delà
d'une maîtrise phénoménale de leur instrument, l'entente entre les deux
interprètes est magique. Ils sont disposés, non face à face, mais l'un à côté
de l'autre, et ne se voient pas jouer. L'échange est pourtant sans ombre
aucune. Et on savoure cette enfilade de
morceaux où la noblesse le dispute à l'humour, ce que, rappelle Skip Sempé,
Rameau cherchait « séparément et conjointement ». Telle cette
« Indiscrète » dont la ligne
agitée confine à un babillage infernal. Ou ces « Tambourins » des Fêtes
d'Hébé, tourbillonnant allègres. Les grandes pièces, telle la Chaconne des
Indes Galantes, sont sous ces doigts de velours pures merveilles. Un bien
beau concert, parfaitement en situation dans l'acoustique feutrée mais
idéalement claire de cette salle mythique qui mérite d'être redécouverte.
Une soirée espagnole bridée dans son élan

Miloš / DR
L'attrait de cette soirée espagnole au
Théâtre des Champs-Elysées, dans le cadre des concerts de l'Orchestre de chambre
de Paris, résidait dans la prestation du guitariste Miloš
Karadaglić, dit Miloš.
De fait, le jeune monténégrain, formé à l'école de
Julian Bream, et désormais mascotte d'un major du
disque, a de la ressource. Sous ses doigts le Concerto d'Aranjuez de
Joaquín Rodrigo (1901-1999) trouve une saveur intime, largement favorisée par
l'écrin que lui fait le chef Roberto Forés Veses.
Cette pièce, créée en 1940, a vite assuré à son auteur la renommée
internationale, masquant peut-être le reste de sa production. Elle est
superbement conçue pour l'instrument soliste et ses mélodies se gravent
aisément dans la mémoire. Miloš ne cherche pas le
brillant dans l'allegro con spirito initial, mais
plutôt une coulée naturelle, aidée par la sage battue
du chef. L'adagio évite le pathos par une courbe d'une réelle intériorité,
agrégeant une douce nostalgie dans le dialogue de la guitare et du cor anglais,
une des pages mémorables de la partition. La cadence est tout sauf virtuose,
pensée. L'allegro gentile final, sur le rythme d'une
danse de cour, évite, là encore, le panache au profit d'une manière sage. Deux
bis archi célèbres du répertoire de l'instrument poursuivront cette félicité,
dont un avec orchestre. Cette partie concertante était précédée de l'Ouverture Les
Esclaves heureux de Juan de Arriaga. Ce musicien,
mort à vingt ans (1806-1826), quitta tôt son Bilbao natal pour Paris où il
recevra l'enseignement des grands de l'époque, Baillon
et Fétis. La pièce, plus italienne qu'espagnole, flattant les bois, se déploie
dans un esprit proche de Rossini. Le concert se terminait par Le Magistrat
et la Meunière, de Manuel de Falla, dans sa version originale pour
formation de chambre (1917). Et bien différente de celle remaniée, et plus
colorée, que de Falla concevra pour les Ballets russes de Diaghhilev,
où elle sera créée sous le titre du Tricorne, en 1919 par Ernest
Ansermet. Est-ce une raison pour faire de ce bijou de verve ibérique, plein
d'humour et de fraicheur, à l'image de son schéma de pantomime tirée d'une
farce du XIXeme, un morceau longuet et presque
ennuyeux. C'est ce à quoi aboutit une exécution bien trop sage pour entraîner,
sinon captiver, l'auditoire. A force de retenir son orchestre, le jeune chef
Forés Veses le bride dans ses élans et refuse à
l'auditeur ce sentiment d'abandon que contiennent tels fandango ou séguedille.
Sous le louable prétexte, sans doute, de conférer au mimodrame quelque
atmosphère, il étire tel autre passage (« la copla du coucou) au
point de le faire sonner curieusement léthargique. La pièce aligne, dès lors,
une mosaïque de séquences, certes agréables chacune en elle-même, mais
aucunement reliées entre elles par un fil conducteur ; sans parler d'une
péroraison tombant comme un anti climax. On aura cependant pu savourer la fine
sonorité des bois de l'Orchestre de chambre de Paris.
Musique des chapelles anglaises à Notre-Dame de Paris

Henri Chalet
/ DR
Après avoir assuré les fonctions de chef de
chœur assistant à la Maîtrise Notre-Dame de Paris, et de professeur d'écriture
et de direction de chœur, Henri Chalet vient d'être nommé chef de chœur
principal de la Maîtrise, succédant à Lionel Sow. La
formation de ce musicien est éloquente, qui le mena après ses diplômes du CNSMD
de Paris et de Lyon, à la direction du Jeune chœur de Paris au département
Supérieur pour jeunes chanteurs / CRR de Paris, puis directeur artistique de la
Maîtrise de Saint-Christophe de Javel, et assistant du chœur de l'Orchestre de
Paris. Il est par ailleurs organiste. Pour son premier concert dans ses
nouvelles fonctions à Notre-Dame de Paris, Henri Chalet a choisi d'illustrer la
riche tradition chorale anglaise. Le « Beata viscera »
de William Byrd, un des grands compositeurs Tudor, chanté a capella au fond du
chœur de la cathédrale, constitue une magnifique entrée en matière. Le fil
passe ensuite à Henry Purcell avec le bel hymne « O God
Thou Art My God », lui
aussi a capella. Avec John Stainer (1840-1901), qui
fut organiste, notamment à la Cathédrale Saint Paul de Londres à partir de
1872, on franchit une nouvelle étape pour entrer dans cet âge d'or que va
connaître le chant choral anglais au XIX ème siècle.
Son choral « I saw the Lord », avec le
soutien de l'orgue de chœur (Yves Castagnet), exprime
une joie éclatante. Un des grands tenants de cette tradition est Ralph
Vaughan-Williams (1872-1958) qui professait une grande religiosité. Se situant
dans l'héritage polyphonique de Byrd et de Thomas Tallis, l'écriture chorale
irrigue beaucoup de ses œuvres dont ses symphonies, comme la Première, A Sea Symphony, sans parler de
son grand œuvre opératique A Pilgrim's Progress.
De la Messe à double chœur en sol mineur, chantée a cappella, émane un
doux mélodisme d'où émergent les voix solistes, le
Gloria restant la section la plus agitée. Les Three
choral Hymns, de Pâques, de Noël et de Pentecôte,
introduisent de souples modulations et une belle sérénité. Benjamin
Britten livra aussi pour les chœurs des pages mémorables. Le « Jubilate Deo » (1962), repris d'un Te Deum de
1934, est glorieux, les voix à pleine puissance proclamant la louange du
Créateur jusqu'à un « Amen » brillant d'un éclat solaire. L'« Hymn to Saint Cecilia » op. 27, écrit en 1942, est
comme le remarque Xavier de Gaulle, « plus qu'un hymne, en fait une petite
cantate d'où ressort un parfum d'éternité naïve comme Britten savait si bien le
suggérer ». Trois parties le composent : après une invocation à la sainte,
d'une placide simplicité, vient un scherzo plus rapide et joyeux, qui laisse
place à une dernière séquence développée, aux harmonies complexes. Le concert
s'achevait par le grand hymne « Zadok the priest » de Haendel, qui
célèbre les grandes occasions Outre Manche. Au fil de ces pièces, la Maîtrise
Notre-Dame démontre ses éminentes qualités, et on admire la précision des
attaques, la ferme assise du registre des basses et une diction
particulièrement soignée.
Jean-Pierre Robert.
Leif Segerstram, un chef très atypique à la tête du
« National »

DR
Tout l'attrait de ce concert du
« National » résidait dans la présence au pupitre du chef finlandais
Leif Segestram. Personnalité pour le moins atypique,
chef d'orchestre, violoniste, pianiste et compositeur, auteur de 285
symphonies, sans parler des concertos pour violon, pour piano, de la musique de
chambre et autres œuvres vocales ! Un « look » de Père Noël,
ventre rebondi, démarche pesante, cheveux blancs et longs, barbe broussailleuse
et sourire aux lèvres…Une véritable apparition ! Une direction également
atypique dans la forme, puisqu'il dirige assis, et tout aussi originale dans le
fond, comme en témoignent la lecture et le choix des œuvres données ce soir. Francesca da Rimini de Tchaïkovski
ouvrait la soirée. Fantaisie symphonique d'après Dante composée en 1876, une
œuvre à programme inspirée par la gravure de Gustave Doré représentant
l'ouragan infernal illustrant le Chant V de l'Enfer. Une composition âpre aux harmonies grinçantes, chargée de
menaces, gémissante et hallucinée, chaotique, aux rythmes abruptes, entourant
une partie centrale lyrique, avant de sombrer de nouveau dans la tempête
conclusive. Une partition d'aspect lisztien que Segestram
interpréta de façon magistrale, parfaitement mise en place, faisant sonner
l'orchestre de manière très expressive. Vint ensuite la scène finale de Capriccio (1941) de Richard Strauss, chantée par la soprano irlandaise Orla Boylan, une prestation
vocale calamiteuse, rigide, forcée, monolithique, sans rien de la souplesse
nécessaire à cette longue mélodie straussienne crépusculaire chargée de
nostalgie. Sans parler d'un solo de cor nasillard à la limite de la justesse.
Bref, gardons le meilleur pour la fin, la Symphonie
n° 2 de Sibelius (1901) que tout le public attendait du fait de sa rareté
d'exécution en concert et de l'expertise du chef finlandais qui s'est fait,
depuis longtemps, le champion de l'œuvre sibelienne.
Là encore, l'atypie fut de mise avec une vision très analytique de la
partition, Leif Segestram privilégiant des tempi
retenus et une illustration minutieuse des différents plans sonores au
détriment de l'unité et de la tension de l'œuvre, d'où un aspect un peu
déroutant, discontinu et fragmentaire de l'interprétation qui ne retrouvera
toute son unité et sa tension que dans le mouvement final. Une lecture
originale, surprenante qui remporta un vif succès auprès du public et de
l'orchestre. Quoi demander de plus ?
Patrice Imbaud.
Youri TEMIRKANOV et le
Philharmonique de Saint-Pétersbourg : Retour aux sources !

DR
Passage annuel, désormais
rituel, au Théâtre des Champs-Elysées, de l'Orchestre Philharmonique de
Saint-Pétersbourg dirigé par son directeur musical, Youri Temirkanov.
Un des derniers représentants de la grande tradition russe, à la tête de
l'orchestre depuis 1988, date à laquelle il succéda à une autre légende de la
direction, le fameux Evgueny Mravinski. Mravinski, figure de légende qui grava dans les années
quatre vingts une intégrale des symphonies du fatum
de Tchaïkovski, qui fait encore référence de nos jours. Programme russe pour
orchestre russe et soliste russe. On oubliera rapidement la mauvaise prestation
du violoniste Vadim Repin dans le Concerto pour violon n° 2 de Prokofiev.
Une interprétation pour le moins hasardeuse, probablement due à une méforme
passagère : un son criard, un phrasé rigide, un jeu dépourvu d'émotion où
tout lyrisme était absent, notamment dans le deuxième mouvement, des décalages
fréquents avec l'orchestre, et une exécution parfois à la limite de la
justesse… Mais, le chef russe avait gardé le meilleur pour la fin, une Symphonie n° 6 dite
« Pathétique » de Tchaïkovski, dernier opus du compositeur russe
qui devait mourir quelques mois plus tard. Dernier volet de la trilogie du
fatum, composée en 1893, œuvre chérie du compositeur, se terminant sur un long
adagio, où les commentateurs ont voulu voir comme un adieu prémonitoire…Une
symphonie ambiguë, véritable tragédie musicale qui alterne lyrisme et
désolation, rythme de danse et lugubres appels des cuivres. Bon sang ne saurait
mentir, Temirkanov en donna une vision magnifique,
digne de son prédécesseur, comme un retour aux sources, associant qualité du
phrasé, choix pertinent des tempi, expressivité, magnificence orchestrale
bientôt recouverte par le voile funéraire des dernières mesures. Une
splendeur !
Patrice Imbaud.
Andrès Orozco-Estrada
sans emphase.

© Werner Kmetitsch
Un concert du « National » qui
valait par la rareté des œuvres présentées et par la présence au pupitre de la
nouvelle étoile sud américaine de la direction, Andrès
Orozco-Estrada. Formé en Europe, à Vienne notamment,
actuellement directeur musical du Houston Symphony
Orchestra et de l'Orchestre Symphonique de la Radio de Francfort, et très
prochainement nommé premier chef invité au London Philharmonic
Orchestra. Voilà donc pour le curriculum vitae déjà impressionnant du chef
jeune colombien, âgé de 37 ans dont chacune des apparitions au pupitre est vécue comme un évènement. Une direction sobre, précise,
efficace, intelligente et une grande complicité avec les musiciens, tout au
long des deux œuvres prévues au programme de cette soirée. La Symphonie n° 3 de Schubert, rarement
jouée, composée en 1815, œuvre de jeunesse écrite à l'âge de 18 ans, oscillant
entre classicisme finissant et romantisme naissant. Elle est faite toute de gaieté, et Orozco en livra
une interprétation brillante, pleine d'allant et de dynamisme. Puis une superbe Symphonie n° 2, dite « Lobgesang » (Chant de louange) de Felix Mendelssohn. Encore une rareté au concert où l'on privilégie
volontiers les symphonies suivantes, Écossaise, Italienne et Réformation.
Composée en 1840, il s'agit d'une symphonie-cantate, comprenant une symphonia instrumentale grandiose en trois mouvements, suivie d'une cantate, un chant de louange tiré des Écritures
Saintes. Le chef colombien en fit une narration quasi profane évitant tout
prosélytisme outrancier et tapageur, d'une foi conquérante, en préférant une
lecture sans emphase, parfaitement claire et équilibrée entre les différents
pupitres, cordes, bois et cuivres, trouvant en permanence le ton juste dans cet
imposant effectif, entre le Chœur de Radio France, excellent, et les chanteurs
solistes d'une grande qualité vocale : Christiane Karg
et Carolina Ulrich, sopranos, et Maximilian Schmitt, ténor. Une belle
soirée !
Patrice Imbaud.
Daniil Trifonov:
brillantissime !

DR
Foule des grands soirs avenue Montaigne
pour ce récital du jeune prodige russe du piano, Daniil
Trifonov. Vingt trois ans, un physique juvénile, mais
un talent qui n'attend pas le nombre des années. Lauréat des plus grands
concours internationaux (Concours Scriabine à Moscou en 2008, Chopin en 2010,
Rubinstein en 2011 à Tel Aviv et Tchaïkovski en
2011), menant une carrière fulgurante depuis, reconnu par les musiciens les
plus réputés dont Martha Argerich ou Valery Gergiev, sous
contrat avec le label à l'étiquette jaune (DG), jouant dans les salles
mythiques de New York, Londres, Amsterdam, Berlin, Vienne, Tokyo, Paris,
accompagné des plus prestigieuses phalanges et s'annonçant probablement comme
LE pianiste du XXIe siècle ! Un récital dans le cadre des « Grands
Solistes » attendu du public parisien, dans un programme Bach, Beethoven
et Liszt. En ouverture de récital, la Fantaisie
et Fugue en sol mineur, BWV 542 pour orgue, transcrite pour piano par
Liszt. Un œuvre menée avec une maitrise étonnante, de façon grandiose mais sans grandiloquence, très articulée,
très contrastée entre les deux mouvements où l'énergie lumineuse de la Fugue triomphe finalement de la
tentation du désespoir énoncée dans la Fantaisie
qui porte en filigrane le deuil de la première épouse de Bach, Maria Barbara,
décédée quelques mois auparavant. Vint ensuite la Sonate n° 32, Op 111 de Beethoven, l'adieu de Beethoven à la sonate
selon Thomas Mann, composée entre 1820 et 1822. Une sonate visionnaire, très
difficile pianistiquement, en deux mouvements, une
ambiance dramatique et tumultueuse dans le premier mouvement auquel succède en
définitive un sentiment de paix dans l'Arietta
conclusive. Daniil Trifonov
en fit une narration sobre, magistrale, toute intériorisée, sans aucune
théâtralité, toute au service de l'œuvre. En deuxième partie de soirée, un
exceptionnel défi physique et musical, les Douze
études d'exécution transcendante de Liszt, composées entre 1826 et 1851. Un
moment magique, un moment d'exception, un moment d'éternité où le temps suspend
son vol, une prestation tout à fait exceptionnelle, le pianiste russe faisant
corps avec son instrument, ici le dos droit dans les forte quand le piano se
fait véhément, ailleurs la tête couchée sur le clavier pour un intime murmure
aux touches. Un jeu puissant, clair dans le toucher et juste dans le ton, un pianisme hors du commun, sobre, efficace où le pianiste
tout entier devient musique. Une œuvre qui dépasse de beaucoup toute
préoccupation didactique pour réaliser un véritable feu d'artifice de couleurs
et de rythmes dans une surprenante synthèse des possibilités expressives du
piano. Un œuvre d'exception pour un pianiste d'exception. Un moment rare !
Un triomphe.
Patrice Imbaud.
David Zinman : De l'ombre à la
lumière

DR
La venue du chef américain à la tête de
l'Orchestre de Paris est toujours un évènement attendu ; preuve en est, une
salle Pleyel bondée comme en ses plus belles soirées. Un public très jeune
probablement attiré par la personnalité du soliste de ce soir, le
violoncelliste Gautier Capuçon. Un programme
audacieux se situant loin des sentiers battus, ardu, tout sauf grand public,
puisque comprenant la difficile et discutée Symphonie
pour violoncelle de Benjamin Britten associée à l'Ouverture de Benvenuto Cellini de Berlioz et à la Symphonie n° 3 dite « Rhénane »
de Robert Schumann. Après quelques mesures hasardeuses et une entrée de la
flûte solo légèrement contestable, David Zinman prit
rapidement la mesure de l'œuvre de Berlioz, l'Ouverture de l'opéra Benvenuto Cellini (1838), seule pièce
qui parvint à résister à la déroute de sa création à Paris. Une étincelante
pièce d'orchestre qui parut parfois un peu brouillonne dans sa réalisation.
Quelque peu brouillon au départ, le concert se poursuivit par la musique
chaotique de Benjamin Britten. Une Symphonie
pour violoncelle, écrite pour Mtistlav
Rostropovitch en 1963, qui ne paraît pas être la meilleure œuvre du compositeur
britannique. Contestée sinon contestable, David Zinman
en fit une lecture d'une étonnante clarté s'appliquant à mettre en avant tous
les timbres de l'orchestre, jardin aride au milieu duquel le chant chaotique du
violoncelle tentait de se faire entendre. Un premier mouvement comme une sorte
d'aphasie verbale, une impossibilité de dire, où l'on retiendra toutefois le
superbe chant de la clarinette de Pascal Moragues
associé aux pizzicati du violoncelle. Un deuxième mouvement plus lyrique
annonçant la libération finale de l'instrument soliste. Une œuvre contestable
mais une réalisation musicale qui ne le fut pas, Gautier Capuçon
faisant merveilleusement sonner son Matteo Goffriler
de 1701. En deuxième partie de soirée, un classique dont le succès jamais ne se
démentit, la Symphonie n° 3 de Schumann,
composée en 1850, que le chef américain interpréta de façon magnifiquement
lumineuse, pleine de nuances et d'allant. On retiendra un quatrième mouvement
d'une solennité exceptionnelle, presque
funèbre, déjà comme une résurgence au milieu de toute cette joie, de la maladie
qui l'anéantira dans les années suivantes.
Patrice Imbaud.
Un banquet vraiment céleste

Damien
Guillon/Photo CTK
Le Banquet Céleste réunit depuis 2009 un
ensemble de musiciens solistes autour du contre-ténor Damien Guillon. Ce
chanteur a étudié au sein de la Maîtrise du Centre de Musique Baroque de
Versailles, puis est admis, en 2004, au sein de la Scola Cantorum
Basiliensis. Il se produit régulièrement sous la
direction de nombreux chefs d'orchestre tels que Christie, Savall,
Herreweghe, Rousset… et a pris part à plusieurs productions scéniques d'opéras
baroques. Les œuvres inscrites au programme de cette soirée d'ouverture de la
saison des concerts à l'Auditorium du Musée d'Orsay, dans le cadre du cycle
« Back to Bach » ont été écrites à des époques différentes de la vie
du Cantor. La cantate BWV 4 s'appuie sur un poème du XIème siècle, qui traite
du passage de l'obscurité vers la lumière. La tonalité est en mi mineur, la
tonalité « triste et désolée ». La cantate BWV 132 est destinée à préparer
la venue du Messie. Elle est réduite à quatre voix et cinq instruments, une
sorte de cantate de chambre. La cantate BWV 153 est destinée au premier jour de
l'an et décrit le massacre des innocents. La cantate BWV 156 est une méditation
sur la foi. La présence du hautbois concertant place l'ensemble sous le signe
du dialogue. Enfin, la cantate BWV 159 ne comporte ni chœur, ni ouverture, ni
même aria da capo. Le point culminant est atteint lors de l'air de la basse
avec hautbois. Le texte commente la dernière des sept paroles du Christ en
croix. La musique sonne alors comme un adieu au monde. Le quatuor des voix est
à la hauteur des œuvres interprétées, avec un petit plus pour la soprano Céline
Scheen. Mais il y a une grande homogénéité dans Le
Banquet Céleste. Le hautbois de Patrick Beaugiraud
a une importance capitale dans plusieurs des pièces, dont l'ouverture
magnifique de la cantate BWV 156. Cet hautboïste n'est
plus à présenter tant il participe à de nombreux orchestres de musique baroque
et accompagne de célèbres chanteurs. On pourrait aussi bien citer Julien Debordes au basson que Kevin Manent à l'orgue et au clavecin,
ou encore Baptiste Lopez au violon. On a pu aussi apprécier la belle sonorité
du violoncelle de Ageet Zweistra qui souvent accompagne seule les chanteurs. Pour
l'ouverture de la saison « Back to Bach », Luc Bouniol-Laffont
et la programmatrice musicale Sandra Bernhard ont mis la barre très haute.
Les Variations Goldberg transcrites pour trio à cordes

DR
Le Trio Goldberg, constitué de musiciens de
l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, a donné à l'auditorium du musée
d'Orsay la transcription pour trio à cordes, due à Dmitry
Sitkovetski, des Variations Goldberg BWV 988
de J.S. Bach. Ces variations seraient un soi-disant hommage de Bach à son
élève, le claveciniste virtuose Johann Gottfried Goldberg, mort à trente ans.
Elles n'ont reçu le nom de Goldberg qu'au XIXème siècle. Le Comte Hermann Carl von Keyserling, qui avait à son service le claveciniste,
serait à l'origine de la commande de ces variations. Goldberg les aurait donc
interprétées pour distraire son maître. Qu'importe, de par sa construction
géométrique, sa sophistication, sa fantaisie inventive, son sens du contraste,
cette série de variations est une œuvre majeure, exceptionnelle, du répertoire.
La transcription de Dmitry Sitkovetski
(1985) est d'abord un hommage au compositeur pour le 300ème
anniversaire de sa naissance, mais aussi au pianiste Glenn Gould, mort en 1982,
un an après avoir gravé sa seconde version de cette œuvre emblématique.
Violoniste, Sitkovetski, par cette transcription,
offrait aux autres instrumentistes à cordes la possibilité de jouer cette œuvre
inaccessible. Une manière de la faire entendre autrement. Mais, contrairement à
une tradition du XIXème siècle, il n'a pas ajouté des voix, ni enrichi
l'harmonie. Il a été très respectueux de l'œuvre ajoutant quelques articulations,
ornements, doublures et pizzicatos. Tout tient en fait dans la manière dont les
interprètes ont envie de les jouer. Le Trio Goldberg a fait sonner cette
transcription de manière baroque, comme une œuvre originale de Bach, sans
romantisme, en faisant ressortir ce que ces variations ont de métaphysique.
Cette interprétation austère, avec ses canons simples, à deux voix, cette
construction subtile, jouée par un trio très en place, demandait une attention
soutenue que le public a accordée, même si quelques auditeurs s'enfonçaient
dans une douce torpeur à l'écoute de certaines variations. Mais la 28ème
avec son tempo infernal, juste avant la reprise de l'Aria, éblouissante de
tenue, de justesse, réveilla tout l'auditoire. Les trois artistes du Trio Goldberg,
Liza Kerob, violon, Cyrille Mercier, alto, et Thierry
Amadi, violoncelle, lauréats de CNSMD de Paris font
honneur à ce conservatoire. Ils ont enregistré ces variations et il serait
intéressant de les entendre dans les trios du répertoire.
Le récital « Saint Petersburg » de Cecilia Bartoli

DR
Quand Cecilia Bartoli,
« déguisée » en Princesse des Neiges, est entrée sur la scène du
Théâtre des Champs-Elysées, avec sa traîne, le public était déjà conquis,
criant déjà bravo. Hélas, ce n'était pas Christian Gasc
qui l'avait habillée, comme il l'avait magnifiquement fait pour le beau film
tourné au Château de Versailles à propos de la sortie de l'album
« Mission » et des œuvres de Agostino Steffani. On était au Théâtre des Champs Elysées plutôt
chez Walt Disney, avec une robe signée pourtant du célèbre Agostino Cavalca ! Diego Fasolis et
l'ensemble I Barocchisti avaient annoncé en fanfare
l'arrivée de la chanteuse avec une Marche de Hermann Raupach.
Le Programme « Saint Petersburg » pouvait commencer. Mis à part Nicola Porpora, Cecilia Bartoli chanta des œuvres que le
public ne connaissait pas. Musicologue avertie, Bartoli était allée chercher
des partitions de maîtres italiens à la cour des Tsarines de Russie. Elle donna
en première partie quatre airs. La voix était en place, avec plus de grave que
d'habitude, et les arias étaient ma non troppo. C'est l'orchestre qui, dans cette première partie -
ainsi que dans la deuxième - jouait allegro. De Raupach,
elle chanta un air en russe qui séduisit l'assistance. L'entracte arriva très
vite après encore une œuvre du même Raupach qu'elle
chanta un poco vivace. Osons le dire, on était loin des feux d'artifice
auxquels nous avait habitués la diva. Après un long entracte, la deuxième
partie commença avec une Sinfonia d'un certain
Domenico Dall'Oglio, très entraînante. Cecilia
Bartoli arriva dans une nouvelle tenue bleutée tout aussi chamarrée de strass.
Est-ce le froid, la deuxième partie fut aussi calme que la première, bien en
place, admirablement chantée, impeccable. Les compositeurs avaient noms plus
connus, Porpora, Hasse, Manfredini. Diego Fasolis et I Barocchisti avaient
la super pêche pour réchauffer l'atmosphère, certains solistes venant au devant
de la scène faire le duo avec la diva. En guise de remerciement ils avaient
droit à de gros bisous. La deuxième partie terminée, aussi courte que la
première, le public était content ; le bouquet de fleurs offert, la promotion
pour l'album « St Petersburg » était remplie.
Mais Cecilia Bartoli est imprévisible ! Elle revint alors et commença une
troisième mi-temps ! Et là, elle se déchaîna pendant une bonne demie heure avec Vivaldi, Haendel… Elle s'amusa même à se
mesurer avec le trompettiste pour savoir qui de lui ou d'elle allait le mieux improviser. La Bartoli se réveilla enfin, la neige fondit et
le soleil sortit de sa gorge. Délire dans la salle : le public était debout
comme celui de Bercy ou du Zénith ! On avait retrouvé La Bartoli qu'on
aimait. Ce 7 novembre, c'est à 22h qu'elle a mis le feu à la salle comme elle
sait le faire depuis vingt ans. Puis elle est sortie sous les acclamations…
L'orchestre a fait son bis et puis…elle est revenue encore sur scène, en
chapka, fausse zibeline et manchon – la tenue de la couverture du disque -,
qu'elle jeta en direction de Fasolis, et tout en se
moquant d'elle-même, partit dans des vocalises dont elle seule a le secret.
Divine Cecilia, elle nous surprendra toujours !
Stéphane
Loison.
***
L'EDITION MUSICALE
ORGUE
Johann Jakob
FROBERGER : Neue Ausgabe sämtlicher
Werke Volume 2. Urtext. Bärenreiter : BA 9212.
Il est bien agréable de
pouvoir bénéficier de cette remarquable édition des œuvres complètes de Johann
Jakob Froberger. On lira avec beaucoup d'intérêt la préface de Siegbert Rampe, extrêmement complète. Elle comporte un
examen très détaillé des sources, dont certaines sont nouvelles, un commentaire
sur chacune des œuvres, et des indications d'interprétation. Le texte lui-même
est à la fois extrêmement précis et fidèle, en même temps que tout à fait
lisible et directement utilisable pour une interprétation commode.

Olivier
SCHMITT : Introduction, Variations
et Finale sur « La Légende de Saint Nicolas » pour orgue. Delatour :
DLT2323.
Destinée à un important
instrument symphonique, cette pièce est un hommage aux grandes improvisations
de Pierre Cochereau dont elle reprend certains éléments formels et
stylistiques. Le thème en est, bien sûr, celui de la célèbre chanson des trois
petits enfants. L'auteur joue sur toutes les possibilités de l'instrument. Il
se garde de donner des indications trop précises de registration : à
chacun de trouver en fonction de son instrument et du vaisseau dans lequel
celui-ci se trouve la juste mesure… Cette œuvre est en tout cas bien exaltante
et séduisante.
PIANO
Christine MARTY-LEJON : Fjords pour
piano. Cycle
2. Soldano : ES 664.
Ce qui caractérise les
œuvres de Christine Marty-Lejon, c'est qu'elles sont
d'abord de l'excellente musique. L'auteur, tout en ayant un langage bien à
elle, sait rendre les différentes ambiances, se couler dans des styles très
divers. Il est toujours très agréable de découvrir ses nouvelles œuvres. Il en
est ainsi pour ces Fjords aux
atmosphères changeantes qu'on aura également plaisir à écouter intégralement
sur le site de l'éditeur.

Christine
MARTY-LEJON – Jean-Claude SOLDANO : Sous la pluie pour piano. Fin de 1er, début de 2nd
cycle. Soldano : ES 610.
C'est donc une
collaboration qui a donné naissance à cette pièce en forme de valse début de
siècle (le XX°, naturellement…). Aux qualités musicales s'ajoute un brin
d'humour qu'il sera intéressant de faire sentir aux élèves. Cette pièce se
décline par ailleurs en de nombreuses versions : piano à quatre mains, hautbois
et piano, clarinette et piano, violon et piano… Elle pourra donc donner lieu à
des compétitions ou collaborations parmi les jeunes instrumentistes ! On
peut également l'entendre sur le site de l'éditeur.

Matthieu
STEFANELLI : 5 Exordes pour
piano. Delatour : DLT2349. Pour piano à 4
mains : DLT2346.
Cette œuvre se décline
donc en deux versions : pour piano solo et pour piano à quatre mains. Il
s'agit bien de la même œuvre. On lira en quatrième de couverture ou sur le site
de l'éditeur la présentation que l'auteur fait lui-même de son œuvre. Si on
ajoute que ces cinq pièces sont chacune un hommage à un compositeur (Olivier
Messiaen, Philippe Hersant, Alfred Schnittke et
Magnus Lindberg) on aura une idée du caractère
général de ces œuvres.


Claude
DEBUSSY : Prélude à l'après-midi
d'un faune. Transcription pour piano à quatre mains par Bruno Rossignol. Delatour : DLT2384.
Saluons une nouvelle
production dans cette collection des « Grandes Transcriptions ».
Grâce au « métier » de Bruno Rossignol, cette transcription est tout
à fait convaincante. Inutile de préciser cependant qu'elle ne s'adresse pas à
des débutants ! Aux pianistes d'utiliser au mieux ce travail pour
retrouver sur leur instrument toute la palette sonore de l'orchestre de
Debussy, et ce ne sera pas une tâche facile…

Alireza MASHAYEKHI : Avec Debussy
pour piano. Op. 162 n°2. Delatour :
DLT2314.
Nous avons rendu compte
dans notre lettre de novembre de Avec Chopin du
même auteur. Le propos est le même : instaurer un dialogue des cultures et
des traditions en reprenant certains extraits d'œuvres de Debussy et en les
faisant dialoguer ou en les développant avec la tradition iranienne et son
propre langage. L'auteur s'est ainsi fait le champion du multiculturalisme.

Alireza MASHAYEKHI. Op. 162. Franz SCHUBERT.
Op 90 n°4 : Impromptu (Une solitude
heureuse) pour piano. Delatour : DLT2316.
De l'évocation à la longue
citation en passant par la réécriture, l'impromptu de Schubert est omniprésent
dans cette œuvre atypique écrite dans le même esprit que la précédente. On
pourra l'écouter intégralement sur le site de l'éditeur.

Pierre-Richard
DESHAYS : Distraction pour piano. Elémentaire. Lafitan : P.L.2730.
Cette charmante distraction dédiée à une élève qu'on
souhaite aussi charmante comporte deux parties. D'abord se déroule une jolie
mélodie en la mineur de style assez classique ; puis une partie plus jazzy
en sol mineur lui succède, à interpréter en « ternaire ». L'ensemble
est fort agréable et plein d'intérêt.

Célino BRATTI : Le portrait de Laetitia pour
piano. Elémentaire. Lafitan : P.L.2788.
Cette Laetitia est pleine
de légèreté et de grâce. Deux aspects se succèdent : une partie plus
insouciante marquée par de jolies gammes descendantes à laquelle succède
un passage plus lyrique et plus mouvementé. Le da capo nous ramène enfin dans
l'ambiance primitive. Gageons que les élèves trouveront beaucoup de plaisir à
brosser ce joli portrait.

André
TELMAN : Dans l'aire de transit pour piano. Débutant. Lafitan :
P.L.2805.
Voici une pièce bien
intéressante. Si le titre est un peu mystérieux, l'œuvre est attachante :
la place des résonnances est primordiale, l'emploi de la pédale
indispensable ! On pourra faire écouter et goûter les différentes
ambiances sonores qui se succèdent de mesure en mesure grâce aux sons qui
s'ajoutent et se nourrissent les uns des autres. Cette aire de transit peut
être l'occasion d'une vraie découverte de l'essence même de la musique.

Gualtiero DAZZI : Tombeau de Claudio Abbado. Piano
solo. Dhalmann : FD0437.
Cette pièce difficile a
été écrite par G. Dazzi quelques jours après la mort
de Claudio Abbado qu'il a connu dans sa jeunesse et auquel il voue une grande
admiration. Il s'agit d'une « pièce en forme d'étude qui, compte tenu des
difficultés techniques qu'elle comporte, peut être inscrite dans un cursus
d'apprentissage à un niveau avancé (début 3ème cycle). ».
L'auteur présente lui-même sa pièce dans une introduction limpide qui donne en
même temps les indications d'exécution et la manière de préparer le piano.

ACCORDEON
Fabrice
TOUCHARD : Swing en Aquitaine. Pièce pour accordéon. Troisième cycle. Lafitan : P.L.2713.
Voici une jolie pièce à la
fois parfaitement écrite pour l'instrument – l'auteur est orfèvre en la matière
– et d'un charme et d'une fantaisie de bon loi. Le « trio » est
particulièrement bienvenu avec comme un parfum de fanfare provinciale. Bref, il
y a de quoi réjouir professeur, élève et auditeurs…

Jean-Michel
TROTOUX : Le bon itinéraire. Pièce pour accordéon. Débutant. Lafitan : P.L.2782.
Cette pièce entrainante
mettra, n'en doutons pas, les jeunes accordéonistes sur le bon chemin. Et quel
meilleur chemin que de leur proposer un thème harmonisé avec les « bons
degrés », comportant une petite escapade sur sol mineur et ré mineur pour
revenir sagement au Fa Majeur initial. On souhaiterait que les jeunes pianistes
reçoivent dès le berceau cette même formation…

HARPE
Michelle
VILLAUME : Bleuets. Deux pièces
pour harpe. Deuxième cycle. Sempre più : SP0117.
Il y a beaucoup de délicatesse
et de charme dans ces Bleuets. La
première pièce, « Printemps », est pleine d'allant tout en gardant un
caractère un peu mélancolique. Ses nombreuses modulations mettront à
contribution l'habileté de la harpiste à manier les pédales. La deuxième,
« Recuerdo » comporte un début et une fin à
2/4 également mouvementées tandis qu'une large phrase à trois temps s'épanouit
dans la partie médiane. Le tout s'écoute avec grand plaisir.

Michelle
VUILLAUME : Vagabondages. Quatre pièces pour harpe ou harpe celtique.
1er cycle. Sempre più : SP0116.
Chacune des pièces se
déroule dans une ambiance bien caractérisée, en particulier la charmante
sicilienne qui devrait avoir un grand succès. Les limites imposées par la harpe
celtique ne nuisent en rien à la délicatesse des harmonies et l'ensemble
permettra aux jeunes harpistes de montrer toute leur sensibilité et toute leur
musicalité.

GUITARE
Laurent
MÉNERET : Cordes sur ciel pour
guitare. 2ème cycle. Sempre più :
SP0109.
« Cordes sur ciel est
une allusion poétique sous forme de recueil de quatre pièces qui m'a été
inspirée lors d'un séjour dans cette charmante ville médiévale (Cordes sur
Ciel) située dans le Tarn. Au travers de ces morceaux progressifs aux styles
variés, je dépeins musicalement certaines images, ambiances et personnages que
j'ai pu rencontrer. » Qu'ajouter à cette présentation de l'auteur sinon
que les interprètes gagneront à voir la vidéo d'extraits enregistrés par
l'auteur sur YouTube, et à aller voir sur internet
toutes les photographies de cette charmante cité.

Alain
LENGLET : Cippora pièce
pour guitare. Elémentaire. Lafitan : P.L.2723.
L'auteur dédie cette
charmante valse à sa fille dont le nom biblique (petit oiseau) correspond bien
au caractère charmant et léger de cette jolie pièce qui porte en exergue cette
belle citation de Pablo Casals : « La musique chasse la haine de ceux
qui sont sans amour ». C'est un très beau programme auquel contribuera
certainement cette œuvre.

Sébastien
LLINARES : Trois bagatelles pour guitare. 2ème – 3ème
cycles. Sempre più : SP0108.
Ces trois bagatelles ne
manquent ni d'originalité ni d'intérêt. L'auteur sait fort bien créer des
ambiances, suggérer des paysages, des états d'âme. Même si elles sont destinées
à des élèves, ces bagatelles peuvent très bien s'intégrer à un récital. Il
faudra suivre de près les prochaines œuvres de ce jeune guitariste et
compositeur.
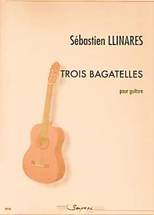
VIOLON
WERNER
/ CASTÉRÈDE / MARGONI / CHAYNES : Quatre
pièces « In memoriam André David »
pour violon seul. Delatour : DLT2407.
Quatre compositeurs ont
décidé d'honorer la mémoire de leur ami André David, mort en 2007. Le recueil
comprend une Elégie de Jean-Jacques
Werner, Asclépios-Orphée d'Alain Margoni, In memoriam
André David de Jacques Castérède et Autour d'une mélopée de Charles Chaynes. Bien que l'ensemble s'apparente à une Suite,
chaque pièce peut être interprétée séparément. On y retrouve, bien sûr, la
personnalité de chacun des auteurs, mais l'unité reste grande entre ces pièces.
Souhaitons une grande diffusion à ces œuvres qui ne comportent pas de
difficultés insurmontables.

Robert
WAECHTER : 24 études pour violon. Volume
2. Pour violon seul ou avec accompagnement. Difficile. Dhalmann :
FD0395.
Nous avons rendu compte
dans la lettre 69 d'avril 2013 du premier volume de ces études. Comme le dit
l'auteur, la deuxième voix est à improviser selon certains critères et par
n'importe quel instrument. Les indications d'interprétation sont également
données. Le rythme en est volontairement difficile et sera à respecter
scrupuleusement. Chaque étude porte un titre qui suggère une ambiance, souvent
avec une pointe d'ironie ou d'humour…

CONTREBASSE
Christophe
PICOT : La poule qui barbote dans sa
baignoire pour contrebasse et piano.
Fin 1er cycle. Sempre più : SP0084.
Ecrite dans une tonalité
flottante et avec des rythmes exprimant bien à la fois la poule qui picore et
barbote, cette pièce pittoresque utilise avec humour les différents registres
de la contrebasse. Les jeunes interprètes devraient y trouver beaucoup de
plaisir.

FLÛTE
Wilhelm
POPP (1828 – 1903) : Idylle tzigane pour
flûte et piano. Restitution Philippe Lesgourgues. 2ème
cycle. Sempre più : SP0124.
L'auteur, grand flûtiste
allemand, a surtout écrit pour son instrument. Cette idylle est-elle vraiment
tzigane ? Peu importe. C'est une « pièce de genre » qui
permettra à son jeune interprète de faire montre de la sûreté de sa technique
car, pour amusante qu'elle soit, elle est loin d'être facile.

Bernard
de VIENNE : Vignette IX Duo de flûtes. Moyenne difficulté. Dhalmann : FD0452.
Cette Vignette est une sorte de miniature
mettant en jeu tous les paramètres du son et la manière de les obtenir :
la palette de timbres va du son pur au bruit en passant par toutes les
recherches acoustiques possibles. La partition est précédée par une explication
précise qui permettra de tirer le meilleur parti de cette expérience sonore et
de l'affinement de l'audition qu'elle procure.

CLARINETTE
Jacky
THEROND : Rédièse 12 pour clarinette sib seule. Elémentaire. Lafitan : P.L.2942.
Pourquoi ce titre sinon
pour signaler une présence dominante du ré dièse et un chromatisme
affirmé ? Le clarinettiste a la réputation de ne pas aimer les dièses.
Ici, les élèves seront servis : aucun bémol en vue ! Mais
attention : il ne s'agit pas d'un simple procédé d'écriture. Il n'y a rien
de scolaire ou d'ennuyeux dans cette œuvre qui est d'abord de la vraie et bonne
musique qui fait appel autant à la virtuosité qu'à la sensibilité de
l'instrumentiste. Oublions donc le procédé et laissons-nous charmer par cette
pièce aux aspects variés, et pleine de vie.

SAXOPHONE
Frédéric
LEDROIT : Chercheurs d'or opus 46 pour saxophone alto et orgue. Delatour : DLT2161.
De cet assemblage peu
conventionnel qu'il a pratiqué, l'auteur tire une œuvre variée, intéressante et
qui entretient un véritable dialogue entre les deux instruments. L'orgue sera
un « trois claviers pédalier» riche en anches et en mutations. Le
titre constitue une allusion au travail du compositeur, véritable découvreur de
sonorités nouvelles. On y retrouve le langage si personnel de ce musicien très
attachant.
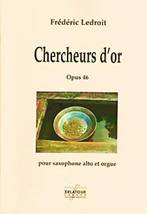
BASSON
Frédéric
LEDROIT : Strate op.52 pour basson et orgue. Delatour : DLT2149.
On lira avec beaucoup
d'intérêt sur le site de l'éditeur la présentation très objective que l'auteur
fait de son œuvre. Celle-ci est née d'une double constatation : basson et
orgue « sonnent » très bien ensemble et, à part les transcriptions,
il n'existe pas de répertoire pour cet assemblage. Ecrite pour un instrument
moyen à deux claviers et pédalier, cette pièce ne réduit pas l'orgue, comme le
dit avec humour l'auteur, à un simple bourdon de 8' ! Faisant appel à
toutes les ressources de couleur des deux instruments, cette œuvre est pleine
de charme, de vie, en un mot, de musique.

TROMPETTE
André
TELMAN : Sur un itinéraire
improbable pour trompette seule en
ut (ou sib). Moyen. Lafitan : P.L.2687.
Cette commande du concours
international de trompette de Markneukirchen
(Allemagne) 2014 ne manque pas effectivement de surprises. Si l'interprète y est
invité à faire montre de virtuosité, ce n'est cependant pas aux dépens de
l'expression et du lyrisme. Pour être improbable, cet itinéraire ne manque
pourtant pas de charme, bien au contraire !

Yves
BOUILLOT : Waltzing pour
trompette ou cornet ou bugle et piano. Débutant. Lafitan :
P.L.2631.
Le titre même de l'œuvre
augure d'une valse un peu déjantée. Si le trompettiste peut être débutant, le
pianiste devra, lui, être nettement plus aguerri ! Après une entrée en
fanfare à quatre temps, le trois temps s'installe pour une valse souvent
endiablée. Le tout jeune trompettiste, bien soutenu par son partenaire devrait
prendre beaucoup de plaisir à ce morceau entrainant.

TROMBONE
Claude-Henry
JOUBERT : Les oies du
capitaine. Une enquête du
commissaire Léonard avec accompagnement du professeur. Fin du 1er
cycle. Lafitan : P.L.2803.
Le « mode
d'emploi » de cette partition est indispensable à une bonne mise en œuvre.
En effet, élève et professeur sont confrontés à deux improvisations au cours de
ce morceau, ou plutôt à deux compositions. C.-H. Joubert nous rappelle que
« Composer n'est pas une activité réservée aux adultes savants. Le mot
« composer » vient du latin cum-ponere, « poser avec ». On peut composer un
menu ou un bouquet. Le compositeur de musique ne « crée » pas, il
dispose, à sa façon, les éléments d'un matériau sonore existant. » Outre
l'humour de l'histoire et des thèmes proposés, on retiendra le côté
« ouvert » de l'œuvre puisque la solution de l'énigme est laissée aux
interprètes… On pourra bien sûr mettre en scène ces « Oies du
capitaine » !

MUSIQUE
DE CHAMBRE
Antonin
SERVIÈRE : Inconstances pour hautbois (ou flûte) et clavecin. Delatour : DLT2335.
Même si l'œuvre revendique
de s'inspirer des codes et de l'esprit de la musique baroque, la présence du
clavecin ne doit pas faire illusion : il s'agit d'une œuvre tout à fait
contemporaine, demandant un clavecin à deux claviers et faisant appel à toutes
les techniques actuelles tant du clavecin que de la flûte ou du hautbois. Cette
œuvre difficile n'en est pas moins fort intéressante.

Antonin
SERVIÈRE : D'après « Dans la
nuit ». Quintette pour
clarinette, violon, violoncelle, percussions et piano. Delatour :
DLT2332.
Il s'agit d'une réécriture
d'une pièce pour orchestre intitulée Dans
la nuit. Voilà pourquoi l'auteur propose en sous-titre : « ou Dans la nuit d'après ? ». Le
tout est inspiré du poème éponyme d'Henri Michaux. L'œuvre, très expressive,
passe par des phases d'agitation suivies de moments méditatifs. L'ensemble est
dense et comporte de nombreux changements de caractère et de sonorités.

ORATORIO
BACH : Himmelfahrts-Oratorium BWV 11. Bärenreiter Urtext :
TP 1011 – BA 1011-90.
Oratorio ou cantate ?
On
peut se poser la question et la préface aborde ce problème. Composé pour la
fête de l'Ascension à Leipzig en 1735, ce court oratorio se caractérise par une
orchestration très colorée, tout à fait conforme à l'aspect triomphant de la
fête. Les éditions Bärenreiter nous proposent
partition de poche, conducteur et matériel d'orchestre et les parties vocales
avec réduction au piano, le tout avec la qualité habituelle. L'ensemble est précédé par une courte mais substantielle préface
d'Andréas Glöckner.


Daniel
Blackstone.
***
LE COIN BIBLIOGRAPHIQUE
Jean-Philippe GUYE (textes réunis et introduits par) : L'enseignement de la
culture musicale. Pratiques et innovations. Sampzon,
DELATOUR FRANCE (www.editions-delatour.com), 2014, BDT0002, 326 p. - 29 €.
Préfacé par Alain
Poirier, directeur de la recherche au CNSMD de Lyon, ce volume regroupe les
communications présentées par treize auteurs d'horizons divers, lors des
journées professionnelles organisées par l'Association des Professeurs de
Culture Musicale (APCM), à Paris en 2012. Dans la conception actuelle,
« la culture musicale recouvre l'ensemble des disciplines — histoire,
analyse, esthétique… — qui donnent sens aux pratiques des musiciens, amateurs
comme professionnels : écoute, interprétation, création ». En tant
que discipline, elle a été lancée vers 1980. Complément obligatoire pour le DEM
et le CFEM avec pour motif conducteur : entendre, comprendre et pratiquer,
elle est donc indissociable de la pratique instrumentale et collective
impliquant formation, culture, analyse, création et cadre historique. Ce livre
tient compte des nouveaux métiers de la musique faisant appel à l'ouverture, à
la recherche, à la créativité et à l'expérimentation. L'accent est mis sur la
reformulation des cours fort éloignés de l'enseignement assez rébarbatif du
solfège au siècle passé ou de l'analyse desséchante. Il s'agit donc d'associer
des approches culturelles émanant de diverses spécialités : histoire,
analyse, esthétique, visant à une pédagogie nouvelle plus attrayante et à une
démarche globale. Après avoir retracé brièvement l'historique de l'enseignement
universitaire et dans les Conservatoires, l'auteur rappelle que, vers 1980,
Marcel Landowski a donné une nouvelle impulsion avec le lancement d'écoles de
musique (municipales, nationales), de Conservatoires de région et la création
du CNSM de Lyon, ainsi que l'introduction de diplômes d'assistants spécialisés
et, en 1987, du CA de culture musicale. Jean-Philippe Guye a judicieusement regroupé
les textes en trois catégories : expériences pédagogiques : pratique
et terrain (par exemple : adolescents tant de Bobigny qu'à l'Université de
Mascate (Sultanat d'Oman) ou au Conservatoire de Cergy-Pontoise, sans oublier
la pratique avec Jean-Baptiste. Lully et Jean-Marie Leclair, Joseph Haydn ou
Franz Liszt…) ; perspectives analytiques : théories et
pratiques (problèmes de transcription, de terminologie et d'analyse);
pédagogie de l'écriture (style, prosodie allemande, composition…). Ce volume
propose donc un bilan des enjeux actuels dans les Conservatoires en France, en
vue d'une synthèse de disciplines. Bref : un cursus ambitieux au service
de cultures en mouvement.

Édith Weber.
« Musique,
foi et raison. Correspondante inédite Gabriel Renoud/Camille
Saint-Saëns 1914-1921 » recueillie, introduite
et annotée par Pierre GUILLOT. Paris, L'Harmattan (www.editions-harmattan.fr ), 237 p. -25 €.
Pierre Guillot —
Professeur émérite à l'Université Paris-Sorbonne, organiste émérite de la
Collégiale Notre-Dame de Bourg (Ain) où la vocation musicale et religieuse du
prêtre Gabriel Renoud s'est déclarée — a, avec
patience et minutie, regroupé pour la première fois (d'après des autographes
conservés dans le Fonds Saint-Saëns du Château-Musée de Dieppe) 116 lettres du
prêtre incitant son destinataire à la conversion et 25 réponses de Camille
Saint-Saëns. Cet échange épistolaire pendant sept ans couvre la Première Guerre
mondiale et l'après-guerre. Il est introduit et annoté avec beaucoup de soin
par Pierre Guillot et présenté sous trois rubriques circonstanciées :
musique, foi et raison.
L'Abbé Joseph Gabriel Marie Renoud, comme le rappelle l'auteur, est
né le 26 septembre 1873 à Bourg-en-Bresse et mort le 9 décembre 1962. Après
avoir été élève à la Maîtrise de la Collégiale Notre-Dame de Bourg, il y a
appris le piano, l'harmonium et l'orgue. En 1890, il entre au Séminaire de Brou
à Bourg, et accompagne de temps en temps les offices à l'harmonium ou à
l'orgue. Ordonné prêtre en 1896, il assume l'année suivante les fonctions de
maître de chapelle à l'institution Saint-Pierre de Bourg. Il sera
successivement vicaire, maître de chapelle, organiste, puis infirmier pendant
la Première Guerre mondiale. Nommé curé de Thoissey, il terminera son ministère
comme aumônier de l'Office des Incurables de Bourg (cf. p. 9-10). Il a été l'auteur de nombreuses publications,
notamment sur la vie religieuse (XVIIe-XIXe siècles), d'un recueil poétique (La croix lumineuse, 1924), des paroles
et de la mélodie de nombreux cantiques.
Sa correspondance
avec le compositeur, pianiste virtuose et écrivain, Camille Saint-Saëns
(1835-1921) illustre leur érudition et reflète leur franchise et leur sincérité
marquées par une cordialité réciproque. L'échange épistolaire porte évidemment
sur la musique religieuse et la liturgie catholique, bien que Camille
Saint-Saëns, organiste pendant 25 ans, fût « relativement prolixe quoique
agnostique » et que Gabriel Renoud, combattant
les « motets théâtraux », fût adepte du nouveau plain-chant et
organiste amateur. Leurs goûts artistiques y sont souvent opposés. Ces lettres
font état de leurs divergences, mais il en ressort que, dès sa première
missive, le prêtre « aurait tant voulu ramener Saint-Saëns, la brebis égarée,
à la foi catholique »… Leur argumentation réciproque est particulièrement
instructive.
La première lettre
porte le cachet postal : Ars, 7 septembre 1914. Elle est destinée à
« M. C. Saint-Saëns Bureau de l'Écho
de Paris, 6 place de l'Opéra Paris (IXe) », alors qu'il habitait au 83
bis, rue de Courcelles, à Paris. La 116e (et dernière), adressée au « Cher
Maître », porte la mention : « Civrieux, 12
sept. 1921 ». Tous ces documents sont assortis de judicieux commentaires
explicatifs permettant au lecteur du XXIe siècle de mieux comprendre les divers
contextes historiques, sociologiques et artistiques. Ils renseignent notamment
sur les activités des deux correspondants, les personnes du monde artistique et
culturel qu'ils ont côtoyées. Dans ce cadre, il est impossible de détailler
cette vaste correspondance particulièrement précise, révélatrice d'une forte
pénétration psychologique et, bien sûr, religieuse, notamment à propos de
l'« âme catholique », truffée de citations bibliques et accompagnées
de quelques exemples musicaux autographes ; et de résumer l'intérêt de tous ces
débats. La confrontation entre lettre et réponse est des plus significatives,
notamment à propos de l'utilité de la religion et l'exposition des doctrines
catholiques.
En cette année du
Centenaire de la déclaration de la Grande Guerre — à côté des discussions
autour des thèmes : Saint-Saëns et
Dieu ! ; La foi contre la
raison ainsi que la musique, l'orgue
et la poésie —, les lecteurs seront aussi sensibles aux lettres concernant
les activités de l'Abbé-infirmier/ambulancier au front (cf. lettre n°85 portant pour adresse : « S.l.n.d., aux
armées, tampon postal Trésor et Postes, 2 mai 18 » (sic)). D'une manière
générale, comme le précise Pierre Guillot : « J'aime à être
aimé », confiait Camille Saint-Saëns au poète Pierre Aguétant
( 17 juillet 1918). Eh bien ! les
116 lettres (1914-1921) que ce volume assemble sont sans doute l'un des plus
admirables témoignages d'amour que le compositeur a jamais reçus : celui
d'un prêtre discret, Gabriel Renoud (1873-1962),
alors vicaire et organiste au village d'Ars ».
Ces échanges
épistolaires convient un panthéon de
personnalités allant de Confucius, Saint Ambroise de Milan, de Jeanne d'Arc
jusqu'à Pierre Curie ; de Henri IV à Bismarck, puis d'Auguste Comte et
Nietzsche, et évidemment de musiciens : de Jean Sébastien Bach à Albert
Alain, en passant par Mozart, Chopin, Wagner, Franck, Fauré, Déodat de Séverac… Tout le mérite revient à Pierre Guillot
qui, avec cette remarquable Correspondance
inédite, a fait preuve d'une
parfaite maîtrise du genre.

Édith Weber.
Marc-Mathieu MÜNCH : La beauté artistique. L'impossible
définition indispensable. Prolégomènes pour une « artologie »
future. Paris, Honoré Champion (www.honorechampion.com ), 2014, 155 p. 22 €.
Marc-Mathieu Münch, Professeur émérite de littérature générale et
comparée à l'Université de Lorraine, et mélomane averti, depuis sa découverte
de l'invariant de l'effet de vie,
poursuit inlassablement ses recherches. Dans ce nouvel ouvrage, après tant
d'auteurs dans le sillage de Baudelaire, il tente de définir la beauté
artistique, démarche certes indispensable
mais quasi impossible. Il constate
que toutes les Sciences humaines sont progressivement issues de la Philosophie
et, dans une brève rétrospective, évoque l'apport de la philosophie occidentale
(tentatives de Roman Ingarden, Nelson Goodman et
Rainer Rochlitz…) en vue d'une Science humaine de l'art, puis l'apport de Claude Lévi Strauss. Il
nous a rappelé récemment que, lors de Colloques internationaux, il a été « encouragé à élargir le débat aux
arts plastiques et à la musique, ceci dans le prolongement de ses spéculations
sur l'invariant mondial de l'effet de vie,
selon lequel une œuvre est réussie lorsqu'elle est capable de créer un effet de vie par le jeu cohérent des
formes et des matériaux ».
Au fil du temps, —
après sa contribution au livre sur L'Esthétique
de l'Effet de vie. Perspectives interdisciplinaires (Paris, L'Harmattan,
2012) —, sa démarche originale s'est affirmée avec ce n°30 de la Collection
Essais, au point de pouvoir lancer une nouvelle discipline : l'ARTOLOGIE (de art et logos), « fondée sur la parole des
artistes et sur ce qu'ils en disent au sens large », d'après le modèle de toutes
les autres sciences se réclamant du logos.
Et c'est précisément l'effet de vie qui
« permet d'exploiter et de définir la spécificité du phénomène art en tant
que tel. » Marc-Matthieu Münch évoque ainsi sa
démarche : « J'ai donc passé ma vie à comparer tout ce que les artistes
[les écrivains] ont dit de leur art, du moins ce qu'on peut en lire posément en
un demi-siècle de travail. Je me suis efforcé de bien distinguer ce qui
concerne un style d'époque, ce qui revient à un génie particulier, ce qui caractérise
une famille d'esprit ou un goût spécifique,tout
en mettant à part ce qui semblait anthropologique » (p. 101-102).
L'auteur a réussi à
dégager les corollaires de l'effet de vie
sous six aspects : 1. le matériau incitatif, 2. le jeu créateur, 3. la forme
vive, 4. la plurivalence, 5. l'ouverture, et 6. la cohérence. Il en arrive à
constater que, en art : « le singulier mène au pluriel, et le pluriel
ramène au singulier. Sous l'impressionnante diversité des fonctions attribuées
à l'art gît la fonction-source de l'effet de vie lui-même ». Quant à
l'art, il « est un phénomène humain interactif reliant un créateur, un
objet et un récepteur en vue d'un but spécifique ». Les perspectives de l'« artologie », discipline se rattachant aux Sciences
humaines et à l'Art en particulier, sont vastes ; elles permettent de définir
la spécificité du phénomène art en
tant que tel grâce à la notion d'effet de
vie. Dépassant déjà son sous-titre : Prolégomènes pour une artologie future, cette publication ouvre
largement la voie à de nouvelles perspectives très prometteuses : de quoi
réfléchir et à suivre avec le plus vif intérêt.

Édith Weber.
André
TUBEUF : Hommages. Portraits de musiciens. 1
vol. Actes Sud, 2014, 523 p, 25 €.
Mieux que quiconque, André Tubeuf sait communiquer une vraie passion pour les
interprètes. Depuis quelques décennies, infatigable, le journaliste livre des
analyses perspicaces sur les grands de l'opéra et du Lied, et scrute l'horizon
musical à l'affût des talents émergents. Cette passion pour la musique déborde
le chant bien sûr. Il dessine leurs portraits amoureusement au fil des mois
dans la revue Classica. Ce livre en reprend
l'essentiel. Le caractère concis de chaque chronique n'enlève rien à sa
complétude, bien au contraire. Plusieurs générations sont passées en revue :
les grands anciens (Enrique Caruso, Maria Ivogün, Lauritz Melchior...), ceux qu'il a connus de près (Arthur
Rubinstein, Christa Ludwig... ou ces figures emblématiques du fameux
« Wiener ensemble » qui, durant les décennies 50 et 60, firent les
beaux soirs de l'Opéra de Vienne, à l'exemple des trois chanteuses qui ornent
la couverture du livre, Irmgard Seefried,
Elisabeth Schwarzkopf et Sena Jurinac),
les jeunes talents devenus valeurs de
demain (Matthias Goerne, Jonas Kaufmann, Leif Öve Andsnes...) La chronologie
veut que Goerne vienne aussitôt après Fischer- Dieskau : plus qu'une belle coïncidence, lorsqu'on mesure
combien l'un a pris le relais de l'autre. L'art de la formule est chez l'auteur
comme une seconde nature : « le violoncelle, c'est la grande voix qui nous
relie depuis les nuées » (à propos de Jacqueline du Pré); « Victoria (de
los Ángeles) était la musique même ; jamais
décevante, jamais déplacée ». Bien sûr, la succession des quelques 130
chapitres peut donner le tournis. Mais un tel ouvrage se lit-il dans la
continuité ? On y vient plutôt guidé par la curiosité
gourmande de voir évoquer ceux qu'on a tant admiré, sur scène ou au disque. Car
André Tubeuf n'a pas son pareil pour relever d'un
trait de plume ce qui distingue tel ou tel : C'est « du côté des
humbles » qu'un Walter Berry tracera une carrière exemplaire, marquée par
« un sens de l'enracinement dans un théâtre », loin du système globe
trotter de bien d'autres. Génial Figaro, de Mozart comme de Rossini, Hermann
Prey restera l'« aristocrate des valets d'opéra ». L'art de la
formule, on la connaît, et elle fait mouche : « L'enfant de plus d'un
siècle » à propos de Christoph Eschenbach, ou
« ce long météore tranquille » qu'est Georges Prêtre. On guette les
absents : ces voix célèbres, qu'on n'aura pas l'outrecuidance de citer ; trop
de glamour peut-être pour mériter les égards de l'auteur ? Sûrement pas oubli,
choix plutôt, lorsqu'on sait la voracité encyclopédique de l'auteur. A moins
qu'il n'y ait matière à quelque suite, car « les absents n'ont jamais
tort ». Peu importe, André Tubeuf offre d'abord
en partage, outre une immense connaissance et une langue peaufinée, même si
fort compacte à l'occasion, ces éléments, parfois peu connus, voire secrets,
ces fines observations qui font qu'on se prend de sympathie pour chacun de ces
grands musiciens. Dès lors, si le trait se fait plus aiguisé (Christian Ferras
ou « la chute d'Icare », « Karajan, Citizen K »), il a le mérite
de la franchise, car rien ne serait pire que l'esquive. A un moment où ce type
d'ouvrage fait florès (« Les grands pianistes », « Les grands
violonistes », etc. ) celui-là s'en démarque par
une vertu rare : l'empathie.

Jean-Pierre Robert.
***
CDs et DVDs
« Christmas Carols ». Hannover
Knabenchor. London Brass.
1CD RONDEAU PRODUCTION (www.rondeau.de) :
ROP7117. TT : 63'24. Jörg Breiding, directeur du célèbre Chœur de Garçons de Hanovre
— fondé en 1950 par Heinz Hennig —, a sous-titré son
programme : Musique festive pour le temps
de Noël (Festliche Musik zur Weihnachtszeit). Il
propose une sélection de cette forme anglaise par excellence : le Christmas Carol (du mot français
« carole »), avec alternance d'un refrain à danser chanté en chœur et
de strophes interprétées généralement par un soliste. Il s'agit de chants
anglais, mi-religieux, mi-populaire, quelque peu l'équivalent des Weihnachtslieder
allemands et des Noëls français. Ce
disque a été enregistré sur le vif à la Marktkirche
(Église du Marché), à Hanovre, avec la participation du London Brass (orchestre de cuivres : trompettes, trombones,
cors et tubas) et du Hannover Knabenchor.
Ils interprètent des Xmas Carols de toujours, en versions soit
vocales, soit instrumentales ou voix et instruments réunis. La tradition est à l'honneur avec le chant latin anonyme (XIIIe siècle) : Angelus ad virginem ou encore Sing Joyfully unto God our Strength de
William Byrd (1543-1623) ; Hosanna
to the Son of David de Thomas Weelkes
(1576-1623). Le
« noël » : Joy to the
World de Lowell Mason (1792-1872) figure dans la
version instrumentale arrangée en 1960 par Richard Bissill.
Plus proches de nous, Benjamin Britten (1913-1976) est représenté par le
Cantique à la Vierge : Of one that is so
fair and bright Velut maris stella. David Wilcocks (*1919) a réalisé un arrangement de O Come, All Ye Faithful (Adeste fideles),
invitation à adorer le Christ, chantée dans le respect des nuances, par les
voix masculines soutenues et colorées par les instruments à vent. L'ensemble
London Brass interprète une version par Simon Wills
(*1957) du Quem pastores
laudavere (laudaverunt) provenant de Bohême
(XVe siècle), chant traditionnel des enfants allemands par excellence qui se
répondaient d'une tribune à l'autre. Il exécute une version instrumentale
extraite de l'Oratorio de Noël (BWV
248) de J. S. Bach : Nun seid ihr wohl
gerochen. Parmi les mélodies incontournables
figurent le vieux noël bilingue : In
dulci jubilo, nun singet und seid froh,
dans un arrangement du XIXe siècle (Robert Lucas Pearsall (1795-1856) ; Es ist ein Ros' entsprungen de Michael Praetorius (1571-1621), mais
traité selon l'idiome du XXe siècle par Donald Cashmore
(mort en 2013). Signalons encore l'arrangement par John Rutter
(*1945) : Desk the Hall chanté
avec élan, légèreté, transparence et virtuosité. Ce disque se termine sur
l'annonce Hark ! the Herald Angels Sing (cf. Il est né, le divin Enfant)
interprétée par le Knabenchor, L. Hahnheiser
(percussion) et le London Brass. Avec ses 22 œuvres
pour Noël, il comptera dans les annales du Chœur de Garçons de Hanovre :
un « tube » à l'initiative du Label allemand RONDEAU PRODUCTION.
Tous : chef, chanteurs, instrumentistes… vous souhaitent a merry Christmas
and a happy New Year ! Édith Weber. « Weihnachten zu Hause ». Martin Petzold, ténor, Jakob Grabenhorst, soprano garçon, Martin Hoepfner,
guitare. 1CD RONDEAU PRODUCTION (www.rondeau.de ) : ROP6084. TT : 58' 34. Les Éditions
RONDEAU PRODUCTION ont fourni un effort particulier en 2014 pour illustrer le
temps de l'Avent et les Fêtes de Noël en des lieux divers. Ce disque, consacré
à des Noëls traditionnels allemands,
propose des versions plus intimes à écouter avec émotion, à la maison (zu Hause), en
famille, près du sapin, afin de recréer l'atmosphère et l'ambiance de Noël dans
le calme et la sérénité. L'enregistrement comprend des anciennes mélodies
(également connues des Catholiques) telles que, pour le temps de l'Avent :
Nun komm, der Heiden Heiland (Viens,
Rédempteur des païens) d'après l'hymne Veni Redemptor gentium (v. 386) de
Saint Ambroise de Milan, adaptée en allemand par Martin Luther en 1524, comme
il se doit chanté sur un ton assez mystérieux par le Ténor Martin Petzold ; Es kommt ein Schiff,
geladen sur le texte (v. 1626) de Daniel
Sudermann, d'après un chant marial strasbourgeois du XVe siècle et publié à
Cologne en 1608 ; pour Noël : Ich steh' an deiner Krippen hier (Je me tiens près de ta crèche) sur les
paroles (1653) de Paul Gerhardt, ou encore la berceuse Joseph, lieber Joseph mein
(Joseph, cher Joseph, aide-moi à bercer mon enfant) remontant à une mélodie
salzbourgeoise du XIVe siècle. Les mélomanes écouteront avec plaisir le
traditionnel noël bilingue respectant les assonances : In dulci jubilo, Nun singet und seid
froh ; Stille Nacht (Voici Noël) sur le texte
de Joseph Mohr et la mélodie de Franz Xaver Gruber, et O du
fröhliche (Ô nuit bienveillante…) sur le texte de
J. G. Herder d'après la mélodie d'une sicilienne (avant 1788). Ils pourront
aussi découvrir la mélodie de Peter Cornelius à propos des Rois mages : Drei Kön'ge wandern aus Morgenland
et surtout le nouveau chant : Simeon composé par l'actuel Kantor de Saint-Thomas, Georg
Christoph Biller (*1955) prouvant que l'esthétique de notre époque peut
s'insérer dans le répertoire de chorals. Les interprètes : Martin Petzold (Ténor) et son élève Jakob Grabenhorst
(Soprano garçon), avec le concours à la guitare de Martin Hoepfner,
n'ont pas ménagé leurs efforts pour agrémenter dans la sérénité et le
dépouillement la Fête de Noël à la maison et aux chandelles. Édith Weber. « Weihnachtliche Musik aus der Maktkirche
Hannover ». Elisabeth
Schwanda, flûte à bec, Ute Engelke,
soprano, Ulfert Smidt,
orgue. 1CD RONDEAU PRODUCTION (www.rondeau.de ) : ROP6095. TT : 65' 49. Après le Noël à la maison, voici le Noël à l'Église du Marché (Marktkirche) à Hanovre, avec le concours de trois
interprètes : Elisabeth Schwanda (flûte à bec), Ute Engelke (Soprano) et l'organiste titulaire bien connu, Ulfert Smidt. L'interprétation de
ces arrangements met en valeur la voix de Soprano si prenante associée aux les
sonorités de la flûte à bec et de l'orgue. Ces musiciens de Hanovre font preuve
à la fois de fantaisie, du souci du détail, de virtuosité, illustrant le
sous-titre de ce CD « Que de joie, que de plénitude » (Lauter Freude, lauter Wonne), conformément à
l'œuvre éponyme de Georg Philipp Telemann. Ce
répertoire tout à fait traditionnel regroupe des compositions Claudio
Monteverdi : Exulta filia Sion (1629), motet pour soprano et basse
continue ; de Michael Altenburg
(1584-1640) : Nun komm, der Heiden Heiland ; de
Michael Praetorius : Wie schön leuchtet der Morgenstern ;
de J. S. Bach : Süsser Trost, mein Jesus kömmt
(annonçant la venue de Jésus). À noter surtout, à titre comparatif, les
versions du choral Vom Himmel hoch, da komm ich
her avec, en introduction, le Prélude de choral
pour orgue (BWV 606) de J. S. Bach, suivi des versions d'Adam Gumpelzhaimer (1559-1625) et de Hans Leo Hassler
(1554-1612), et, en conclusion, son choral (Choralbearbeitung) (BWV 243aA).
Les auditeurs seront également sensibles au Cantabile
du Concert pour flûte, op. 10
n°3, d'Antonio Vivaldi et à la Pastorale
de César Franck pour orgue op. 19.
Voici presque 66 minutes de musique de la Renaissance au XXe siècle et un bel
exemple actuel de l'atmosphère de Noël à la Marktkirche
de Hanovre. Édith Weber. « Weihnachten mit der Oper Leipzig ». Solistes de l'Opéra
de Leipzig. Membres du Gewandhaus Orchester
Leipzig. Mendelssohn Quartett, dir.
Christian Hornef. 1CD RONDEAU PRODUCTION (www.rondeau.de ) :
ROP6096. TT : 71' 48. Après Noël à la
maison et Noël à l'Église, voici « Noël à l'Opéra », petite Anthologie de
Chants de Noëls internationaux
interprétés avec le concours de grands solistes de l'Opéra de Leipzig qui,
toutefois, se produisent dans la modeste Église luthérienne de Gundorf (banlieue de Leipzig). L'initiative en revient à
Martin Petzold, chanteur international d'oratorio,
qui a regroupé autour du thème de Noël — fête de famille, fête de la musique —
un plateau de solistes internationaux et sélectionné des œuvres, entre autres,
d'origines allemande (O Tannenbaum du trägst ein' grünen Zweig, d'après
une mélodie populaire de Westphalie remontant au XVIe siècle — à ne pas
confondre avec l'autre chant traditionnel : O Tannenbaum (bis)… (Mon beau sapin) ; Christnacht de Johann Wolfgang
Franck et Wilhelm Osterwald, interprété par Martin Petzold, soutenu discrètement l'orgue), scandinave,
coréenne (évocation de la petite ville de Bethléhem),
ukrainienne (Noël marial sur le thème de l'espoir et de l'attente : In der Hoffnung Mutter Gottes, chanté a
cappella), brésilienne (O Natal Existe,
chanté par Sandra Janke avec guitare), totalisant 22
pièces. Ces solistes internationaux (allemand, autrichien, bulgare canadien,
finlandais, nord-américains, sud-coréens, suédois…) chantent sous la direction
de Christian Hornef qui a été directeur des études à
l'Opéra de Leipzig et dirige notamment de nombreux programmes de Lieder avec des membres de cet ensemble.
Les quatorze
chanteurs internationaux et un soprano garçon sont associés à des
instrumentistes appartenant à l'Orchestre du Gewandhaus,
au Quatuor Mendelssohn ou à l'Opéra de Leipzig prêtent leur concours :
violons : G. Harms et A. Schuberth-Meister ; guitare : M. Hoepfner ;
piano et orgue : Chr. Hornef ; bugle :
U. Lehmann ; contrebasses : R. Leuscher et
T. Martin ; alto : L. Petersen ; violoncelle : S. Rassbach et flûte : J. Schlag. Ils forment ainsi une
belle brochette internationale, et ont réalisé un éloquent digest, commençant
par la chanson populaire planant dans la douceur : Maria durch ein Dornwald ging pour 2 voix,
quintette à cordes, guitare et flûte, et se terminant par l'incontournable Stille Nacht de Fr.
Gruber, mais dans un arrangement de Andreas Pieske
(né en 1928), avec le concours d'Eun Yee You, de
solistes de l'Opéra et d'un quintette à cordes. Magnifique programme à
connotation internationale hors des sentiers battus, loin de la théâtralité
inhérente aux chanteurs d'opéra. Édith Weber. «
Fireworks of music. Festliches Silvesterkonzert aus Hannover ». Ulfert Smidt,
orgue, Jackson Crawford, saxophone. 1CD RONDEAU PRODUCTION (www.rondeau.de ):
ROP6089. TT : 58' 36. Ce disque pour la
Saint Sylvestre et la Nouvelle Année offre un panorama très varié de 16
morceaux à succès, enregistrés à l'Église du Marché (Marktkirche)
de Hanovre lors du Concert de Nouvel An (2014) et interprétés par l'organiste
titulaire Ulfert Smidt
(Orgue Goll (2009) : 4 claviers et pédale) et
Jackson Crawford (saxophone). Le programme comprend notamment des œuvres de
Dimitri Chostakovitch (Valse extraite
de sa Suite pour orchestre de variétés),
Serguei Rachmaninov, (Vocalises n°14) ;
Charles-Marie Widor, (Adagio et la Toccata n°5 de sa Ve Symphonie), Gabriel
Fauré, (Après un rève),
Pierre-Max Dubois (Cinq Danses) ;
Robert Schumann (Abendlied
n°12) ; Edward Elgar (Marche
militaire n°1), Jackson Crawford (né en 1943), avec son Thème et Variations sur Ah vous dirai-je,
maman… Il s'agit de musiques festives, divertissantes ou solennelles.
L'atmosphère de Noël est rendue musicalement par l'Allegretto-Allegro extrait des Rumänische Weihnachtslieder (Chants de Noël
roumains : Colindas)
de Béla Bartók. La dernière
pièce enregistrée est l'hymne strophique très connue : The Holy City
composée en 1892 par le baryton anglais Michael Maybrink
(sous le pseudonyme de Stephen Adam). Cette mélodie largement exploitée au XXe
siècle met en valeur les qualités expressives et très chantantes du saxophone. Édith Weber. « Variations des Cîmes ». FRANCK-BACH-BUSONI-BRAHMS-LISZT. Jacqueline
Bourgès-Maunoury, piano. 1CD VDE GALLO (www.vdegallo-music.com) : GALLO CD 1438. TT : 58' 01. La pianiste suisse
Jacqueline Bourgès-Maunoury, titulaire d'une Licence
de Concert de l'École Normale de Musique (Paris) et du Premier Prix de
Virtuosité du Conservatoire de Genève, disciple notamment de Louis Hiltbrand, successeur de Dinu Lipati au Conservatoire de cette ville, Karl Engel, Leon Fleisher et Jean Fassina, solistes de réputation internationale, interprète
avec musicalité et un grand sens des reliefs sonores : Prélude, Fugue et Variations en si mineur op.
18 de César Franck (transcription pour piano : H. Bauer), ainsi que la Chaconne en ré mineur de J. S. Bach d'après la Partita n°2 pour violon seul (BWV 1004), avec des accords d'une
sonorité exceptionnelle. Dans les Variations
sur un thème original en Ré Majeur op. 21, n°1 de Johannes Brahms, celui-ci
est énoncé avec une remarquable subtilité et une recherche très précise de
nuances bien différenciées. Quant aux Variations
sur la Cantate BWV 12 de J. S. Bach « Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen » par
Franz Liszt, elles bénéficient d'une interprétation énergique avec des accords
plaqués cédant la place à la virtuosité, avec également des passages à
découvert à la main droite et un toucher très égal : de quoi ravir les
mélomanes les plus exigeants. En effet, ces « variations des cîmes » atteignent des sommets techniques et
expressifs étincelants confirmant l'assertion de Jean-Bernard Pommier :
Jacqueline Bourgès-Maunoury « joue sans
artifice, sans influence, avec la seule recherche de la sincérité qui est une
des obligations essentielles de l'artiste ». Édith Weber. William BYRD : Infelix ego. Mass for 5 Voices. Motets.
Collegium Vocale Gent, dir.
Philippe Herreweghe. 1CD PHI.
OUTHERE MUSIC (www.outhere-music.com ): LPH 014. TT : 49' 49. Philippe Herreweghe
et le Collegium Vocale de Gand, fondé il y a plus de
quarante ans, se sont distingués dans le monde discographique, notamment par
leur qualité sonore et leur souci rhétorique. Leur répertoire va de la
Renaissance à l'époque contemporaine. Le présent CD révèle, dans d'excellentes
conditions, la Messe Infelix ego à 5 voix, ainsi qu'une sélection de
4 Motets de William Byrd (v.1540-1623), organiste (1563-1572) de la Cathédrale
de Lincoln, au début du règne d'Élisabeth Ière. Il a composé des œuvres pour
l'Église anglicane et, à partir de 1590, surtout pour la liturgie catholique.
Il est l'auteur de 3 Messes. Comme le
Motet éponyme, la Messe Infelix ego, à 5 voix, tire son titre du Psaume
50/51, qui a inspiré une méditation à Jérôme Savonarole (1452-1498) évoquant
une âme tourmentée et suscitant de fortes émotions. Le très bref Kyrie, avec les trois invocations
traditionnelles, s'impose d'emblée par sa plénitude et la transparence ; le Gloria, par l'indépendance des
voix et l'excellente diction. Dans le Credo,
après l'intonation, les divers plans sonores sont mis en valeur avec élan. Le Sanctus, intense et calme, est suivi du Benedictus avec l'Hosanna, d'une rare élévation. L'Agnus Dei sert de conclusion apaisante à cette messe assez proche
de l'esthétique continentale. Quatre Motets complètent le programme : Emendemus in melius,
pour le premier Dimanche de Carême, première pièce du recueil publié avec
Thomas Tallis en 1575 ; Infelix ego
(1591), motet tripartite (éponyme de la Messe à 5 voix), le plus développé des
quatre, marquant un sommet dans la production religieuse de Byrd ; Ave Maria baignant dans la plénitude et
le calme. Enfin, le motet Christe qui lux es,
repose sur le cantus firmus en plain-chant de l'hymne (pour le Carême)
circulant à travers l'œuvre, d'une strophe à l'autre, en allant du grave à
l'aigu et bénéficiant d'un traitement homophonique et homosyllabique. Le CD comprend encore le motet Peccantem me quotidie d'Alfonso
Ferrabosco (1543-1588) et le Miserere mei de Philippe de Monte
(1521-1603), contemporains de William Byrd. Le Collegium
Vocale Gent, placé sous la direction éclairée de Philippe Herreweghe, a apporté une magnifique contribution au
répertoire catholique pratiqué en Angleterre au XVIe siècle. Ce disque, associé
à des commentaires explicatifs éclairant le contexte historique et présentant
rapidement les œuvres, a sa place attitrée dans toute discothèque de musique
sacrée. Indispensable. Édith Weber. Francesc VALLS : Misa Scala Aretina. La Grande Chapelle, dir.
Albert Recasens. 1CD LAUDA.
OUTHERE MUSIC (www.outhere-music.com ): LAU 014. TT : 74' 34. Albert Recasens, directeur de La Grande Chapelle, toujours
soucieux de faire découvrir des œuvres rarement entendues, a programmé une
sélection d'œuvres de Francesc Valls (v. 1671-1747). Ce musicien est, selon
Alvaro Torrente, « l'un des compositeurs et
théoriciens les plus importants du baroque espagnol, actif à Barcelone pendant
le premier quart du XVIIIe siècle. Rien n'est connu de sa vie avant 1696, et
même s'il a toujours été considéré comme natif de Catalogne, il est probable
qu'il naquît ou, au moins, qu'il se formât à Valence. » Il a été maître de
chapelle à Barcelone, et composa pour la Chapelle de la Cathédrale : c'est
le cas de sa Misa Scala Aretina (1702), à 11 voix. D'une manière générale, Francesc Valls y fait d'abord appel au traitement
syllabique des paroles pour une meilleure compréhension, puis aux entrées
successives et exploite largement les longues vocalises entrecoupées et
soutenues par les sonorités altières et si prenantes des trompettes. La Misa comprend les parties
traditionnelles : Kyrie, intense
prière très expressive ; Gloria toujours
en mouvement, avec traduction figuraliste des images
et des idées du texte ; Credo où,
après l'intonation traditionnelle, le compositeur insiste sur l'affirmation du
verbe credo (je crois) ; Sanctus resplendissant, se terminant sur
l'Hosanna ; l'Agnus Dei, de caractère
et méditatif. Francesc Valls a signé une Messe très brillante. Ce disque comprend
également des œuvres appartenant à des genres différents : Salmo, Responsorio, Tono, Leccion, Motete, Invitatorio et Villancico, forme
typiquement espagnole pour le temps de Noël. À noter : le motet Domine vim patior (à 4 voix), homophonique et homosyllabique,
avec des chromatismes et modulations subtiles que, comme le signale A. Torrente, Francesc Valls utilise
dans son traité à des fins de démonstration. À noter également le villancico (1708) pour la Fête de Saint Thomas d'Aquin
: Sombras cobardes
(à 12 voix), polychoral et particulièrement rythmé aux instruments, du
meilleur effet. Accompagnée d'une somptueuse plaquette, d'illustrations
judicieusement sélectionnées et de remarquables commentaires très instructifs,
des paroles (en latin, espagnol, anglais et français) de toutes les œuvres,
cette réalisation révélée avec tant de fidélité aux intentions
compositionnelles permet de découvrir un compositeur exceptionnel du dernier
baroque. Albert Recasens a su mener La Grande
Chapelle (11 chanteurs et 9 instrumentistes — dont 2 trompettes et 2 orgues
positifs) à une maîtrise jubilatoire d'un langage musical dont ils détiennent
les secrets : ils méritent les plus vifs éloges. Édith Weber. « Ullrich Böhme an der Sauer-Orgel der Thomaskirche zu Leipzig ». 1CD RONDEAU PRODUCTION (www.rondeau.de ): ROP6092. TT : 75' 01. Ullrich Böhme est
titulaire du poste prestigieux de Cantor et organiste de l'Orgue Sauer (1908) de l'Église Saint Thomas à Leipzig. Il
maîtrise parfaitement les possibilités de cet instrument à 3 claviers (1 :
25 jeux, 2 : 21 jeux, 3 : 19 jeux) et pédale (23 jeux), et — en plus
d'une Toccata et Fugue de J. S. Bach
— propose des œuvres des XIXe et début XXe siècles. Il ouvre brillamment ce CD
par le Praeludium und Fuge über B.A.C.H de Fr.
Liszt, avec le thème caractéristique : si
bémol la do si bécarre correspondant au nom de
l'illustre prédécesseur du cantor actuel. Très bien structuré, il est
interprété avec assurance, brio et une registration tout à fait conforme à la
conception de Fr. Liszt concernant l'orgue romantique. Il est suivi de la Toccata et Fugue en Fa majeur (BWV 540)
de J. S. Bach, bien enlevée avec clarté et dans un tempo raisonnable. La
musique d'orgue romantique est encore représentée par le Prélude de choral Herzlich tut mich verlangen (op. 122, n°10) de Johannes Brahms,
aspiration à la mort paisible, de caractère méditatif, qui est vivement ressentie
par l'interprète. À cette œuvre liturgique, succède la Fantasie-Sonate en La b majeur
(op. 65) de Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901)
datant de 1871, en 3 parties contrastées : Grave & Allegro, Adagio
espressivo, Finale (Fuga), baignant dans le romantisme. Ullrich
Böhme rend un vibrant hommage à l'un de ses prédécesseurs : Karl Piutti — né en 1846 à Elgersburg
en Thuringe, mort en 1902 à Leipzig — en interprétant son Fest-Hymnus (op. 20), œuvre d'une grande
virtuosité composée précisément pour la consécration de l'Orgue Sauer. Max Reger (1873-1916) figure en bonne place, avec
son Benedictus (op. 59, n°9), son Prélude de choral (op. 135a, n°5) et Ein feste Burg ist unser Gott en
deux versions : son Prélude de
choral et sa redoutable Fantaisie
chorale (Choralfantaisie,
op. 27). Cette mélodie Ein feste Burg (d'après le
Psaume 46) représente l'identité hymnologique de la musique luthérienne. Ce
programme essentiellement leipzicois sera un vrai
régal pour les hymnologues et tous les amis de
l'orgue. À ne pas manquer. Édith Weber. « Musica encerrada ». Mara Aranda.
Capella de Ministrers, dir.
Carles Magraner. 1 CD
CdM (www.outhere-music.com ): CdM 1435.
TT : 57' 38. Ce disque
intitulé : Musique
« enfermée » représente un exemple de transmission orale révélée
par la littérature judéo-espagnole et, notamment, par les chansons des Juifs
séfarades. Elles traduisent leurs diverses identités, leur évolution,
soulignent les influences subies et brossent un tableau de leurs conditions de
vie. Les textes tirent leur origine de la littérature espagnole du Moyen-Âge ou de la Renaissance, mais les mélodies ne sont
pas médiévales, comme le constate Miguel Angel Nieto
qui, à raison, place son commentaire sous l'adage : « Entre l'aventure et
la légende ». Cette réalisation (enregistrée en 2013) est structurée en
trois parties : Al hogar de la lumbre (À la
chaleur du feu), Las carceles
del alma (Les prisons de l'âme) et La llavedura del corazon (La serrure du
cœur). Elle comprend des œuvres instrumentales et vocales, et commence par une
chanson instrumentale : Sadawi, chanson de Tétouan à la fin du XVIe siècle, suivie
de kanticas,
par exemple : Una ramika de ruda (Une petite
branche de rue…), de caractère descriptif et lyrique, adaptation séfarade de la
Guirlanda de rosas, romance
judéo-espagnole, ainsi qu'une autre romance séfarade d'Orient : Hero y Leandro (Héro
et Léandre). Elle présente, en outre, des chants de circonstance sur le
thème du mariage, Pour habiller la
fiancée, Pour le bain rituel, La remise de la fiancée à Salonique ;
des Kanticas
amoureuses, sans oublier des Danses klezmer. Ces pièces proviennent notamment de
Rodes, Sofia, Istanbul, Izmir et Salonique. La chanteuse, Mara
Aranda — rompue aux intonations particulières (notamment secondes augmentées et
vocalises), à la voix si prenante — et la Capella de Ministrers
dirigée par Carles Magraner groupant, entre autres,
des instruments orientaux tels que : zanfona (vièle à roue), kanun, baglama… et, bien
entendu, des percussions, créent les atmosphères bien orientales et redonnent
vie à l'héritage oral de la diaspora séfarade. Un documentaire hors pair qui —
à plus d'un titre — intéressera les historiens de la musique, du judaïsme en
particulier et les discophiles curieux. Édith Weber. « Carmina Carolingiana ». Ensemble Ligeriana. 1CD LIGIA
DIGITAL. Distribution HARMONIA MUNDI (www.harmoniamundi.com) : Lidi
0202251-13. TT : 65' 58. Le rôle politique,
éducatif et spirituel de Charlemagne (mort en 814 à Aix-la-Chapelle), Roi des
Francs, couronné Empereur en l'an 800, est bien connu. La « Renaissance
carolingienne » est marquée, entre autres, par sa création d'écoles, de
monastères et la composition de nombreux chants épiques (carmina). Ce disque comprend 4 versus
(genre poétique, composition en vers métriques destinée à être chantée au cours
de processions) et 2 planctus
(ou planh, signifiant plainte,
déploration) et un chant de Boèce dans la mouvance du renouveau des lettres
latines dès le VIIIe siècle. Grâce à ses minutieuses recherches dans des
manuscrits d'époque (en notation neumatique sans portée) et ses restitutions,
Katia Caré invite les discophiles et les historiens à
redécouvrir des documents relatifs à la Bataille de Fontenoy-en-Puisaye, qui
s'est déroulée le 25 juin 841, relatée par Angilbert (mort en 814) dans son Versus de bella quae fuit acta Fontaneto ;
ou encore à l'incendie et la destruction du Monastère de Saint-Florent-le-Vieil
(près de Saumur), relatés dans les Versiculi de eversione monasterii S. Florentii d'après un cartulaire conservé à la BnF. Comme le rappelle l'historien médiéviste Guy Lobrichon dans sa remarquable présentation, il s'agit d'un
poème en dimètres iambiques daté au plus tôt des
années 940 ou 960, sinon fin Xe siècle. À signaler également le Versus Godiscalchi
concernant Gottschalk d'Orbais (v. 807- vers
867/869) et « l'ami de Reichenau », en
fait Walafrid Strabon (808/809-849), évoquant
« l'amitié qui réunit les deux hommes séparés jusque dans leurs visions
théologiques ». Quant aux planctus, ils concernent l'Abbé Hugues de Saint Quentin
(fils naturel de l'Empereur, tombé au combat en 844) et Charlemagne lui-même,
d'après le manuscrit provenant de l'Abbaye Saint-Martial de Limoges (cf. Doctorat de Jacques Chailley)
conservé à la BnF (lat. 1154) avec ce refrain
déplorant la perte de l'Empereur et traduisant la douleur : Heu me dolens,
Heu mi misero,
en 20 strophes ; selon G. Lobrichon, ce « Planctus Karoli n'est
pas une hymne… il se rapproche plutôt du rituel de l'office des morts. »
Charlemagne a aussi relancé les lettres latines, comme en témoigne le chant en
douze parties de Boèce : O stelliferi conditor orbis (O créateur de
la voûte étoilée), Ode du Premier Livre de sa Consolatio philosophiae, manuscrit conservé à la BnF (Ms lat. 1154, f. 118r-119v.). L'Ensemble Ligeriana – comprenant six chanteurs et les instruments
suivants : flûtes de roseau, comes, lyre et lyre à
archet, organistrum s'étant adjoint Guy Robert (harpe
angulaire, carillon, percussion) – s'est surpassé pour restituer musicalement
ces redoutables carmina carolingiana. Il a bénéficié des judicieux conseils
linguistiques de Christophe Tellart pour la
prononciation du latin carolingien selon l'habitude germanique. Tous les textes
figurent en latin et en traduction française. L'excellente acoustique de
l'Abbaye Royale de Fontevraud a largement contribué à
la qualité de l'enregistrement en mettant en valeur les voix si homogènes de
l'Ensemble Ligeriana, avec quelques effets de résonance.
Avec Katia Caré, ils ont le mérite de recréer
fidèlement ces trésors de la Renaissance carolingienne dont ils ont signé une
belle Défense et Illustration. Édith Weber. Marie-Claire ALAIN : « L'Orgue français ». Coffret de
22CDs ERATO (www.erato.com) : 0825646310647. Cet imposant
coffret paraît en 2014, soit un an après la disparition de la regrettée
Marie-Claire Alain. Consacré à ses enregistrements de musique française, il
représente aussi un hommage non seulement à l'une de nos meilleurs organistes,
mais encore à son père, Albert Alain (1880-1971) (CD 18) et à son frère, Jehan
Alain— né en 1911 et mort pour la France, le 20 juin 1940, près de Saumur —
(CDs 3, 20, 21, 22), avec des œuvres connues : Litanies, Tantum ergo… ou moins connues : Intermezzo, Trois Danses… enregistrées aux Orgues Ghys/Bossier/Cicchero de l'Église
Saint-Ferjeux à Besançon ; Dallery/Frères Basiliens/Haerpfer à l'Abbaye de Valloires
(Somme) ; Cavaillé-Coll de l'Église Saint-Germain à Saint-Germain-en-Laye
; Haerpfer-Erman de
l'Église Saint-Jean-Baptiste à Château-Salins, entre autres. L'ensemble reflète
l'éclectisme et l'immense talent de Marie-Claire Alain, ainsi que sa capacité
d'adaptation à des instruments très variés et à des esthétiques si diverses,
allant d'œuvres de Nicolas Lebègue (1631-1702),
François Couperin (1668-1733), Louis
Marchand (1669-1732), Nicolas de Grigny (1672-1703), Pierre Dumage
(1674-1751), Louis-Claude Daquin (1694-1772), jusqu'à
Olivier Messiaen (1908-1992) et Charles Chaynes (né
en 1925), sans oublier César Franck (1822-1890), Alexandre Guilmant
(1837-1911), Eugène Gigout (1844-1925), Charles-Marie
Widor (1844-1937) : c'est dire l'ampleur du répertoire organistique
français : du XVIIe au XXIe siècle. La remarquable Anthologie réalisée par
la « Grande Dame de l'orgue » offre un éloquent panorama des formes
cultivées : Suites, Magnificat, Messes, Hymnes, Noëls, Préludes, Fugues,
Variations, Toccata (Théodore Dubois), Fantaisies, Symphonies pour orgue, Concerto
(de Charles Chaynes pour orgue, orchestre à cordes,
timbales et percussions)... Elle s'est assurée le concours des Chantres de la
Chapelle de Versailles (direction : Emmanuel Mandrin), du Bamberg Symphony Orchestra (dir. : Jean-Jacques Kantorow),
de la Compagnie musicale Catalane (dir. : Josep
Cabré), du Danmarks Radio symfoniorkertret
(dir. : Tamas Veto), de l'Orchestre National (dir. : Jean Martinon) et de l'Orchestre Philharmonique
de l'ORTF (dir. : Serge Baudo),
entre autres. Chaque CD est
illustré par des reproductions des divers instruments enregistrés. Cette
version d'anciens disques stéréo et mono bénéficie évidemment de tous les
progrès techniques actuels de la remastérisation,
mettant encore plus en valeur le résultat sonore. Ce coffret, témoignage
particulièrement émouvant, est à l'honneur du Label ERATO et de la famille
Alain qui a si largement contribué au rayonnement de l'Orgue français. Édith Weber. Jean Sébastien BACH : Chorals de Leipzig (II). Intégrale de l'œuvre
d'orgue, Vol. 9. Helga Schauerte, orgue.
1CD SCAM/SYRIUS. Distribution : Socadisc (www.socadisc.com) : SYR
141458. TT : 70' 36. Helga Schauerte — concertiste internationale, disciple, entre
autres, de Marie-Claire Alain, spécialiste de l'œuvre de Jehan Alain —
poursuit, dans le cadre de son Intégrale
de l'œuvre d'orgue de J. S. Bach, son enregistrement des Chorals de Leipzig (II). Elle a retenu
l'Orgue Johann Berenhard Klausing
(1717) de l'Église abbatiale d'Oelinghausen (près
d'Arnsberg, en Westphalie) dont la dernière restauration a été réalisée par le
facteur Kuhn entre 1999 et 2002. Cet instrument à deux claviers (principal et
pectoral) et pédale, accordé en tempérament mésotonique
modifié, est restitué sur le plan technique et esthétique dans son état de
1717. Le programme commence par la Fantaisie
en sol (BWV 542) et se termine logiquement par la Fugue correspondante, avec un jeu presque staccato et très détaché.
Au milieu de ce triptyque, figurent des Préludes de chorals (à 2 claviers et
pédale) précédés ou suivis de leurs
harmonisations à 4 voix. Ils se réfèrent aux temps liturgiques de l'Avent et de
Noël, avec Nun komm, der Heiden Heiland : Choral harmonisé (BWV 62), Prélude de choral (BWV 659) et Trio (BWV 660) ; et de Pentecôte, avec
Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist, d'après le choral de Martin Luther (adaptation
allemande du Veni
Creator) en 2 versions : Prélude de choral (BWV 667) pour grand orgue et pédale obligée, et Choral harmonisé (BWV 370) ; à ne
pas confondre avec l'autre invocation au Saint Esprit : Komm, Heiliger Geist, Herre Gott,
d'après le choral de Martin Luther (adaptation allemande du Veni Sancte Spiritus) en 2 versions : Choral harmonisé (BWV 226) et Prélude de choral (BWV 652). Parmi les
autres œuvres bien connues, figurent notamment le Choral Nun danket alle Gott, d'abord en sa version harmonisée (BWV 386), puis
comme Prélude (BWV 657). À noter 3
versions du Choral Allein Gott in der Höh sei Ehr
d'abord harmonisé (BWV 104), puis le Prélude
(BWV 662) et enfin le Trio super Allein Gott… (BWV 664), et
également deux versions du Choral Wenn wir in höschsten Nöten sein (Quand nous sommes au plus profond de la
détresse) — que, selon Johann Nikolaus Forkel, quelques jours avant sa mort, J. S. Bach, aveugle,
dicta à son élève et gendre, Johann Christoph Altnikol —
: Choral harmonisé (BWV 432), Prélude de choral (BWV 668a), écrit
d'une main anonyme, peut-être sa dernière œuvre, méditative, dépouillée et
sereine, qui a été vraisemblablement ajoutée au Recueil autographe de Leipzig. L'excellente organiste de l'Église
Évangélique allemande de Paris et Professeure au Conservatoire du IXe
arrondissement (Paris) confirme, par ce CD, sa réputation de brillante
concertiste ; elle réussit à mettre particulièrement en valeur la
structure de chaque choral, avec l'exposition du cantus firmus, soit en valeurs
longues (pédalier ou manuel), soit ornée, ou encore avec des entrées
successives, et à recréer leur atmosphère spécifique : joie, exubérance ou
intériorité. Une réussite de plus à son actif. Édith Weber. « Opus Guitar ». Olivier Pelmoine, guitare.
1CD SKARBO (www.skarbo.fr) : DSK1144. TT : 60' 07. Toujours à l'affût
de programmes variés à découvrir, sous le titre : Opus Guitar, le Label SKARBO propose des
enregistrements d'Olivier Pelmoine qui utilise deux
guitares du luthier français Hugo Cuvilliez (montées
avec des cordes Savarez « Cantiga »). Ce
Professeur au CNR de Dijon, lauréat de plusieurs Concours internationaux et
dédicataire de nombreuses œuvres, s'est imposé sur la scène internationale. Son
programme, particulièrement éclectique, va de Homenaje : Le Tombeau de Claude
Debussy composé par Manuel de Falla (1876-1946) et du Tiento de Maurice Ohana (1913-1992) aux œuvres contemporaines :
Derviches tourneurs d'Éric Pénicaud
(*1952) — de caractère mélancolique et lancinant, inspiré par la mystique
soufie pratiquée par les Derviches qui chantent, dansent inlassablement et
privilégient « l'ivresse répétitive comme un exercice spirituel de
dépouillement ». La Suite Elfique comporte 3 Danses :
incisives, percutantes et très rythmées) et
l'Hommage au Bateau ivre (d'Arthur
Rimbaud), œuvre de José-Luis Narvaez
(*1953), dépouillée, suggestive, avec extraits du texte parlé et traduction
musicale figuraliste des images et idées du texte.
Pour Bic'inium
(sic) — de bicinium : chant à deux voix) — composé par
François Rossé (*1945), l'excellent guitariste s'est assuré la participation,
au violon, de Sara Chenal qui fait preuve de son sens du dialogue en
contrechant avec la guitare, et s'impose notamment par sa remarquable justesse
dans l'extrême aigu et ses solides coups d'archet. Ces pages sont d'inspiration
classique ou non, avec des thèmes traditionnels, par exemple le Sakura,
cerisier-fleurs, faisant l'objet de variations élégiaques, en fait représentant
« une méditation de la mort, une poésie du sacrifice… Elles invitent
à un voyage dans le temps et dans l'espace : Inde, Balkans (Toryanse Tales d'Atanas
Ourkouzonov, où la guitare crée des sonorités proches
du carillon), Caucase (extraits de la Suite
caucasienne de Laurent Boutros, né en 1964)… Cette réalisation originale
bénéficie de remarquables commentaires très circonstanciés d'Étienne Gruillot. Les guitaristes, les discophiles, avides
d'originalité, d'inattendu ou encore de fortes sensations et d'émotions
multiples, ou les mélomanes curieux admireront à sa juste valeur ce programme
révélant des possibilités et sonorités guitaristiques
insoupçonnées. Édith Weber. « Syrinx.
Musique française pour flûte ». Claude Régimbald, flûte, Olga Kerevel, piano, Nathalie Chatelain,
harpe, Gwendoline Quartenoud, alto. 1CD VDE-GALLO (www.vdegallo-music.com) : GALLO CD 1428. TT : 72' 22. Cet hommage à la
musique française pour flûte est réalisé par Claude Régimbald
(flûtiste français originaire du Québec, ayant fait ses études à Montréal et au
Conservatoire de Genève, actuellement Professeur au Conservatoire de Ferney Voltaire), avec le concours de la pianiste Olga Kerevel (élève de l'Académie estonienne, puis du CNSM de
Lyon, chef de chant et répétitrice, pianiste du Chœur de l'Université de Genève
et de plusieurs orchestres), la harpiste Nathalie Chatelain
(élève du Conservatoire de Lausanne, bien connue notamment en Suisse, au
Canada, aux États-Unis et au Brésil) et l'altiste Gwendoline Quartenoud (diplômée de la Haute École de Musique de Genève
et du Conservatoire de Cergy-Pontoise). Comme il se doit, il commence
symboliquement par Syrinx de Claude
Debussy (1862-1918), suivi de sa Sonate
pour flûte, alto et harpe (1915), en 3 mouvements : Pastorale, Interlude et Final. Albert
Roussel (1869-1937) est représenté
par Joueurs de flûte op. 27 (1924) en
4 parties. Le programme se poursuit par des œuvres de compositeurs plus
récents : Pierre-Octave Ferroud (1900-1936) avec Trois pièces pour flûte seule (1920-1921) ; Francis Poulenc
(1899-1963) avec sa Sonate pour flûte et
piano (1957) en 3 mouvements et, pour flûte seule, un titre évocateur
: Un joueur de flûte berce les ruines. Plus
proche de nous, Charles Chaynes (né en 1925) a
beaucoup écrit pour cet instrument dont il connaît parfaitement toutes les
possibilités, comme dans son Prélude pour
la flûte de Jade. Quant à André Jolivet (1905-1974), dans sa Sonate pour flûte et piano : Fluide, Grave, Violent, selon ses
propres termes, il voulait composer « une musique qui retrouve son sens
originel antique lorsqu'elle était l'expression magique et incantatoire de la
religiosité des groupements humains. » D'ailleurs, la flûte est pour
lui : « l'instrument de la Musique ; cela parce que, animée
par le souffle, émanation profonde de l'homme, la flûte charge les sons de ce
qui est en nous d'à la fois viscéral et cosmique. » Voici une synthèse
stylistique originale et convaincante, oscillant entre classicisme, modernisme
et avant-gardisme pour l'époque (dodécaphonisme), avec une remarquable palette
expressive alliant discrétion, calme, volubilité, puissance
magique... Les interprètes se tirent à
merveille de tous les traquenards techniques et restituent avec bonheur tant
d'atmosphères diverses tout en mettant en valeur les nombreuses possibilités de
l'instrument. Sous le titre générique Syrinx,
ils ont le mérite d'illustrer plus d'un siècle de musique française pour flûte. Édith Weber. Frédéric CHOPIN : 14 Waltzes [sic]. 7 Mazurkas. Jean-Marc
Luisada, piano. 1CD RCA Red
Seal : 888 750 28062. Diffusion Sony Music (www.sonymusic.fr ) : CD 0825646310647. TT : 73' 32. Selon Franck Ciup — propriétaire du Théâtre Saint-Bonnet à Bourges et
concertiste —, le pianiste Jean-Marc Luisada
est : « l'enchanteur, l'humaniste à son instrument, l'homme à sa
passion, à son amour de l'art, sculptant ses sons dans un marbre blanc
imaginaire dressant un véritable Taj Mahal dans les nuages et ce ciel où il
vagabonde avec les anges mélomanes ravis de sa présence. » Jean-Marc Luisada a été l'élève, notamment, de Marcel Ciampi et
Dominique Merlet au CNSM de Paris, puis de Nikita Magaloff et Paul Badura-Skoda.
Sous la direction de très grands chefs parmi lesquels Jehudi
Menuhin, Michel Plasson, il s'est produit en France
et à l'étranger et lors de nombreux Festivals. Lauréat en 1983 du Concours
Chopin de Varsovie, il s'est beaucoup investi dans la musique du musicien
franco-polonais. Tenant compte de l'évolution de ses conceptions esthétiques,
il vient d'enregistrer en 2014 une nouvelle version de 14 Valses de Frédéric Chopin (1810-1849) — extraites des opus 18, 34,
42, 64, 69, 70 et posthume — ainsi que 7 Mazurkas,
des op. 67 et 68. Soutenues par une technique à toute épreuve, jamais
ampoulées, ses interprétations des Valses
brillent par la transparence, la fluidité, la clarté, la précision et l'élan
contenu, et s'imposent aussi par le juste choix des tempi, la fidélité aux
intentions du compositeur et l'intelligence de la partition. Les Mazurkas bénéficient d'un solide sens
des accents rythmiques ou encore d'un timbre lumineux et d'une grande
musicalité. Ce disque ne dément certes pas l'appréciation du pianiste mélomane Fanck Ciup. Les discophiles les
plus exigeants seront, eux aussi, comblés. Édith Weber. Aubert LEMELAND : Œuvres pour piano. Jean-Pierre Ferey,
Chrystel Marchand, piano. 1CD SKARBO (www.skarbo.fr) : DSK 1131. TT : 52' 11. Jean-Pierre Ferey et les Disques SKARBO ont bien raison de continuer à
diffuser des œuvres d'Aubert Lemeland (1932-2010). Ce
compositeur français est né à La Haye-du-Puits dans la Manche, le 19 décembre
1932, et décédé à Paris, le 15 novembre 2010. Grand Prix du disque de
l'Académie Charles-Cros (1995) et Diapason d'Or (1998), il comptabilise plus de
200 numéros d'opus, dont des Symphonies, Concertos, Cycles pour voix et orchestre. Il privilégie souvent la
formation pour piano et récitant : c'est le cas de cette réalisation
faisant appel à la voix de Nathalie Bécue, de la Comédie Française — ancienne
élève du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris — et de Chrystel Marchand (deuxième piano) — élève de Nadia
Boulanger et Lauréate du CNSM de Paris, Docteur en Musicologie. Ce tryptique s'ouvre sur Sonath (sic)(op.
191, 2004), œuvre de commande dédiée à « Nath »,
créée par Jean-Pierre Ferey, épousant effectivement
la structure de la forme sonate à l'italienne : vif-lent-vif, et interprétée
par ce pianiste qui a collaboré pendant trente ans avec le compositeur et
assuré la direction artistique de presque tous ses enregistrements. Il se
termine par la transcription (pour récitante et deux pianos) du 1er mouvement
de la Symphonie n°10 (op. 172)
effectuée par Chrystel Marchand, page dans laquelle
la voix de Nathalie Bécue plane sur un fond assuré aux pianos réalisant
également les transitions. Il s'agit de la reproduction de dernières lettres de
soldats allemands encerclés à Stalingrad en 1942, confisquées par les nazis.
Elle a été donnée en première audition à Coblence en 1998, puis en première
exécution publique en France, en 2011, au Conservatoire Municipal Darius
Milhaud (Paris) par les mêmes interprètes. La partie centrale comprend des
titres évocateurs tels que : Suite
des Ballades du Soldat (op. 171) avec, entre autres : Seagulls
(Mouettes), Russian snow, Alaska, Groenland ou encore Impression
of the rain (Impression de la pluie), ainsi que 5
pièces de l'op. 121 : Marines d'été.
Il comporte également Variations (op.
133). Cette musique, tour à tour pittoresque, mystérieuse, descriptive, bien
construite, faisant appel à tout le registre du piano, confirme la parfaite
connivence entre compositeur et interprètes. Édith Weber. Isabelle Aboulker : « 1918. L'homme qui
titubait dans la guerre ». Oratorio.
Thierry Gaches, récitant, A. Dimitrova, soprano, Y.
Toussaint, baryton. Chœur Capriccio. Orchestre d'Harmonie de la Police
nationale, dir. Jérôme Hilaire et Marie-France
Messager. 1CD TRITON (www.disques-triton.com ) : TRI331189. TT : 50' 21. L'année
commémorative de la Grande Guerre a suscité de nombreuses publications
(témoignages, lettres, documents historiques…) et les Éditions TRITON apportent
à leur tour un beau « plaidoyer pour la paix » par le biais de cet
Oratorio sur le livret d'Arielle Augry et la musique
d'Isabelle Aboulker (*1938), avec des titres
évocateurs — dont 4 en versions vocale
et instrumentale. L'Oratorio a été créé en novembre 1998 par l'Orchestre de
Picardie sous la direction d'Edmon Colomer à l'Historial de la Grande Guerre de Péronne et enregistré à Weimar. Les thèmes traités
sont, entre autres l'angoisse, le sang, la douleur, les horreurs de la guerre,
la furie, la rage ; les tranchées, la pluie, les blessés… Comme le précise
l'auteur : « La clé de voûte de notre dramaturgie est la mise en
situation d'un soldat français lors de ce dernier assaut. Nous assistons, avant
qu'il ne meure, à son désespoir, ses souvenirs, ses dernières interrogations et
réflexions sur la tourmente qui l'a emporté. » Il s'agit donc d'un soldat
imaginaire, ultime victime de la guerre, ayant participé à l'un des derniers
combats sur le front, le jour même de l'Armistice du 11 novembre 1918. Certains
textes sont extraits de poèmes de Guillaume Apollinaire, Blaise Cendrars, Jean
Cocteau, Romain Rolland… Les protagonistes sont le comédien Thierry Gaches (récitant), A. Dimitrova (soprano) et Y. Toussaint
(baryton), le Chœur Capriccio créé par Marie-France Messager, de réputation
internationale, et l'Orchestre d'Harmonie de la Police nationale. Ces pièces
très brèves sont dirigées avec infiniment de sensibilité par Jérôme Hilaire et
Marie-France Messager. Nul ne sera insensible aux accents tour à tour
poignants, douloureux, réalistes, lyriques, quasi insoutenables ou encore
percutants et énergiques planant sur ce contexte brutal, inexorable et
implacable. À remarquer le dialogue entre la femme du soldat et le
soldat ; les descriptions (La nuit
descend) ; le texte trilingue : Il pleut, the rain, Regen
insistant sur la pluie lancinante, intrusive ; les accents debussystes
dans J'ai emporté le capitaine
(d'après Jean Cocteau), mais aussi la propagande patriotique, l'intégrité du
territoire à reconquérir, la répartition des tâches : les infirmières
soignent, les soldats exposent leur vie… Chefs et interprètes s'investissent
complètement dans l'action et la commémoration : oratorio à écouter et
réécouter pour en saisir toutes les subtilités psychologiques et toute
l'émotion débouchant sur l'affirmation conclusive : « ceux qui
veulent la paix sont dans un éternel combat. Adieu Paul, adieu Lou »
(Romain Rolland). Réalisation exceptionnelle. Devoir de mémoire oblige. Édith Weber. « Bel Oiseau ». 1CD Assomandarine (www.monthabor.com). Diffusé par L'Autre Distribution : MANDA 1427. TT : 50'
20. L'Association
Mandarine publie des disques pour enfants « dès la naissance et pour toute
la famille » accompagnés d'un livret abondamment illustré reproduisant les
textes faisant preuve d'une grande diversité. Cette réalisation sur des thèmes
inouïs possède des finalités précises : pour compter (Jusqu'à 5), pour caresser les cheveux : Le peigne, pour se faire des bisous originaux : Des bisous… ; des objectifs
pédagogiques : pour dessiner lignes et points : Neige et gribouillis et Dessine-moi,
pour marcher et se cacher : Dans la
forêt (piano), pour manipuler des balles : Le hérisson, sans oublier des « jeux de doigts, de mots et de
maux » (homonymies) : Les
doigts malades et encore une chanson de doigts : Gymnastique. Le disque s'ouvre sur un conte chinois : Monsieur Tsing — qui avale une mouche, une grenouille, un
serpent, une mangouste, un gros tigre, un chasseur… : ça le chatouille ! et appelle le
docteur pour un diagnostique — résultant
d'une imagination folle et faisant appel à des onomatopées percutantes et à des
polyphonies très recherchées. Le n° 17 : Les Sœurs Claquette exploite une voix enfantine en dialogue avec un
adulte, des monosyllabes, onomatopées (snap/clac/croc…)
et bruits très suggestifs. Parmi les œuvres, signalons encore trois
intermèdes : Pâquerette, Aubépine, Pique-fleur et une Valse à
Sido (en version instrumentale). Selon les morceaux, l'interprétation est assurée
par un soliste, un quatuor vocal et les instruments suivants : piano,
percussions, guitare, vibraphone, clarinette, basson, banjo, violon, conférant une grande variété
de sonorités et d'atmosphères. Les enfants seront fascinés par toutes ces
descriptions (devinettes avec les cris des animaux : chien, cochon,
serpent, lion, poule, chat, vache, signe, chèvre, loup) et récits hauts en
couleurs. Les adultes n'en reviendront pas de la capacité imaginative et du
remarquable investissement littéraire et sonore de ce disque comportant 26
pièces : « À vous qui les découvrez aujourd'hui de saisir au vol ces mots
et ces mélodies ». Édith Weber. Antonio CALDARA : La
Concordia de' Pianeti. Composition théâtrale
en musique. Delphine Galou, Veronica Cangemi, Ruxandra Donose, Franco Fagioli, Carlos
Mena, Daniel Behle, Luca Tittolo.
Vokalensemble Basel. La Cetra,
dir. Andrea Marcon. 2 CDs Universal Archiv Produktion : 479 3356. TT.: 58'14+49'55. Le très prolixe compositeur Antonio
Caldara, né à Venise en 1670 (ou 1671), a été très tôt amené à travailler
auprès des grands, appelé par Ferdinand Charles Gonzague, à Mantoue, puis par
le prince Ruspoli, à Rome, enfin par l'empereur
Charles VI, à Vienne, où il demeurera vingt ans à son service et y mourra, en
1736. La sérénade La Concordia de' Pianeti (La
Concorde des planètes) a été composée en 1723 à l'occasion de l'anniversaire de
l'impératrice Élisabeth. Destinée à être jouée en plein air, cette pièce de
circonstance, sans prétention littéraire, qui vante l'harmonie entre les astres
et convoque les dieux pour fêter la souveraine, appelée ici Elisa, renferme une
musique ne souffrant pas de temps mort, souvent grandiose (Ouverture, chœurs
d'entrée et de fin ), toujours extrêmement variée et
magistralement écrite pour la voix. L'inspiration italienne est bien présente,
mais asservie au goût allemand, car l'empereur Charles VI d'Autriche aimait les
sonorités fastueuses. Le schéma est une succession de courts récitatifs
introduisant des arias de haute vocalité. L'interprétation de cette première au
disque, captée live en janvier dernier, le démontre amplement. Au premier chef, Franco Fagioli,
dans le rôle d'Apollon, créé par le castrat Carestini, déploie un timbre charnu, souple comme
velours, et tricote des vocalises incandescentes enchaînées sur un rythme
soutenu jusqu'à l'ivresse de l'extrême aigu. A ses côtés, et le voisinage n'est
pas aisé à assumer, le contre-ténor Carlos Mena, en Mars, offre une manière
moins policée, mais engagée. Les dames ont de glorieux accents, dont les voix
graves de Delphine Galou, Vénus, et Ruxanda Donose, Jupiter. Le ténor
ductile de Daniel Behle, Mercure, et la basse claire
de Luca Tittolo, Saturne, découvert à Aix, dans Ariodante de Haendel,
complètent une distribution homogène. Andrea Marcon,
à qui l'on doit cette redécouverte, imprime à ces pages attachantes des accents
marqués et cette légère tendance à accélérer le tempo qui imprime la vie. Son orchestre de La Cetra n'est pas en reste question flexibilité et finesse de
ton. Jean-Pierre Robert. « Saint
Petersburg ». Arias de Francesco Domenico ARAIA (La forza dell'amore e dell'odio. Seleuco).
Hermann RAUPACH (Altsesta). Domenico
DALL'OGIO/ Luigi MADONIS (Prologue pour La Clemenza
di Tito de HASSE). Vincenzo MANFREDINI (Carlo Magno).
Domenico CIMAROSA (La vergine del
sole). Cecilia Bartoli, mezzo-soprano. I Barocchisti,
dir. Diego Fasolis. 1 CD Universal Decca : 478 6767. TT.: 77'57. Avec ce nouvel album, Cecilia Bartoli nous
offre encore une passionnante leçon d'histoire musicale. Après ses recherches
pour retrouver la trace des maîtres italiens oubliés, c'est vers les musiciens
ayant composé pour la cour de Russie qu'elle se tourne maintenant et nous livre
des inédits pleins de surprises et de saveurs, chantés en italien et même en
russe ; une première ! Ils ont été dénichés dans les archives de la
bibliothèque du Théâtre Mariinsky de Saint
Saint-Pétersbourg. On y voit que trois tsarines ont façonné la musique en
Russie : Anna Ivanovna (1730-1740), Elisabeth I ère (1741-1761) et bien sûr
Catherine II, dite la Grande (1762-1796). Car si l'essor de l'opéra russe
remonte à Mikhail Glinka, avec Une vie pour le
Tsar (1836), il connut de glorieux prémisses à
l'époque baroque, puis à la période classique, lorsque les souveraines
appelèrent à leurs côtés des musiciens renommés, italiens pour la plupart. Et
les compositeurs de la cour auront pour nom le napolitain Francesco Domenico Araia (1709-1770), puis Hermann Raupach
(1728-1778) et enfin Vincenzo Manfredini (1737-1799).
Si le premier vrai opéra représenté en Russie, en 1736, semble être La Forza dell'amore e dell'odio de Araia, sous le
règne d'Anna Ivanovna, c'est Elisabeth I ére qui le
développera, par exemple en faisant venir le célèbre castrat Carestini, ou en confiant à un auteur russe, Alexandre
Soumarokov, pour le première fois un livret d'opéra,
ou encore en nommant Raupach comme compositeur
officiel de la cour. L'épanouissement viendra durant le long règne de Catherine
II. Cecilia Bartoli nous convie à un nouveau
voyage pas moins passionnant que les précédents, peut-être plus extraordinaire
encore. Le choix des morceaux est fascinant, révélant souvent des arias de
facture concertante où la voix dialogue avec un instrument soliste, comme la
flûte (prologue de La clemenza di Tito de
Hasse, composé par Domenico Dall'Oglio) ou la
clarinette (extrait de La vergine del sole de Cimarosa). Il défie aussi toute
catégorisation vocale, mêlant les tessitures de mezzo et de soprano, couronnées
d'aigus percutants. Conformément à une tradition désormais bien établie, vont
alterner pièces de bravoure, de haute voltige, enchaînant les vocalises à
perdre haleine (air d'Hercule extrait de l'Altsesta
de Raupach), et morceaux élégiaques où se déploie un
legato fabuleux. C'est là qu'on apprécie par dessus tout la diva, car ces
longues vocalises cherchées loin dans le medium, et pianissimo, ces trilles
vibrantes coulées sur une phrase, voire sur un mot (le prédestiné « Palpitar », dans l'aria de Seleuco
de Araia) ou ces échanges enamourés avec l'instrument
soliste, le hautbois dans le même extrait, révèlent un art qui n'appartient
qu'à elle et n'a pas d'autre exemple aujourd'hui. Toutes ces musiques, Cecilia Barloli les ennoblit. La complicité avec le chef Diego Fasolis, révélée dans le précédent album « Mission »,
n'est plus à démontrer : le bouillant italien sait déchaîner les éléments en
des tempêtes effrayantes ou des chevauchées inouïes, mais aussi tenir la laisse
courte pour tourner une suave cantilène, cravacher ses forces ou les faire
chanter en des tenues d'une placidité étonnante. Ses musiciens de I Barocchisti se mesurent formidablement à des pages qu'ils
ont dû découvrir avec ravissement avant nous. Sur les ailes du chant. Jean-Pierre Robert. « The sound of light ». Jean-Philippe RAMEAU : Extraits
des Fêtes d'Hébé, Zoroastre, Les Boréades,
Les Indes Galantes, Platée, Naïs, Hippolyte et Aricie, Dardanus, Castor
et Pollux. « La Poule » (six concerts
en sextuor). Nadine Koutcher, soprano, Alexei Svetov, basse. Orchestre
et Chœur Musicaeterna, dir.
Teodor Currentzis. 1 CD
Sony classical : 88843082572. TT.: 66'. Ce disque affiche un titre accrocheur comme
s'il s'agissait de faire de Rameau un vecteur de marketing. N'en fut-il pas
naguère d'un Arvo Pärt !
Avec Teodor Currentzis on
est sûr d'un décapage en règle des canons habituels. Mozart a d'ores et déjà
été testé par le chef grec. Mais comment se singulariser dans Rameau ?
« La musique de Rameau irradie la plus riche lumière apollinienne »
dit-il. Dont acte. Il semble que l'orchestration ramiste,
certes originale, soit pour Currentzis un terrain
d'expérimentation propice. Au mieux, des tempos redondants, passages vifs
secoués de frénésie ou au contraire sections lentes étirées jusqu'à
l'immobilisme. Au pire, des accents inutilement martelés, des écarts de
dynamique incroyablement exagérés. La célèbre « Chaconne » des Indes
Galantes en ressort grossie à l'envi. L'Orage du « ballet des
fleurs » est une course folle plus que rapide. Pareille furia distingue
encore celui de Platée. On est à la limite de la parodie. Même le
« tube » que constitue « Forêts paisibles » des Indes
Galantes sombre dans une rengaine dépourvue d'esprit. Et ce n'est pas parce
que « La Poule » imite les turbulences de la gallinacée qu'il faut en
grossir encore les effets par des ralentissements et des sautes d'humeur aussi
excentriques qu'inefficaces, et surtout hors de contexte. La litote a ses
limites... Faire « moderne » au motif que Rameau l'a été à son époque
n'autorise pas toute licence. Dès lors se pose la question : à qui s'adressent
ces interprétations ? Sûrement pas aux puristes. A de nouveaux amateurs ? Mais
ces derniers ne s'en lasseront-ils pas aussi vite qu'ils les auront découvertes
? La contribution vocale est à l'avenant (acrobaties hystériques de « La
folie » de Platée), pour ne pas dire banale. L'enregistrement,
saisi de très près, n'arrange rien. Que sauver de ce naufrage ? L'Ouverture de Zoroastre,
ou celle de Naïs, encore que cette dernière verse dans la modernisation
outrancière. C'est peu. Une contribution bien inutile à l'année Rameau. Jean-Pierre Robert. Wolfgang Amadé
MOZART : Die Zauberflöte.
Singspel en deux actes. Livret d'Emanuel Schikaneder.
Juia Kleiter, Bernard
Richter, Mandy Fredrich, Georg Zippenfeld,
Markus Werba, Elisabeth Schwarz, Sandra Trattnigg, Anja Schlosser, Wiebke Lehmkuhl, Rudolf Schasching, Martin Gantner. Tölzer Knaben. Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor. Concentus Musicus Wien, dir. Nikolaus Harnoncourt. Mise en scène :
Jens-Daniel Herzog. Salzburger Festspiele
2012. 2DVDs Sony Classical : 88843005729. TT.: 186' Cette version de La Flûte enchantée
est une affaire sérieuse, voire grave. La captation de la production du
Festival de Salzbourg 2012, qui focalise sur un aspect visuel sans cesse en
mouvement, exacerbe l'impression qu'on en avait lors de la représentation. On
est loin de la « magic flute », avec ce que
cela implique de part de rêve, et ce malgré la profusion de couleurs, dans les
costumes et certains accessoires. L'interprétation maçonnique est soigneusement
déplacée vers d'autres significations.
La mise en scène de Jens Daniel Herzog donne résolument dans
l'interprétation sollicitante : des héros soumis à un
parcours d'embuches plus que d'épreuves, une lutte à mort entre la Reine de la
nuit et Sarastro, des visées plus que libidineuses de
la part de Manostatos et de ses acolytes, sortis tout
droit de quelque pensionnat... On ne s'y retrouve pas toujours au milieu de
cette approche foisonnante, souvent absconse. Ainsi de Sarastro
et de ses adjoints zélés en blouses blanches, chaussant lunettes, proches d'une
secte en quête d'expérimentation. La dureté de certains traits, soulignée par
le film, procure presque un sentiment de malaise : les trois Knaben transformés en petits vieillards, la Papagena aux tics accentués d'Alzheimer, dont les
évolutions gauches sont téléguidées par quelques gourous en mal de nouvelles
expériences, ou encore la mise en place de la batterie de tests auxquels vont
être soumis les protagonistes masculins, Tamino et Papageno, version interrogatoire plutôt musclé. Le texte
parlé, donné ici dans une version assez détaillée, ne facilite pas non plus les
choses pour un spectateur français. Reste une direction d'acteurs au cordeau,
parfaitement saisie par la prise de vues, qui pousse loin l'investigation, même
pour ce qui est de chaque membre du chœur. L'attrait de cette version réside en
réalité dans son volet musical, et au premier chef dans l'exécution de Nikolaus Harconcourt à la tête de
son Concentus Musicus. Même
si, là aussi, la gravité du propos s'impose, en émane une vivante dramaturgie
sonore marquée par un souci extrême de l'articulation, du plus alerte au plus
posé, qui transcende l'idée même de tempo. Ainsi l'Ouverture, extrêmement vive,
préjuge peu de la manière grandiose dont le grand chef autrichien habite cette
œuvre immense dans l'accompagnement des arias et des ensembles. Et quelle
fascinante beauté sonore, dans les vents en particulier ! Chaque aria est un
modèle, ciselée avec un soin infini, idéal écrin pour la voix. La sûreté instrumentale
est un constant sujet de bonheur, la flûte notamment. La distribution est de
haute tenue, dominée par le Pagageno de Markus Werva, d'une santé vocale et scénique merveilleusement
authentique. Jean-Pierre Robert. César FRANCK : Sonate pour violon et piano
en La majeur. Edvard GRIEG : Sonate pour
violon et piano N° 3, en do mineur, op. 45. Antonin DVOŘÁK : Pièces
romantiques, op. 75. Renaud Capuçon, violon, Khatia Buniatishvili, piano. 1CD
Erato : 0825646250189. TT.: 66'20. Avec les trois mêmes œuvres que celles de
leur récent concert parisien, le voyage auquel nous convient Renaud Capuçon et Khatia Buniatishvili se fait, au disque, dans l'ordre inverse. Il
débute par la Sonate de Franck. Ce sommet d'élégance française, où pas une note
n'est de trop, les deux interprètes en livrent une vision emplie de contrastes
et d'une rare beauté plastique. Le « ben moderato » initial est très
retenu voire lent, avant une montée en intensité du violon magistrale.
L'allegro suivant est presque emporté en comparaison, contraste fort, alors que
le développement élégiaque renoue avec l'extrême mesure. La récapitulation sera
haletante. Au « recitativo fantaisie »,
centre de l'œuvre, dont il forme le mouvement lent, le violon solaire de Renaud
Capuçon est à son meilleur, souple, réfléchi,
idéalement timbré sur tout le registre, tandis que Khatia
Buniatishvili ménage un pianisme
magique. L'apparente mélancolie n'est pas tristesse. Le rondo final magnifie
l'écriture contrapuntiste de Franck, refrain et ses couplets, sur le mode
cyclique. Lorsque le débit s'anime, les deux partenaires prennent des risques
calculés pour faire éclore la passion. La péroraison n'est rien moins que
glorieuse. Une immense exécution, servie par une prise de son saisissant les
deux instruments dans leur vraie dimension, leur idéale fusion, qui laisse loin
derrière la vieille séparation stéréo gauche-droite. La Troisième Sonate violon
et piano de Grieg (1887) offre une écriture plus compacte que celle du
français, et encore ancrée dans le climat romantique. Mais faisant la part
belle aux nombreux motifs l'innervant, et servant magistralement le violon. A
l'exemple du « molto ed appassionato » qui
l'ouvre, contrastant un thème puissamment dramatique et un thème lyrique,
aérien, et offrant des climats tour à tour allant et en vagues déferlantes. La
partie centrale évolue comme un Lied, d'abord introduite par le piano. Puis
l'allure se fait vite plus agitée et scandée avec des pizzicatos rageurs du
violon, dans un mode emprunté au folklore norvégien. L'« animato »
conclusif prolonge cette impression de musique populaire, mettant la pression
sur le violon, ce qui ne va pas sans une note plus nostalgique dans une seconde
section plus expansive. Les Pièces romantiques de Dvořák
alignent quatre délicats morceaux que Renaud Capuçon
qualifie de « perles de poésie et de romantisme ». A juste titre, à l'écoute de ce qu'il en fait
avec sa partenaire inspirée. Un superbe CD. Jean-Pierre Robert. « Prayer ».
Ernest BLOCH : Jewish Life. Baal Shem. Méditation Hébraïque.
Schelomo. Dimitri
CHOSTAKOVITCH : 4 pièces tirées de « Jewish Folk
Poetry », op. 79 (arrangement pour violoncelle
et orchestre à cordes de Mikhail Bronner).
Pablo CASALS : Song of the Birds.
Sol Gabetta, violoncelle. Amsterdam Sinfonietta, Cello Ensemble
Amsterdam Sinfonietta. Orchestre National de Lyon, dir. Leonard Statkin (Schelomo). 1CD Sony : 88883762172. TT.: 59'03. Le compositeur Ernest Bloch (1880-1959)
d'origine suisse, naturalisé américain en 1924, est un néoclassique. Et un
chantre de la musique hébraïque, de par son habileté à exprimer « la
grandeur de la souffrance humaine » dira son élève Roger Sessions. Rien
d'étonnant dès lors à ce qu'il ait écrit pour le violoncelle, l'instrument de
l'âme. La Rhapsodie hébraïque Schelomo
(Salomon), de 1916, pour violoncelle et orchestre est en fait un grand et beau
poème symphonique composé de trois mouvements enchaînés selon le schéma
lent-vif-lent. Ne se voulant pas archéologue, Bloch évoque l'esprit hébreu dans
cette évocation de Salomon, inspirée des textes bibliques et de l'Ecclésiaste.
La partie soliste est virtuose et celle d'orchestre tout aussi luxuriante. Sol Gabetta en livre une exécution vibrante, pleine d'émotion.
Et Leonard Slatkin déploie la large palette de
couleurs de cette musique. Jewish Life (1924)
est une succession de pièces chambristes, jouées de manière continue :
évocatrices de la douleur, aux sombres accents (Prayer),
magnifiant la déclamation hébraïque, plus élégiaque dans
« Supplication », et de nouveau comme une plainte déchirante dans le
morceau éponyme. Sol Gabetta rapproche de ces
diverses pièces de Bloch quelques extraits de La poésie populaire juive
op.79a de Dimitri Chostakovitch, conçue à l'origine comme un cycle pour chant
et piano, puis transcrit par l'auteur pour soprano, alto, ténor et orchestre
(1963). Il s'agit ici d'un arrangement pour violoncelle et orchestre à cordes
dû à Mikhail Bronner. Sont
mis en exergue tour à tout le registre grave de l'instrument sur une pédale des
cordes (Berceuse), la douceur du trait (Avertissement), la déploration profonde
(Chant de misère), et un rythme allègre, d'inspiration folklorique (Le chant de
la jeune fille). Elle conclut par une courte œuvre de Pablo Casals, Le chant
des oiseaux, écrite pour un ensemble de violoncelles, arrangement d'un
chant catalan de Noël, qui fut l'hymne des exilés lors de la dictature
franquiste. Jean-Pierre Robert. Gabriel FAURE : Quatuor pour piano et
cordes N° 1 op. 15. Mel BONIS : Quatuor pour piano et cordes N° 1, op. 69. Quatuor Giardini. 1CD Evidence Classic / Little Tribeca :
EVCD004. TT.: 56'43. Voici un couplage original dans un
répertoire exigeant, le quatuor pour piano et cordes. Gabriel Fauré aborde son
premier quatuor op. 15 en 1877. La genèse en sera lente, et peu après la création
en 1880, il en réécrira le finale. Tout n'est ici que jaillissement thématique.
Le jeune Quatuor Giardini en donne une exécution
pudique, se gardant de tout excès « romantique » : énergie canalisée au
premier mouvement et au scherzo dont la scansion est justement primesautière,
refus d'un inutile épanchement à l'adagio, pas moins bien chantant, par un
refus de se laisser aller à une trop facile ivresse sonore. Le finale, allant,
sait s'animer dans le développement. Cette vision retenue, différente d'autres
exécutions plus volontaristes comme l'est celle du Trio Wanderer
et d'Antoine Tamestit (Harmonia Mundi),
et qu'on n'attendait peut-être pas chez de jeunes musiciens, n'a cependant rien
de compassé. L'équilibre piano-cordes est parfait car le piano de David Violi reste magistralement fluide. L'attrait du disque se
concentre sur l'autre pièce. La compositrice Mel (pour Malénie)
Bonis (1858-1937) appartient à ces musiciens qui au tournant du siècle auront
revitalisé la vie musicale. Poussée par Franck pour entrer au Conservatoire,
elle y côtoiera Debussy et Pierné. Elle cachera une vie sentimentale difficile
- mariée à un grand industriel, elle gardera une tendresse pour un journaliste
musical dont elle aura une fille, l'identité en étant tenue secrète - dans la
composition. Son corpus important, piano, orgue, voix, musique de chambre et
même orchestre, sort peu à peu de l'ombre. Écrit durant sa période créatrice
essentielle, son premier Quatuor pour piano op. 69 (1900/1905), montre une
grande sensibilité à travers une écriture structurée, au contrepoint rigoureux
et d'une belle veine mélodique. Des élans passionnels, dignes de Fauré,
distinguent l'Intermezzo, marqué allegretto tranquillo,
avec une section médiane d'un beau lyrisme évanescent, comme le finale, habité
d'un sûr sens de la modulation. Dans le moderato initial, le piano s'affirme
par rapport aux cordes. Mais c'est l'andante, centre névralgique de l'œuvre,
qui séduit le plus, méditatif, ample, un brin nostalgique, avec une progression
en intensité où le piano marque, là encore, sa prééminence. Comme dans le
Fauré, les Giardini démontrent un sens parfait de
l'équilibre des voix et un fini instrumental enviable. Une prise de son proche
ajoute à la démonstration de chaude musicalité. Une formation à suivre de près. Jean-Pierre Robert. Gabriel FAURE : Trio pour piano op. 120.
Gabriel PIERNE : Trio pour piano op. 45. Trio Wanderer.
1CD Harmonia Mundi : HMC 902192. TT.: 57'25. Autre rapprochement saisissant que les
trios avec piano de Fauré et de Pierné, dont les dates de composition sont
pratiquement contemporaines. Le Trio op 120, qu'il compose à la demande de son
éditeur Durand, appartient à la dernière manière de Fauré : dépouillée, quelque
peu énigmatique, d'une intériorité presque troublante, d'« une noble et
sereine mélancolie », selon Vladimir Jankélévitch (in « Fauré et
l'inexprimable », Plon). La deuxième audition sera confiée, en juin 1923,
au Trio Cortot, Thibault, Casals. Un flot ininterrompu ouvre l'allegro initial,
d'abord feutré, pour progresser en intensité et conclure rayonnant. L'ascétisme
du matériau n'empêche pas la limpidité. Le thème, en apparence simple par
lequel débute l'Andantino, laisse peu présager ce que Fauré va en faire en
termes de développement complexe. Si la conclusion se fait apaisée, elle est
gagnée au prix de bien des méandres, typiques chez le musicien. L'allegro vivo
final mêle deux thèmes : l'un, pathétique, est inspiré de l'air de Paillasse
« Vesti la Giubba »
de Ruggero Leoncavallo, l'autre fébrile, bondissant au
piano, livre des accents bien tranchés que traverse soudain un geste
dramatique, avant une conclusion jubilatoire. Gabriel Pierné (1863-1937) avait
composé son Trio op. 45 en 1921. De vastes proportions, car atteignant près de
40', l'œuvre évolue entre tradition, l'héritage franckiste par sa forme
discrètement cyclique, et modernité du fait d'une écriture solidement
charpentée, pour ne pas dire complexe. L'inventivité harmonique semble y être
illimitée comme les audaces rythmiques. Les trois voix sont utilisées de manière très libres, dont une partie de piano extrêmement
ouvragée. « Agité, de mouvement et de sentiment », le long premier
mouvement offre élan et rythmique affirmée. Celle-ci se poursuit dans l'allegro
scherzando suivant, inspiré du zortzico basque,
sur un rythme à 5 temps, donnant une agréable impression de sautillement. Cette
étrange scansion avait déjà été expérimentée par Saint-Saëns, et surtout par
Ravel dans son Trio pour piano précisément. Pierné lui-même y avait recouru
dans son Quintette avec piano de 1916. Le « Modérément lent » final,
bâti sur le schéma du thème et variations, offre une variété de climats et des
trouvailles originales : notes répétées du violon dans l'extrême aigu,
succession d'accords du piano, etc. Ces pièces n'ont point de secret pour le
Trio Wanderer qui, outre la perfection instrumentale
que l'on sait, distille des exécutions hautement chargées de sens. Jean-Pierre Robert. Reynaldo HAHN : Ciboulette. Opérette en trois actes et quatre
tableaux. Livret de Robert de Flers et François de Croisset. Julie Fuchs,
Jean-François Lapointe, Julien Behr, Eva Ganizate, Roman Dubois, Cécile Achille, Jean-François
Saragosse, Guillemette Laurens, Patrick Kabonga Mubenga. Bernadette Lafont,
Michel Fau, Jérôme Deschamps. Accentus. Orchestre
symphonique de l'Opéra de Toulon, dir. Laurence Equilbey. Mise en scène : Michel Fau. Opéra Comique,
février 2013. 2DVDs Fra Musica/Opéra Comique : FRA
0009. TT.: 145 '. Saisi live lors des
représentation de février 2013, à l'Opéra Comique, ce spectacle
réhabilite sûrement Reynaldo Hahn et une certaine
forme d'humour facile et de mélodies aisées, tant en vogue à l'époque, 1923, la
dite Belle Époque. « Moi, j' m'appelle Ciboulette », le refrain du
muguet ou le duo « Nous avons fait un beau voyage » restent des
moments de musique simple mais efficace. L'absence de prétention littéraire du
livret, remis au goût du jour avec tact ici, ne gêne pas : on sourit à tel bon
mot désopilant ou se délecte de telle sentence bien assénée. Car ce type d'opérette
n'a pas pour dessein de faire réfléchir, mais avant tout de divertir. Et à
cette aune, on ne s'ennuie pas. La mise en scène de Michel Fau a le bon goût de
ne pas souligner le convenu de certaines situations, mais créé une habile
connivence avec le public. Elle évite en effet la mièvrerie, qui en particulier
peut naître du passage du chanter au parler, pierre d'achoppement de ce type
d'œuvre. Dans ce qui est un marivaudage amoureux traité sur le ton léger, une
pointe de nostalgie appert çà et là, car on ne peut jouer innocemment avec les
vrais sentiments. On admire l'ingéniosité de la décoration qui, sur l'aire
relativement restreinte de la scène de la salle Favart, parvient à créer
l'illusion d'espace, par des toiles peintes évocatrices et un attirail d'objets
au délicieux charme rétro. Les mouvements sont vifs, même si le dernier tableau
du triomphe de Conchita Ciboulero frôle la revue de
Caf' conc'. Tout cela est servi par un plateau vocal
qui a du répondant. L'abattage de Julie Fuchs, Ciboulette, fait plaisir à voir
et son joli minois ravit tout autant que l'achèvement musical émeut. Le Duparquet de Jean-François Lapointe dépasse le cliché du
faiseur de destins heureux et apporte une épaisseur insoupçonnée à un Rodolphe
devenu fonctionnaire, lors de l'évocation de la fin de Mimi, l'instant d'un air
de haute tenue. Le ténor Julien Behr est attachant à
force de franche innocence et de vraie-fausse balourdise, colorant un chant
finement ciselé. Alors que le fil dramatique pourrait s'essouffler, le numéro
de Castafiore de Michel Fau au dernier acte est
irrésistible, quoique un peu longuet, et l'incarnation du Directeur d'opéra par
le maître de céans, Jérôme Deschamps, un morceau d'anthologie. Tout comme celle
de Bernadette Lafont en poissarde réhabilitée en dame
du monde. Le chœur Accentus est plus opératique que
nature et Laurence Equilbey sait trouver le ton juste
d'une musique dont la qualité première est la sincérité dans ses tournures légères, ses échanges vifs,
ses ensembles bien ficelés. Jean-Pierre Robert. Claude DELVINCOURT : L'œuvre pour violon et
piano. Danceries. Sonate pour violon et piano (1922). Contemplation. Sonate de
jeunesse pour violon et piano (1907). Eliot Lawson, violon, Diane
Andersen, piano. 1 CD Azur Classical : AZC121. TT.:
73'25. Claude Delvincourt (1888-1954), formé
auprès d'Henri Büsser et de Charles-Marie Widor,
obtient le Prix de Rome en 1913, en même temps que Lili Boulanger
, et va dès lors poursuivre une carrière enviable de compositeur,
nullement ralentie par ses fonctions administratives : après celui de
Versailles, en 1932, il prend la direction du conservatoire de Paris en 1941.
Sa production touchera les genres les plus divers, symphonique, vocal, musique
de chambre et même opéra. Mais son instrument favori restera le piano. Le
présent disque, édité sous l'égide du Centre international Albert-Roussel et de
la Fondation Palazzetto Bru Zane, propose l'intégrale
des pièces écrites pour violon et piano. Elle débute par une Sonate de jeunesse
(1907), manuscrit récemment retrouvé, d'un musicien « affamé de
musique » dira Hélène Jourdan-Mohrange dans son
livre « Mes Amis Musiciens » (1955). Ses quatre mouvements, joués
d'un seul tenant, révèlent une belle générosité mélodique, même si le clavier
laisse éclater sa prédominance, alors que la partie de violon est d'inspiration
plus banale. Rien de tel dans l'autre sonate, écrite en 1919, qui par son style
personnel imaginatif et sa sûre écriture pour les deux instruments, ne pâlit
pas auprès des autres chefs d'œuvre d'une époque peu avare dans ce genre
musical. Ses quatre mouvements déploient une inspiration qui ne faiblit pas, où
alternent des climats changeants, dont un andante mystérieux, comme un songe
hors du monde. La pièce se termine de manière méditative par un retour du thème
sombre qui ouvrait le premier mouvement. Deux autres œuvres plus tardives
montrent combien le style de Delvincourt a évolué. Danceries
(1934) s'affiche moderniste, succession de morceaux emplis d'une vitalité
débordante, voire facétieux, pas loin du music-hall, mais aussi de l'humour
distingué de Chabrier. Elles déclinent un vrai catalogue de bonne humeur sur le
mode de la fantaisie souvent débridée (« Ronde »,
« Farandole »), avec de surprenantes ruptures de ton (« Bourrée »)
ou une manière plus apaisée (« Louisiane ») faisant référence à la
musique noire américaine. Contemplation (1935), dernière œuvre confiée
au violon et au piano, déroule une thématique orientaliste et une ligne
violonistique affirmée. Le violoniste belge Eliot Lawson et la pianiste Diane
Andersen jouent ces pièces avec une évidente empathie et nous font toucher du
doigt un pan oublié de la musique de chambre française. Jean-Pierre Robert. Carl Philipp Emanuel BACH : Cello Concertos.
I Solisti di Pavia,
violoncelle et dir. Enrico Dindo.
1 CD Decca : 481 0070. TT : 65'51. Un enregistrement datant de 2012 qui
présente les trois concertos pour violoncelle de Carl Philipp
Emanuel Bach (1714-1788), compositeur dont on fête cette année le bicentenaire
de la naissance. Excellente occasion pour réécouter ces trois concertos dont on
ne sait s'ils ont été écrits initialement pour le violoncelle ou s'il s'agit de
transcriptions de concertos pour clavecin, instrument dont le fils Bach était
un maitre reconnu. Des œuvres probablement composés dans les années 1750. Une
musique virtuose, très ornementé,e
allant au bout des possibilités techniques et acoustiques de l'instrument et du
soliste. Une musique pleine d'allant, qui peut parfois sembler manquer un peu
d'âme, qui s'éloigne du monde baroque pour aborder aux rives du classicisme
naissant, dont Haydn saura s'inspirer pour la composition de ses deux concertos
pour violoncelle plus tardifs. Une belle interprétation d'Enrico Dindo à la tête de ses Solistes de Pavie. Patrice Imbaud. « Invitation
au voyage ». Mélodies françaises. Stéphanie d'Oustrac,
mezzo-soprano. Pascal Jourdan, piano. 1 CD Ambronay :
AMY042. TT : 70'59. Au-delà de toute vaine querelle
philosophique sur les rapports de la musique et de la poésie, et de toute
considération sociologique, aujourd'hui dépassée, sur la place de la mélodie
dans l'univers bourgeois du XIXe siècle, il faut bien avouer que cet
enregistrement, dès la première écoute, nous place sous un charme envoûtant, un
véritable enchantement. Le charme si particulier de la mélodie française, où
prosodie et musique se fondent intimement. Un univers d'une subtile délicatesse
où chant et piano se complètent, s'entrelacent dans une étonnante et élégante
complicité, une symbiose totale confinant rapidement à l'égrégore. Des
compositeurs (Henri Duparc, Jacques de la Presle, Debussy, Lili Boulanger et Reynaldo Hahn) et des auteurs (Baudelaire, Sully Prudhomme,
Mallarmé, Francis Jammes) pour un choix avisé d'une vingtaine de mélodies. Un
piano chatoyant et attentif, une belle voix ronde et voluptueuse, d'une grande
plasticité dont on regrettera parfois le caractère un peu maniéré qui nuit à la
diction et à la compréhension des textes… Un très beau voyage à travers la
mélodie française. Patrice Imbaud. Ludwig van BEETHOVEN. Piano Concertos 1
& 2. Louis Schwizgebel,
piano. London Philharmonic Orchestra, dir. Thierry Fischer. 1 CD Aparté : AP098. TT :
65'. Deux concertos pour piano que l'on peut
regrouper sous le même corpus, correspondant tous deux à la même période créatrice
où le jeune Beethoven, âgé d'une trentaine d'années cherche à faire valoir et
reconnaître ses talents de pianiste et d'improvisateur, pour conquérir le
public viennois. Deux œuvres qui n'eurent pas les faveurs tardives du
compositeur, une musique encore tournée vers le XVIIIe siècle, fortement
inspirée par Mozart et Haydn. Des compositions où les caractéristiques
beethovéniennes de la musique concertante ne se font pas encore sentir, le
piano restant ici largement prédominant. Prenons donc ces concertos pour ce
qu'ils sont, de belles pièces pianistiques où Louis Schwizgebel
peut laisser libre cours à sa magistrale virtuosité et à son pianisme très abouti. Thierry Fischer, plein de fougue, à
la tête du LPO, tisse un superbe écrin à cette belle interprétation. Une
musique en devenir qui atteindra par la suite les sommets que l'on sait avec
« l'Empereur » notamment.
Un bel enregistrement. Un pianiste à suivre… Patrice Imbaud. Ludwig
van BEETHOVEN. Concerto
N° 5 pour piano et orchestre , dit « L' Empereur ». Cyprien Katsaris, piano. Academy of St Martin in the Fieds, dir. Sir
Neville Mariner. 1CD Piano 21 : P21 051- N. TT.: 75'35. Certains esprits frondeurs se diront avec
raison, voici une version de plus du célébrissime Concerto n° 5 de Beethoven, dernier de ses concertos pour piano et
orchestre, composé en 1809, créé en 1812
à Vienne par Carl Czerny, Beethoven étant incapable d'en assurer la création du
fait de sa surdité. L'accueil du public viennois, conservateur, fut pour le
moins mitigé devant cette œuvre novatrice qui peut être considérée comme une
véritable symphonie concertante avec piano. Force est d'avouer que ce nouvel
enregistrement n'apporte rien de plus à l'important corpus d'interprétations de
cette œuvre mythique. Une interprétation honnête, un peu fade, qui ne fera pas
référence. De ces versions agréables faisant montre d'un beau piano et d'un
accompagnement orchestral de qualité, mais sans génie, sans ce petit rien qui
accroche l'oreille pour faire les versions de référence. Vient s'y adjoindre
une version, en première mondiale, pour piano solo, réalisée par Cyprien Katsaris. Un arrangement qui correspond à un rêve
d'enfant…Un rêve bien personnel qu'il convient de respecter mais qu'on n'est
pas obligé de partager ! Patrice Imbaud. « Erik SATIE. 1912-1925 ». Orchestration de
Michel DECOUST de pièces pour piano. Orchestre Régional de Basse-Normandie, dir. Jean-Pierre Wallez. 1 CD Skarbo : DSK3135. TT : 66'38. Erik Satie (1866-1925) un compositeur pour
le moins original et inclassable, une sorte d'électron libre surgi dans la
musique, une personnalité hors du commun, ironique, dont l'humour dévastateur
se retrouve souvent dans les annotations de ses partitions. Auteur de
nombreuses pièces pour piano dont cet enregistrement présente un large aperçu :
Trois nouvelles enfantines, Embryons
desséchés, Heures séculaires et instantanées, Les chapitres tournés en tous
sens, Vieux sequins et vieilles cuirasses, Les trois valses distinguées du
précieux dégouté, l'enfance de Ko-Quo, Véritables préludes flasques (pour un
chien), Les pantins dansent, Descriptions automatiques, Sports et
Divertissements, Les avant dernières pensées et Croquis et agaceries d'un gros bonhomme en bois. Des œuvres toutes tirées de la période dite
humoristique ou satirique, de 1912 à 1915, dans une orchestration magnifique de
Michel Decoust. Une orchestration admirable et
brillante, utilisant de façon savante et pertinente tous les timbres de
l'orchestre, notamment les vents, pour rendre à la musique de Satie tout son
génie, son pouvoir de séduction et d'humour, toute sa délicatesse et sa beauté
énigmatique, parfois vénéneuse… Un pari audacieux, totalement réussi qui
enrichit ces pièces d'un nouvel éclairage particulièrement juste et
intelligent. L'Orchestre de Basse-Normandie, sous la baguette de Jean-Pierre Wallez, se montre à la hauteur de la tâche en restituant à
ces pièces leur éclat et en exploitant toutes les facettes de cette musique
souvent insolite et charmante. Un
disque original à ne pas manquer ! Patrice Imbaud. Francis
POULENC. Ballet Suites : Les Biches. Les Animaux modèles. Aubade.
(Versions pour piano). Jean-Pierre Armengaud, piano.
1 CD Naxos : 8.573170. TT : 77'14. Qui mieux que le pianiste Jean-Pierre Armengaud, spécialiste de la musique française et notamment
de Poulenc, pouvait servir, de manière judicieuse, cette très belle musique de
ballet, à la fois légère et désespérée ? Des versions pour piano qui ne
sont en rien des réductions, mais qui gardent au contraire toute leur
légitimité, car correspondant aux partitions originales secondairement
orchestrées pour la scène. Francis Poulenc (1899-1963), membre du groupe des
Six, a beaucoup composé pour la danse, collaborant avec Diaghilev et ses
Ballets Russes. Ces Suites de ballet, dans leur version initiale pour piano
correspondent, en effet, à une sorte d'épure compositionnelle où peut se lire
l'évolution de la « manière » du compositeur. Centrées sur le thème
de l'amour, elles portent en filigrane le véritable parcours biographique de la
vie sentimentale du compositeur. Les Biches (1923), Aubade (1929) et Les Animaux
modèles (1940), trois « ballets pour piano » ou encore
« concertos chorégraphiques » ayant toutes trois une double
destination, la danse et le concert. Une musique et une interprétation très
chorégraphique, pleine de charme et de couleurs, cocasse et poignante. À ne
manquer sous aucun prétexte. Patrice Imbaud. Richard
STRAUSS. Also sprach Zarathustra, op. 30. Till Eulenspiegels
lustige Streiche, op. 28. Don Juan, op.
20. Berliner Philharmoniker, dir. Gustavo Dudamel. 1 CD Universal Deutsche Grammophon :
479 1041. TT; : 69'40. Il est certain qu'à la Philharmonie de
Berlin, on connaît son Richard Strauss sur le bout du doigt. Une expertise
reconnue, fruit d'une longue et parfois houleuse collaboration entre la
mythique phalange et le compositeur allemand. En revanche il s'agit, ici, du
premier enregistrement « live » des Berliner
sous la direction du chef vénézuélien Gustavo Dudamel.
Un coup d'essai, mais un coup de maître compte tenu de la jeunesse de celui-ci.
Trois grands poèmes symphoniques au programme de ce disque, corpus peut-être le
plus original de l'œuvre straussienne où le compositeur révèle toute son
inspiration créatrice. Ainsi parlait
Zarathoustra, d'après Nietzsche, datant de 1896. Une œuvre à programme où
le compositeur se propose de retracer l'épopée humaine depuis les origines
jusqu'à l'avènement du Surhomme. Ambitieux projet dont Gustavo Dudamel donne une lecture presque chambriste, très
pertinente, faisant valoir toute la somptuosité et la transparence de
l'orchestration et des couleurs straussiennes. Une interprétation toute en
délicatesse, en nuances, respectueuse des équilibres. Till l'Espiègle (1895), figure emblématique de la libération
flamande contre la tyrannie de Charles Quint, dont Strauss n'a gardé que le
côté facétieux et turbulent, dans une succession d'aventures burlesques mettant
à l'épreuve la plasticité et la virtuosité de l'orchestre. Don Juan (1889) enfin, très réussi, à la fois romantique et
tragique, lyrique et méditatif, étalant l'évidente beauté de ses thèmes, se
développant autour du désir, de la possession et du désespoir. Un disque
remarquable, qui au-delà des options d'interprétation de Gustavo Dudamel, montre, une fois de plus, la qualité musicale superlative
des Berliner Philharmoniker,
sans toutefois remettre en cause les références historiques gravées par Karajan
ou Furtwängler. Patrice Imbaud. Nikolaj
KAPUSTIN : Cello Concerto n° 2. Astor PIAZZOLLA : Las Cuatro Estaciones Portenas. Le Grand Tango. Oblivion. Ave Maria. I Solisti di Pavia, violoncelle et dir. Enrico
Dindo. 1 CD Decca : 481 0758. TT : 69'58. Un disque découverte, du moins pour ce qui
concerne le compositeur russe Nikolaj Kasputin
(*1937). Piazzolla et Kasputin, deux compositeurs
inclassables, à la marge de la musique classique, deux compositeurs ayant
réussi le difficile syncrétisme du classique et des musiques populaires, Jazz
pour l'un, Tango pour l'autre. En cette époque post moderne, les écoles ne font
plus recette et la musique s'atomise en de nouveaux courants où chacun créé sa
propre voie créative, privilégiant les aspects les plus proches de sa
sensibilité. Le Concerto n° 2 pour
violoncelle et orchestre à cordes de Kasputin date de
2002. Toutes les structures classiques y sont transformées par les principes du
jazz. Même syncrétisme pour Piazzolla, maître du « nouveau tango »,
un tango peut-être plus policé que celui qu'on dansait dans les bouges des
quartiers populaires de Buenos Aires. Le
Grand Tango associe contrepoint, chromatismes et éléments jazzistiques. Les Cuatro Estaciones Portenas parviennent
à fondre tango et musique savante, échappant à la danse pour devenir musique à
écouter. Un disque plein de charme, original, magnifiquement joué. Une belle
complicité entre Enrico Dindo et son ensemble des
Solistes de Pavie. A découvrir absolument. Patrice Imbaud.






































***
MUSIQUE ET CINEMA
CONCERTS
Les
AUDI TALENTS AWARD : La BO en cinémascope au Grand Rex à Paris !

Le 1er et 2 novembre derniers
ont eu lieu les Audi Talents Award pour la troisième édition. A La Gaité Lyrique
et au Grand Rex c'était la fête de la musique à l'image. Chaque année, entre
autres prix, - pour designers,
urbanistes, plasticiens, architectes – le mécénat Audi récompense un jeune
compositeur et un réalisateur de court-métrage. Cette année, le musicien Laurent
Graziani a été nommé et le prix du court-métrage a été attribué à Coralie Fargeat
pour son film magnifique de SF « Reality Plus ». Parallèlement, des master classes ont eu lieu avec Jean-Michel Bernard, le
compositeur attitré de Michel Gondry, Michael Giacchino - en direct depuis Los Angeles -, le musicien des films de J.J.Abrams, et la découverte pour la plupart des personnes
présentes - la salle était bondée à la Gaité Lyrique – de Fernando Velázquez.
Brillant jeune compositeur, ce dernier a écrit, entre autres, la musique de
« Mama » de Muschietti (grand prix à
Gérardmer) avec la splendide Jessica Chastain,
d'« Orphelinat », de Bayona, auréolé de
prix internationaux, de « Impossible » du même réalisateur, la
musique terrifiante de « Devil », et plus
récemment d'« Hercule », une daube, mais avec un score étonnant.
Aujourd'hui Hollywood se l'arrache. Il compose la musique du prochain Guillermo
Del Toro, « Crimson Peak »,
mais il ne veut pas le dire… Fernando Velázquez tient pour l'instant à garder
ses attaches espagnoles. L'apothéose fut
l'énorme messe au Grand Rex où la salle archi comble a vibré au son du grand
orchestre à géométrie variable de 90 musiciens, Le Paris Symphonic
Orchestra. Il a interprété des musiques de ces trois compositeurs sur des
extraits de films : « Love Punch, La Science des Rêves, Star Treck, Lost, Là Haut,
Indestructible, Ratatouille »…Un grand moment d'émotion a submergé le
public lorsque Velázquez a conduit l'orchestre sur des images de
« Impossible » et le dramatique sauvetage de Noami Watts du tsunami
en Thaïlande. C'est avec bien sûr l'arrangement ahurissant du thème de
« Mission Impossible » de Lalo Schifrin,
réécrit par Michael Giacchino, que l'orchestre, sous
la baguette de Diego Navarro, a terminé sa prestation. Énorme ovation du
public ! La soirée s'est achevée avec le groupe britannique Archiv et l'interprétation de son album BO « Axion ». Succès assuré.
De nombreux
concerts de musique de film sont programmés pour 2015 au Grand Rex ou au Palais
des Congrès :
« West Side Story », « Le
Parrain », « Titanic »… La musique à l'image a enfin trouvé son
public en France. Merci à Audi et à son mécénat.
https://www.youtube.com/watch?v=hMjKgvsQN70
https://www.youtube.com/watch?v=3K1c6kcH70o
https://www.youtube.com/watch?v=n5-glrcmP-M
FILMS
CASANOVA VARIATIONS
Réalisation de Mickael Sturmiger
avec John Malkovitch, Veronica Ferres, Victoria
Guerra, Fanny Ardant, et avec les chanteurs Jonas Kaufmann, Kerstin Avemo, Florian Boesch, Miah Persson, Kate Lindsey, Anna Prohaska, Barbara Hannigan, Topi Lehtipuu.

L'histoire : « Viva la libertà ! » s'écrie
Casanova, seul dans sa demeure, avant de s'évanouir. Lorsque la belle et
mystérieuse écrivaine Elisa von der Recke vient lui rendre visite, elle insuffle à nouveau un
peu de vie chez le vieil homme. « Casanova Variations » est un film
qui capture le mythe du plus grand séducteur de tous les temps, Giacomo
Casanova. Son histoire est racontée à la fois de sa dernière demeure et sur
scène, à travers des extraits d'opéra livrant ainsi ses aventures, ses passions
et sa peur de la mort.
Notre Avis : Michael Sturminger est un metteur en scène qui cherche constamment
à créer de nouveaux ponts entre la musique classique et le théâtre
contemporain. En 2006, ses expérimentations l'ont conduit à créer un opéra
original I Hate Mozart («Je hais Mozart»).
Par la suite, il a créé deux opéras avec le concours de John Malkovitch: The Infernal Comedy
et The Giacomo Variations. Son premier film Whore's
son, avec l'actrice russe Chulpan Khamatova, avait reçu de nombreux prix, et, en 2008, le
documentaire Malibran Rediscovered, avec
Cecilia Bartoli, fut diffusé sur Arte. C'est l'adaptation de sa pièce qu'il a
mise en scène pour le cinéma. Ce projet est un mélange de cinéma, de musique,
de théâtre, de littérature. C'est une histoire qui « pille » les
grands chefs-d'œuvre de Mozart, savoir Le Nozze di
Figaro, Don Giovanni et Così fan
tutte. Elle s'inspire aussi des pages du manuscrit autobiographique de
Casanova, qui contient 5000 pages ! Le scénario fait de la liberté un
véritable leitmotiv. En tant que réalisateur, Michael Sturminger
s'amuse à changer sans cesse de genre et à transposer des œuvres célèbres dans
un autre contexte, à les réemployer sous une nouvelle forme. On est dans le
théâtre total et qu'importe d'où viennent les extraits qu'emprunte le
réalisateur pour créer son film. L'œuvre d'opéra devient du théâtre, les scènes
réalistes de l'opéra etc, etc…
Il faut avouer que l'on se perd un peu si on n'a pas une connaissance des
opéras et de Casanova lui-même. Mais ce serait une erreur de ne pas se laisser
emporter par ce mélange des genres et d'essayer de décortiquer chaque scène.
C'est, comme le dit le titre du film, des variations autour de Casanova. Un
acteur étonnant, John Malkovitch, joue à être
Casanova et devient Casanova à son tour. C'est la magie du masque. Tout le film
est un effet miroir sur les dernières années de Casanova et celle d'un acteur
qui joue Casanova et qui porte le nom de Malkovitch.
« Casanova Variations » est un film pour mélomane, pour ceux qui
aiment Mozart, le théâtre, le théâtre dans le théâtre à la Pirandello, et pour
ceux qui aiment John Malkovitch. Cela fait de bonnes
raisons pour se laisser entraîner dans ces Variations où l'on se perd avec
délice.
https://www.youtube.com/watch?v=9bjhjJsi7eE
WHIPLASH.
Réalisation : Damien Chazelle. Musique : Justin Hurwitz
L'histoire :
Andrew, 19 ans, rêve de devenir l'un des meilleurs batteurs de jazz de sa
génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où
il s'entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d'intégrer le fleuron des
orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce et
intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance, sous
sa direction, dans la quête de l'excellence...
Notre
Avis : Damien Chazelle a été batteur et se
souvient des heures qu'il a passées à s'entraîner sur sa batterie, des
ampoules, des mains en sang, des glaçons pour soulager la douleur. Il se
souvient des nausées, des repas sautés, des crises d'angoisse, de sa relation
avec son professeur. C'est ce qu'il a filmé dans « Whiplash ».
C'est ce que vit Andrew dans son combat avec son professeur sadique qui le
dirige. Une anecdote raconte que Jo Jones, batteur célèbre, aurait lancé sa
cymbale à la tête de Charlie Parker, 19 ans, trouvant nul son solo, et que le
public a hué sa prestation. Parker aurait dit je reviendrai un an plus tard …
La suite on la connaît, il est devenu le plus grand saxophoniste de jazz de
tous les temps. C'est ce rapport si lourd, si tendu, qu'illustre brillamment Chazelle dans son film. Il pose la question sans
réponse : A quel moment un professeur dépasse-t-il les bornes pour amener
son élève à l'excellence ? ou peut-être au
suicide ? On assiste tout au long du film à des répétions – le morceau Whiplash est le thème principal – où la peur s'installe, où
jouer est une question de vie et de mort. La musique et l'image rendent
parfaitement les émotions que l'on peut ressentir dans ces situations. La
musique de jazz est donc le centre de ce film. Les morceaux entendus ont été
orchestrés superbement par Justin Hurwitz. Whiplash est une composition de H.J. Levy dont une
magnifique interprétation a été donnée par Don Ellis dans son album Soaring. La BO est sortie chez Varèse Sarabande. Il y a de
l'énergie, de la sueur dans cette BO et des larmes dans ce film.

https://www.youtube.com/watch?v=f_bmXeLbr7k
20 000 JOURS SUR TERRE
Réalisation : Ian
Forsyth et Jane Pollard
Ce
film est un portrait intime et fascinant d'une icône pop de la musique :
Nick Cave. La construction est assez simple mais l'idée est originale : 24
heures dans la vie du rockeur d'origine australienne. C'est un film hybride
entre le documentaire et la fiction. La qualité du film vient, bien sûr, des
metteurs en scène. Ils sont tous les deux issus du monde de l'art contemporain
et cela se sent dans le choix des cadres, le dispositif mis en place. Cette
journée est supposée être la 20 000 ème de Nick Cave.
Le film a été tourné pendant un an. Atypique, il a pour point de départ les
carnets de notes du musicien. Il se construit avec des voix off de Nick, des
dialogues avec des personnalités phares dans la carrière du chanteur. Elles
apparaissent dans la voiture du chanteur mais sont supposées ne pas être
présentes car Nick est seul dans sa voiture et va aux rendez-vous prévus dans
sa journée. Il va ainsi chez son psychiatre, interprété par un vrai psychiatre
renommé, Darian Leader. Celui-ci va l'amener à parler
de moments importants de son existence, de son père, et d'une scène incroyable
qu'il a vécue avec Nina Simone: Nick, en voiture, va manger chez son vieux
complice de toujours Warren Ellis avec qui il a écrit de nombreux morceaux et
quelques BO de films – « Lawless »,
« The Road » de John Hillcoat, « The Assasination Of Jesse » de James By, « The Coward Robert Ford » d'Andrew Dominic.
On assiste à une répétition en studio, puis il va choisir des photos aux
Archives Nick Cave, qui se trouvent à Melbourne, mais reconstituées en
Angleterre. Il parlera ainsi des moments de sa vie, de sa carrière. La voiture
permet d'aller d'un lieu à un autre, mais aussi de faire un chemin intérieur ;
elle est une sorte d'extension de l'esprit. Nick Cave ne joue pas, mais il est
Nick Cave et tout ce qui se passe en une journée paraît authentique. C'est le
tour de force de la réalisation. Le film se termine avec un superbe concert à
Melbourne. C'est un film qui quelque part tente de mieux cerner le mystère de
la création. Il a reçu les prix de la mise en scène et du montage au dernier
festival de Sundance.

https://www.youtube.com/watch?v=VhrZ1u-S7GA
Entretien
avec ERIC NEVEU

DR
Éric Neveu
est le compositeur, entre autres, de « Ceux qui m'aiment prendront le
train », « Intimité », « Persécution », de Patrice
Chéreau, « Just like a woman »
et « La voie de l'ennemi » de Rachid Bouchareb,
« Les vacances du Petit Nicolas » de Laurent Tirard,
« Graziella » de Mehdi Charef, « Un
beau dimanche » de Nicole Garcia, « Il était une forêt » de Luc
Jacquet, « L'attentat » de Ziad Doueiri, « Les Kaira »
de Franck Gastambide... Il travaille régulièrement
pour la télévision sur des séries de prestige : « Borgia », « La
Commune », « Un village français », « Le vol des
cigognes »…
A 15 ans vous vouliez être musicien et sur
votre site vous dites avoir quitté très tôt le conservatoire. En 1994 vous
intégrez une école de commerce... J'avoue être un peu perdu dans votre
trajectoire.
Je ne
vois pas où est le problème. Je quitte le conservatoire de quartier à Paris où
j'ai eu une formation très moyenne parce que je n'étais pas très bon. Mais oui,
j'ai toujours, toujours, voulu faire de la musique et très tôt de la musique de
film. J'étais fasciné par les musiques des films de Spielberg - Lucas, par
cette adéquation entre musique et image, cette sorte de « space opéra » comme « E.T » ou des films
comme « Star Wars ». Notre génération
comprenait l'importance fondamentale de la musique dans les films. En France,
on ne l'utilisait que dans une attitude post nouvelle vague, on s'en méfiait un
peu, parfois à juste titre, parfois pour se démarquer des américains. J'ai 40
ans, j'ai baigné dans cet univers un peu paradoxal que celui de l'arrivée de
films avec des musiques extraordinaires, avec une richesse immense, et dans un
contexte franco-français totalement différent. Mais c'est ce qui fait aussi la
spécificité des compositeurs français et ce pourquoi on est apprécié à
l'étranger. Ce que les américains aiment chez nous, c'est que nous ne sommes
pas dans le style « popcorn movies », gros
score, grosse cavalerie à tout prix. On est dans une économie musicale et dans
le plaisir de la musique.
La musique américaine aujourd'hui est assez
formatée. Avec Zimmer, par exemple, on se retrouve à
l'époque de Max Steiner, non ?
On ne
peut pas généraliser : oui, on a des musiques
autoroutes, il y a eu une industrialisation ; mais tout n'est pas si simple. Au
milieu de ça, le score d'« Inception » par
exemple est assez inventif dans l'écriture et pourtant je ne suis pas un grand
amateur de Zimmer.
Revenons
à vous, à vos débuts.
Quand
j'étais gamin je chantais dans un chœur d'enfant, j'étais soliste. Ma formation
initiale vient de là, j'étais en cinquième. Après, comme j'étais bon à l'école,
j'ai fait une prépa, puis une école de commerce. L'avantage quand on intègre
une école, c'est qu'on ne fait plus rien, et moi je faisais l'école de la
musique et j'ai amélioré ma formation d'autodidacte. Disons que je suis un semi
autodidacte. J'arrange toutes mes musiques, je les pré-orchestre, j'ai aussi un
orchestrateur. En studio je réagis sur la partition, je travaille sur
l'écriture, je ne fais pas tout d'oreille et en même temps, j'ai des lacunes
sur l'harmonie. Ce qui fait que j'ai parfois des approches différentes de
celles de mes confrères.
Au départ c'est vers la musique
électronique que vous vous êtes dirigé ?
Mes
premières musiques sont des musiques électroniques. C'est cette couleur
qu'appréciait Patrice Chéreau et ce pourquoi j'ai travaillé avec lui.
Comment a commencé cette collaboration
incroyable que vous avez eue jusqu'à sa disparition ?
A l'époque, je travaillais dans une
maison de disque, chez Polygram. J'étais l'assistant du conseiller musical pour
la pub, Charles-Henri de Pierrefeu, mon mentor. Il
était consultant aussi pour le cinéma, mais n'aimait pas la musique de film. Il
préférait la pop, l'électro. Et je me suis retrouvé à travailler avec des gens
comme Despléchin, l'époque post Tarantino,
où on mettait beaucoup de synchro dans les films. Grâce à un ami comédien j'ai
rencontré Patrice Chéreau sur « Ceux qui m'aiment prendront le
Train ». Il avait décidé, traumatisé par « Breaking
the Waves », de Lars Von Trier, de faire un film
avec uniquement des chansons. Il sortait de « La Reine Margot » et ne
voulait pas de musique de film. Je participais comme conseiller musical sur ce
nouveau film et Patrice me demanda d'écrire un morceau pour le film. Il aimait
bien ce que je faisais, il me testait. Sur « Intimité » il m'a
demandé de chercher des musiques existantes. Je crois que j'avais quitté
Polygram, c'est l'époque où je me lançais, je devais faire le premier Ozon, et là il m'a proposé de composer le score. On était
dans des logiques musicales très influencées par « Lost
Higway ». A partir de cette époque on est devenu
très proche et je l'ai accompagné quasiment non stop sur tous ses travaux
musicaux, de cinéma ou de théâtre, à part sur « Gabriel » et sur un
film où il n'y a pas de musique, « Son Frère ». J'ai composé pour son
dernier film « Persécution » et pour ses dernières mises en scène de
théâtre, « Rêve d'Automne » et « I Am The Wind » de Jon
Fosse. De très beaux et grands souvenirs que cette
collaboration !
En 1997, vous avez aussi fait les premiers
films de Lionel Delplanque et de François Ozon mais votre collaboration s'est arrêtée là.
A
l'époque je ne savais pas ce que c'était qu'un orchestre. Ces réalisateurs
étaient influencés par la musique orchestrale et je n'étais pas au niveau pour
ces garçons. Lionel, c'était Herrmann qu'il voulait
et moi j'étais incapable d'écrire ce genre de musique. Ozon,
lui, voulait de la musique classique. Philippe Rombi,
qui aujourd'hui compose pour lui, avait cette formation. Ozon/Rombi c'est une des grandes collaborations entre un
réalisateur et un compositeur.
Vous
avez beaucoup travaillé pour la télévision;
Patrice
Chéreau a été mon passeport, il avait cette qualité de donner sa chance à des
jeunes inconnus, acteurs ou autres, alors que des gens très connus rêvaient de
travailler avec lui. J'ai fait ensuite pas mal de films qui ne m'intéressaient
pas vraiment mais qui m'ont permis de mieux acquérir mon métier. A un moment la
télé est venue vers moi pour des unitaires. Et paradoxalement, sur ces films de
commande on avait une liberté artistique totale. J'ai fait plusieurs films avec
Serge Ménard et on faisait des musiques à la Lynch. Serge était un fondu de ce
réalisateur. Au cinéma, les producteurs m'auraient sûrement demandé de me
calmer. J'ai beaucoup évolué grâce à ses téléfilms, j'ai eu des prix dans les
festivals de télévision ; les gens étaient très contents. Vers 2008, le cinéma
est revenu vers moi. J'ai changé d'agent avec qui je m'entends très bien, je
raisonne plus en terme de carrière et je réfléchis sur les films que j'ai envie
de faire. Je ne compose plus pour la télé sauf pour Serge, par amitié.
Comment arrivez-vous à faire tant de films
en une année, dix l'année dernière ?
Je
travaille beaucoup et assez vite. J'ai monté une équipe technique autour de
moi, ce qui a pour résultat que je ne m'occupe plus que de la composition et des
contacts avec les réalisateurs. Toutes les manip
techniques sont faites par deux assistants, un orchestrateur, à Londres, pour
la partie orchestre, et un assistant qui s'occupe du mixage 5.1. J'ai mis au
point une méthode de travail qui fait que je ne perds plus de temps.
Vous venez de composer pour le dernier film
de Patrice Leconte, qui sort à la fin du mois. Il pense qu'un compositeur ne
peut pas écrire pour tous les genres, car il n'est pas un caméléon. Qu'en
pensez-vous ? Vous qui avez quand même fait le grand écart de la comédie
au drame ?
Il a
raison, mon problème est que je m'ennuie très vite. J'adore les séries télé en
tant que spectateur et compositeur. J'aime la variété. Par exemple, sur le film
de Patrice Leconte on est parti avec une espèce de combo rythmico
latino. Jamais je n'essayerai de faire une musique que je ne maîtrise pas.
J'aime aller piocher, comme le fait magistralement Morricone, dans des styles
parfois anecdotiques et très décalés, mais j'essaie de toujours garder ma
couleur en explorant ces styles là. C'est ce que modestement j'ai toujours à
l'esprit. Quand je fais de l'orchestre, je ne vais jamais essayer de faire du
Tchaïkovski ; j'en serais bien incapable. J'essaye d'appliquer mon approche un
peu empirique à la matière orchestrale, de faire quelque chose qui me plaît,
mais qui reste moi, tout en utilisant la matière de l'orchestre. Patrice a
raison de penser qu'on ne peut pas tout faire ; c'est intéressant pour les
librairies musicales. Ce qui est intéressant c'est d'aller aux frontières des
styles musicaux qu'on aime et qu'on sait faire, et dans cette zone de fragilité
il se passe des événements amusants, des accident.
Mais il ne faut jamais tomber dans le faux, dans « à la manière de ». Il
faut toujours garder sa couleur. Ce qui est génial avec des réalisateurs comme
Patrice c'est que lorsqu'il fait un film d'époque, il ne va pas me le proposer,
même si ça m'exciterait de le faire ; mais il va demander à Gabriel Yared qui est le compositeur idéal pour ce genre de
musique. Par contre, s'il fait une comédie déjantée, il a vu comment sur
« Le Petit Nicolas » je sais m'amuser avec les codes ; là il
m'appellera. Il y a des réalisateurs qui ont un compositeur attitré et ils lui
demanderont de faire un film dans un style puis dans un autre ; ça peut
marcher, mais ce sont des réalisateurs qui ont un peu moins l'oreille musicale.
Patrice adore la musique, il en écoute beaucoup.
Morricone disait que grâce à
l'expérimentation qu'il pouvait faire sur certains films de série B ou Z, il
pouvait écrire des scores plus riches sur des films plus ambitieux. Comment
réagissez-vous à cette vision de votre métier ?
Il a
parfaitement raison. Lorsqu'on regarde sa production, elle est très
hétéroclite. Il y a des films où c'est un terrain de jeu pour moi. Sophie
Marceau, qui avait vu « Intimité », m'a appelé pour faire la musique
de son film. Lorsque j'ai vu le film, je lui ai dit qu'il fallait de
l'orchestre classique et que ce serait absurde de mettre de l'électronique sur
ses images. Elle a accepté. Je n'avais jamais fait d'orchestre de ma vie et je
me suis servi de ce film pour faire une musique orchestrale. Quand je suis
arrivé en studio j'étais terrifié, je n'avais pas conscience que j'allais me
retrouver en face de quarante musiciens, je rasais les murs. La musique, bien
sûr, avait été validée avant, mais quand même cette première expérience a été
très angoissante.
Est-ce que vous avez travaillé sur des
projets en amont, avant tournage ?
J'adore
lire les scénarii mais j'ai du mal à composer sans les images. Je suis un
enfant de l'image, et même le pré montage va dire tellement de choses en termes
de couleur, rythme, texture. Je me jette dans l'image, je m'imprègne de ce que
je vois pour écrire.
Vous n'êtes pas influencé par les musiques
temporaires qui sont couchées pour monter.
C'est
très variable, il y a des films qui sont plus verrouillés que d'autres, c'est
une gymnastique à avoir. Quelquefois c'est embêtant. J'ai souvent été confronté
à ce genre de problème. C'est très désagréable car il y a des réalisateurs qui
s'accrochent à certaines couleurs, mais ce n'est qu'une couleur. Si on essaye
de faire ce qu'on entend sur le pré montage, en général ça ne se termine pas
bien. Il faut savoir reprendre la main, mais quand on trouve la bonne idée, ils
oublient le style de la musique temporaire.
Votre
musique n'est pas très thème et variations
A
l'origine j'avais peur des thèmes, j'étais même contre. En vieillissant je m'y
suis mis, je me suis progressivement détendu. Mais je reste sur des cellules
thématiques mélodiques, très simples, ça fait partie de ma réflexion du moment.
Est-ce que mon écriture supporte la variation, le développement ? Je suis
très collé sur des thèmes assez minimaux, par goût aussi.
Parlez-moi
de votre travail sur « Borgia » ?
On
vient de terminer la troisième saison. J'ai composé sur les deux saisons. C'est
important pour moi parce que même si c'est un projet européen, j'ai envie de
composer aux États-Unis. Tom Fontana, le show runner
de Borgia, est New Yorkais ; il est aussi le créateur de Oz.
Pour le générique vous avez dû le refaire,
celui de la saison un n'avait pas plu.
Pour
la saison un le générique image était une horreur.
Pour le deux, ils l'ont refait et c'est beaucoup mieux ; ce sont des vitraux
magnifiques. La musique du générique est venue assez naturellement. Vu la
mauvaise expérience sur la première saison, j'ai accepté de faire des tests, ce
que je ne fais jamais. J'ai écrit les deux premiers épisodes, une sorte
d'examen de passage. Tom était satisfait, on s'est vu rapidement et j'ai bouclé
la troisième saison.
Est-ce que la question s'est posée sur la
couleur de votre musique. Musique contemporaine avec instruments anciens ou
musique d'époque avec instruments modernes ? Vous avez mis de la viole de
Gambe avec le Philharmonia Orchestra.
Avec
Fontana on s'est vu trois fois un quart d'heure, après on a fonctionné par
internet vu la distance. Ses mails étaient très courts : « I like
it, Try something else ». Après la première
saison, Tom a été assez distant par rapport aux compositeurs français. Le
premier est un bon musicien mais ça ne collait pas. J'ai été choisi parce que
j'avais travaillé avec Canal et ils avaient apprécié mon travail sur « La
Commune ». Tom m'a dit qu'il ne savait pas parler de musique mais qu'il
cherchait quelque chose d'un peu violent, une exaltation des sentiments, et
qu'il ne voulait pas un score d'époque. Pour lui, dans les Borgia il y a
quelque analogie avec la mafia contemporaine. Il voulait sentir l'époque mais pas avoir un score d'époque. J'aurais bien été
incapable d'écrire un score Renaissance. Avec ce qu'il m'a dit j'ai fait ma
sauce là-dedans. J'aime bien les scores hybrides. Là, c'était exactement ce que
voulait le réalisateur. Donc une musique avec beaucoup de machines et beaucoup
d'orchestre aussi. J'avais envie d'utiliser, pour le coup, un ou deux
instruments de la Renaissance, d'où la viole de gambe, un instrument important
pour moi, qui peut se concevoir quasiment comme un violoncelle. J'ai eu de
superbes gambistes : Carolyne Dale ainsi que
Suzanne Heinrich, qui jouent dans les ensembles baroques anglais. Il y a eu
aussi beaucoup de programmations, c'est un score que j'aime particulièrement.
J'ai une préférence pour la troisième saison. On a beaucoup chargé sur le grave
avec huit contrebasses et beaucoup de violoncelles, on avait un orchestre
déséquilibré qui nous convenait.
Vous
disiez que vouliez ouvrir votre carrière aux États-Unis.
J'aime
le cinéma français, j'enregistre à Londres parce que j'ai de grandes
accointances musicales avec la musique anglaise. J'aime le professionnalisme
des musiciens d'orchestre anglais. J'aime aller sur des films qui m'excitent,
et il y a une plus grande considération pour la culture musicale chez les
anglo-saxons que chez nous. Et j'aimerai me frotter à leur cinéma. Hormis les blockbusters, ils ont un cinéma
qui est un véritable terrain de jeux pour un compositeur de musique de film. Le
cinéma épique avec effets spéciaux. Un film d'animation écrit au cordeau, qui ne
voudrait pas faire ça !
Et bien je vous le souhaite ! Et au
plaisir de vous entendre à la fin du mois dans « Une Heure de
Tranquillité » de Patrice Leconte




https://www.youtube.com/watch?v=ZaRwnacjk0A
https://www.youtube.com/watch?v=lsS6HwIpIc0
Propos
recueillis par Stéphane Loison.
BIBLIO
Jacques
Hiver : MAURICE JARRE. un livre d'Hiver
pour cet automne et pour toutes les saisons.
Maurice Jarre est peut-être un des
compositeurs les plus populaire de musique de films,
avec Ennio Morricone et Michel Legrand. La musique de « Laurence d'Arabie », de « Paris Brûle-t-il ? » et
surtout le thème « La Chanson de Lara » du « Docteur Jivago »
ont fait le tour du monde. On peut aussi citer les musiques des films de Peter
Weir (« Witness »,
« Le Cercle des Poètes Disparus », « Gorilles dans la
Brume »…). Trois Oscars, quatre Golden Globes, un Ours d'Or à Berlin,
un Hollywood Walk of Fame à
Los Angeles, de nombreuses nominations ou d'autres prix ont couronné sa
carrière. A Avignon, dans la cour d'honneur du Palais des Papes, sa fameuse
fanfare résonne toujours pour annoncer le début du spectacle.
Jacques Hiver, auteur dramatique,
scénariste, est depuis l'âge de 14 ans un fan de la musique de Maurice Jarre.
C'était à l'époque de Jean Vilar, du TNP des années 50-60. C'était la première
fois qu'il entendait une musique autre. Qui n'était pas du classique, pas de la
variété. Mais une sorte de musique qui lui donnait des émotions inconnues. Il
se trouva que le père d'un de ses copains était le copiste de ce compositeur,
et c'est ainsi qu'il fit sa connaissance. Maurice Jarre écrivit pour le cinéma
la fameuse musique du film de Franju, « La Tête Contre les Murs ». Jacques Hiver acheta le 45 tours. S'en suivirent d'autres compositions, d'autres
45 tours, puis des trente-trois tours, puis des CD, puis des compilations, et
des pressages étrangers. Il devint collectionneur des musiques de Maurice
Jarre. Il reprit contact avec Jarre et avec ses propres moyens, sa pugnacité,
il produisit un coffret de CD des musiques du TNP. Il obtint le Grand Prix
Charles Cros. Hiver commença à faire une biographie à partir d'entretiens
avec le compositeur, mais hélas ne put
la terminer. Maurice Jarre décéda après les sept premiers chapitres. Il devait
y en avoir 42 ! En souvenir de
cette relation exceptionnelle avec ce compositeur d'exception, Jacques Hiver
décida, une nouvelle fois, avec ses fonds propres, de faire un catalogue
« raisonné » des musiques de Maurice Jarre .
Ce livre magnifique il faut se le procurer. C'est un des plus beaux hommages
qu'on a fait à ce très grand compositeur. La mise en page, les informations,
les illustrations, font qu'il doit être dans toutes les bibliothèques des
amoureux du cinéma, de la musique de films, de la musique tout court. Même si
nous sommes encore en automne, on peut déjà penser à Noël ! A propos de
cadeaux, Jacques Hiver propose d'autres beaux livres qui peuvent donner
d'autres idées.

Le
site pour commander le livre « Maurice
Jarre » de Jacques Hiver ou d'autres est : www.jacques-hiver.com
BO
en CDS
FURY. Réalisateur : David Ayer. Compositeur : Steven Price. 1CD Varese
Sarabande.
Avril
1945, alors que la Seconde Guerre Mondiale touche à sa fin, le sergent Don
« Wardaddy » Collier commande un char M4
Sherman et son équipage de 5 soldats pour une mission suicide derrière les
lignes ennemies. Mettre en scène ce genre de film n'est pas évident. Le choix
du réalisateur est intéressant. L'histoire se passe en 24h et on vit cette
épisode à travers le regard d'une jeune recrue qui ne connaît rien à la guerre
et encore moins à ce qu'est un char. Il y a bien sûr des clichés, mais ils font
partie des règles de la construction du récit comme il y en a dans le western.
Ici, David Ayer s'en sort avec les honneurs, le film
est bien fait et les acteurs formidables. Un autre écueil dans ce style de film
est la musique. C'est le dernier compositeur oscarisé,
Steven Price, qui a eu la lourde tâche de composer la musique. Lui aussi s'en
sort avec les honneurs. Sa musique est introvertie, psychologique, d'une grande
mélancolie avec des chœurs d'une profonde tristesse. Il n'y a rien de martial
dans la conception, on est plus proche du requiem, la victoire n'est pas au
bout du canon. Le morceau de bravoure du film, l'attaque du Tigre, le combat
des deux chars, a des accents à la Zimmer. Steven
Price a travaillé avec lui, on en sent l'influence. Le CD s'écoute sans
déplaisir et on reconnaît dans cette musique le compositeur de « Gravity ».

https://www.youtube.com/watch?v=fd9E9u2lLW4
LA VIE A L'ENVERS. Réalisatrice :
Anne
Giafféri. Compositeur :
Jean-Michel Bernard. A télécharger chez BOriginal - Cristal Records.
Ce téléfilm raconte sous l'angle de la
comédie et de l'émotion le point de vue de trois sœurs (Isabelle Carré, Barbara
Schulz, Pascale Arbillot) face à la maladie de leur
mère - rôle magnifiquement interprété par Marthe Keller. Il a reçu le prix du
meilleur scénario au festival de la fiction TV 2014 de La Rochelle. Jean-Michel
Bernard, le compositeur de la musique, est surtout connu pour être le
compositeur attitré de Michel Gondry – « Human Nature », « La Science des rêves »,
« Soyez Sympa rembobinez » - mais il a aussi composé pour Fanny
Ardant – « Chimères absentes », « Cadences
obstinées », pour Francis Verber, pour Joël Hopkins « Love Punch ». ( Cf. Entretien dans la NL de 3/2014). Il a déjà travaillé
pour Anne Giafféri en signant la musique de
« Qui a envie d'être Aimé », sorti en 2012. Pour ce Téléfilm, il propose
une musique dépouillée, émouvante et sensible, avec un très jolie
thème. Il est lui-même au piano, accompagné par l'Orchestre à cordes de
l'Alhambra-Colbert. Certains morceaux à coloration jazzy, comme les aime
Bernard, sont chantés par Nevil Bernard ou Kimiko
Ono. Le générique de fin, une comptine allemande, est interprété par Marthe
Keller.

SIDEWALK. Réalisation :
Charles Lane. Compositeur ; Marc Marder. 1CD Milan / Universal
n°399 568-2
A
l'occasion de la sortie en DVD et Blue Ray de ce superbe film, Milan nous
propose la musique de Marc Marder. « Sidewalk » est l'histoire d'un artiste noir à New-York
qui gagne sa vie en dessinant le portrait de passants. Il emménage bientôt dans
le sous-sol d'un vieil immeuble abandonné. Un soir, il est témoin, dans le
quartier de Manhattan, du meurtre d'un homme. Il recueille sa petite fille de
deux ans, et, au même moment, vit une histoire d'amour avec une jeune femme de
son âge. C'est un film muet en noir et blanc, un bel hommage à Charlie Chaplin
et au Kid. Ce film a été réalisé bien avant « The Artist »,
mais comme il n'est interprété que par des noirs, il n'a pas eu le succès du
très surestimé film d'Hazanavicius, qui ne sait faire
que des films « à la manière de.. ». « Sidewalk
stories » est un vrai film d'artiste comme « Blancanieves »,
chef-d'œuvre espagnol, lui aussi muet et en noir et blanc avec une musique
étonnante. Charles Lane, qui est aussi l'acteur du
film, a su capter un New-York contemporain et authentique dont la musique
étonnamment moderne et variée, signée Marc Marder,
construit les dialogues subtils et importants des personnages, donne le ton de
leurs situations et de leurs émotions. Paris Film Festival l'avait programmé en
version restaurée, en Juillet 2013. Aujourd'hui, on peut le voir et revoir en
numérique. La BO est excellente et le travail très important pour ce genre de
film est exemplaire. Cette musique seule s'apprécie par la richesse, les
couleurs, les styles qu'elle offre. Marc Marder est
le compositeur attitré de Rithy Panh
et a reçu le prix de « France Musique-Sacem »
de la musique de film le mois dernier. Il y a un an, l'Éducation Musicale avait
fait un compte rendu sur cet artiste complexe et inventif. Avec l'édition de ce
CD on peut remarquer l'éclectisme de cet artiste atypique. Une belle réédition
chez Carlotta Films du DVD.

https://www.youtube.com/watch?v=SKixhUj942k
UNE NOUVELLE AMIE. Réalisateur :
François Ozon. Compositeur : Philippe Rombi. 1CD Label BOriginal –
Cristal Records – Sony
À la
suite du décès de sa meilleure amie, Claire fait une profonde dépression. Mais
une découverte surprenante au sujet du mari de son amie va lui redonner goût à
la vie. Le couple Ozon / Rombi
fonctionne toujours pour notre plus grand plaisir. Chaque année on a droit à la
musique de Philippe Rombi. Elle est toujours pareille
et en même temps pas tout à fait la même. Rombi aime
la belle musique bien orchestrée, de jolis thèmes, trouver l'ambiance qui colle
parfaitement au film. Ozon aime la musique classique,
la musique orchestrale. Rombi sait la lui offrir. On
reconnaît toujours la patte de Philippe Rombi. Dans
cette BO on est dans une belle musique traditionnelle d'une autre époque, comme
une musique éternelle. Elle flirte avec celles qu'écrit Joe Hisaishi
pour les films d'animation de Hayao Miyazaki. Le CD
est très agréable à écouter. On entend
la chanson « Une Femme avec Toi », chantée par Nicole Croisille, dont souvent des travestis se sont emparés pour
s'en moquer. La célèbre Jenny Bel'air du Palace était
inénarrable dans cette imitation. Peut-être est-ce le pourquoi de la présence
de cette rengaine dans le film ? Une autre icône des nuits parisiennes apparaît
dans le disque, Amanda Lear, qui interprète son fameux « Follow me », très ambigu. Il y a aussi le « Laudate Dominium » des Vêpres
Solennelles de Mozart. Un disque très sympathique à écouter. Tout cela est
charmant.

https://www.youtube.com/watch?v=qg4w_oq0b70
LE SEL DE LA TERRE. Réalisateur :
Wim Wenders. Compositeur : Laurent Petitgand.
1CD Idol – Decia Films.
Wim
Wenders a confié à son complice de longue date, Laurent Petitgand
– « Tokyo Ga », « Les Ailes du Désir », « Carnet de
Note sur Vêtements et Villes », « Arisha »,
« The Bear and the Stone Ring », « Si
Loin Si Proche », « les Lumières de Berlin » - la composition de
la bande originale de son film, « Le Sel de la Terre » co-réalisé
avec Juliano Salgado. Le film est consacré au père de
ce dernier, le grand photographe Sebastião Salgado
qui parcourt la Terre depuis 40 ans, documentant les mutations de l'humanité et
ses conséquences pour la planète, par ses magnifiques et saisissantes
photographies. Ainsi la beauté des images est enluminée par les mélodies quasi
mystiques du compositeur, prolongeant l'atmosphère du film en proposant une
œuvre à part entière. Composite, hétéroclite, née de la rencontre des peuples,
des images et des cultures qui forment l'humanité d'aujourd'hui, sa musique est
un splendide parcours sensoriel et sensuel, solidement ancrée à la terre, à ses
racines, tout en restant en apesanteur. Musicien, compositeur, auteur, chanteur
et acteur, Laurent Petitgand a travaillé avec
Christophe, Bashung, Paul Auster, et composé des
musiques pour les ballets d'Angelin Preljocaj et Camilla Saraceni.
« Le Sel de la Terre » est sa huitième collaboration avec Wim
Wenders…

https://www.youtube.com/watch?v=kZVFmxVHNzw
Stéphane
Loison.
***
LA VIE DE L’EDUCATION MUSICALE
Si vous souhaitez promouvoir
votre activité, votre programme éditorial ou votre saison musicale dans L’éducation musicale, dans notre Lettre
d’information ou sur notre site Internet, n’hésitez pas à me contacter au 01 53
10 08 18 pour connaître les tarifs publicitaires.
maite.poma@leducation-musicale.com
|
Les projets d’articles sont à envoyer à redaction@leducation-musicale.com
Les livres et les CDs sont à envoyer à la rédaction de l’Education
musicale : 7 cité du Cardinal Lemoine 75005 Paris
Tous les dossiers de l’éducation musicale
·
La librairie de L’éducation
musicale
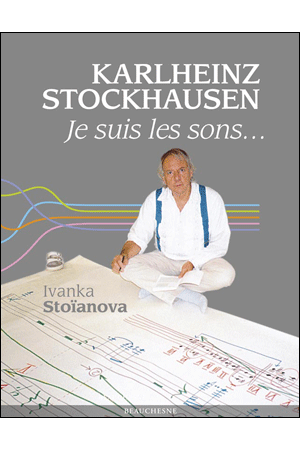 |
Ce livre, que le compositeur souhaitait publier dans sa maison d’édition à Kürten, se propose de présenter les orientations principales de la recherche de Karlheinz Stockhausen (1928-2007) à travers ses œuvres, couvrant sa vie et ouvrant un accès direct à ses écrits. Divers domaines investis par le plus grand inventeur de musique de la seconde moitié du xxe siècle sont abordés : composition de soi à travers les matériaux nouveaux ; découvertes formelles et structures du temps ; musique spatiale ; métaphore lumineuse ; musique scénique ; l’hommage au féminin de l’opéra Montag aus Licht ; Wagner, Stockhausen et le Gesamtkunstwerk, œuvre d’art total. Les témoignages des femmes qui l’ont accompagné dressent un portrait vif et saisissant de l’homme, artiste génial qui aimait plus que tout la musique et la recherche compositionnelle au nom du progrès de l’être humain...(suite) |
 |
Analyses
musicales
XVIIIe siècle – Tome 1
L’imbroglio
baroque de Gérard Denizeau
BACH
Cantate BWV 104 Actus tragicus Gérard Denizeau Toccata ré mineur Jean Maillard Cantate BWV 4 Isabelle Rouard Passacaille et fugue Jean-Jacques Prévost Passion saint Matthieu Janine Delahaye Phœbus et Pan Marianne Massin Concerto 4 clavecins Jean-Marie Thil La Grand Messe Philippe A. Autexier Les Magnificat Jean Sichler Variations Goldberg Laetitia Trouvé Plan Offrande Musicale Jacques Chailley
COUPERIN
Les barricades mystérieuses Gérard Denizeau Apothéose Corelli Francine Maillard Apothéose de Lully Francine Maillard
HAENDEL
Dixit Dominus Sabine Bérard Israël
en Egypte Alice Gabeaud
Ode à Sainte Cécile Jacques Michon L’alleluia du Messie René Kopff
Musique feu d’artifice Jean-Marie Thill |
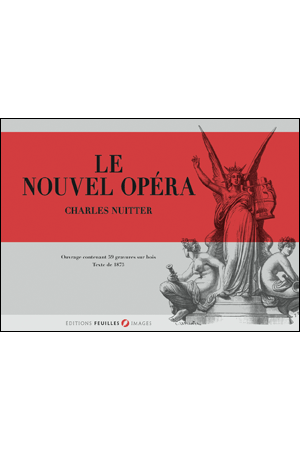 |
Publié l'année même de son ouverture, cet ouvrage raconte avec beaucoup de précisions la conception et la construction du célèbre bâtiment. |
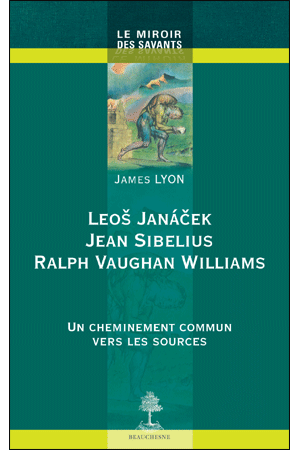 |
Pour la première fois, le Tchèque Leoš Janácek (1854-1928), le Finlandais Jean Sibelius (1865-1957) et l'Anglais Ralph Vaughan Williams (1872-1958) sont mis en perspective dans le même ouvrage. En effet, ces trois compositeurs - chacun avec sa personnalité bien affirmée - ont tissé des liens avec les sources orales du chant entonné par le peuple. L'étude commune et conjointe de leurs itinéraires s'est avérée stimulante tant les répertoires mélodiques de leurs mondes sonores est d'une richesse émouvante. Les trois hommes ont vécu pratiquement à la même époque. Ils ont été confrontés aux tragédies de leur temps et y ont répondu en s'engageant personnellement dans la recherche de trésors dont ils pressentaient la proche disparition. (suite). |
 |
Ce guide s’adresse aux musicologues, hymnologues, organistes, chefs de chœur, discophiles, mélomanes ainsi qu’aux théologiens et aux prédicateurs, soucieux de retourner aux sources des textes poétiques et des mélodies de chorals, si largement exploités par Jean-Sébastien Bach, afin de les situer dans leurs divers contextes historique, psychologique, religieux, sociologique et surtout théologique. Il prend la suite de La Recherche hymnologique (Guides Musicologiques N°5), approche méthodologique de l’hymnologie se rattachant à la musicologie historique et à la théologie pratique dans une perspective pluridisciplinaire. Nul n’était mieux qualifié que James Lyon : sa vaste expérience lui a permis de réaliser cet ambitieux projet. Selon l’auteur : « Ce livre est un USUEL. Il n’a pas été conçu pour être lu d’un bout à l’autre, de façon systématique, mais pour être utilisé au gré des écoutes, des exécutions, des travaux exégétiques ou des cours d’histoire de la musique et d’hymnologie. » (suite) |
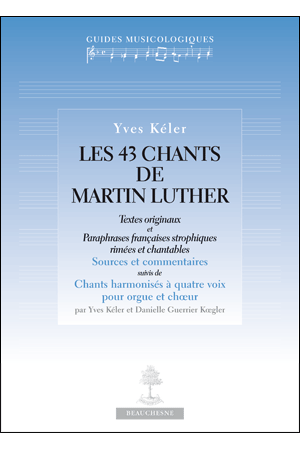 |
Cet ouvrage regroupe pour la première fois les 43 chorals de Martin Luther accompagnés de leurs paraphrases françaises strophiques, vérifiées. Ces textes, enfin en accord avec les intentions de Luther, sont chantables sur les mélodies traditionnelles bien connues. Aux hymnologues, musicologues, musiciens d'Eglise, chefs, chanteurs et organistes, ainsi qu'aux historiens de la musique, des mentalités, des sensibilités et des idées religieuses, il offrira, pour chaque choral ou cantique de Martin Luther, de solides commentaires et des renseignements précis sur les sources des textes et des mélodies : origine, poète, mélodiste, datation, ainsi que les emprunts, réemplois et créations au XVIè siècle... (suite) |
 |
Mozart aurait-il été heureux de disposer d'un Steinway de 2010 ? L'aurait-il préféré à ses pianofortes ? Et Chopin, entre un piano ro- mantique et un piano moderne, qu'aurait-il choisi ? Entre la puissance du piano d'aujourd'hui et les nuances perdues des pianos d'hier, où irait le cœur des uns et des autres ? Personne ne le saura jamais. Mais une chose est sûre : ni Mozart, ni les autres compositeurs du passé n'auraient composé leurs œuvres de la même façon si leur instrument avait été différent, s'il avait été celui d'aujourd'hui. Mais en quoi était-il si différent ? En quoi influence-t-il l'écriture du compositeur ? Le piano moderne standardisé, comporte-t-il les qualités de tous les pianos anciens ? Est-ce un bien ? Est-ce un mal ? Qui a raison, des tenants des uns et des tenants des autres ? Et est-ce que ces questions ont un sens ? Un voyage à travers les âges du piano, à travers ses qualités gagnées et perdues, à travers ses métamorphoses, voilà à quoi convie ce livre polémique conçu par un des fervents amoureux de cet instrument magique.
|
A PARAÎTRE
|
Au travers du récit que James Lyon nous fait de l’existence de Dickens, il apparaît bien vite que l’écrivain se doublait d’un précieux défenseur des arts et de la musique. Rares sont pourtant ses écrits musicographiques ; c’est au travers des références musicales qui entrent dans ses livres que l’on constate la grande culture musicale de l’écrivain. Il se profilera d’ailleurs de plus en plus comme le défenseur d’une musique authentiquement anglaise, forte de cette tradition évoquée plus haut. Et s’il ne fallait qu’un seul témoignage enthousiaste pour décrire la grandeur musicale de l’Angleterre, il suffit de lire le témoignage de Berlioz (suite). |
***
 |
PARUTION DU NUMÉRO SPÉCIAL BAC 2015
PRIX TTC : 19 euros
Contact : maite.poma@leducation-musicale.com Tel : 01 53 10 08 18 Fax : 01 53 10 85 19
|
·
Où trouver le numéro du Bac ?
Les analyses musicales de L'Education Musicale



