PAROLES D'AUTEUR : Les ScÈnes de Faust de Robert Schumann
REPÈRES PÉDAGOGIQUES : Improviser l’introduction d’une chanson ou d’un standard
FESTIVALS! LES BERLINER PHILHARMONIKER SUPERLATIFS
L'AGENDA
9 / 5
Donnez-moi la mémoire

A l'occasion du 70e anniversaire de la
libération du camp de Theresienstadt, sera donnée la
Cantate d'Annick Chartreux, « Donnez-moi la mémoire », pour chœurs
d'enfants, chœur mixte, cordes et percussions. Elle a été écrite sur des poèmes
d'enfants internés à Theresienstadt. Dans ce camp de
transit furent enfermés, entre autres, près de 15000 enfants. Le camp connut
aussi une vie culturelle dont l'essor et le rayonnement extraordinaires
devaient être utilisés comme vitrine de la propagande nazie. Annick Chartreux
dirigera elle-même l'œuvre où se produira le chœur Capriccio, qui a remporté 4
prix internationaux au concours de Saint Pétersbourg,
Sera interprétée également la Cantate BWV 112, « Der Herr
ist mein getreuer Hirt » (Le Seigneur est mon berger) de JS.
Bach par Georges Guillard et la Camerata Saint Louis
de Paris, dans le cadre de la mission qu'ils se sont assignés, de donner en
concert toutes les cantates de Bach.
Oratoire du Louvre, 145, rue Saint-Honoré,
75001 Paris, le 9 mai à 18H.
Entrée libre. Participation aux frais;
19, 20, 21 / 5
Brundibár au
Théâtre de Caen

Benoît Bénichou / DR
Pour sa 3ème collaboration avec
la Maîtrise de Caen, Benoît Bénichou mettra en scène
une nouvelle production de Brundibár de Hans Krása au théâtre
de Caen du 19 au 21 mai, avec l'Orchestre régional de Basse-Normandie dirigé
par Olivier Opdebeeck. Brundibár
est un opéra du souvenir pour voix d'enfant. Ce sera surtout une soirée riche
en émotion, et un événement exceptionnel puisque Ela
Stein Weissberger, survivante du camp de Terezín, qui y chanta 55 fois le rôle du Chat, fait le
voyage depuis New-York à cette occasion. Elle se joindra au chœur final de
l'opéra. Un choix artistique de
Benoît Bénichou pour redonner la voix aux survivants
- également sur la scène d'un théâtre… alors qu'Ela
Stein Weissberger est la seule encore en vie de tous
les participants à cet opéra. En complément de programme : le Ier
mouvement du Quatuor à cordes N° 2 op 7 de Pavel Haas, deux chansons d'Ilse
Weber, l'Ouverture for small orchestra de Hans
Krasa et les Couplets du badigeon de Bertolt
Brecht.
Théâtre
de Caen, les 19 et 20 mai 2015 à 20H, et le 21 mai à 14 H (matinée scolaire)
Réservations : Théâtre de Caen, 135 Bld Maréchal Leclerc, 14000 Caen; par tel : 02 31 30 48 00
; en ligne ; theatre@caen.fr
22 / 5
Jubilations baroques en Avignon

Julien
Chauvin / DR
Le violoniste Julien
Chauvin, fondateur et membre du Concert de la Loge Olympique et du
Quatuor Cambini-Paris, se produira avec l'Orchestre
Régional Avignon-Provence dans un programme intitulé Jubilations Baroques, le 22 mai à l'Opéra d'Avignon. Au
chapitre des compositeurs abordés et d'un programme construit autour de
concertos pour violon et symphonies, on entendra de C.P.E. Bach la Symphonie n°182/5 en si mineur pour cordes et continuo, de J.S.
Bach, le Concerto n°1 pour violon, orchestre à cordes et continuo en la
mineur BWV 1041, de Michel Corette Les
sauvages, concerto comique n°25 en sol
mineur, de Jean-Marie Leclair, le Concerto pour
violon et orchestre op.7 n°5 en la
mineur, et enfin de Joseph Haydn, sa Symphonie
n°88 en sol majeur Hob.88. L'Orchestre Régional Avignon-Provence sera dirigé par Jérôme Pillement.
Opéra
Grand Avignon, le 22 mai 2015, à 20H30.
Réservations : Billetterie, Place de
l'Horloge, 84000 Avignon ; par tel.: 04 90 14 26 40 ; en
ligne : www.orchestre-avignon.com ou www.forumsirius.fr
23, 28,
31 / 5
Un autre Falstaff... d'Antonio Salieri, en 1799 !

Antonio
Salieri en 1825
Producteur
d'opéra, le Théâtre Roger Barat propose depuis
quelques années de sortir du répertoire habituel en présentant des œuvres
méconnues.
Après
Vanessa
de Samuel Barber en 2012, repris à l'Opéra de Metz, Zanetto de Mascagni et Abu
Hassan de Weber en 2013, Le Consul de Gian Carlo Menotti en
coproduction avec à l'Athénée Théâtre Louis Jouvet, est présenté cette année Falstaff d'Antonio Salieri (1750-1925), d'après Les
Joyeuses Commères de Windsor de William Shakespeare. Cet
opéra en deux actes a été créé en 1799 et connut un grand succès. Salieri le
remaniera ensuite à plusieurs reprises. Les auteurs de la présente production
se sont penchés sur les diverses sources pour en donner une version restituant
l'œuvre dans toutes ses dimensions. Près
d'un siècle avant le chef d'œuvre de Verdi, le grand et fat séducteur imaginé
par Shakespeare connaissait déjà les honneurs de la scène opératique ! Iñaki Encina Oyón
assurera la direction musicale, Camille Germser
la mise en scène. Ils seront accompagnés de l'Ensemble
Diderot jouant sur instruments d'époque.
Théâtre Roger Barat,
Place de la halle, 95220 Herblay, les 23, 28 mai 2015, à 20H, et le 31/5 à 16H.
Réservations : sur place ; par tel : 01 39
97 79 74 ou 01 30 26 19 15 ; en ligne :
billetterieculture@herblay.fr
29 / 5
Une nouvelle création d'Edith Canat de Chizy

Mireille
Delunsch / DR
Une création d'Edith Canat de Chizy, "Voilé, dévoilé"
pour soprano et orchestre, sera au programme des concerts de Radio France avec
Mireille Delunsch en soliste, le vendredi 29
mai prochain. Voilé, dévoilé est
la troisième pièce d'Edith Canat de Chizy inspirée par la poésie de Philippe Jaccottet. Le
texte relate une expérience mystérieuse et itinérante dans la nuit jusqu'à la
révélation d'un "autre chose" de plus caché mais plus
proche. Le premier volet, "voilée", de cet itinéraire se déroule en deux
parties et six sections, puis survient le basculement correspondant au
"dévoilement" de cet '' autre chose'' en deuxième partie. L'Orchestre
Philharmonique de Radio France sera dirigé par Joshua Weilerstein,
et Mireille Delunsch, soprano, en sera la
soliste. Au programme également : le poème symphonique d'Ernest Chausson, Viviane,
et les Danses symphoniques de Sergueï
Rachmaninov.
Auditorium de la Maison de la Radio, le 29 mai 2015, à 20H.
Réservations : Billetterie,
Maison de la radio, 116 avenue du Président Kennedy, 75016 Paris ; par tel.: 01 56 40 15 16 ; en ligne :
www.maisondelaradio.fr/billetterie
9, 10 & 11 / 6
Le Premier Festival de musique classique belge francoohone

Scherzi musicali / DR
Le Centre Wallonie-Bruxelles
organise à Paris le premier rendez-vous de la musique classique belge
francophone, du 9 au 11 juin prochain, autour de 3 thématiques, musique
contemporaine, musique classique, musique baroque, et l'espace de 6 concerts.
Trois soirées pour mieux faire connaître, en France, les ensembles, interprètes
et compositeurs qui ont déjà conquis la scène belge francophone. Le 9 juin
2015, se produiront Anton'&Armide (Sarah Picavet, piano et Benjamin Glorieux, violoncelle) avec au
programme : Martin Matalon et Daan
Janssens (création française) ; puis l'Orchestre Sturm und
Klang, sous la direction de Thomas van Haeperen dans un programme réunissant Gregory d'Hodp, Jean-Luc Fafchamps, Sofia Gudaibulina et Pierre Slinckx. Le
10 juin, on entendra successivement le Warnier & Gurning Duo (Sébastien Walnier,
violoncelle et Alexander Gurning, piano) jouer Richard Strauss et Beethoven, puis le Quatuor
Alfama dans Britten, Mendelssohn, Webern et Dvořák. Enfin, le 11 juin, l'ensemble Scherzi Musicali donnera son
programme Il Pianto
d'Orfeo, sur des musiques de Peri,
Monteverdi, Rossi, Sartorio.... et Les Muffatti nous berceront du thème Italian Craze, ou la vogue italienne à Londres.
Centre de
Wallonie-Bruxelles, salle de spectacles, 46 rue Quincampoix,
75004 Paris, les 9, 10 et 11 juin 2015, à 20H
Réservations : par tel.: 01 53 01 96 96 ; en ligne :
reservation@cwb.fr
13, 15, 17, 19, 21, 23 /
6
Les Mousquetaires au
couvent investissent l'Opéra Comique
![]()

Photo
de la production à l'Opéra de Lausanne / DR
Créée
en 1880, aux Bouffes parisiens, l'opérette Les mousquetaires au couvent
de Louis Varney (1844-1908) connut un succès immédiat et durable. Tiré du
vaudeville « L'habit ne fait pas le moine » d'un certain Aimable de
Saint-Hilaire, il met en scène, dans la France du XIII ème
siècle, les incartades militaro-religieuses de deux mousquetaires, qui après
avoir enlevé une novice, permettent de déjouer un complot contre le cardinal de
Richelieu... Le couvent, ses secrets et ses propices échappatoires ont tenté
bien des auteurs de l'époque, en particulier Rossini dans Le comte Ory. La musique en est fort agréable et les airs
souvent cocasses tel ce « De la cloche qui nous appelle » ou
l'inénarrable quintette dit « de l'échelle ». Jérôme Deschamps
signera là son ultime spectacle en tant que directeur de la salle Favart où cette
opérette n'avait plus été montée depuis 1992, avec alors Gabriel Bacquier dans l'entreprenant Narcisse de Brissac. Pour
l'occasion, Deschamps revêtira les habits du régisseur avec comme complice
Laurent Peduzzi aux décors. Gageons que cette pochade
reprendra du service intelligent, parodique, ironique, et pas mièvre. En tout
cas, la direction d'orchestre de Laurent Campellone
et une distribution alléchante devraient entraîner le public dans un soirée festive.

Louis
Varney
Opéra Comique, les 13,
15, 17, 19, 23 juin 2015, à 20H et le 21/6 à 15H.
Réservations : Billetterie, 5 rue Favart, 75002 Paris ; par tel : 0825
01 01 23 ; en ligne : www.opera-comique.com
Le Festival de Saint-Denis

L'édition 2015 du Festival de
Saint-Denis est déjà à marquer d'une pierre blanche tant sa programmation est
riche d'œuvres d'envergure excitantes et de soirées de musique de chambre
débordant d'intérêt. Dans la Basilique, aux côtés des grandes fresques que sont
la Messa da Requiem de Verdi –
encore! - (par Myung-Whun
Chung avec un beau quatuor de solistes (les 23 & 24/6), le Requiem de
Brahms – re encore – (confié à Daniele Gatti et aux voix de Christine Schäfer et de Peter
Mattei (le 2/7) et la Messe en Ut de Mozart, que dirigera le talentueux Raphaël
Pichon avec une brochette de voix enviables, Devieilhe,
Crebassa, Boden et Sempey,
et son orchestre et chœurs Pygmalion (18/6), on donnerait beaucoup pour
entendre Le Paradis et la Péri de Schumann. Cet oratorio profane,
de 1843, présente un caractère lyrique si marqué qu'il lui valut le sous titre
de « Dichtung » (Poésie ).
Jérémie Rhorer sera à la tête du National, des Chœurs
de Radio France et de superbes solistes, Kühmeier, Deshayes, Antoun, Crossley-Mercer. Une occasion de
découvrir une pièce rarissime. Toujours dans le vaisseau de
la Basilique, et autre événement, Leonardo Garcia Alarcon livrera
« La dernière nuit », autour de Funérailles royales au temps de Louis
XIV, en l'occurrence celles de la reine Marie-Thérèse, en 1683, sur des
musiques de Lully (Dies Irae et De Profundis), et de Charles d'Helfer (Requiem de Grands Motets). Seront réunis la Capella
Mediterranea, l'Orchestre Millenium, nouvellement
créé, deux formations chorales, l'ensemble Psallentes
et le Chœur de Chambre de Namur, et enfin six solistes (8/6). Jordi Savall nous entraînera dans une exploration de « La
Route de l'esclavage » avec le Tembembe Ensamble Continuo, les 3MA et la Capella Reial de Catalunya, et bien sûr
son unique viole de gambe ; un voyage de l'Ancien au Nouveau monde, pour fêter
les 40 ans de son ensemble, et s'inscrire dans la thématique Métis, au
centre des soirées de Saint-Denis
(15/6). Un jeune chef prometteur, vainqueur du Concours de Salzbourg, Maxime
Pascal, et dont les prestations au théâtre de l'Athénée ont retenu l'attention,
s'attaquera aux Vêpres de Monteverdi, avec son orchestre Le Balcon
(26/6). Haendel dans tous ses états sera défendu par Sonya
Yoncheva et Nathalie Stutzmann
qui conduira son orchestre Orfeo 55 (16/6). La
trilogie Haydn, Mozart, Beethoven le sera par Diego Matheuz,
le chef qui monte, dirigeant ici l'Orchestre de Chambre de Paris et le celliste
Gauthier Capuçon pour le concerto N°1 de Haydn
(30/6). Et Enrique Mazzola entreprendra de raconter
des « American stories », autrement dit des musiques de Bernstein, de
Phil Glass et d'un de ses assistants, le jeune Nico Muhly
(*1981) dont on aura la création française du Concerto pour alto, entre baroque
et rock (10/6).

Nico
Muhly © Fabio de Paola
Coté musique de chambre, à la
Légion d'Honneur, les stars seront là : Alexandre Tharaud,
pour Mozart, Mahler et Ravel (6/6), Nicholas Angelich
et le celliste Edgar Moreau pour jouer la 2ème Sonate de Brahms et Cinq
pièces dans le ton populaire de Schumann (13/6), Benjamin Grosvenor et la violoniste Hyeyonn
Park dans les Sonates de Debussy et de Franck (14/6), David Fray
et Renaud Capuçon dans Bach et la Sonate « Le
printemps » de Beethoven (20/6). Enfin, une carte blanche est offerte au
compositeur Nico Muhly (7/6). Embarras de richesses,
comme toujours, aux portes de Paris.
Basilique Cathédrale de
Saint-Denis et Palais de la Légion d'Honneur, du 4 juin au 4 juillet 2015, à
20H30, sauf les 7, 14 et 28/6, à 17H
Réservations ; Par correspondance, Festival
de Saint-Denis – Réservations, 16, rue de la Légion d'Honneur, 93200
Saint-Denis ; sur place : Bureau de location du Festival, à gauche de la
Basilique ; par tel.: 01 48 13 06 07; en ligne :
www.festival-saint-denis.com
La saison 2015 de Royaumont

Logo
de l'édition 2015
Lors d'une conférence de presse très suivie
était dévoilé le programme de la prochaine saison de Royaumont. Sous le thème
en forme de trilogie « Musique, jardins, patrimoine ». Après l'année
jubilaire 2014, fêtant les 50 ans de la fondation, on
a voulu miser sur « un temps différent » ; autrement dit ne pas se
satisfaire des lauriers engrangés d'un passé prestigieux ; mais, surfant sur le
concept de centre culturel de rencontres, donner tout son sens à l'idée de
liberté d'action, et sa vraie effectivité. Donc, « s'investir dans
l'avenir », ce qui pour être un trait communément partagé, n'est pas
toujours suivi d'effet. Aussi les programmes de concerts, de recherches de
formation et de création, seront-ils articulés en deux phases, en juin et
octobre, entrecoupées d'un entre-actes chorégraphique
en septembre.
L'acte 1, du 6 au 21 juin,
s'étalera sur trois week end. Le premier est dédié à
l'orgue, avec des combinaisons originales : orgue et alto, orgue et voix, et
récital d'orgue « dans les années 30 » (les 6 &7/6). Le deuxième
sera consacré aux musiques transculturelles (13 & 14/6). Le troisième à des
créations (20 & 21/6).

DR
L'acte 2 sera constitué de deux
week end. Le premier (3 & 4/10), autour de
Scarlatti et de ses contemporains, permettra d'entendre des clavecinistes
renommés, Pierre Hantaï, Bertrand Cuiller, Diego Ares, mais aussi Enrike Salini à la guitare
baroque, au théorbe et au luth, Aline Zylberajch,
pianoforte, donnant la réplique au danseur Olivier Fourès,
et un « Scarlatti Book » conçu par Aka
Moon et ses amis : Scarlatti façon jazz... Le second (10 & 11/10) abordera
le thème des joies célestes au XVIII ème siècle allemand, dont le Winterreise
de Schubert (par Christoph Prégardien), des musiques
pour un temps de désolation, de Schütz à Bach, par l'ensemble Pygmalion et
Raphaël Pichon, des madrigaux chantés par l'ensemble israélien Profeti della Quinta,
et les Vêpres chypriotes (c. 1430), Ars subtilior
et chant byzantin, interprétés par
l'Ensemble Graindelavoix, en résidence à
Royaumont, et enfin une thématique « de Rome à Lisbonne » par Vox Luminis.
Des formules de week end musical avec hébergement à proximité sont
proposées, comprenant les trois concerts du samedi, le dîner buffet, la nuitée
et le petit déjeuner (avec possibilité d'assister aux concerts du dimanche à
tarif préférentiel, et/ou de bénéficier
d'une visite guidée de l'abbaye).

DR
Royaumont c'est aussi un
immense domaine où l'on vient en famille. Des ateliers sont organisés à
l'intention des plus jeunes. Ce sont encore des jardins merveilleux qu'il faut
parcourir : « Dimanche aux jardins », « Rendez-vous aux
jardins » (6 & 7/6) « Un week end aux
jardins » (17 & 18/10) sont des formules attractives mises en place
par Royaumont. Enfin les Journées du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2015,
seront l'occasion de découvrir un ensemble architectural et botanique
d'exception.
Informations et réservations :
par tel.: 01 34 68 05 50 ; en ligne : royaumont.com ou billetterie-spectacles@royaumont.com
Jean-Pierre
Robert.
***
PAROLES D'AUTEUR
Les Scènes de Faust de Robert Schumann
Szenen aus Goethe's Faust für Solostimmen, Chor und Orchester
composées entre 1844 et 1853, et créées en 1862 à Cologne sous la direction de Ferdinand Hiller
Ouverture
Partie I
N°1 Scène au jardin
N°2 Scène devant la statue de la Mater Dolorosa
N°3 Scène dans le Dôme
Partie II
N°4 Ariel au lever du soleil
N°5 Minuit
N°6 Mort de Faust
Partie III
N°7 La transfiguration de Faust
La composition de cette œuvre qui s'étend sur près de dix ans présente une démarche insolite : Robert Schumann (1810-1856) a commencé en 1844 par ce qui sera la fin de la troisième partie, puis il a ajouté les deux premières parties entre juillet 1849 et 1850, avant d'écrire une Ouverture en 1853. Comment s'explique ce parcours à rebours ?
L'emprise de Faust
Quand en 1844 Schumann ose se mesurer au Faust de Goethe (1749-1832), cette « Bible mondaine de tous les Allemands » selon la formule de Heinrich Heine (1797-1856) en 1835(1), contrairement à ses contemporains, compositeurs ou peintres, il s'intéresse à la fin du second Faust, œuvre parue en 1832, donc posthume selon la volonté de Goethe qui pensait que les lecteurs allaient avoir du mal à comprendre les formes et les enjeux de cette œuvre « incommensurable » et qu'ils la critiqueraient vigoureusement. Dans ce contexte de réception tendu, l'interprétation musicale de Schumann a largement contribué à la diffusion de cette seconde partie de la tragédie de Faust, assez difficile à comprendre car fantasque et donc désarmante... (Accolé )De manière tout à fait singulière, Schumann est donc d'abord inspiré par la fin de la dernière scène du second Faust de Goethe – scène qui, consacrée à l'élévation de l'âme de Faust après sa mort, se passe dans un paysage décrit dans le titre : « Gorges montagneuses - Forêt, rochers, solitudes. De saints anachorètes, répartis sur les sommets des monts, campent entre les ravins ». Par cette première approche du Faust de Goethe, Schumann consacre le genre de l'oratorio profane, expression d'une haute spiritualité dans une œuvre qui ne s'appuie plus sur un sujet tiré des saintes écritures ou de l'histoire du christianisme.
Schumann, qui a longtemps hésité entre la littérature et la musique, a sans doute été sollicité par Faust plus que tout autre, étant donné que son père était libraire-éditeur dans sa ville natale de Zwickau : il a donc eu l'occasion de connaître le Faust de Goethe, ainsi que les nombreuses publications concernant Faust. D'ailleurs, ses camarades qui, comme lui, adoraient les surnoms à connotation littéraire, l'appelaient Faust ou Fust, indice de son identification avec le personnage de Faust : le jeune Robert Schumann ressent la même aspiration à l'absolu, le même désir de connaissance, il possède le même genre de mélancolie qui va jusqu'à la tentation du suicide et il témoigne du même désir impatient d'aller toujours de l'avant. A peine âgé de 22 ans, il inscrivait les premiers vers de la chanson de Marguerite au rouet sur la partie centrale de son Intermezzo pour piano op.4 : « Meine Ruh ist hin ». Pourtant, contrairement à Schubert qu'il vénérait ou à Mendelssohn qu'il admirait, il ne s'intéressa au thème de Faust qu'après avoir d'abord consacré son énergie créatrice à des pièces pour piano au cours des années 1830, puis à des Lieder au cours de l'année 1840, avant d'aborder l'écriture pour orchestre à partir de 1841, la musique de chambre à partir de 1842 et enfin la composition pour orchestre et voix, solistes et chœur en 1843 avec son premier oratorio profane, Le Paradis et la Péri. Le livret s'inspire de la fable orientale Lalla Rookh (1817) du poète irlandais Thomas Moore (1779-1852).
Le Paradis et la Péri ou l'invention de l'oratorio profane
Il semble donc que Schumann ait choisi de se confronter systématiquement et successivement à tous les genres. Dans cette perspective, au moment d'aborder l'opéra, il est en quête d'un livret : cette recherche, qui l'occupe en fait depuis qu'il compose, va dans toutes les directions, depuis les grands textes tels Hamlet, L'Odyssée, Bajazet de Racine ou les Lettres de Cicéron jusqu'aux grands écrivains que sont Byron, Goethe, Calderon ou Hoffmann. Mais, avant de se décider en avril 1846 pour une légende médiévale, Genoveva de Friedrich Hebbel (1813-1863) dont il fait établir le livret par son ami Robert Reinick - dans son impatience il compose l'ouverture avant même d'avoir le livret dont d'ailleurs il finit par rédiger lui-même le texte du troisième acte -, il s'arrête entre février et juin 1843 sur Le Paradis et la Péri pour composer une sorte d'oratorio profane qui chante le triomphe de l'amour grâce à sa pureté et à son innocence. Cette œuvre, son op. 50, est créée le 4 décembre 1843 à Leipzig, avec un certain succès (elle sera exécutée une cinquantaine de fois du vivant de Schumann) alors qu'elle est de facture inhabituelle, correspondant à un nouveau genre, « neue Genre », voulu par Schumann qui la dénomme « Dichtung » (« Poésie ») et non oratorio. Sa mise en œuvre musicale, qui nécessite la réunion de sept solistes (2 sopranos, mezzo-soprano, alto, ténor, baryton et basse), d'un chœur et d'un grand orchestre, est de fait insolite : les solistes chantent différents rôles (l'Ange, le Jeune homme, la jeune fille, le Tyran, etc.) tout comme les chœurs qui représentent différents groupes de personnages (Indiens, Conquérants, Anges, Génie du Nil, etc.), si bien que la référence vocale prime sur le déroulement de l'intrigue contribuant à donner à l'œuvre un caractère lyrique, d'où la dénomination de « Dichtung » voulue par Schumann. L'œuvre, organisée en trois parties, est constituée de 26 numéros musicaux dont 12 tenus par les chœurs et 9 par la Péri. L'orchestre rassemble les bois par deux dont un piccolo, 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones (alto, ténor et basse), une ophicléide, timbales, triangle, grosse caisse, harpe et cordes. Ainsi, cette histoire orientale que Schumann connaît depuis son enfance (en 1822 son père en publia une traduction en allemand), lui permet de mettre à l'épreuve son désir de s'aventurer dans la création de formes inédites. Quand son ami Emil Flechsig la lui fait redécouvrir en 1841, il est enthousiasmé par ce qu'il ressent comme de la poésie écrite pour la musique et prend plaisir à en élaborer un livret en allemand en collaboration avec son ami. « L'histoire de la Péri se trouve dans Lalla Roohk de Thomas Moore et est écrit pour la musique. L'idée d'ensemble est si poétique, si pure, que j'ai été complètement enthousiasmé » écrivait-il à son ami Johannes Verhulst en juin 1843 (« Die Geschichte der Peri steht in Thomas Moore's « Lalla Rookh » und ist wie für Musik geschrieben. Die Idee des Ganzen ist so dichterisch, so rein, dass es mich ganz begeisterte »).(2)

Robert
Schumann. Lithographie de Joseph Kriehuber, 1839
Avec cette œuvre de conception originale, Schumann crée donc un genre nouveau de l'ordre de l'oratorio profane puisque cette « invention », qui procède à la fois, de son admiration pour les Passions de Bach ou pour le Paulus de Mendelssohn, et de son refus de composer une œuvre religieuse, porte une intention spirituelle : mettre en musique, chanter le geste qui assure le salut de l'être en quête de pardon ; en l'occurrence, celui de la Péri, fée de la mythologie persane, créature féminine ailée née d'un ange déchu et d'une mortelle : chassée du paradis pour avoir commis une faute, après l'échec de plusieurs tentatives pour retrouver sa place, elle finit par être acceptée au paradis quand elle fait don des larmes d'un criminel repenti à la vue d'un enfant en prière. Ravie que ce don soit agréé, la Péri chante alors sa jubilation d'avoir accompli son œuvre : « Mein Werk ist getan » (J'ai accompli mon œuvre).
« Mein Werk ist getan » et « Hier ist's getan » de la « Faust's Verklärung »
Ces paroles font étrangement écho aux derniers vers du second Faust : « Hier ist's getan » (Ici est accompli). Ce rapprochement permet de supposer que l'appel de ce vers a poussé Schumann à s'intéresser au « Chorus mysticus », c'est-à-dire à l'ensemble des derniers vers de la tragédie de Goethe ; d'autant plus que cette idée d'accomplissement, ici de l'inaccessible, de l'indescriptible, est associée à celle de l'amour qui vous élève spirituellement :
« Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichnis ;
Das Unzulängliche,
Hier wird's Ereignis ;
Das Unbeschreibliche,
Hier ist's getan ;
Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan .» (v.12104-12111)
(Toute chose périssable
N'est qu'un symbole ;
L'insuffisant
Ici devient événement ;
L'indescriptible
Ici est accompli ;
L'Éternel féminin
Nous attire vers le haut.) (3)
C'est donc sous l'emprise de ce Chorus mysticus que Schumann tourne autour de l'idée d'une composition pour voix solistes, chœurs et orchestre, restant incertain quant au genre : opéra ? Oratorio ? Nouveau genre ? Au cours de son voyage en Russie entrepris durant l'été 1844 pour accompagner Clara, alors en tournée de concert (Berlin, Tilsit, Riga, Saint-Pétersbourg, Moscou), il semble s'orienter vers un oratorio. Puis de retour à Leipzig, il associe ses esquisses au texte de Goethe pour mettre en musique simplement le chœur final, dénommé Chorus mysticus par Goethe, de cette transfiguration de Faust, « Faust's Verklärung ».
Après s'être installé à Dresde à la fin de l'année 1844 (il quitte Leipzig, déçu de ne pas succéder à Mendelssohn au poste de chef d'orchestre du Gewandhaus), Schumann est stimulé par les recherches de Wagner, alors maître de chapelle du Théâtre de la cour, en matière d'opéra allemand : il est alors de plus en plus impatient de trouver le livret adéquat... Décidément pourquoi pas Faust ? Ce projet retient son attention alors qu'il vient d'être impressionné par Die Erste Walpurgisnacht de Mendelssohn créée à Leipzig le 2 février 1843, œuvre qui lui rappelle la Symphonie fantastique de Berlioz (créée à Paris en 1830) et en particulier son dernier mouvement consacré au « Songe d'une nuit de sabbat ». Faust le tient... mais quelle forme va prendre cette emprise ? La poursuite de son travail de composition est d'autant plus problématique que Schumann semble inhibé par la force de la poésie de Goethe qui se suffit à elle-même : « Wozu Musik zu solche vollendeter Poesie ? » (A quoi bon de la musique pour une poésie aussi achevée?) écrit-il à son ami Mendelssohn, auquel il confie que l'œuvre ébauchée stagne sur son pupitre et qu'il a bien peur de ne pas la reprendre. L'émotion qui se dégage de cette poésie sublime, en particulier de la fin, l'incite à s'y risquer sans pour autant affirmer que l'œuvre verra le jour (« Die Scene aus Faust ruht auch im Pult;ich scheue mich ordentlich, sie wieder anzusehen. Das Ergriffensein von der sublimen Poesie grade jenes Schlusses liess mich die Arbeit wagen ; ich weiss nicht ob ich sie jemals veröffentlischen werde. » - lettre du 24 septembre 1845).
Schumann est inhibé par la perfection de la poésie de Goethe, alors que sa santé psychique est chancelante, particulièrement à partir en 1845 : il est la proie de crises nerveuses, de crises de larmes, devient familier de pensées effrayantes, notant dans son Tagebuch ses vertiges, son pouls faible, son manque d'appétit, ses maux de tête… Si bien qu'il renonce à se rendre à Bonn en août 1845 pour le dévoilement de la statue de Beethoven, événement qu'il avait pourtant largement préparé, se préoccupant de réunir les fonds nécessaires. Malgré son état fragile, la perspective du centenaire de la naissance de Goethe, en été 1849, l'incite à mener à bien cette transfiguration. Et pour donner sens à la mise en musique du Chorus mysticus, il décide de composer la musique de toute la dernière scène du second Faust de Goethe, celle de l'élévation de l'âme de Faust après sa mort (donc depuis le vers 11844 jusqu'au vers 12111). Or, quand Schumann se décide à orchestrer cette « Faust 's Verklärung », il vient de remplacer, depuis la fin de l'année 1847, son ami Ferdinand Hiller (1811-1885) à la tête du Liedertafel, chœur d'hommes, ce qui lui permet d'étendre sa maîtrise des chœurs et de l'écriture chorale. Cette activité professionnelle stimule Schumann pour concevoir une musique complexe pour double chœur et solistes.
Faust's Verklärung
Cette transfiguration « poétisée » par Goethe s'opère dans un paysage décrit par le titre de la scène : « Gorges montagneuses - Forêt, rochers, solitudes. De saints anachorètes, répartis sur les sommets des monts, campent entre les ravins ». Cette configuration poétique ne pouvait qu'inciter Schumann à s'inspirer de ce qu'il venait de faire dans le Paradis et la Péri puisque différents solistes (le Pater Extaticus, le Pater Produndus, le Pater Seraphicus, un Ange, le Docteur Marianus, les trois pécheresses que sont la Magna Peccatrix, la Mulier Samaritana, Maria Aegytiaca, enfin Gretchen pénitente et la Mater Gloriosa), et différents chœurs (des saints anachorètes, des enfants bienheureux, des jeunes anges, des anges accomplis, des pénitentes, répartis dans l'espace scénique imaginaire), se succèdent et s'étayent pour culminer dans le « Chorus mysticus » final.
Ainsi, après avoir composé son opéra sur la légende populaire de Genoveva (il y travaille entre 1846 et 1848 et dirige sa création le 25 juin 1850 à Leipzig), Schumann décide de terminer sa « Faust's Verklärung ». Avant les festivités du premier centenaire de la naissance de Goethe en août 1849, une première mise en œuvre musicale a lieu dans le Palais Cosel à Dresde le 25 juin 1848 ; le programme annonce : « Schlussscene aus dem zweiten Teile des Faust von Goethe, für Solostimmen Chor und Orchester von R. Schumann ». Cette première audition bien accueillie incite toutefois Schumann à composer une nouvelle version, plus concentrée, du Chorus mysticus pour 1849. Il ne touche pas au début de la scène et conserve la division initiale en sept numéros musicaux qui s'enchaînent. Cette division qui s'appuie sur les didascalies de Goethe n'altère pas le texte initial que Schumann suit scrupuleusement.
La scène est ouverte – N°1 – par les Chœurs des anachorètes qui se font écho de part et d'autre du ravin : ils décrivent le paysage constitué de forêts, de rivières, de grottes, de lions qui veillent... « Waldung, sie schwankt heran » (« La forêt se balance et s'avance »). Schumann a conféré un caractère solennel à cette description : le tempo est Ziemlich langsam (assez lent), la métrique à 9/8, et la tonalité est en fa majeur. La musique commence par de courtes phrases qui s'étagent depuis les sonorités graves des bassons doublés par les cordes basses jusqu'à celles plus aiguës des flûtes soutenues par les violons avec intervention des timbales, ce qui évoque un paysage calme ; les voix du chœur, bien individualisées, se répartissent dans le temps et dans l'espace sonore de façon à faire éprouver la dimension spatiale de la scène, tout autant que les déplacements des anachorètes ou que l'intensité de leur foi. Intervient alors après un moment de suspension, le N°2, confié au Pater Extaticus « qui flotte dans les airs, en s'élevant et en descendant » et qui appelle l'amour éternel : « ewige Liebe ». Schumann choisit un tempo plus animé, Etwas bewegter, la tonalité de ré mineur, à quatre temps, et confie la conduite de cet air de ténor à un solo du violoncelle qui brode une ligne ondulante et chromatique continue, la voix étant soutenue par les broderies des cordes. N°3, le Pater Profundus, basse, qui se trouve dans « les zones très basses », rend hommage à tous les « messagers d'amour » manifestation de « l'éternelle création ». Son récitatif en si bémol majeur est accompagné dans un tempo lent, Langsam, par les sonorités graves des trombones et des cors, l'évocation de l'amour, « Liebe », étant soulignée par les bois, tandis que le tempo s'anime, lebhaft, pour faire ressentir la mise en acte des éléments de la création. Suit le solo du Pater Seraphicus, également basse, qui se trouve dans une « zone intermédiaire » et, sous forme d'un arioso, voit pointer un nuage d'aurore ; son solo est ponctué par le chœur des enfants bienheureux (sopranos et altos) qui s'inquiètent de leur destinée et que le Pater Seraphicus invite à gagner les hautes sphères, lieu de la révélation de l'éternel amour. La musique se fait alors plus véhémente et éclatante, Lebhafter. Le N°4 solennel, Ziemlich langsam, en la bémol majeur, à trois temps, avec grand orchestre est ouvert par le chœur des Anges « planant dans l'atmosphère supérieure et portant la part immortelle de Faust ». Le chœur chante la persévérance de Faust, facteur de son salut : « Wer immer strebend sich bemüht, /Den können wier erlösen .» (« Celui qui, dans son constant effort, n'épargne pas sa peine/ Celui-là, nous pouvons le sauver. »). Puis dans une sorte de marche rythmée par les cordes basses, Allegretto à 2/4, les solistes, le chœur des anges et celui des enfants bienheureux chantent la joie d'avoir échappé au démon, avec une suspension extatique sur l'évocation de l'amour. Éclate alors le « Gerettet », « il est sauvé » en si bémol majeur à quatre temps, des chœurs et des solistes, soutenus par cordes intenses et par les trompettes. Ce passage très développé, qui entrelace voix solistes et chœurs, est une référence directe au Finale de Fidelio comme à celui de la Neuvième Symphonie de Beethoven.

L'édition
originale publiée à Leipzig, du Faust de Goethe
Après ce moment de jubilation et d'extase provoqué par le salut de Faust, le N°5 est consacré au Docteur Marianus, ténor ou baryton, qui dans « sa cellule la plus élevée et la plus pure » adresse une prière à « la glorieuse » « reine du ciel » ; le tempo est Langsam, à quatre temps, la tonalité sol majeur et l'orchestre conduit par la fluidité de deux harpes. Ce moment aérien se termine en sol mineur sur une suspension harmonique : le Docteur Marianus demandant la grâce pour les pécheresses. Suit le N°6, au cours duquel les pénitentes sont agréées par la Mater Gloriosa, introduit par le Docteur Marianus et le chœur qui appellent la miséricorde de la reine du ciel. Arrivent les Pénitentes, dont celle jadis nommée Gretchen, qui prient, soutenues par les enfants bienheureux. La Mater gloriosa apparaît, pardonne et promet à Gretchen que son bien-aimé est lui aussi sauvé. Ce moment est toujours lent, en si bémol majeur ; trois violoncelles soutiennent la gravité de cette imploration, tandis que un motif rapide de trompettes ponctuent l'imploration des pénitentes. La prière de Gretchen, sous forme d'arioso, est en la majeur. La Mater gloriosa apparaît et chante sur la même note soutenue par les tremolos des cordes, de manière solennelle, ses paroles d'agrément étant ponctuées par un court motif d'appel des cors et trompettes : « Komm ! Hebe dich zu höhen Sphären !/ Wenn er dich ahnet, folgt er nach. » (« Viens, élève-toi vers des sphères plus hautes,/ S'il pressent ta présence, il te suivra. » Ce moment se termine par les paroles de reconnaissance du Docteur Marianus dans la même forme : « Gottin, bleibe gnädig ! » (« Déesse reste plein de grâce »).
Ce moment de pardon intense est couronné par le N°7 consacré au Chorus mysticus qui réunit les sept solistes et un double chœur. Il commence de manière très solennelle en ut majeur à 4/2 par un contrepoint savant des voix sur : « Alle vergängliche / Ist nur ein gleichnis ;» (« Tout ce qui passe / n'est que symbole »), répété. Puis « Das Unzulängliche, / Hier wird Ereignis » (L'inachevé / trouve ici sa réalisation); ces deux derniers vers s'intriquent avec les deux premiers vers. L'ensemble s'intensifie par mouvement ascendant soutenu par les timbales, avant de s'arrêter de manière extatique sur les quatre derniers vers : « Das Unbeschreibliche, / Hier ist's getan ;/ Das Ewig-Weibliche/ Zieht uns hinan. » (L'indescriptible/ Ici s'accomplit ; / L'amour de l'Éternelle/ Nous exalte.), avec tenue sur « hinan ». Après ce moment de grande solennité, le tempo s'anime, Lebhaft, à C/ et la tonalité passe en fa majeur, pour faire éclater la jubilation finale, autour des trois derniers vers avec insistance sur l'idée d'accomplissement. La musique se caractérise alors par sa spatialisation, son élévation, ses timbres aigus, les entrelacs des voix avec importance des voix hautes et l'effet de surprise provoqué par l'intervention de la masse des chœurs après des passages réservés aux solistes. Cette intensité jubilatoire se métamorphose en une fin extatique : les voix et les instruments ont de longues tenues, tandis que les cordes sont légères, jusqu'à une progressive extinction sonore, qui provoque une impression de grand apaisement.
Cette vaste scène est donc interprétée par Schumann, à la suite de Goethe, comme la mise en œuvre d'une dramaturgie de l'élévation qui se termine sur ce Chorus mysticus. La composition musicale de Schumann de la scène consacrée à la transfiguration de Faust eut beaucoup de succès au cours de l'été 1849 quand elle fut exécutée simultanément dans trois villes, les 28 et 29 août 1849 : à Dresde sous la direction de Schumann, à Leipzig sous la direction de Julius Rietz et à Weimar sous la direction de Liszt. Ce succès, qui comble Schumann, lui fait prendre conscience qu'il s'agit d'un finale et qu'il doit compléter ces Scènes de Faust.
Le détour par Manfred
Au moment où Schumann s'était décidé à orchestrer la « Faust's Verklärung » il venait de perdre le 4 novembre 1847 son ami Felix Mendelssohn qui, dix ans auparavant, avait rendu hommage à l'invention de l'imprimerie – il y avait quatre cents ans - donc à Gutenberg, sous la forme d'une symphonie qui se terminait par une cantate conçue à partir d'extraits des Évangiles et composée à la manière de la Neuvième Symphonie de Beethoven : le Lobgesang (Chant de louange), quatrième mouvement de sa deuxième Symphonie en si bémol majeur op.52 (créée le 24 juin 1840 dans l'église Saint-Thomas de Leipzig, dirigée par Mendelssohn lui-même). Or Faust était souvent associé à cette invention de l'imprimerie.... Donc en s'inspirant de la cantate de Mendelssohn, Schumann rendait hommage tant à son ami qu'à Faust/ Fust ou à Gutenberg qui avaient permis à l'humanité de sortir de l'obscurantisme... et d'accéder à une spiritualité purement humaine.
Cette référence implicite à Mendelssohn est donc une façon de s'inscrire dans son héritage, et cela autour du thème de Faust qui taraude Schumann depuis sa jeunesse, soit par l'intermédiaire de la tragédie de Goethe, soit par celle du poème dramatique de Byron (1788-1824) : Manfred, que Goethe lui-même a immédiatement reconnu comme inspiré par son Faust, dès sa publication en 1817. Or la lecture de Manfred a bouleversé Schumann à l'âge de 18 ans : comme il l'a noté le 26 mars 1829, dans son Tagebuch : « Aufgeregter Seelenzustand -Bettlektüre : Manfred v.Byron – schreckliche Nacht » (« bouleversement de l'âme ; lu Manfred de Byron avant de m'endormir – terrible nuit ») ; puis, comme s'il suivait les pas de Manfred, durant l'été 1829, il fait un voyage dans les Alpes. (4)
Ce n'est pourtant que près de vingt ans plus tard, en août 1848, donc juste après la première création de la « Faust's Verklärung », qu'il décide d'en composer la musique : il termine le 31 mai 1849. Schumann s'enthousiasme pour Manfred comme le note Clara dans le Tagebuch à la date du 4 août 1848, signalant qu'il pense à un mélodrame et qu'il a arrangé le texte de Byron pour le rendre possible sur scène. Cet enthousiasme créateur suscité par Manfred, variation du thème de Faust, est en fait pour Schumann directement lié à la question de la mort. Ainsi, s'est imposé pour lui le glissement de la mort de Faust suivie de sa « Verklärung » (transfiguration) à celle de Manfred – à remarquer que Byron a mené le drame jusqu'à la mort de Manfred, alors qu'il ne connaissait que le premier Faust. Manfred, malgré sa haute maîtrise de la magie, ne possède pas le moyen d'oublier qu'il a causé la mort de la seule personne qu'il aimait au monde, Astarté, jeune femme qui lui ressemblait point par point… et il l'a tuée par excès d'amour en l'embrassant. Depuis, Manfred cherche désespérément « l'oubli » qu'il finit par trouver dans une mort radicalement athée, une fois que l'ombre d'Astarté – apparition qu'il a sollicitée en implorant Arimane souverain du royaume des morts – l'autorise à mourir…

Frontispice
de la partition de Manfred
Quand au cours de l'été 1848, Schumann décide de composer la musique du poème dramatique de Byron, il utilise une nouvelle traduction publiée en 1839 par Posgaru (pseudonyme pour Karl Adolf Suckow 1802-1847). Un exemplaire de cette traduction utilisé par Schumann et annoté par lui se trouve à Zwickau. Or, cette publication comprend une longue préface, annoncée dans le titre : "Manfred. Einleitung, Übersetzung und Anmerkungen, Ein Beitrag zur Kritik der gegenwärtigen deutschen dramatischen Kunst und Poesie, Breslau, 1839" (Introduction, traduction et annotation, une contribution à la critique de l'art et de la poésie dramatiques allemands contemporains). Dans cette préface d'une centaine de pages, l'auteur Suckow voit en Manfred l'essence du drame musical (dans la conception qu'il a de ce genre), exactement ce qu'il faut pour rénover le théâtre allemand en associant poésie et musique, « Wort und Ton », comme le prince Radziwill l'a fait pour la musique qui accompagne le Faust de Goethe (publié en 1835). L'auteur imagine même l'organisation musicale de ce drame : une ouverture orchestrale, puis des interventions musicales en fonction des incitations du texte... et il nomme le compositeur capable de réaliser cela : Mendelssohn... Or Felix meurt le 4 novembre 1847 à Leipzig... Comme il n'est plus là pour réaliser cette œuvre attendue, Schumann va tenter cette aventure : puisque ce ne peut plus être Mendelssohn, ce sera l'ami... qui justement a été ébranlé par ce poème dramatique, sans action. D'autre part, Schumann est en parfait accord avec l'analyse de Posgaru, l'auteur de la préface : comme la musique est d'ordre spirituel, le drame musical est la voie du renouvellement de la scène allemande.
Schumann se sent donc autorisé à se confronter à ce texte de poésie incomparable, même en traduction. Pour rendre envisageable la diffusion de ce poème dramatique sur une scène de théâtre, il en réduit la longueur à 350 vers au lieu de 1336, sans toucher au texte : il se borne à couper et à réorganiser légèrement. Pour cela il utilise la traduction de Suckow (l'exemplaire annoté se trouve à Zwickau) ainsi que celle de Böttger Adolf (1815-1870) et non celle publiée par son père en 1821 (Drittes Bändchen des poèmes de Byron) ; puis, après les représentations scéniques de Weimar, en juin 1852 sous la direction de Liszt, il établit un livret avec l'aide de son ami Pohl pour les représentations en version de concert avec récitant qui situe les moments et lieux du drame.
La conception de Schumann qui s'apparente au Gesamtkunstwerk par l'association du texte poétique, de la musique, du décor et du jeu des acteurs sur une scène, ne se situe pourtant ni dans le registre du théâtre ni dans celui de l'opéra. Pour Schumann, il ne s'agit pas d'une simple musique de scène, mais d'une œuvre originale, cohérente : son intention est de suivre le poème dramatique de Byron pour faire ressentir ce qui se passe dans l'intime, dans la tête et le cœur, de Manfred. Il se situe donc dans un registre émotionnel étranger à la représentation mais appartenant à l'univers de la musique conformément à l'interdit de la représentation qui favorise la vie de l'esprit puisqu'il privilégie la parole sans l'image. Mais si Schumann souhaite que ce poème dramatique soit exécuté en public, il se préoccupe d'éviter toute confusion car ce drame n'est pas du registre de la représentation théâtrale ; ce qu'il spécifie dans sa lettre à Liszt au moment de la préparation d'une réalisation scénique, en ces termes : « il faudra annoncer Manfred au public, non comme un opéra, un Singspiel ou un Melodram, mais comme un 'poème dramatique en musique'. Ce serait quelque chose de totalement nouveau et inouï. » (« 'dramatisches Gedicht mit Musik' – Es wäre etwas ganz Neues und Unerhörtes »).
La musique de Manfred
Pour réaliser cette œuvre d'un genre nouveau, Schumann dispose toutefois de références offertes tant par Berlioz que par Mendelssohn ou par Beethoven. De Berlioz, il hérite des recherches autour du théâtre de l'imagination (ce qui suppose une autre façon d'écouter) mises en œuvre dans la Damnation de Faust créée en 1846. De Mendelssohn, il retient le Melodram, cette technique d'écriture qui associe orchestre et voix parlées : plusieurs exemples se trouvent dans le Songe d'une nuit d'été, musique de scène constituée de l'Ouverture op.21 (composée en 1826) et de treize numéros op.61 pour accompagner la pièce de Shakespeare en allemand - commande du roi de Prusse créée le 14 octobre 1843 à Berlin. Cette écriture sous forme de Melodram a été consacrée par la scène de « La gorge aux loups », Finale de l'acte II, n°10, du Freischütz de Karl Maria von Weber quand Samiel est convoqué pour forger les balles ensorcelées (l'opéra a été créé à Berlin en juillet 1821). Enfin, la référence à Beethoven procède de la musique de scène pour le drame de Goethe Egmont. Pour élaborer une œuvre d'un genre nouveau, Schumann s'en inspire, reconnaissant de facto qu'il ne s'agit pas d'une simple musique de scène, mais que la musique participe au drame : l'exemple par excellence étant celui du moment de la mort de Klärchen que la musique évoque selon les termes inscrits sur la partition, « Klärchen's Tod bezeichnend » (« faisant ressentir la mort de Klärchen »). En fait, la musique de scène conçue par Beethoven pour Egmont correspond aux injonctions de Goethe qui demande des chansons, de la musique au moment de la mort, un mélodrame lors du sommeil d'Egmont, une Symphonie triomphale après la mort du héros, moments de musique de nature et de genre variés, destinés à conférer à la mise en scène de la pièce d'Egmont une dimension émotionnelle perceptible par les sens, en particulier par le corps. Par delà ces musiques exigées de Goethe, Beethoven devait respecter les pratiques de mise en scène habituelles à son époque et écrire une Ouverture ainsi que des musiques destinées aux Entractes (quand aucune musique n'était spécifiquement écrite, des musiques symphoniques déjà composées étaient utilisées).

Robert et
Clara Schumann en 1847
Suivant l'exemple de Beethoven pour Egmont, ou du prince Antoni Radziwill (1775-1833) pour le Faust de Goethe, Schumann s'appuie sur les incitations de Byron. Il le dit lui-même à Liszt dans une lettre du 31 mai 1849, après lui avoir annoncé qu'il vient de terminer une musique « zu Byron's Manfred, den ich mir zur dramatischen Aufführung bearbeitet, mit Ouvertüre, Zwischenakten und anderen Musikstücken, wie sie der Text in reicher Fülle darbietet.» (« pour le Manfred de Byron, que j'ai élaboré pour une représentation dramatique, avec une ouverture, des entractes et des morceaux de musique comme le texte y invite abondamment.»). Ainsi, c'est en compagnie de Faust et de son univers que Schumann compose une musique pour Manfred, une Ouverture et 15 numéros.
Pour réaliser son intention de faire advenir une œuvre d'un genre inédit, Schumann se place dans la lignée de Beethoven et suit les propositions de Suckow. Il commence par une ouverture pour grand orchestre qui installe l'auditeur dans une atmosphère de grande tension dramatique, produite par l'écriture et la facture : tonalité instable autour d'ut mineur, succession de tempo opposés - Rasch, Langsam, Nach und nach rascher, in leidenschaftlichem Tempo, Langsam (Tempo wie zu Anfang mit Ausdruck) -, contrastes de densité, accents, timbres différenciés, rythmes, scansion régulière, syncopes, cellules thématiques faciles à mémoriser, obsédantes comme le spécifie Clara qui ne cesse d'entendre le thème. Cette ouverture est de forme A B A ce qui contribue à sa grande unité comme à l'effet de concentration dramatique. Schumann compose un autre moment symphonique destiné à l'entracte entre les actes I et II : cette fois la musique est très calme à trois temps en fa majeur.
A la suite de ces pages symphoniques, il prend le texte de Byron en allemand avec les coupures et quelques remaniements surtout au début du IIIe acte : il conserve donc la continuité dramatique et les unités de lieu et de temps tout en introduisant de la musique, de plusieurs façons. En premier lieu, il répond aux incitations de Byron qui compte sur la musique à plusieurs endroits. Au premier acte, au cours de la première scène, après le monologue de Manfred et la conjuration des esprits, « un chant s'élève » - la musique de Schumann (n°1) respecte le texte de Byron, « Vos voix me parviennent, leurs accents doux et mélancoliques, telle la musique à fleur d'eau » : quatre voix se succèdent dans un contexte orchestral et mélodique différencié, pour chanter « Dein Gebot zieht mich heraus » (« A ton adjuration je me plie »). Puis au cours de la deuxième scène de ce premier acte : dans les hautes montagnes, au moment où Manfred veut se suicider, « On entend au loin un chalumeau de berger ». Schumann compose le n°4 Alpenkuhreigen, confié au cor anglais (Nicht schnell, en do majeur, à trois temps). « Silence, la mélodie » enjoint Manfred qui décrit cette musique ancestrale : « La musique naturelle de la flûte des montagnes, se mêle à la caresse du vent, à l'harmonie des cloches... ». Comme le poème de Byron fait souvent intervenir des êtres surnaturels, Schumann imagine des chœurs qui jalonnent le déroulement du drame (n°1, 3, 7, 8, 9, 15) ; toutefois, il exclut les démons du domaine choral (le n°14 est un Melodram). Rappelons qu'au cours de l'hiver 1847/1848 Schumann prend la succession de Ferdinand Hiller à la tête du chœur d'hommes de Dresde, dénommé Liedertafel. Au cours de la quatrième scène du deuxième acte, le chœur des esprits appartenant à la cour d'Arimane chante une hymne à la gloire de la toute-puissance de leur souverain (n°7) et ponctue les décisions comme dans une Passion (n°8 et n°9). Enfin, un chœur mystique, à la fin du troisième acte, accompagne la mort de Manfred.
Interprétant le poème de Byron, Schumann insère du Melodram aux endroits qui lui paraissent le demander, dépassant le plus souvent cette technique d'écriture puisque la voix libre, proclamée, se mêle à la musique, si bien que le poème aussi bien que la musique gardent leur autonomie : Schumann ne sacrifie ni à l'un ni à l'autre. Ainsi, le n°2 soutient l'apparition de la figure enchanteresse sur « Regarde » (« Behold ») « Schau' her ». Le n°6 est consacré à l'apparition de la Witch, l'esprit, fée des Alpes, sur invocation murmurée de Manfred qui disperse de l'eau, l'esprit surgissant derrière l'arc-en-ciel du torrent – avant un dialogue sans musique. Le n°10 est consacré à Némésis qui appelle Astarté, et le n°11, à Manfred qui s'adresse à Astarté : « la voix qui fut ma musique ». Le n°12 (début de l'acte III, 1) est une mise en musique continue du premier monologue de Manfred dans cet acte (il dit son calme intérieur) non suggérée par Byron. Le n°13 (acte III, 2) est une mise en musique du deuxième monologue de Manfred : l'adieu au soleil, cette fois sur une musique discontinue, quand il dit : « tu ne brilleras plus pour celui dont les dons de chaleur et de vie se sont avérés fatals. Il s'éteint... Je vais le suivre ». Le n°14 est destiné à l'esprit démoniaque, la confrontation s'effectuant par bribes, terrible. La partition comprend donc différentes formes de Melodram ajoutées par Schumann pour souligner certains passages : apparitions (Zauberbild, Astarté, démons), invocations (Witch, Astarté), monologue poétique (sensation de paix intérieure, adieu au soleil).
Le résultat de cette interprétation musicale est saisissant : la musique permet au spectateur de vivre le drame intérieur de Manfred et malgré sa diversité, assure la cohésion d'ensemble, puisque la musique sans le poème n'a pas de sens. Par exemple, la musique du chœur des esprits qui chantent la toute-puissance d'Arimane est reprise pour servir de lien entre les actes II et III (après la disparition d'Astarté qui a donné à Manfred l'autorisation de mourir, donc de se trouver dans le royaume des morts?). Ainsi, Schumann conserve la continuité du drame et l'unité de temps et de lieu de celui-ci, qui comprend trois actes, trois parties, mais il imagine une musique éclatée suivant la structure de Faust I de Goethe et comme bien des œuvres de Schumann qui sont des suites de différentes pièces. La structure continuité / discontinuité contribue à la tension, d'autant plus que la forme de la mise en musique est inattendue à chacune de ses interventions. Le texte n'est pas écrasé et la musique peut s'épanouir, car Schumann voulait conserver sa force à la poésie comme il l'écrit le 5 novembre 1851 à Liszt : « Wie schön, wenn wir das gewaltige Zeugniss höchster Dichterkraft den Menschen vorführen könnten ! » (« Que c'est beau, quand nous pouvons présenter aux hommes le puissant témoignage de la plus haute force de la poésie ! ») Ainsi, Schumann organise les sons pour donner le poids du réel à ce qui se passe dans le cœur et les émotions de Manfred, à son drame intérieur tel que la poésie l'exprime, le fait ressentir.
La portée de Manfred
Par cette réalisation dramatique créée par Liszt à Weimar les 13 et 17 juin 1852, Schumann offre une sorte de manifeste en faveur de l'autonomie de la musique : il dépasse la querelle entre musique absolue et musique à programme, entre la primauté de la parole ou celle de la musique. Pour lui la musique est un langage à part entière, spécifique, qui ne correspond pas au langage fait de mots : il s'agit d'autre chose, car si d'un côté le texte littéraire raconte, décrit, d'un autre côté la musique donne consistance au présent, au réel qui échappe justement au langage des mots. Seule la musique est apte à inscrire dans le réel l'expérience émotionnelle, y compris la plus dramatique.
Tous les commentateurs ne manquent pas de faire le parallèle entre Schumann et Manfred. Oui, il est indéniable que Schumann a reconnu ses souffrances dans celles de Manfred : la mort de sa sœur (par suicide) suivie de celle du père, sa culpabilité inconsciente, sa fixation sur Clara, les voix intérieures qui l'obsèdent, le goût pour le fantastique et le surnaturel, l'attrait pour le spiritisme, le sentiment de toute-puissance qui se heurte au réel, symbolisé par l'oubli impossible, la solitude car il se sent un être à-part, ou encore l'amour partagé malgré les interdits. Mais, en plus, de la dimension de réel conférée à la musique, Schumann sait que pour Manfred, Astarté est d'abord une voix : « The voice which was my music-- Speak to me! » (« ta voix, ma musique !») Rappelons que dans l'Allemagne du Vormärz, celle des poètes de « la jeune Allemagne », Schumann n'est pas seul à admirer Byron : c'est le poète constitutif de la sensibilité, des émotions, des références poétiques de la génération à laquelle Schumann appartient.
Ainsi, par l'intermédiaire de Manfred, poème dramatique, Byron a offert la possibilité à Schumann, tiraillé entre littérature et musique, de s'affirmer créateur, de tenter de conjurer ses angoisses de culpabilité en mettant en œuvre de manière inédite (libératoire), d'inscrire dans le réel, ce qui se trame dans l'âme de bien des êtres humains. Dès l'Ouverture qui installe l'auditeur/spectateur dans le drame, par l'écriture qui signifie choix de l'orchestration, des tonalités, des dynamiques, des combinaisons de cellules différenciées qui s'engendrent, de forme ABA : il ne s'agit pas de description, mais de musique qui est seule à pouvoir rendre présent le drame dans sa continuité. Ce qui intéresse Schumann, c'est le drame intérieur et non l'opéra qui suppose action, intrigue.
La mort de Manfred
Reste la question de l'interprétation musicale que Schumann a donnée de la mort de Manfred. Il est évident qu'il ne peut se résoudre au néant : même s'il conserve le texte de Byron, il interprète, donne sens à l'interrogation de l'abbé qui ne sait où s'en va Manfred....Pour lui, la voix, la musique - comme pour la transfiguration de Faust - assure la rédemption, le pardon, la transfiguration. Elle donne accès à la plus haute spiritualité, ce « paradis musical ». D'ailleurs, tout en reprenant les Scènes de Faust, Schumann poursuit ses recherches de « paradis musical » avec un Requiem pour Mignon (été 1849, op.98b) et avec la mise en musique des Drei Gesänge d'après les « Hebrew melodies » de Byron traduites par Körner, op.95 (1849), pour harpe ou piano ; et il utilise la déclamation sur piano dans des ballades sur des textes de Hebbel (1813-1863), et de Percy Shelley (1792-1822) op.122 (1853). Cette recherche le tient depuis plusieurs années : déjà à Dresde, le 31 mars 1845, il notait sur son Tagebuch : « Idee : Gedichte z. Deklamation mit Pianoforte », affirmant alors que la déclamation est une façon de composer qui n'existe pas encore : « Deklamation, eine Art von Composition, die noch noch nicht existiert », note-t-il en décembre 1849 au moment où il compose l'op.106.
La reprise de la composition des Scènes de Faust : les parties I et II

Faust et
l'Esprit, illustration de la main de Wolfgang von Goethe
C'est donc muni de l'expérience de Manfred et tenu par l'exigence de conférer son entière autonomie à la musique que Schumann reprend sa composition du Faust de Goethe. Quand Schumann comprend qu'il doit inscrire la transfiguration de Faust dans un contexte dramatique, au lieu d'établir un livret tiré de l'œuvre de Goethe que tous ses contemporains connaissent par cœur (« bible mondaine de tous les Allemands » selon Heine), il choisit de juxtaposer – à la manière de la structure même du premier Faust composé de scènes juxtaposées - quelques scènes de façon à donner sens à la rédemption finale de Faust opérée par la pénitente Gretchen. Dans cette perspective, Schumann centre une première partie sur la figure de Gretchen : il retient la scène du jardin (vers 3163-3210), celle de sa prière adressée à la Mater dolorosa (3588-3669), puis celle du Dôme (3776-3832) – il va ainsi de la séduction aux tourments de la conscience en passant par la prière – ; ces scènes, très connues, ont été illustrées en particulier par Peter Cornelius, par Retzsch et par Delacroix, bien avant que Schumann ne les choisisse. Puis, il organise une deuxième partie des Scènes de Faust autour de la renaissance de Faust après son aventure douloureuse avec Gretchen, donc en prenant des scènes du second Faust. Tout d'abord, la première scène de l'acte I (vers 4621-4727) : « Ariel. Lever du soleil. Faust. Chœur » ; puis la rencontre « A minuit » (« Mitternacht », acte V, vers 11382-11510) avec les quatre femmes personnifiant der Mangel (le Manque), die Schuld (la Dette, la Faute), Die Sorge (le Souci) et die Not (la Détresse, la Nécessité), et, enfin, la mort de Faust (acte V, « Grosser Vorhof des Palasts - Fackel » « Grand péristyle du palais – flambeaux » ; vers 11511-11594) – la succession de ces trois scènes évoquant une sorte de passion christique, précédant la résurrection et l'ascension déjà mise en musique avec les sept numéros de la « Faust's Verklärung ».
Partie I
La première partie est donc constituée d'un duo d'opéra, d'un monologue dans le style d'un Lied accompagné par l'orchestre et d'un duo ponctué par des chœurs dans le style oratorio. La scène au jardin est un duo entre Faust rajeuni et Gretchen, émerveillés l'un et l'autre par cette rencontre et leur amour naissant : elle effeuille une marguerite et s'arrête sur « il m'aime ! » - exclamation qui exalte Faust. Ce duo est en fa majeur à 12/8, « Nicht schnell », donc dans un tempo calme. La musique est intense, délicate et ponctuée d'élans ; les bois chantent tandis que les cordes assurent le balancement du bonheur, jusqu'à l'arrivée du solo de basson, « quasi récitatif », qui accompagne le moment où Méphistophélès sort de l'ombre pour donner le signal de la séparation.
La deuxième scène, « Zwinger », se passe sur les remparts devant la statue de la Mater dolorosa : Gretchen se sachant coupable, et d'être enceinte et de la mort de sa mère ainsi que de celle de son frère Valentin, adresse une prière à cette figure divine, la suppliant de la protéger, de lui épargner la honte et de la sauver de la mort. Le tempo lent au début s'anime, dans une métrique à quatre temps et dans la tonalité d'ut mineur. « Ach neige Du Schmerzereiche, Dein Antlitz gnädig meiner Not ! » (« Incline/ dans ta pitié/ ton visage sur ma détresse). Cette supplique est introduite par un motif discontinu et haletant des altos, qui ponctue les bribes de phrases de Gretchen ; les violons dans l'aigu témoignant de sa détresse. Puis un passage en fa majeur à 6/4 éclaire cette plainte du souvenir des moments heureux de ses amours avec Faust. La reprise de l'ut mineur et du motif plaintif termine ce moment d'imploration.
La troisième scène est celle du « Dom », quand Gretchen qui cherche à prier est assaillie par Méphistophélès et qu'un impitoyable Dies Irae semble la condamner d'avance. Comme l'écrit André Boucourechliev(5): « les accords du chœur soutenus par les cuivres progressent en gigantesques bloc sonores, écrasants, fatidiques. L'effet atteint son paroxysme dans le Judes ergo qui suit les plaintes de la pécheresse, le rire de Méphistophélès. » Goethe spécifie que la scène se passe pendant l'office, que l'orgue et les chœurs résonnent et qu'il y a beaucoup de monde dans l'église, tandis que le « Böser Geist » se tient derrière Marguerite. Schumann a choisi les sonorités lugubres des cuivres auxquels se joignent les trombones dès le début lent en ré mineur marqué par une longue descente des cordes basses. Puis les trombones soulignent les insinuations de plus en plus perfides du mauvais esprit. Gretchen est de plus en plus troublée quand le Dies Irae l'écrase littéralement. Après une Judex ergo en ré majeur, le ré mineur revient dans une très grande tension de l'orchestre, avec des timbales inéluctables.
Partie II
Cette partie est constituée de trois grandes scènes associant de manière complexe, solistes, chœurs et orchestre. L'inspiration se situe dans la continuité des chœurs composés pour Manfred. Après le moment de tension de la scène du Dôme, la deuxième partie s'ouvre sur une musique calme en si bémol majeur à trois temps marquée par les ondulations de triolets aux violoncelles et par la sonorité aérienne de la harpe, conformément aux injonctions de Goethe. Ariel, l'esprit qui protège Faust (en référence à la Tempête de Shakespeare), chante au lever du soleil dans un « paysage agréable », tandis que « Faust est allongé sur une prairie en fleurs, fatigué, agité, cherchant le sommeil. Une ronde d'esprits, petites créatures gracieuses vole dans les airs. » Cette musique introduit dans l'atmosphère plus mystique du second Faust, Schumann se conformant aux indications de Goethe pour faire ressentir la métamorphose intime de Faust, rasséréné par un sommeil réparateur. La scène commence par une introduction d'orchestre puis Ariel, dans une sorte de récitatif accompagné, appelle les esprits pour qu'ils apaisent Faust. Le chœur des esprits accomplit ce qui leur a été demandé par un chant fluide, immatériel, les voix aiguës répondant aux voix plus graves, avant de se réunir, solistes et chœur. Après un passage à 6/8 un roulement de timbales annonce le lever du soleil. Puis « mässig », Faust se réveille et chante en sol majeur à 6/8 le bien-être qu'il éprouve après ce sommeil réparateur. Schumann se conforme au texte de Goethe pour faire ressentir ce qu'éprouve Faust dans une sorte de Lied accompagné par l'orchestre. Après l'émerveillement de Faust devant le reflet coloré qui est celui même de la vie, la fin de cette scène, en mi majeur, semble une marche décidée : Faust repart à la découverte du monde inconnu.
Suit la deuxième scène de cette deuxième partie : l'apparition des quatre femmes grises à minuit, der Mangel (la Misère), die Schuld (le Péché), die Sorge (le Souci), die Not (la détresse). Il s'agit donc d'une scène d'ensemble : chacune des femmes se présentant pour annoncer sa mort à Faust qui refuse de les entendre et les chasse, jusqu'à ce que le Souci ne le harcèle et ne l'ébranle en lui jetant un sort qui le rend aveugle. La musique donne un caractère hallucinatoire à cette longue scène dramatique. Elle commence « Schnell » à 6/8 en si mineur quand les femmes se présentent dans une texture orchestrale fantastique (éclatée, avec des pointes sonores aiguës). Puis Faust garde son calme, avec une sorte de récitatif accompagné, pour justifier son attitude inébranlable. Suit le dialogue entre le Souci, sur une ligne très chromatique et ondulante pour faire entendre la séduction mortifère, et Faust qui « mit Kraft und Feuer » (avec force et feu), ne renie rien de sa vie alors que le Souci l'accuse de toutes sortes de méfaits et lui jette le sort qui le plonge dans la nuit. Faust manifeste pourtant sa volonté de poursuivre son œuvre de civilisation : la musique soutenue par les vents exprime sa détermination héroïque.
La troisième scène retenue par Schumann suit immédiatement la précédente dans la tragédie de Goethe : c'est celle de la mort de Faust. Schumann l'ouvre par des sonorités funèbres sur le rythme inexorable des Lemures qui creusent la tombe, comme l'a ordonné Méphistophélès. Faust aveugle sort de son palais et se méprend sur le bruit des pioches : il croit que c'est le travail d'assèchement des marais qu'il a demandé... Content de ce qu'il a accompli il prononce alors, à la fin d'un long monologue chanté, la phrase qui doit mettre fin à ses jours et le livrer à Méphistophélès : « Verweile doch du bist so schön » (« Arrête-toi donc, tu es si beau »), dit-il à « l'instant » en ut majeur. Une tension harmonique accompagne la mort de Faust, et la musique se déploie telle une marche funèbre. Méphistophélès prend acte en parodiant l'Évangile de Saint Jean : « Es ist vollbracht » (« Tout est accompli »), tandis qu'un chœur très recueilli reprend ce constat, ponctué par des timbales funèbres dans la tonalité d'ut majeur.
L'Ouverture des Scènes de Faust
Une fois les Scènes juxtaposées et achevées, Schumann compose en 1853 – donc après celle de Manfred - l'ouverture instrumentale sans reprendre les thèmes musicaux mis en œuvre dans les trois parties déjà composées, mais en mettant en évidence la tension inhérente à la condition humaine, le conflit entre les forces antagonistes, l'une poussant à la réalisation immédiate du plaisir – rendue par le thème impétueux en ré mineur dont la texture, sur roulement de timbales, et les dissonances traduisent une grande inquiétude – et l'autre à l'élévation de l'âme – exprimée par un thème nostalgique en fa majeur et par un thème séraphique en si bémol majeur. L'ouverture qui commence Langsam und feierlich (lentement avec solennité) se termine de manière très solennelle en ré majeur sur des accords répétés, affirmatifs, très sonores sur roulement de timbales.
Une musique d'une très haute spiritualité
L'exécution de l'ensemble de cet oratorio profane composé entre 1844 et 1853 n'eut lieu qu'en 1862 – donc bien après la mort de Schumann qui datait du 29 juillet 1856 - à Cologne sous la direction de Ferdinand Hiller. Cette œuvre laissa perplexes les amis de Schumann. En particulier, Brahms critiqua la disparité des styles de la partition(6). Pourtant le critique proche de Schumann, Franz Brendel, reconnut dans la troisième partie les « éléments de la musique d'église du futur » (« Elemente der Kirchenmusik der Zukunft », in NZF 31, N°22, S.113-115)(7).
En avance sur l'horizon d'écoute de ses contemporains, Schumann avait conçu une œuvre d'une grande difficulté technique – redoutée par les chanteurs pour ses rythmes solennels et ses longues tenues – et d'une grande complexité. Il a écrit pour douze voix (double chœur et solistes) et l'œuvre nécessite dix-neuf personnages ; et il a conféré un rôle central à un langage harmonique très personnel constitué d'accords mystérieux car instables, de sonorités inquiétantes, fantastiques, de « notes étrangères » à l'harmonie produisant des effets de dissonance. En outre, la structure éclatée en scènes autonomes dérouta alors qu'elle participe, tout autant que l'écriture musicale insolite, au sens et à la portée de cette œuvre. Malgré sa structure cyclique, l'ensemble de l'œuvre tendue vers son accomplissement – la transfiguration de Faust – possède des éléments d'unité très subtiles qui résident dans l'emploi de cellules mélodiques, rythmiques, harmoniques, et de gestes musicaux tissant des allusions et des références entre les différentes scènes sans qu'il n'y ait pour autant de motifs récurrents.
Avec cette œuvre de construction insolite, Schumann, qui adorait les mises en scènes fictives de ses états d'âme – telle celle du cycle des dix-huit pièces pour piano intitulée Davidsbündlertänze (Danses des compagnons de David) op.6, composées en 1837, complicité et confrontation entre l'impétueux Florestan et le tendre Eusebius, personnages provenant de romans de Jean-Paul –, a proposé une démarche d'élévation spirituelle sur une scène imaginaire par l'intermédiaire de la figure de Faust, qui émeut, bouleverse, remue - symbolisant ce qui se trame au cœur de l'être. Schumann s'est donc fait l'interprète de la conception de Goethe. « Es irrt der Mensch so lang er strebt » (« Tout homme qui marche peut s'égarer », traduit Nerval) : Goethe confie ces paroles au Seigneur pour signifier que l'homme qui cherche à aller toujours plus loin avec ténacité et sans relâche, malgré difficultés et échecs, ne peut qu'être sauvé, comme Faust, qui malgré sa culpabilité dans la mort de Gretchen, puis tous les méfaits qu'il a commis et tous les déboires qu'il a rencontrés, a fini par consacrer sa vie à une grande œuvre civilisatrice, celle d'assécher des marais en bord de mer pour y créer les conditions favorables à l'installation durable d'une collectivité humaine.
La postérité de la transfiguration de Faust
Malgré sa difficulté d'exécution, cet oratorio profane, produit d'une longue élaboration dans lequel Schumann dévoile son être intime et profond, a rendu le second Faust plus accessible que les nombreuses analyses publiées sur cette dernière œuvre de Goethe. Et, cette mise en œuvre musicale de l'élévation spirituelle a été retenue par Liszt (1811-1886) qui a ajouté, en 1857, un Chorus mysticus à sa Faust-Symphonie, terminée en 1854, puis par Gustav Mahler (1860-1911) qui a repris cette dernière scène du second Faust comme second mouvement final de la gigantesque Huitième Symphonie, composée en 1906 et créée à Vienne le 12 septembre 1910 : les huit solistes y alternent avec les différents chœurs dans une grande masse orchestrale. Avec cette œuvre monumentale qui porte le surnom de « Symphonie des mille », Mahler a fait éclater le genre symphonique en dépassant toutes les formes préétablies et tous les genres pour instruments seuls et pour instruments et voix : symphonie, cantate, oratorio, choral avec air d'opéra, chœurs d'enfants, mélodies solistes. L'élévation spirituelle apportée par la musique dans le cadre de la religion de l'art s'est transformée, avec Mahler, en expression d'une affirmation de toute-puissance bien éloignée de l'intériorité du Lied de Schubert ou de l'oratorio profane de Schumann – transformation qui témoigne d'une évolution dans les incitations créatrices de Faust centrées au début du XXe siècle sur l'exigence de dépassement grandiose plus que sur l'élaboration d'un nouveau langage conférant son autonomie à la musique.
Elisabeth Brisson.
(1) Voir E. Brisson, Faust, biographie d'un mythe, Paris, ellipses, 2013.
(2) Martin Geck, Robert Schumann. Mensch und Musiker der Romantik, München, Pantheon, 2012, p.192.
(3) Johann Wolfgang von Goethe, Faust, Urfaust, Faust I, Faust II, édition établie par Jean Lacoste et Jacques Le Rider, Paris, Bartillat, 2009.
(4) Cf. Martin Geck, op.cit., pp.277-283.
(5) André Boucourechliev, Schumann, Paris, Solfège, Seuil, 1956, p.151.
(6) Voir Emmanuel Reibel, Faust – La musique au défi du mythe, Paris, Fayard, 2008, p.83.
(7) Voir Hans Joachim Kreutzer, Faust – Mythos und Musik, C.H. Beck, München 2003, p.97.
***
REPÈRES PÉDAGOGIQUES
Improviser l'introduction d'une chanson ou d'un
standard
L'enseignement
de l'improvisation est souvent un sujet délicat pour le professeur de musique. Dès lors que
l'on souhaite en définir le cadre, la méthode ou la pédagogie,
deux notions fortement opposées s'invitent : connaissances techniques et
liberté[1]. La plupart des ouvrages
traitant de l'improvisation ne font qu'énoncer un ensemble de règles
théoriques : composition des accords, cadences, contrepoint etc. Ces
connaissances sont la matière première de la grammaire musicale. Tout musicien
doit connaître ces règles. Ce substrat sonore doit être organisé afin d'avoir
une valeur musicale. Des choix esthétiques doivent être fait.
Cet aspect est trop souvent absent des traités et méthodes. Il est tout juste
évoqué : et pour cause, comment expliquer le don le génie d'un acte de
création ?
Pour ces
raisons, les lignes qui vont suivre ne seront que des directions ou des
conseils de travail pour les apprentis improvisateurs. Les enseignants pourront
également s'en inspirer pour proposer des plans de travail à leurs élèves.
Pourquoi improviser et improviser sur quoi ? L'improvisation est un vaste
domaine. Il est donc nécessaire d'en limiter le sujet. Cet article
s'intéressera plus particulièrement à l'étude d'une facette de cette
pratique : l'improvisation au piano d'un prélude introductif à une chanson
ou un standard. Ce cas de figure est très intéressant car il est lié à une
œuvre préexistante tout en laissant une grande liberté à son acteur.
L'article
s'adressant principalement à des professeurs de musique, je n'ai pas jugé utile
de redéfinir certains points théoriques. L'aspect temporel du geste improvisé
sera évoqué dans une première partie, son discours dans une deuxième, et en dernier
lieu les particularités du piano seront interrogées.
Structure de
l'improvisation
Le geste de
l'improvisation ne peut se dissocier de la notion de temps. Tout discours, même
extrêmement libre, repose sur une orientation, un sens musical et doit parfois
se plier à une limite de temps contraignante (durée d'une prestation ou d'un
enregistrement par exemple). Parmi les éléments préliminaires à
l'improvisation, le plan, directement lié à l'aspect temporel de la musique,
est certainement le paramètre le plus contraignant. En cas d'improvisation à
partir d'une structure préexistante, le plan tonal et la succession des
harmonies dictent un canevas au musicien. Ce
dernier est libre de la suivre « à la lettre » ou, au contraire, de
le contourner.
Le musicien
improvisateur peut aussi avoir recours à un plan libre créé ex nihilo. Un grand nombre de solutions
est envisageable pour le créateur. Mon ambition n'est pas de lister toutes les
possibilités, le format de cet article ne le permet pas. Il est d'ailleurs impossible
d'en établir un recensement complet mais l'observation de la pratique courante
des musiciens et mon expérience permettent de proposer quelques cas assez
fréquents :
-
le geste musical s'appuie sur un ou deux
accords. Ce procédé est souvent associé à un discours méditatif. Les mélodies
ainsi créées sont reconnaissables par leur grande continuité et leur lyrisme.
Même si la chanson ou le standard suivant cette introduction improvisée ne
repose pas sur une échelle modale, ce procédé permet d'en explorer ses
nombreuses possibilités à condition de jouer
sur l'ambiguïté de certains degrés
« faibles ». En improvisant sur les degrés VI et III du mode
majeur, il est possible d'utiliser le mode de la ;
-
le musicien créateur donne naissance à une
grille. Cette création instantanée est possible si l'auteur possède la technique suffisante pour anticiper son discours
mélodico harmonique. C'est pourquoi, la notion d'habitude est primordiale. En
effet, de nombreux plans harmoniques connus (anatoles,
christophes, II/V/I…) appartiennent au langage
courant des improvisateurs. L'originalité du musicien sera liée à sa capacité
de contourner, moduler, transformer ces formules de bases mais aussi d'en créer
de nouvelles. Dans l'hypothèse d'un prélude
improvisé, le musicien peut s'inspirer du thème qui suivra. Ces citations
doivent s'inscrire dans son discours sans donner l'impression d'être des pièces
rapportées. Tout le talent du musicien apparaît dans ce travail de synthèse et
d'intégration de thèmes.
Que
l'improvisateur s'appuie sur une grille préexistante ou en soit l'auteur, il
doit respecter une règle fondamentale : la continuité du discours. Les quelques
remarques du paragraphe précédent suggèrent des improvisations fluides et
carrées assez proches des thèmes les accompagnant. Or,
rien n'interdit au musicien créateur d'introduire des
ponctuation ou des brisures. Les thèmes suivant les introductions
improvisées reposent souvent sur des canevas aux carrures régulières. Pour
différencier son improvisation de ce qui va suivre, le musicien doit donc
interpeler l'auditeur avec des éléments dramatiques. Les ponctuations
rythmiques usuelles peuvent briser facilement ces cycles : points
d'orgue, ralentis, accélérations, changements de métriques permettent de créer
du relief.
Afin
d'éviter tout effet gratuit, ces brisures, de caractère dramatique, doivent
avoir une signification et une fonction musicales. Par exemple, un point
d'orgue s'associera facilement à un accord instable, telle la septième
diminuée, mais n'apportera rien à une cadence parfaite. Mal placé, le point
d'orgue devient très vite synonyme de maniérisme musical. Un ralenti fera la
transition entre la fin de l'introduction et le début du thème. Une
accélération pourra s'associer à un passage harmonique instable. Un changement
de métrique sera la conséquence d'un motif mélodico rythmique singulier. Pour
faire bon usage de ces ponctuations, il est important de suivre son instinct musical. Tout abus de ces formules
alourdira votre discours musical.
Le contenu
littéraire d'une chanson peut avoir une influence directe sur son introduction
improvisée. Les effets dramatiques évoqués plus haut peuvent avoir une relation
avec le texte de l'œuvre. Le musicien improvisateur utilise son bagage
technique et sa sensibilité pour évoquer le climat, l'ambiance de la chanson.
Les cadences sont très utiles dans la figuration musicale. Une cadence parfaite
donne l'impression de calme et de stabilité. Une demi cadence
laisse à l'auditeur une impression de
suspension ou d'attente. Une cadence rompue provoque un effet d'éloignement ou
de nouveau départ et permet de relancer le discours musical.
Stratégie du
discours
Ainsi, le
musicien possède un ensemble de formules et d'outils lui permettant d'organiser
rapidement un court prélude. Il ne lui reste plus qu'à choisir deux ou trois
idées mélodiques pour élaborer son discours et le tour est joué !
Cependant, ce n'est pas si simple à
réaliser. En effet, la mélodie, l'harmonie et le rythme doivent être liés afin
de donner l'impression de former un tout. La musique ne fonctionne pas par
collage ou montage mais comme une entité.
« La
mélodie vulgaire [dans le sens de populaire] est bonne si elle est
trouvée »[2]
nous expliquait Francis Poulenc en 1920. Ce bon mot du célèbre musicien
français nous renvoie à cette fameuse notion d'inspiration. Autrement dit,
comment définir un coup de génie ? Tout comme la notion d'inspiration, le
génie ne s'apprend pas dans les livres. Définir ce qui est mélodique ou ce qui
ne l'est pas relève du défi. La seule méthode dont dispose l'apprenti
improvisateur est l'analyse d'exemples préexistants : il retiendra ainsi
quelques « ficelles » ou quelques « trucs ».
Une
« lecture » des grand maîtres du passé lui
permet de retenir quelques principes. Tout d'abord, il doit se rappeler que la
quantité de notes ne fait pas la qualité d'une mélodie improvisée. Cette règle
est primordiale, nous devons l'avoir continuellement en tête lorsque nous
improvisons. Afin de donner de la cohérence à son discours, le musicien doit
chercher des motifs relativement courts afin de pouvoir les développer sur les
différentes harmonies de la grille. Ces cellules permettent à l'auditeur de
fixer son attention sur le déroulement de la prestation et au musicien de
démontrer son habileté musicale. La maîtrise de ces micros éléments musicaux
est essentielle ; elle doit se pratiquer dès les premières tentatives
d'improvisation. Elle empêche les réflexes instrumentaux habituels. Il n'est
pas inutile de rappeler qu'enchaîner des gammes et des arpèges à toute vitesse apporte peu à la musique ; surtout si le cadre n'est que
l'introduction d'une chanson ou d'un standard de jazz.
Une fois que
le musicien commence à maîtriser le placement des cellules mélodiques, il doit
rapidement agrémenter ces dernières de petites variantes afin d'éviter de
donner l'impression de tourner en rond ou de se répéter. De nombreux ornements
peuvent augmenter le discours musical : appoggiature, gruppetto, retard, notes
de passages… Mais il faut aussi sortir des sentiers battus et
« oser » des intervalles jugés trop dissonants ou malvenus dans les
traités d'harmonie. Malgré toutes ces contraintes,
une improvisation doit garder une certaine fraicheur. La fragilité et
l'empirisme ne sont pas à exclure ; la recherche de la « note bleue »
ou de l'ultime dissonance doit se faire sur l'instant avec tous les risques que
cela implique : tâtonnements, hésitations et petites imprécisions. Tout
sera accepté si la démarche musicale est sincère !
Nous l'avons
dit plus haut, le prélude improvisé peut se faire sur la structure harmonique
du thème qui va suivre. En fonction de ses compétences, de ses envies ou de son
inspiration, l'improvisateur pratique des modifications plus ou moins
importantes sur la trame harmonique utilisée. Il est difficile et prétentieux
d'établir une typologie complète de ces altérations mais les plus fréquentes
dans la sphère de la chanson et du jazz sont :
-
l'enrichissement des accords, c'est-à-dire
l'ajout de 7èmes, 9èmes, 11èmes et 13èmes mais aussi l'altération de certaines
notes ou le retrait d'autres (fondamentales ou quintes en principe) ;
-
l'utilisation de substitutions : dans ce
cas l'improvisateur remplace un accord par un autre. Cette pratique n'est pas
très éloignée de la précédente dans la mesure où l'altération ou
l'enrichissement d'accords transforme ces derniers. L'exemple le plus fréquent
est la fameuse « substitution tritonique » consistant à remplacer un sol 7ème de dominante (sol, si,
ré, fa) par un réb 7ème (réb, fa, lab, dob). Dans ce cas, le réb est la quinte
diminuée de l'accord original, le fa sa
7ème, le lab
sa 9ème mineure ajoutée et le dob sa tierce (par
enharmonie) ;
-
la grille originale peut être amputée d'une
partie plus ou moins importante. En cas d'introduction libre au piano, le
musicien peut se contenter d'improviser sur une seule partie du thème. Le plus
souvent, il utilise la fin de la séquence afin d'enchaîner facilement le thème.
Ces courtes introductions ont parfois la fonction de donner le
« ton » aux chanteurs.
Le pianiste
a la particularité d'être à la fois soliste et accompagnateur. En règle
générale, la main gauche joue le rôle de l'accompagnement. Les musiciens
avancés répartiront l'accompagnement entre les deux mains tout en faisant
ressortir la mélodie à la main droite (ou parfois à la main gauche, s'ils
souhaitent faire chanter les basses du piano). Quel que soit le mode de jeu
retenu, la difficulté sera de maintenir un équilibre et une cohérence entre les
deux mains. Comme toujours en musique, il est recommandé de commencer par des
choses simples.
Il est
possible, par exemple, de jouer uniquement les basses des accords à la main
gauche et de jouer la mélodie improvisée à la main droite. Autrement dit, jouer
à deux voix. Cette technique permet d'appréhender assez facilement toutes les
notions d'harmonie tout en allégeant le jeu.
Passée cette
étape, le pianiste improvisateur pourra enrichir son jeu. De nombreuses
solutions sont envisageables : arpèges main gauche, pompes, accords ou arpèges
répartis entre les deux mains. Il faut éviter cependant les accords plaqués à
la main gauche : trop lourds et trop envahissants. Tout ce que la musique pour
piano possède peut être utilisé ; encore une fois, la connaissance des
répertoires anciens et actuels est bien utile.
La densité
des notes de la main gauche doit toujours être surveillée car l'improvisateur
débutant a une tendance naturelle à trop en faire (sans doute pour se
rassurer). Par ailleurs, le balancement rythmique est mieux perçu si le
musicien fonctionne à l'économie.
L'harmonie
et le rythme sont extrêmement liés. La carrure des phrases musicales est la
principale conséquence du canevas harmonique. Dans mon métier d'enseignant, je
constate que les problèmes rythmiques sont souvent liés à des hésitations. Ces
dernières sont liées à des problèmes de déchiffrages ou de repère de notes sur
le clavier. Chez les apprentis improvisateurs, les hésitations sont la
conséquence d'un manque d'anticipation. Encore une fois, la pleine liberté de
l'improvisation n'est possible que si un minimum de travail préparatoire est
fourni. Il est donc nécessaire de bien connaître la grille sur laquelle on va
improviser.
Pour les
improvisations libres, le musicien doit anticiper
davantage, il doit décider et entendre par avance sa trame harmonique. Comme
évoqué précédemment, une improvisation spontanée repose sur des réflexes ou des
plans. Ce vocabulaire doit bien sûr être acquis dans ce cas.
La
régularité du rythme, l'élément moteur de la musique, doit être un souci
permanent chez le musicien et plus en particulier chez l'improvisateur.
L'irrégularité, les hésitations, les incohérences brisent la crédibilité d'une
prestation. Un auditeur, même non musicien, repère rapidement les hésitations,
les accrocs et les rythmes erronés. Par ailleurs, si le prélude improvisé
introduit un soliste, ce dernier ne sera pas à l'aise pour commencer son
intervention si ce qui précède n'est pas en place.
Il existe
plusieurs façons d'améliorer un défaut de tempo irrégulier. Dans un premier
temps, il faut chercher les causes du problème. Dans le cas d'hésitations sur
les notes ou les accords, il faut travailler les enchaînements de la grille. Le
plus simple est de faire tourner en boucle le canevas harmonique en utilisant
le métronome ou éventuellement une boîte à rythme. Il faut bien sûr insister
sur la partie d'accompagnement main gauche afin de créer des réflexes.
Dans le plupart des cas, ce travail n'est pas suffisant car un
autre problème s'ajoute : la superposition de la mélodie improvisée à
l'accompagnement, autrement dit, la mise en place. Le canevas harmonique peut
être parfaitement en place mais dès qu'une phrase mélodique se place, le rythme
se met à « boiter ». Encore une fois, il faut appliquer la méthode de
la simplification. Si, par exemple, l'accompagnement consiste en une continuité
de croches, il faut chercher du côté des rythmes simples et éviter les
syncopes, triolets et autres quintolets. Même une personne peu douée en rythme
peut progresser avec cette méthode. Le plus important est la patience et la ténacité.
Dans la
première partie de cet article, il était évoqué les
brisures et les ponctuations rythmiques. Ces suspensions, ralentis,
accélérations ou points d'orgue doivent s'inscrire dans la logique rythmique du
fragment improvisé. Leur présence est dictée par le discours et doivent donc
être assumés. Un ralenti ne doit pas ressembler à une faiblesse, une
accélération à un manque de contrôle et un point d'orgue à une hésitation. Des
nuances peuvent accompagner ces brisures rythmiques. Leur rôle sera de faire
comprendre qu'il s'agit d'un effet dramatique et non d'une erreur. Les
changements de dynamique sont liés de façon intrinsèque au discours et à la
mobilité du rythme.
L'accentuation
n'est pas à négliger dans le travail de l'improvisation. Certaines figures
rythmiques sont directement liées aux accents. Tel un percussionniste, le
pianiste fait ressortir telle ou telle attaque d'une cellule. Le geste
pianistique, animé par un fort sentiment rythmique, peut figurer un ensemble de
percussions. Des notes fortement accentuées sur les temps deux et quatre
rappelleront le jeu des cymbales charleston (pour le jazz) ou de la caisse
claire (pour le rock).
La palette
sonore du piano est infinie. Un pianiste expérimenté peut suggérer un grand
nombre de timbres grâce à son toucher. L'improvisation est une discipline à la
fois révélatrice et formatrice. L'imagination étant fortement sollicitée, le
pianiste doit être en mesure de faire sonner son instrument comme il l'entend
intérieurement. Encore une fois, pour une débutant
dans le domaine de l'improvisation, les progrès sont possibles. Un musicien ne
disposant pas d'une grande palette sonore pourra faire progresser son jeu
pianistique par le biais de l'improvisation. Le fait de chercher des mélodies,
des harmonies et des rythmiques développe la connaissance de l'instrument.
Cette prospection oblige le pianiste à jouer davantage avec ses
« oreilles ». Le cadre formel d'une partition bloque souvent les
débutants. En se concentrant sur les problèmes de notes, de doigtés et de
rythmes, les pianistes amateurs oublient très souvent la notion de timbre et de
qualité sonore. En libérant le musicien du texte imposé, l'improvisation permet
une connaissance plus intime de l'instrument.
Réflexes
instrumentaux
J'indiquais,
plus haut, que les remplissages systématiques avec des gammes et des arpèges
étaient à éviter. L'idée mélodique doit bien sûr prévaloir sur le geste
purement mécanique mais il ne faut pas pour autant oublier les caractéristiques
du piano. Certains idiomatismes ne sont pas à
exclure. Improviser au piano implique une façon de penser la musique. Les
doigts ont leurs mots à dire ! Ces réflexes instrumentaux ne sont pas à
exclure de l'improvisation, dans la mesure où ils agrémentent une pensée
musicale. Selon le principe de partir du plus simple pour aller au plus
complexe, il est possible d'enrichir une mélodie de traits et de gestes
pianistiques. Dès qu'un thème, un motif ou
une cellule existe, il est possible de les varier et de les développer. Ainsi,
les gammes, arpèges intermédiaires peuvent s'insérer dans l'improvisation à
condition de ne pas prédominer. Ces traits plus ou moins virtuoses
s'intercalent entre les notes pivots de la mélodie.
Ces
enrichissements appartiennent au vocabulaire pianistique. Encore une fois,
l'héritage des grands maîtres du passé n'est pas à négliger. Selon la culture
pianistique de l'improvisateur, certaines formules vont ressurgir dans son
discours. Ces traits, ces gestes, qui sont en principe en parfaite adéquation
avec l'instrument, permettent de bien faire sonner ce dernier.
Le pianiste
peut également s'inspirer de la musique vocale. Le lyrisme de certains traits
s'apparente aux vocalises improvisées par les chanteurs. Les ornements, les gruppettos, les trilles, les appogiatures,
les retards seront bienvenus pour enrichir une mélodie improvisée. Ainsi, une
cellule constituée de très peu de notes pourra devenir une grande phrase
musicale.
L'accompagnement
est également tributaire des caractéristiques de l'instrument. Certains intervalles
(les tierces par exemple) sonnent très mal dans le grave du piano. D'autres
sonnent très bien. Les dixièmes sont d'un excellent effet et mettent en valeur
les basses de l'instrument. Il est possible de les jouer de façon simultanée
(pour les grandes mains uniquement) ou de les arpéger en utilisant la pédale forte afin de maintenir la note la plus
grave.
Toutes ces
considérations techniques et esthétiques doivent fusionner. Pour improviser
correctement, un minimum de connaissance de l'instrument est requis. Une pédale
mal utilisée peut créer la pire des cacophonies même si l'harmonie est
correcte. Un mauvais doigté entrainera des irrégularités rythmiques et cassera
le sens des intentions musicales (phrasé, articulations, nuances). La non
maîtrise du toucher créera des incohérences dynamiques : accompagnement
plus fort que la mélodie, faux accents…
Ainsi
exposés, ces quelques remarques techniques peuvent effrayer le pianiste amateur
ou débutant. Mais il est possible de prendre le problème à l'envers. La
pratique de l'improvisation peut faire progresser un instrumentiste ne
possédant pas beaucoup de technique. La plupart des problèmes techniques
engendrent directement une mauvaise qualité sonore. Or, l'improvisation repose
essentiellement sur un travail d'écoute. Par cet exercice, l'apprenti pianiste
met directement en relation un travail physique (la technique instrumentale) et
une production sonore (ce qu'il souhaite faire entendre). Son oreille le
guidera et lui fera prendre conscience de la conséquence de tel ou tel défaut
de jeu. Le résultat obtenu sera beaucoup plus efficace que l'étude d'exercices
purement mécanique et anti musicaux. Une improvisation peut devenir ainsi une
mini étude dont le but est d'améliorer certains point
pianistiques : jeu en arpège à la main gauche, enchainement de dixièmes,
maîtrise de la dynamique etc.
Le parcours
de l'apprenti improvisateur est jalonné de contraintes techniques, théoriques
et esthétiques. Le chemin semble bien long pour atteindre le but ultime :
improviser en toute liberté. Pourtant toutes ces règles permettent d'éliminer
les gestes musicaux inutiles. Une improvisation trop longue et mal cadrée
s'assimile à du bavardage. Des mélodies ou des accords trop chargés en notes
alourdissent le style. Des nuances mal maîtrisées déstructurent l'organisation
rythmique. Sans chercher à expliquer la notion de don ou d'inspiration, ces
quelques éléments vous permettront peut-être d'organiser vos futures
improvisations.
Dominique Arbey.
[1]
Lire à ce sujet, l’ouvrage d’Antoine Pétard, L’improvisation musicale, Enjeux et contrainte sociale, Paris,
l’Harmattan, 2010, 210 p.
[2]
Francis Poulenc, « Accents Populaires », Le
Coq n° 4.
***
FESTIVALS! LES BERLINER PHILHARMONIKER SUPERLATIFS

Le Festspielhaus de
Baden-Baden © Festspielhaus
L'édition 2015 de l'Osterfestspiele a
encore montré à quel top niveau ce festival pascal se situe. Est-ce la magie de
la tranquille cité de Baden-Baden, les musiciens sont comme chez eux et
montrent une empathie toute particulière : des vacances peut-être au milieu de
la saison berlinoise. Et à ceux qui regrettent la cité salzbourgeoise, où avait
lieu naguère le festival fondé par Herbert von Karajan en 1966, d'autres
peuvent répondre qu'ici on fait plus dans la diversité. Ainsi des concerts
matinaux et vespéraux de musique de chambre. Après La Flûte enchantée,
en 2013, Manon Lescaut l'année passée, on donnait Der Rosenkavalier,
comme était joué, côté musique chorale, La Damnation de Faust, après
La Passion selon Saint Jean en 2014. Les deux concerts symphoniques étaient
confiés à Bernard Haitink et Isabelle Faust, et à Riccardo Chailly et Igor
Levit. Sans oublier les jeunes du Bundesjugendorchester et une myriade de
Kammerkonzerte. Le public nombreux, fort attentif et bien mis, se délecte des
sommets artistiques qui lui sont proposés. A-t-il réelle conscience que ce
qu'il entend là ressortit à l'exceptionnel ? Indéniablement dans son immense
majorité. Il pourra se régaler en 2016, entre autres, de Tristan und Isolde et
de la IX ème symphonie de Beethoven.
Riccardo Chailly et un jeune prodige du clavier

Riccardo
Chailly et le Berliner Philharmoniker / DR
Le second concert symphonique
était donc dirigé par Riccardo Chailly. Il reprenait le même programme que
celui donné à la tête de l'Orchestre de Paris, en début de saison, dans le
défunte Salle Pleyel : rapprochant Mendelssohn, Schumann et Rachmaninov. Cette
fois, Martha Argerich devait déclarer forfait suite à une méchante influenza.
Sur les « conseils » de l'Orchestre, on engagea sur le champ le jeune
pianiste russe Igor Levit pour jouer le Concerto de Schumann. Divine surprise !
Car voilà une exécution pour le moins magistrale. A Quelques 28 ans, Igor Levit
a déjà derrière lui une enviable carrière dans les grandes institutions
européennes et aux USA, ainsi qu'au disque (un contrat d'exclusivité avec
Sony). Le Concerto de piano que Schumann achève en 1845, trouve son origine
dans une Phantasie für Klavier und Orchester écrite en 1841, qui formera
le premier mouvement de l'œuvre. Créée par Clara en décembre 1845, sous la
direction de Ferdinand Hiller, elle le jouera en février 1883 à Berlin avec
l'Orchestre Philharmonique ! Son motif central, énoncé par le hautbois, est une
sorte de signature hommage à son inspiratrice et dédicataire puisqu'il se
compose des notes (dans la notation allemande ) C H A A , autrement dit
l'anagramme du pseudonyme de Clara, Chiarina. Ce motif
revient dans l'intermezzo médian et au finale. A noter au demeurant qu'il n'est
pas sans rappeler une formule rythmique du Fliegende Holländer qu'un
certain Richard Wagner avait créé en 1843 à Dresde, où devait l'être aussi
ledit concerto. Sachant que les esquisses en remontent à 1841, il est permis de
se demander qui a influencé qui. Ce sommet du concerto romantique, Riccardo
Chailly le conçoit sans emphase. La partie lente de l'allegro affetuoso est
prise retenue et les vents (hautbois de Jonathan Kelly, clarinette d'Andreas
Ottensamer et flûte d'Emmanuel Pahud) déploient une vraie magie. Les contrastes
sont là bien sûr, offrant au soliste le plus magistral des écrins. Igor levit
donne le ton : sa vision sera empreinte d'une belle sérénité et même la cadence
ne cherchera pas à épater l'auditeur. Le sublime Intermezzo, Levit le distille
comme un jeu d'elfe dans son deuxième thème en particulier. Cela tient aussi
beaucoup à l'accompagnement prodigué par Chailly qui refuse toute insistance
romantique, au sens de sentimentalité. On savoure le toucher immatériel du
pianiste, qui fait penser à la manière d'un de ses compatriotes, Grigory
Sokolov. Il en a la même volonté d'anti virtuose. Le finale attaca déploie un
rondo d'un grand classicisme, sans pathos. A n'en pas douter une interprétation
pensée du tréfonds, souverainement jouée. En bis, il donnera un choral de JS.
Bach dans un tempo très retenu et pianissimo : un beau moment de musique pure,
applaudi autant par le public que par les musiciens. Le concert avait débuté
par l'Ouverture de Ruy Blas op. 95 de Mendelssohn. Composée en trois
jours, en mars 1839, elle fait la part belle aux cuivres dans une fanfare
liminaire et à l'entier orchestre traité tour à tour sombre et vif, ce que met
en valeur l'exécution nerveuse de Chailly. Les solistes sont amenés à briller,
dont la flûte, la clarinette, et le premier violon de Daishin Kashimoto.

Igor Levit & Riccardo Chailly / Monika Rittershaus
La Troisième Symphonie de
Serge Rachmaninov allait nous transporter dans d'autres climats, du romantisme
tardif, aux frontières de la modernité. Après un silence
« symphonique » de près de trente ans, Rachmaninov fait créer son
ultime opus pour grand orchestre le 9 novembre 1936 : Leopold Stokowski dirige
l'Orchestre de Philadelphie et donne à entendre au public comment sonne la
dernière manière du compositeur russe alors installé aux USA. L'opulence de la
composition frappe et ses diverses influences. « Ma musique est le produit
de mon tempérament, aussi est-elle de la musique russe » confiera-t-il
dans une interview en 1941. Sans doute. Quoique la russité soit asservie à bien
d'autres considérations. Les passages grandiloquents se font, certes, plus
rares que dans la Deuxième Symphonie, par exemple, et la thématique plus
raffinée. Mais la complexité demeure et la « tendre mélodie » voulue
par l'auteur encore bien discernable. Reste qu'il faut en suivre les méandres
de la pensée. Riccardo Chailly dénoue l'écheveau et fuit tout pathétisme. Le
lento initial est introduit par une phrase du cello solo qui ouvre la voie à
une foule de thèmes, à une dramaturgie à épisodes qui finit piano. L'adagio
s'ouvre par des solos de cor (Stefan Dor) et du Ier violon, et on remarque plus
loin une intervention de flûte et de harpe (Marie-Pierre Langlamet). Cela vire
au scherzo dans la partie allegro vivace, avec rythme de marche, fort nerveuse
sous la baguette de Chailly. Puis tout revient au calme à la coda et son solo
de clarinette. Le finale, un allegro qui s'accentue progressivement vivace,
offre des climats véhéments, donnant une impression de fébrilité, avec des coqs
à l'âne et un instrumentarium original de clarinette basse (Manfred Preis) et
de contrebasson (la jeune Sophie Dartigalongue). La coda brillante, Chailly la
voit flamboyante avec des fusées de la petite harmonie et des percussions. On
est loin de Chostakovitch. Mais l'interprétation des berlinois et de leur chef
italien fait la différence. Triomphe public.
Sir Simon Rattle enlumine La Damnation de Faust
Hector BERLIOZ : La
Damnation de Faust. Légende-dramatique en quatre parties. Livret du compositeur et
d'Almire Gondonnière d'après le Faust I de Goethe. Charles Castronovo, Joyce DiDonato, Ludovic Tézier, Edwin
Crossley-Mercer. Staatsopernchor Stuttgart und Kinderchor der Oper Stuttgart. Herren
des Philharmonia Chors Wien. Berliner Philharmoniker, dir. Sir Simon Rattle.
Version de concert.

© Monika
Rittershaus
Le concert choral du festival était
consacré à La Damnation de Faust. Créée à l'Opéra Comique en 1846, sous
forme concertante, l'œuvre devait rapidement s'imposer. Au concert, à la scène
? Vieux débat qui agita le compositeur : « Opéra de concert », La
Damnation de Faust devait vite trouver son titre de
« légende-dramatique ». Elle n'atteindra la scène, escomptée en vain
par Berlioz, qu'en 1883, à Monte Carlo. Elle est depuis lors présentée sous
l'une ou l'autre forme. Car elle dépasse les cadres établis de l'une et de
l'autre. On a pu dire qu'il s'agissait d'« un opéra de l'œil interne,
représenté sur la scène idéale de l'imagination » ( David Cairns,
« Hector Berlioz », Fayard, T II). Car c'est un théâtre du rêve,
voire de l'hallucination, de la fantaisie au sens le plus noble du terme, où le
compositeur, lui-même librettiste, aidé de Almire Gondonnière, puise
directement au Faust I de Goethe, grâce à la traduction qu'en fit Gérard
de Nerval en 1828. Il en condense l'action en une suite de tableaux sonores,
autant d'épisodes d'un théâtre du monde à portée cosmique. Combinant musique,
texte et impact théâtral de manière révolutionnaire à l'époque. L'œuvre trouve
sa première ébauche dans les Huit scènes de Faust, composées en 1829,
que Berlioz adressera d'ailleurs au poète allemand, sans réponse. Berlioz se
concentre sur le personnage éponyme pour en montrer l'isolement ; ce thème de
la solitude de l'esthète si cher aux romantiques, d'un héros confronté à
l'errance, à l'amour impossible, à l'idéalisme déçu, qui malgré le panthéisme
de la nature, ne trouvera pas le salut. Une approche plus tragique que celle
portée par le poète. Dans une succession de quatre parties découpées en
plusieurs scènes, schéma à priori disparate qu'unit pourtant une logique
implacable. La lecture de Sir Simon Rattle vérifie à chaque instant la
constante originalité de cette musique, sa modernité aussi. Le timbre autant
que la mélodie et l'harmonie caractérisent chaque situation, tandis que chacun
des trois protagonistes est pourvu d'instruments spécifiques : les cordes
graves pour Faust, la flûte, la clarinette et le cor anglais pour Marguerite,
les cuivres pour Méphisto. A l'écoute de cette phalange d'élite on se prend à
redécouvrir bien des trésors. Visuellement on est frappé par deux blocs se
faisant face, de part et d'autre de l'entier orchestre : à gauche quatre
harpes, à droite huit contrebasses. Le début, avec les appels de cors est doux,
mais la « Marche hongroise » sera martelée sans ménagement, et
l'intervention de Faust « Sans regret » majestueuse dans un bel effet
de contraste. Fidèle à sa manière, Rattle creuse les écarts dynamiques. Ainsi
de la « Danse des Sylphesd, sur une pédale de violoncelles et des basses,
ponctuée des harpes, s'effilochant dans une pppp immatériel. Le sens du
détail tient aussi du prodige : la berceuse de Méphisto « Voici des
roses » affirme une douceur perverse amenée par les cuivres. Les hautbois
déchirants traversent la « Course à l'abîme », dans un tourbillon de
plus en plus sec et rapide, presque sauvage ; la scansion sèche de la
« Danse des feux follets », unit la petite harmonie au grand complet,
tandis que la grand « Pandémonium » asséné dans un fortissimo
assourdissant prend l'allure d'une vision de cauchemar.

Joyce
DiDonato, Charles Castronovo, Ludovic Tézier © Monika Rittershaus
Ludovic Tézier est Méphisto et n'a pas
besoin de la scène pour exprimer ce qui dans le personnage ressortit au
sardonique : point d'emphase, le texte d'abord, dit d'une façon si naturelle
qu'on en a froid dans le dos. Un regard, une expression, et tout est dit. Et
comment ne pas succomber à cette intonation dans le médium, à ce ton général
loin de toute convention, une morgue plus hautaine que diabolique
(« Chanson de la Puce »). La Marguerite de Joyce DiDonato frôle
l'idéal : depuis les premiers mots « Que l'air est étouffant », où
l'on sent passer un sentiment oppressant, alors que la flûte (Andreas Blau) tresse
une mélopée lugubre, à la « Ballade du Roi de Thulé », si
profondément vécue, sur un accompagnement d'alto obligé (Amihai Grosz),
instrument fétiche que Berlioz traitera avec panache dans Harold en Italie.
Il revient au cor anglais (Dominik Wollenweber) d'agrémenter l'air
« D'amour l'ardente flamme », où la mezzo soprano américaine est
d'une vérité émouvante : le solo instrumental s'efface peu à peu dans un
souffle. Pure poésie. Une interprétation marquée au coin du génie, agrémentée
d'une excellente diction. Le Faust de Charles Castronovo ne vise pas le
tonitruant. La voix n'est pas assez large pour cela. Mais que de nuances et
d'intelligence du texte. Si l'«Invocation à la nature » pêche par manque
de puissance, les interventions solo précédentes et lors du duo d'amour ou du
trio infernal sont bien proportionnées. Il y a là sans doute le choix de
privilégier une voix plus ductile que lourde, et l'expression au-delà de la
force. Le Brander d'Edwin Crossley-Mercer est de belle facture et son air un
exemple de beau chant. Les Chœurs de l'Opéra de Stuttgart, augmentés du Chœur
d'hommes Philharmonia de Vienne font du beau travail, même si la diction n'est
pas toujours des plus tranchantes. Mais l'arrivée des chœurs d'enfants
(Staatsoper Stuttgart), tout de blanc vêtus, apporte une aura de grâce à la
scène de transfiguration finale. Une exécution mémorable !
Un Chevalier à la rose musicalement exceptionnel
Richard STRAUSS :
Der Rosenkavalier. Comédie en musique en trois actes. Livret de Hugo von
Hofmannsthal. Anja Harteros, Peter Rose, Magdalena Kožená, Anna Prohaska,
Lawrence Brownlee, Clemens Unterreiner, Irmgard Vilsmaier, Stefan Margita,
Carole Wilson, John Euchen, Thomas Michael Allen, Kevin Conners, Martin Snell,
Tamara Banjesevic, Moritz Kallenberg, Sonja Saric, Felicitas Brunke, Susanne
Kreusch. Philharmonia Chor Wien. Mädchen des Cantus Juvenum Karlsruhe. Berliner
Philharmoniker, dir. Sir Simon Rattle. Mise en scène : Brigitte Fassbaender.

Acte
I : Magdalena Kožená & Anja Harteros © Monika Rittershaus
Tout aussi musicalement accompli que ce Der
Rosenkavalier, la production scénique de l'édition 2015 ! Certes, nous
sommes avec les Berliner et Rattle dans un mode différent de l'« echte wiener
Klang », la sonorité viennoise spécifique qui a cours au Staatsoper de
Wien ou au Festival Salzbourg. Mais quelle fulgurante alternative ! Pas moins
irrésistible. A commencer par la finesse des cordes, pellucides, et leur fameux
prolongement dans le grave avec le travail sur les contrebasses ; puis l'éclat des
vents, dont se détachent les magnifiques solos imaginés par Strauss, et nursés
par Rattle : du cor bien sûr, du premier violon évidemment, aux ultimes pages
du premier acte. On se prend à découvrir des traits insoupçonnés tel le
contrebasson au début du monologue de la Maréchale au Ier acte. La lecture du
chef anglais est vive, contrastée, comme cette entame du II ème acte prise vite
et cette fin du même acte qui ne cherche pas à étaler de vaines effluves
ronflantes lors du vrai-faux collapse du Baron Ochs. Le III ème fuit
pareillement le clinquant des premières scènes dans l'auberge et de la joyeuse
fiesta qui tourne à la confusion du pauvre Lerchenau. Puis tout s'illumine à
l'arrivée de la Maréchale et durant des échanges inouïs : un Trio montant en puissance
un crescendo transfiguré par trois voix d'exception. Un moment proprement
magique, qui ne laisse pas de marbre le spectateur qui en a vu pourtant bien
d'autres. Un duo tout aussi incandescent qui laisse pantois. Du Richard Strauss
à son épure que ces deux passages, et tels qu'interprétés de la sorte. Ces
trois voix de femmes il faut les avoir entendues et vues pour saisir le
caractère exceptionnel de la prestation. Anja Harteros, La Maréchale, d'une
prestance naturelle et d'une intensité vocale émouvante, qui contrebattent
l'idée de froideur qu'on a pu attribuer à cette artiste. Toute différente d'une
Elisabeth Schwazrkopf, ne cultivant pas un sous entendu qui serait
« entendu », encore moins le maniérisme. Voilà la « femme de 32
ans » qui, souligne l'auteur, n'en est pas à sa première aventure non plus
qu'à sa dernière. Qui sait le poids des choses « Die Zeit, die ist ein
sonderbar Ding », dit-elle : le temps, cette chose singulière ; ce temps
qui file inexorablement. A l'heure des choix, il faut se résoudre à passer la
main à plus jeune que soi, alors qu'on a sans doute volontairement décidé de
pousser le fringuant Octavian dans les bras de Sophie en lui confiant le rite
du port de la rose. Les adieux avec le jeune garçon sonnent vrai, et la réponse
au « Marie-Thérèse... », plus interrogatif qu'angoissé de celui-ci,
ne laisse pas trace aux vains regrets. C'est elle qui dans un geste du doigt
appelle près d'elle Sophie, lui soulignant que le bonheur est là, désormais à
portée de main. De retour avec Faninal, elle abandonne la partie, digne, avec
le fameux « Ya, Ya », qu'elle laisse tomber sans amertume ni
afféterie. Quelle voix : l'art suprême de la modulation straussienne, qui
ressort de par sa parfaite projection, dans le mélancolique monologue ou les
volutes du Trio. Une interprétation d'anthologie. L'Octavian de Magdalena Kožená
est « boyish » à souhait, et vrai : pas d'empressement amoureux
débordant dans la chambre, sur le sofa, au Ier acte ; un côté un peu désabusé
lors de la présentation de la rose, au suivant, mais un rapprochement sincère
avec l'épousée et une propension à la réponse directe lorsqu'elle en décoche un
à l'infatué Baron. Aucune gaudriole à l'heure du repas dans le Heuriger du III,
juste ce qu'il faut d'humour ravageur sur « Ich trink kein Wein » (Je ne
bois pas de vin), alors que portant bas bleus et canotier de paille. Si le
deuxième acte révèle quelques limites, l'engagement vocal reste de tous les
instants ailleurs et les deux ensembles finaux la trouvent au meilleur.

Acte II : Magdalena
Kožená © Monika Rittershaus.
La prise de rôle d'Anna Prohaska est une
des autres joies de la soirée : enfin une Sophie ni soubrette ni pâle ; une
jeune fille qui sait où elle va, décide vite de prendre de la distance avec le
lourdaud Ochs, et saisit la belle au bond de l'amour qui lui est offert sur un
plateau – une rose – d'argent ! La voix est glorieusement conduite, depuis la
scène de la réception de la rose, parée d'aiguës extatiques, jusqu'aux Trio et
Duo finaux où la puissance ne manque pas, non plus que la finesse de la ligne.
Une ascension réussie chez une artiste attachante, intelligente, à l'orée d'une
carrière des plus prometteuses. Le Baron Ochs de Peter Rose, plus
conventionnel, est à la hauteur vocalement et les notes graves, bien sonores,
sont là pour émailler une prestation accomplie. Même si la dramaturgie lui
laisse peu d'espace, comme on le verra. Les autres rôles sont parfaitement
distribués. Le Faninal de Clemens Unterreiner est conçu dramatiquement sans
charge, et la Marianne Leitmetzerin de Irmgard Vilsmaier quoique détonnant, est
amusante dans ses empressements. On a pris soin de peaufiner les deux
intrigants et ils ont la pêche : elle, Annina, Carole Wilson, inénarrable de
drôlerie, fagotée en improbable sosie de la Reine d'Angleterre, lui, Valzacchi,
Stefan Margita, d'un humour tout aussi décapant. Lawrence Brownlee, noir et de
noir vêtu avec une chemise jaune poussin, donne de l'aria du chanteur italien
une exécution fort sympathique, grâce à la complicité de la flûte d'Emmanuel
Pahud en fosse.

Acte
III : Anna Prohaska © Monika Rittershaus
La mise en scène de Brigitte Fassbaender
laisse interrogatif. On a voulu moderniser, actualiser. L'histoire se passe qui
dans un immeuble de grande hauteur dans quelque ville animée, qui dans les
salles basses de la demeure-entreprise de Herr von Faninal, dont le
« Stadt Palais » renferme des ateliers de couture. Robert Carsen,
naguère à Salzbourg, avait situé les choses chez un marchand de canons... La
chambre de la Maréchale est un vaste salon impersonnel flanqué d'un immense
sofa sur lequel celle-ci s'entretient avec Octavian. Des tulles en fond
laissent paraître ce qui se passe au dehors, telle l'intrusion de Ochs qui
glapit et finit par forcer la porte. Le premier acte découvre des dialogues
aisés, certes, et sans façons, entre les deux protagonistes. Aucune préciosité
n'affecte ces échanges enamourés. Mais si modernisation il y a, on a gardé
l'esprit des conventions véhiculées par le texte. Cela se vérifie au II, alors
que passés des préparatifs fébriles - les machines à coudre revêtues de nappe
pour sabler le champagne -, la présentation de la rose découvre un Octavian en
perruque et habit de cour... tout comme le sera le baron faisant une entrée
remarquée endimanché pur XVIII ème. Le mélange des époques dans les costumes
est amusant, mais pas très signifiant. La grande foire aux solliciteurs du Ier
acte est prétexte à force démonstration de couleurs, à l'aune des invités
bigarrés qui viennent faire leur numéro, dont le ténor italien. Les digressions
du II avec les acolytes du Baron, joyeux lurons en jean et espadrilles ultra
mode, et le Leopold en patins à roulettes, sont juste grotesques et la fin de
l'acte, qui voit Ochs affalé sur quelque meuble, ne sera pas spécialement chargée
et heureusement pas ridicule. Le dernier acte nous transporte de nouveau dans
une pièce du palais où l'intrigante Annina distribue les costumes pour la
fiesta aux fins de berner Ochs. La scène de l'auberge est curieusement très
conventionnelle, sauf que le mets sera une pizza apportée dans sa boîte par
Leopold sur ses agiles patins... Heureusement que le Trio donne lieu au
formidable influx dramatique déjà souligné. Tout comme le Duo : les deux
jeunes, d'abord assis de part et d'autre d'une immense table, décident de
s'asseoir côte à côte, les jambes ballantes, belle liberté de la jeunesse.
Fassbaender, immense Octavian des années 1970/80, truffe sa mise en scène de
fines touches et offre une habile caractérisation des trois femmes, de
Rofrano-Octavian en particulier. Reste que les scènes d'ensemble n'ont pas le
même impact, tandis que les projections en fond de plateau, dues à Erich
Wonder, ne développent pas l'effet sidérant de celles de sa Traviata,
pour la régie de Peter Mussbach, naguère à Aix. La force du présent spectacle,
c'est dans son volet musical qu'il réside. Au centuple.

Les
Berliner Philharmoniker et leur chef aux saluts finaux © Monika Rittershaus
L'enthousiasme des jeunes musiciens du Bundesjugendorchester

Le
Bundesjugendorchester / DR
Le Bundesjugendorchester, fondé
en 1969, est composé de musiciens âgés de 14 à 19 ans, recrutés après épreuves
de sélection. Ils ont des phases de travail intensif avec de grands chefs, à
raison de trois par ans, préludant à chaque fois une tournée en Allemagne mais
aussi à l'étranger. C'est ainsi qu'ils se sont déjà produits aux USA, sous la
direction de Kurt Masur, au Japon, au Venezuela avec Gustavo Dudamel et Andris
Nelsons, en Afrique du sud pour la Coupe du Monde de Foot en 2010. Ils ont joué
sous la direction de Simon Rattle à l'automne 2012 à la Philharmonie de Berlin.
L'idée est alors née d'une prestation dans le cadre du Festival de Pâques de
Baden-Baden. La première eut lieu lors du Festival de 2013, et ils étaient
dirigés par Rattle. Il devait le faire de nouveau cette année. Les plus
« vieux » ont tout juste 20 ans, les trois benjamines, 15, dont l'une
native de Bayreuth ; et le Konzertmeister vient de fêter ses 19 printemps !
Leurs prochaines « Working phases » les verront être dirigés par
Patrick Lange (été 2015), Michael Sanderling (janvier 2016) et Sebastian Weigle
(printemps 2016, avec un concert au Festival de Pâques, le 24 mars 2016).
Depuis 2014, pour les 25 ans de la réunification allemande, ils ont le rôle
d'« ambassadeurs culturels ». Ils sont très, très nombreux à investir
le plateau du Festspielhaus. Il y a autant de filles que de garçons. Le tout
jeune Konzertmeister est flanqué d'un senior, tuteur actif dans un orchestre
allemand, comme quelques autres pupitres. Bel exemple d'entraide. La première
partie du programme était dirigée par Simon Rattle. Ils donneront l'Inachevée
de Schubert, au tempo soutenu dans l'allegro moderato, tout le contraire de la
vision cosmique de Harnoncourt, en janvier dernier à la Mozartwoche de Salzbourg.
L'orchestre montre une belle cohésion et traduit les moindres exigences du chef
en termes de tempos et de nuances dynamiques. L'adagio sera de la même eau :
brillant du pénétrant solo de clarinette et d'une ligne des bois à faire pâlir
bien des phalanges reconnues. Rattle enveloppe du regard les dix jeunes
contrebassistes et les fait sonner avec autant de rutilance ronflante qu'il le
fait avec ses propres Berliner. La « Danse des sept voiles » de
Salomé de Richard Strauss sera un showpiece de démonstration. Du renfort
à la petite harmonie et surtout aux percussions arrive en rangs serrés. Le solo
de clarinette est sensuel et le crescendo, d'abord lascif, devient furieux, les
percussionnistes en herbe se lâchant sans vergogne. Après cette lecture sous haute
tension, Rattle étreint le premier violon, qui du haut de ses « Neunzehn
Jahre » en est tout ému ; tandis que le gros nounours, la mascotte de
l'orchestre, qui trône au pied du podium, ne reste pas de marbre... En seconde
partie, ils jouent la Quatrième Symphonie de Tchaïkovski. Là encore, et
peut-être même plus, quel travail ! Les cuivres de l'andante sostenuto sont
glorieux et l'ensemble des cordes sonne clair, chauffées à blanc qu'en sont les
titulaires par leur chef Karl-Heinz Steffens, ex clarinettiste solo des
Berliner, et désormais GMD de la Staatskapelle de Hallé. La mélodie du hautbois
et le solo de violoncelle de l'andantino apportent à ce « modo di
canzona » un beau souffle, et la coda du mouvement est pleine
d'atmosphère. Ils connaissent tout l'art du jeu en pizzicatto ostinato lors du
scherzo et les fifres ne sonnent pas aigres. Le con fuoco final a grande
allure, le chef ayant mis le turbo. Et le tout s'achève dans un vertigineux
prestissimo. Chapeau, jeunes gens !
Musique de chambre au casino

Daishin
Kashimoto, Ludwig Quandt, Éric Le Sage, Emmanuel Pahud,
Wenzel
Fuchs © Monika Rittershaus
Les matinées de musique de
chambre se donnent dans divers lieux en ville. Celui du lundi de Pâques l'était
au casino de Baden-Baden, un endroit improbable pour faire de la musique, autre
que celle argentine des machines à sous. De fait, pour accéder à la
Florentinersaal, l'auditeur parcourt les salles de jeu et leurs stucs et
cariatides, leurs amphores en vielle porcelaine chinoise et autre attirail kitsch,
sans parler des instruments consacrés, roulette, tables de jeu, etc... La
salle Florentine, dite aussi des « mille bougies » en raison de ses
lustres imposants aux myriades de flambeaux, servait pourtant déjà de salle de
concert au XIX ème et on dit que Niccolò Paganini et Clara Schumann s'y
produisirent. L'acoustique en est au demeurant fort agréable, pas trop feutrée.
Sous le titre de « Kontraste », le programme donnait à entendre des
compositions de deux représentants de la Seconde école de Vienne, Berg et
Schoenberg et un de la Première, Joseph Haydn. La brochette composée de Daishin
Kashimoto, violon, Ludwig Quandt, violoncelle, Emmanuel Pahud, flûte, et Wenzel
Fuchs, clarinette accueillait le pianiste français Éric Le Sage. Un peu de
L'Empéri en Bade-Wurtenberg donc, puisqu'aussi bien Le Sage et Pahud sont deux
des trois chevilles ouvrières (avec Albrecht Meyer) du festival provençal des
nuits juillet! On commença par l'adagio du Kammerkonzert d'Alban Berg,
dans l'arrangement du compositeur pour violon, clarinette et clavier. Après une
courte introduction sombre le mouvement se développe en arche laissant au
violon et au piano le soin de débuter et de conclure une alternance des
passages vifs et lents, très virtuoses pour le violon et le flûte. Le Trio
Hob. XV: 16 de Haydn fait un contraste saisissant, de par sa distribution
instrumentale, piano, flûte et cello, et son caractère enjoué. À la différence
des Trios pour baryton (violoncelle) ou pour piano et cordes, cette
instrumentarium est rare, encore que le violoncelle joue plus les utilités
qu'il n'assure un rôle déterminant. Celui-ci l'est par le violon et la flûte.
L'allegro initial aurait pu être écrit par Mozart, tant il est fluide et
joyeux. L'andantino est gracieux, une suite de variations sans prétention autre
que de désir de plaire. Un finale vivace assai, en forme de rondo allègre
conclut, le piano menant la danse. Exécution de classe des trois protagonistes.
Le morceau de résistance sera la Kammersinfonie Nr.1 d'Arnold
Schoenberg. Achevée en 1906, la pièce a été écrite pour 15 instruments, et
créée l'année suivante par le Quatuor Rosé et des vents des Wiener
Philharmoniker. Plusieurs transcriptions en ont été faites dont une pour
flûte, clarinette, violon, violoncelle et piano, due à Anton Webern en 1922. La
boucle était ainsi bouclée et les trois amis réunis, du moins par la pensée.
D'un seul tenant, on y distingue cependant cinq mouvements enchaînés. Quelques
brèves mesures d'introduction lente cèdent la place à un allegro. Puis vient une
séquence « sehr rasch » (très vif), en forme de scherzo, et qui sonne
comme un orchestre. Le « sehr langsam » (très lentement), qui ne
l'est pas tant ici, fait figure, selon l'auteur, de développement. Puis le
« Schungvoll » (plein de vigueur) déploie un adagio, et offre de
grands climax. La section finale, « Hauptzeitmass » (correspondant à
récapitulatif), est véhémente, avec de traits à l'arraché. Un challenge pour
les cinq musiciens qui n'en font qu'une bouchée.
Jean-Pierre
Robert.
***

Le Festspielhaus de Baden-Baden © Festspielhaus
L'édition 2015 de l'Osterfestspiele a encore montré à quel top niveau ce festival pascal se situe. Est-ce la magie de la tranquille cité de Baden-Baden, les musiciens sont comme chez eux et montrent une empathie toute particulière : des vacances peut-être au milieu de la saison berlinoise. Et à ceux qui regrettent la cité salzbourgeoise, où avait lieu naguère le festival fondé par Herbert von Karajan en 1966, d'autres peuvent répondre qu'ici on fait plus dans la diversité. Ainsi des concerts matinaux et vespéraux de musique de chambre. Après La Flûte enchantée, en 2013, Manon Lescaut l'année passée, on donnait Der Rosenkavalier, comme était joué, côté musique chorale, La Damnation de Faust, après La Passion selon Saint Jean en 2014. Les deux concerts symphoniques étaient confiés à Bernard Haitink et Isabelle Faust, et à Riccardo Chailly et Igor Levit. Sans oublier les jeunes du Bundesjugendorchester et une myriade de Kammerkonzerte. Le public nombreux, fort attentif et bien mis, se délecte des sommets artistiques qui lui sont proposés. A-t-il réelle conscience que ce qu'il entend là ressortit à l'exceptionnel ? Indéniablement dans son immense majorité. Il pourra se régaler en 2016, entre autres, de Tristan und Isolde et de la IX ème symphonie de Beethoven.
Riccardo Chailly et un jeune prodige du clavier

Riccardo
Chailly et le Berliner Philharmoniker / DR
Le second concert symphonique était donc dirigé par Riccardo Chailly. Il reprenait le même programme que celui donné à la tête de l'Orchestre de Paris, en début de saison, dans le défunte Salle Pleyel : rapprochant Mendelssohn, Schumann et Rachmaninov. Cette fois, Martha Argerich devait déclarer forfait suite à une méchante influenza. Sur les « conseils » de l'Orchestre, on engagea sur le champ le jeune pianiste russe Igor Levit pour jouer le Concerto de Schumann. Divine surprise ! Car voilà une exécution pour le moins magistrale. A Quelques 28 ans, Igor Levit a déjà derrière lui une enviable carrière dans les grandes institutions européennes et aux USA, ainsi qu'au disque (un contrat d'exclusivité avec Sony). Le Concerto de piano que Schumann achève en 1845, trouve son origine dans une Phantasie für Klavier und Orchester écrite en 1841, qui formera le premier mouvement de l'œuvre. Créée par Clara en décembre 1845, sous la direction de Ferdinand Hiller, elle le jouera en février 1883 à Berlin avec l'Orchestre Philharmonique ! Son motif central, énoncé par le hautbois, est une sorte de signature hommage à son inspiratrice et dédicataire puisqu'il se compose des notes (dans la notation allemande ) C H A A , autrement dit l'anagramme du pseudonyme de Clara, Chiarina. Ce motif revient dans l'intermezzo médian et au finale. A noter au demeurant qu'il n'est pas sans rappeler une formule rythmique du Fliegende Holländer qu'un certain Richard Wagner avait créé en 1843 à Dresde, où devait l'être aussi ledit concerto. Sachant que les esquisses en remontent à 1841, il est permis de se demander qui a influencé qui. Ce sommet du concerto romantique, Riccardo Chailly le conçoit sans emphase. La partie lente de l'allegro affetuoso est prise retenue et les vents (hautbois de Jonathan Kelly, clarinette d'Andreas Ottensamer et flûte d'Emmanuel Pahud) déploient une vraie magie. Les contrastes sont là bien sûr, offrant au soliste le plus magistral des écrins. Igor levit donne le ton : sa vision sera empreinte d'une belle sérénité et même la cadence ne cherchera pas à épater l'auditeur. Le sublime Intermezzo, Levit le distille comme un jeu d'elfe dans son deuxième thème en particulier. Cela tient aussi beaucoup à l'accompagnement prodigué par Chailly qui refuse toute insistance romantique, au sens de sentimentalité. On savoure le toucher immatériel du pianiste, qui fait penser à la manière d'un de ses compatriotes, Grigory Sokolov. Il en a la même volonté d'anti virtuose. Le finale attaca déploie un rondo d'un grand classicisme, sans pathos. A n'en pas douter une interprétation pensée du tréfonds, souverainement jouée. En bis, il donnera un choral de JS. Bach dans un tempo très retenu et pianissimo : un beau moment de musique pure, applaudi autant par le public que par les musiciens. Le concert avait débuté par l'Ouverture de Ruy Blas op. 95 de Mendelssohn. Composée en trois jours, en mars 1839, elle fait la part belle aux cuivres dans une fanfare liminaire et à l'entier orchestre traité tour à tour sombre et vif, ce que met en valeur l'exécution nerveuse de Chailly. Les solistes sont amenés à briller, dont la flûte, la clarinette, et le premier violon de Daishin Kashimoto.

Igor Levit & Riccardo Chailly / Monika Rittershaus
La Troisième Symphonie de Serge Rachmaninov allait nous transporter dans d'autres climats, du romantisme tardif, aux frontières de la modernité. Après un silence « symphonique » de près de trente ans, Rachmaninov fait créer son ultime opus pour grand orchestre le 9 novembre 1936 : Leopold Stokowski dirige l'Orchestre de Philadelphie et donne à entendre au public comment sonne la dernière manière du compositeur russe alors installé aux USA. L'opulence de la composition frappe et ses diverses influences. « Ma musique est le produit de mon tempérament, aussi est-elle de la musique russe » confiera-t-il dans une interview en 1941. Sans doute. Quoique la russité soit asservie à bien d'autres considérations. Les passages grandiloquents se font, certes, plus rares que dans la Deuxième Symphonie, par exemple, et la thématique plus raffinée. Mais la complexité demeure et la « tendre mélodie » voulue par l'auteur encore bien discernable. Reste qu'il faut en suivre les méandres de la pensée. Riccardo Chailly dénoue l'écheveau et fuit tout pathétisme. Le lento initial est introduit par une phrase du cello solo qui ouvre la voie à une foule de thèmes, à une dramaturgie à épisodes qui finit piano. L'adagio s'ouvre par des solos de cor (Stefan Dor) et du Ier violon, et on remarque plus loin une intervention de flûte et de harpe (Marie-Pierre Langlamet). Cela vire au scherzo dans la partie allegro vivace, avec rythme de marche, fort nerveuse sous la baguette de Chailly. Puis tout revient au calme à la coda et son solo de clarinette. Le finale, un allegro qui s'accentue progressivement vivace, offre des climats véhéments, donnant une impression de fébrilité, avec des coqs à l'âne et un instrumentarium original de clarinette basse (Manfred Preis) et de contrebasson (la jeune Sophie Dartigalongue). La coda brillante, Chailly la voit flamboyante avec des fusées de la petite harmonie et des percussions. On est loin de Chostakovitch. Mais l'interprétation des berlinois et de leur chef italien fait la différence. Triomphe public.
Sir Simon Rattle enlumine La Damnation de Faust
Hector BERLIOZ : La Damnation de Faust. Légende-dramatique en quatre parties. Livret du compositeur et d'Almire Gondonnière d'après le Faust I de Goethe. Charles Castronovo, Joyce DiDonato, Ludovic Tézier, Edwin Crossley-Mercer. Staatsopernchor Stuttgart und Kinderchor der Oper Stuttgart. Herren des Philharmonia Chors Wien. Berliner Philharmoniker, dir. Sir Simon Rattle. Version de concert.

© Monika
Rittershaus
Le concert choral du festival était consacré à La Damnation de Faust. Créée à l'Opéra Comique en 1846, sous forme concertante, l'œuvre devait rapidement s'imposer. Au concert, à la scène ? Vieux débat qui agita le compositeur : « Opéra de concert », La Damnation de Faust devait vite trouver son titre de « légende-dramatique ». Elle n'atteindra la scène, escomptée en vain par Berlioz, qu'en 1883, à Monte Carlo. Elle est depuis lors présentée sous l'une ou l'autre forme. Car elle dépasse les cadres établis de l'une et de l'autre. On a pu dire qu'il s'agissait d'« un opéra de l'œil interne, représenté sur la scène idéale de l'imagination » ( David Cairns, « Hector Berlioz », Fayard, T II). Car c'est un théâtre du rêve, voire de l'hallucination, de la fantaisie au sens le plus noble du terme, où le compositeur, lui-même librettiste, aidé de Almire Gondonnière, puise directement au Faust I de Goethe, grâce à la traduction qu'en fit Gérard de Nerval en 1828. Il en condense l'action en une suite de tableaux sonores, autant d'épisodes d'un théâtre du monde à portée cosmique. Combinant musique, texte et impact théâtral de manière révolutionnaire à l'époque. L'œuvre trouve sa première ébauche dans les Huit scènes de Faust, composées en 1829, que Berlioz adressera d'ailleurs au poète allemand, sans réponse. Berlioz se concentre sur le personnage éponyme pour en montrer l'isolement ; ce thème de la solitude de l'esthète si cher aux romantiques, d'un héros confronté à l'errance, à l'amour impossible, à l'idéalisme déçu, qui malgré le panthéisme de la nature, ne trouvera pas le salut. Une approche plus tragique que celle portée par le poète. Dans une succession de quatre parties découpées en plusieurs scènes, schéma à priori disparate qu'unit pourtant une logique implacable. La lecture de Sir Simon Rattle vérifie à chaque instant la constante originalité de cette musique, sa modernité aussi. Le timbre autant que la mélodie et l'harmonie caractérisent chaque situation, tandis que chacun des trois protagonistes est pourvu d'instruments spécifiques : les cordes graves pour Faust, la flûte, la clarinette et le cor anglais pour Marguerite, les cuivres pour Méphisto. A l'écoute de cette phalange d'élite on se prend à redécouvrir bien des trésors. Visuellement on est frappé par deux blocs se faisant face, de part et d'autre de l'entier orchestre : à gauche quatre harpes, à droite huit contrebasses. Le début, avec les appels de cors est doux, mais la « Marche hongroise » sera martelée sans ménagement, et l'intervention de Faust « Sans regret » majestueuse dans un bel effet de contraste. Fidèle à sa manière, Rattle creuse les écarts dynamiques. Ainsi de la « Danse des Sylphesd, sur une pédale de violoncelles et des basses, ponctuée des harpes, s'effilochant dans une pppp immatériel. Le sens du détail tient aussi du prodige : la berceuse de Méphisto « Voici des roses » affirme une douceur perverse amenée par les cuivres. Les hautbois déchirants traversent la « Course à l'abîme », dans un tourbillon de plus en plus sec et rapide, presque sauvage ; la scansion sèche de la « Danse des feux follets », unit la petite harmonie au grand complet, tandis que la grand « Pandémonium » asséné dans un fortissimo assourdissant prend l'allure d'une vision de cauchemar.

Joyce
DiDonato, Charles Castronovo, Ludovic Tézier © Monika Rittershaus
Ludovic Tézier est Méphisto et n'a pas besoin de la scène pour exprimer ce qui dans le personnage ressortit au sardonique : point d'emphase, le texte d'abord, dit d'une façon si naturelle qu'on en a froid dans le dos. Un regard, une expression, et tout est dit. Et comment ne pas succomber à cette intonation dans le médium, à ce ton général loin de toute convention, une morgue plus hautaine que diabolique (« Chanson de la Puce »). La Marguerite de Joyce DiDonato frôle l'idéal : depuis les premiers mots « Que l'air est étouffant », où l'on sent passer un sentiment oppressant, alors que la flûte (Andreas Blau) tresse une mélopée lugubre, à la « Ballade du Roi de Thulé », si profondément vécue, sur un accompagnement d'alto obligé (Amihai Grosz), instrument fétiche que Berlioz traitera avec panache dans Harold en Italie. Il revient au cor anglais (Dominik Wollenweber) d'agrémenter l'air « D'amour l'ardente flamme », où la mezzo soprano américaine est d'une vérité émouvante : le solo instrumental s'efface peu à peu dans un souffle. Pure poésie. Une interprétation marquée au coin du génie, agrémentée d'une excellente diction. Le Faust de Charles Castronovo ne vise pas le tonitruant. La voix n'est pas assez large pour cela. Mais que de nuances et d'intelligence du texte. Si l'«Invocation à la nature » pêche par manque de puissance, les interventions solo précédentes et lors du duo d'amour ou du trio infernal sont bien proportionnées. Il y a là sans doute le choix de privilégier une voix plus ductile que lourde, et l'expression au-delà de la force. Le Brander d'Edwin Crossley-Mercer est de belle facture et son air un exemple de beau chant. Les Chœurs de l'Opéra de Stuttgart, augmentés du Chœur d'hommes Philharmonia de Vienne font du beau travail, même si la diction n'est pas toujours des plus tranchantes. Mais l'arrivée des chœurs d'enfants (Staatsoper Stuttgart), tout de blanc vêtus, apporte une aura de grâce à la scène de transfiguration finale. Une exécution mémorable !
Un Chevalier à la rose musicalement exceptionnel
Richard STRAUSS : Der Rosenkavalier. Comédie en musique en trois actes. Livret de Hugo von Hofmannsthal. Anja Harteros, Peter Rose, Magdalena Kožená, Anna Prohaska, Lawrence Brownlee, Clemens Unterreiner, Irmgard Vilsmaier, Stefan Margita, Carole Wilson, John Euchen, Thomas Michael Allen, Kevin Conners, Martin Snell, Tamara Banjesevic, Moritz Kallenberg, Sonja Saric, Felicitas Brunke, Susanne Kreusch. Philharmonia Chor Wien. Mädchen des Cantus Juvenum Karlsruhe. Berliner Philharmoniker, dir. Sir Simon Rattle. Mise en scène : Brigitte Fassbaender.

Acte
I : Magdalena Kožená & Anja Harteros © Monika Rittershaus
Tout aussi musicalement accompli que ce Der Rosenkavalier, la production scénique de l'édition 2015 ! Certes, nous sommes avec les Berliner et Rattle dans un mode différent de l'« echte wiener Klang », la sonorité viennoise spécifique qui a cours au Staatsoper de Wien ou au Festival Salzbourg. Mais quelle fulgurante alternative ! Pas moins irrésistible. A commencer par la finesse des cordes, pellucides, et leur fameux prolongement dans le grave avec le travail sur les contrebasses ; puis l'éclat des vents, dont se détachent les magnifiques solos imaginés par Strauss, et nursés par Rattle : du cor bien sûr, du premier violon évidemment, aux ultimes pages du premier acte. On se prend à découvrir des traits insoupçonnés tel le contrebasson au début du monologue de la Maréchale au Ier acte. La lecture du chef anglais est vive, contrastée, comme cette entame du II ème acte prise vite et cette fin du même acte qui ne cherche pas à étaler de vaines effluves ronflantes lors du vrai-faux collapse du Baron Ochs. Le III ème fuit pareillement le clinquant des premières scènes dans l'auberge et de la joyeuse fiesta qui tourne à la confusion du pauvre Lerchenau. Puis tout s'illumine à l'arrivée de la Maréchale et durant des échanges inouïs : un Trio montant en puissance un crescendo transfiguré par trois voix d'exception. Un moment proprement magique, qui ne laisse pas de marbre le spectateur qui en a vu pourtant bien d'autres. Un duo tout aussi incandescent qui laisse pantois. Du Richard Strauss à son épure que ces deux passages, et tels qu'interprétés de la sorte. Ces trois voix de femmes il faut les avoir entendues et vues pour saisir le caractère exceptionnel de la prestation. Anja Harteros, La Maréchale, d'une prestance naturelle et d'une intensité vocale émouvante, qui contrebattent l'idée de froideur qu'on a pu attribuer à cette artiste. Toute différente d'une Elisabeth Schwazrkopf, ne cultivant pas un sous entendu qui serait « entendu », encore moins le maniérisme. Voilà la « femme de 32 ans » qui, souligne l'auteur, n'en est pas à sa première aventure non plus qu'à sa dernière. Qui sait le poids des choses « Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding », dit-elle : le temps, cette chose singulière ; ce temps qui file inexorablement. A l'heure des choix, il faut se résoudre à passer la main à plus jeune que soi, alors qu'on a sans doute volontairement décidé de pousser le fringuant Octavian dans les bras de Sophie en lui confiant le rite du port de la rose. Les adieux avec le jeune garçon sonnent vrai, et la réponse au « Marie-Thérèse... », plus interrogatif qu'angoissé de celui-ci, ne laisse pas trace aux vains regrets. C'est elle qui dans un geste du doigt appelle près d'elle Sophie, lui soulignant que le bonheur est là, désormais à portée de main. De retour avec Faninal, elle abandonne la partie, digne, avec le fameux « Ya, Ya », qu'elle laisse tomber sans amertume ni afféterie. Quelle voix : l'art suprême de la modulation straussienne, qui ressort de par sa parfaite projection, dans le mélancolique monologue ou les volutes du Trio. Une interprétation d'anthologie. L'Octavian de Magdalena Kožená est « boyish » à souhait, et vrai : pas d'empressement amoureux débordant dans la chambre, sur le sofa, au Ier acte ; un côté un peu désabusé lors de la présentation de la rose, au suivant, mais un rapprochement sincère avec l'épousée et une propension à la réponse directe lorsqu'elle en décoche un à l'infatué Baron. Aucune gaudriole à l'heure du repas dans le Heuriger du III, juste ce qu'il faut d'humour ravageur sur « Ich trink kein Wein » (Je ne bois pas de vin), alors que portant bas bleus et canotier de paille. Si le deuxième acte révèle quelques limites, l'engagement vocal reste de tous les instants ailleurs et les deux ensembles finaux la trouvent au meilleur.

Acte II : Magdalena Kožená © Monika Rittershaus.
La prise de rôle d'Anna Prohaska est une des autres joies de la soirée : enfin une Sophie ni soubrette ni pâle ; une jeune fille qui sait où elle va, décide vite de prendre de la distance avec le lourdaud Ochs, et saisit la belle au bond de l'amour qui lui est offert sur un plateau – une rose – d'argent ! La voix est glorieusement conduite, depuis la scène de la réception de la rose, parée d'aiguës extatiques, jusqu'aux Trio et Duo finaux où la puissance ne manque pas, non plus que la finesse de la ligne. Une ascension réussie chez une artiste attachante, intelligente, à l'orée d'une carrière des plus prometteuses. Le Baron Ochs de Peter Rose, plus conventionnel, est à la hauteur vocalement et les notes graves, bien sonores, sont là pour émailler une prestation accomplie. Même si la dramaturgie lui laisse peu d'espace, comme on le verra. Les autres rôles sont parfaitement distribués. Le Faninal de Clemens Unterreiner est conçu dramatiquement sans charge, et la Marianne Leitmetzerin de Irmgard Vilsmaier quoique détonnant, est amusante dans ses empressements. On a pris soin de peaufiner les deux intrigants et ils ont la pêche : elle, Annina, Carole Wilson, inénarrable de drôlerie, fagotée en improbable sosie de la Reine d'Angleterre, lui, Valzacchi, Stefan Margita, d'un humour tout aussi décapant. Lawrence Brownlee, noir et de noir vêtu avec une chemise jaune poussin, donne de l'aria du chanteur italien une exécution fort sympathique, grâce à la complicité de la flûte d'Emmanuel Pahud en fosse.

Acte
III : Anna Prohaska © Monika Rittershaus
La mise en scène de Brigitte Fassbaender laisse interrogatif. On a voulu moderniser, actualiser. L'histoire se passe qui dans un immeuble de grande hauteur dans quelque ville animée, qui dans les salles basses de la demeure-entreprise de Herr von Faninal, dont le « Stadt Palais » renferme des ateliers de couture. Robert Carsen, naguère à Salzbourg, avait situé les choses chez un marchand de canons... La chambre de la Maréchale est un vaste salon impersonnel flanqué d'un immense sofa sur lequel celle-ci s'entretient avec Octavian. Des tulles en fond laissent paraître ce qui se passe au dehors, telle l'intrusion de Ochs qui glapit et finit par forcer la porte. Le premier acte découvre des dialogues aisés, certes, et sans façons, entre les deux protagonistes. Aucune préciosité n'affecte ces échanges enamourés. Mais si modernisation il y a, on a gardé l'esprit des conventions véhiculées par le texte. Cela se vérifie au II, alors que passés des préparatifs fébriles - les machines à coudre revêtues de nappe pour sabler le champagne -, la présentation de la rose découvre un Octavian en perruque et habit de cour... tout comme le sera le baron faisant une entrée remarquée endimanché pur XVIII ème. Le mélange des époques dans les costumes est amusant, mais pas très signifiant. La grande foire aux solliciteurs du Ier acte est prétexte à force démonstration de couleurs, à l'aune des invités bigarrés qui viennent faire leur numéro, dont le ténor italien. Les digressions du II avec les acolytes du Baron, joyeux lurons en jean et espadrilles ultra mode, et le Leopold en patins à roulettes, sont juste grotesques et la fin de l'acte, qui voit Ochs affalé sur quelque meuble, ne sera pas spécialement chargée et heureusement pas ridicule. Le dernier acte nous transporte de nouveau dans une pièce du palais où l'intrigante Annina distribue les costumes pour la fiesta aux fins de berner Ochs. La scène de l'auberge est curieusement très conventionnelle, sauf que le mets sera une pizza apportée dans sa boîte par Leopold sur ses agiles patins... Heureusement que le Trio donne lieu au formidable influx dramatique déjà souligné. Tout comme le Duo : les deux jeunes, d'abord assis de part et d'autre d'une immense table, décident de s'asseoir côte à côte, les jambes ballantes, belle liberté de la jeunesse. Fassbaender, immense Octavian des années 1970/80, truffe sa mise en scène de fines touches et offre une habile caractérisation des trois femmes, de Rofrano-Octavian en particulier. Reste que les scènes d'ensemble n'ont pas le même impact, tandis que les projections en fond de plateau, dues à Erich Wonder, ne développent pas l'effet sidérant de celles de sa Traviata, pour la régie de Peter Mussbach, naguère à Aix. La force du présent spectacle, c'est dans son volet musical qu'il réside. Au centuple.

Les
Berliner Philharmoniker et leur chef aux saluts finaux © Monika Rittershaus
L'enthousiasme des jeunes musiciens du Bundesjugendorchester

Le
Bundesjugendorchester / DR
Le Bundesjugendorchester, fondé en 1969, est composé de musiciens âgés de 14 à 19 ans, recrutés après épreuves de sélection. Ils ont des phases de travail intensif avec de grands chefs, à raison de trois par ans, préludant à chaque fois une tournée en Allemagne mais aussi à l'étranger. C'est ainsi qu'ils se sont déjà produits aux USA, sous la direction de Kurt Masur, au Japon, au Venezuela avec Gustavo Dudamel et Andris Nelsons, en Afrique du sud pour la Coupe du Monde de Foot en 2010. Ils ont joué sous la direction de Simon Rattle à l'automne 2012 à la Philharmonie de Berlin. L'idée est alors née d'une prestation dans le cadre du Festival de Pâques de Baden-Baden. La première eut lieu lors du Festival de 2013, et ils étaient dirigés par Rattle. Il devait le faire de nouveau cette année. Les plus « vieux » ont tout juste 20 ans, les trois benjamines, 15, dont l'une native de Bayreuth ; et le Konzertmeister vient de fêter ses 19 printemps ! Leurs prochaines « Working phases » les verront être dirigés par Patrick Lange (été 2015), Michael Sanderling (janvier 2016) et Sebastian Weigle (printemps 2016, avec un concert au Festival de Pâques, le 24 mars 2016). Depuis 2014, pour les 25 ans de la réunification allemande, ils ont le rôle d'« ambassadeurs culturels ». Ils sont très, très nombreux à investir le plateau du Festspielhaus. Il y a autant de filles que de garçons. Le tout jeune Konzertmeister est flanqué d'un senior, tuteur actif dans un orchestre allemand, comme quelques autres pupitres. Bel exemple d'entraide. La première partie du programme était dirigée par Simon Rattle. Ils donneront l'Inachevée de Schubert, au tempo soutenu dans l'allegro moderato, tout le contraire de la vision cosmique de Harnoncourt, en janvier dernier à la Mozartwoche de Salzbourg. L'orchestre montre une belle cohésion et traduit les moindres exigences du chef en termes de tempos et de nuances dynamiques. L'adagio sera de la même eau : brillant du pénétrant solo de clarinette et d'une ligne des bois à faire pâlir bien des phalanges reconnues. Rattle enveloppe du regard les dix jeunes contrebassistes et les fait sonner avec autant de rutilance ronflante qu'il le fait avec ses propres Berliner. La « Danse des sept voiles » de Salomé de Richard Strauss sera un showpiece de démonstration. Du renfort à la petite harmonie et surtout aux percussions arrive en rangs serrés. Le solo de clarinette est sensuel et le crescendo, d'abord lascif, devient furieux, les percussionnistes en herbe se lâchant sans vergogne. Après cette lecture sous haute tension, Rattle étreint le premier violon, qui du haut de ses « Neunzehn Jahre » en est tout ému ; tandis que le gros nounours, la mascotte de l'orchestre, qui trône au pied du podium, ne reste pas de marbre... En seconde partie, ils jouent la Quatrième Symphonie de Tchaïkovski. Là encore, et peut-être même plus, quel travail ! Les cuivres de l'andante sostenuto sont glorieux et l'ensemble des cordes sonne clair, chauffées à blanc qu'en sont les titulaires par leur chef Karl-Heinz Steffens, ex clarinettiste solo des Berliner, et désormais GMD de la Staatskapelle de Hallé. La mélodie du hautbois et le solo de violoncelle de l'andantino apportent à ce « modo di canzona » un beau souffle, et la coda du mouvement est pleine d'atmosphère. Ils connaissent tout l'art du jeu en pizzicatto ostinato lors du scherzo et les fifres ne sonnent pas aigres. Le con fuoco final a grande allure, le chef ayant mis le turbo. Et le tout s'achève dans un vertigineux prestissimo. Chapeau, jeunes gens !
Musique de chambre au casino

Daishin
Kashimoto, Ludwig Quandt, Éric Le Sage, Emmanuel Pahud,
Wenzel Fuchs © Monika Rittershaus
Les matinées de musique de chambre se donnent dans divers lieux en ville. Celui du lundi de Pâques l'était au casino de Baden-Baden, un endroit improbable pour faire de la musique, autre que celle argentine des machines à sous. De fait, pour accéder à la Florentinersaal, l'auditeur parcourt les salles de jeu et leurs stucs et cariatides, leurs amphores en vielle porcelaine chinoise et autre attirail kitsch, sans parler des instruments consacrés, roulette, tables de jeu, etc... La salle Florentine, dite aussi des « mille bougies » en raison de ses lustres imposants aux myriades de flambeaux, servait pourtant déjà de salle de concert au XIX ème et on dit que Niccolò Paganini et Clara Schumann s'y produisirent. L'acoustique en est au demeurant fort agréable, pas trop feutrée. Sous le titre de « Kontraste », le programme donnait à entendre des compositions de deux représentants de la Seconde école de Vienne, Berg et Schoenberg et un de la Première, Joseph Haydn. La brochette composée de Daishin Kashimoto, violon, Ludwig Quandt, violoncelle, Emmanuel Pahud, flûte, et Wenzel Fuchs, clarinette accueillait le pianiste français Éric Le Sage. Un peu de L'Empéri en Bade-Wurtenberg donc, puisqu'aussi bien Le Sage et Pahud sont deux des trois chevilles ouvrières (avec Albrecht Meyer) du festival provençal des nuits juillet! On commença par l'adagio du Kammerkonzert d'Alban Berg, dans l'arrangement du compositeur pour violon, clarinette et clavier. Après une courte introduction sombre le mouvement se développe en arche laissant au violon et au piano le soin de débuter et de conclure une alternance des passages vifs et lents, très virtuoses pour le violon et le flûte. Le Trio Hob. XV: 16 de Haydn fait un contraste saisissant, de par sa distribution instrumentale, piano, flûte et cello, et son caractère enjoué. À la différence des Trios pour baryton (violoncelle) ou pour piano et cordes, cette instrumentarium est rare, encore que le violoncelle joue plus les utilités qu'il n'assure un rôle déterminant. Celui-ci l'est par le violon et la flûte. L'allegro initial aurait pu être écrit par Mozart, tant il est fluide et joyeux. L'andantino est gracieux, une suite de variations sans prétention autre que de désir de plaire. Un finale vivace assai, en forme de rondo allègre conclut, le piano menant la danse. Exécution de classe des trois protagonistes. Le morceau de résistance sera la Kammersinfonie Nr.1 d'Arnold Schoenberg. Achevée en 1906, la pièce a été écrite pour 15 instruments, et créée l'année suivante par le Quatuor Rosé et des vents des Wiener Philharmoniker. Plusieurs transcriptions en ont été faites dont une pour flûte, clarinette, violon, violoncelle et piano, due à Anton Webern en 1922. La boucle était ainsi bouclée et les trois amis réunis, du moins par la pensée. D'un seul tenant, on y distingue cependant cinq mouvements enchaînés. Quelques brèves mesures d'introduction lente cèdent la place à un allegro. Puis vient une séquence « sehr rasch » (très vif), en forme de scherzo, et qui sonne comme un orchestre. Le « sehr langsam » (très lentement), qui ne l'est pas tant ici, fait figure, selon l'auteur, de développement. Puis le « Schungvoll » (plein de vigueur) déploie un adagio, et offre de grands climax. La section finale, « Hauptzeitmass » (correspondant à récapitulatif), est véhémente, avec de traits à l'arraché. Un challenge pour les cinq musiciens qui n'en font qu'une bouchée.
Jean-Pierre Robert.
***
Musique
au Val-de-Grâce : « Nada te turbe »

Dans le cadre de sa dix-septième Saison, la
Chapelle Musique du Val-de-Grâce et son organiste titulaire, Hervé Désarbre, ont rendu un bel Hommage à Sainte-Thérèse
d'Avila (1515-1582) qui — issue d'une famille juive sépharade convertie — a
fondé un nouveau Monastère Carmélite à Avila, préconisant une vie spirituelle
plus intériorisée et plus mystique dans le sillage des Confessions de Saint Augustin. Placée sous le signe de la Semaine
Sainte et de l'impératif Nada te turbe
(Que rien ne te trouble), cette
audition donna lieu à d'intéressantes découvertes : tout d'abord de l'Ave Maria du musicien espagnol Alonso
Lobo (1555-1617), antienne dépouillée et méditative, suivie du Magnificat a 8 pour chœur et continuo de
son compatriote Antonio Soler (1729-1783), faisant
appel à la virtuosité vocale, à différents volumes sonores bien dosés, allant
du mystère vers la puissance et aboutissant à la doxologie plus affirmée.
Grâce à sa maîtrise
parfaite des possibilités de registrations de l'Orgue Cavaillé-Coll (1853) —
avec machine Barker, relevé en 1927 par le facteur Paul-Marie Koenig, classé
« monument historique » en 1979 et restauré par les facteurs François
Delangue et Bernard Hurvy
en 1992/3 —, le volet moderne de ce programme éclectique a permis à Hervé Désarbre de rendre sensibles les diverses peintures
d'atmosphère de 4 extraits de La
Symphonie des Mystères de Joaquin Nin-Culmell
(1908-2004), américain d'origine cubaine : Les coups mystérieux, obsédants ; Les Nuages, créant un certain dépaysement énigmatique ; Le Vent, sortant avec élan de la
torpeur ; La couronne mystique,
envoûtante, avec une facture mélodique assez modale. Ce fut une prouesse
organistique que de ciseler chaque note, détailler tant d'ambiances diverses
voire inattendues.
Changement de
couleur avec 3 motets mariaux pour voix de femmes : Alma Redemptoris Mater, riche en
frottements et dissonances ; Regina Coeli, de caractère plus tourmenté et Ave Regina caelorum
dont les lignes mélodiques évoluent dans tous les sens, décidément le
compositeur parisien François Vercken (1928-2005) ne
facilite pas la tâche des interprètes et met leurs voix (de surcroît a
cappella) à rude épreuve. Federico Mompou (1893-1987), dans son œuvre pour
chœur et orgue : Cantar del alma (sur
un texte de St Jean de La Croix) spécule sur la spatialisation, les effets
d'écho, la résonance environnante et les contrastes de tension et de détente.
Après ces exploits vocaux : retour à l'orgue avec la pièce de l'organiste Jean
Henry (1889-1959) O Filii
et Filiae, dont le thème bien connu, d'abord
énoncé à la pédale, sera modifié et trituré, assorti de commentaires décoratifs
aux claviers, à mi-chemin entre postromantisme et modernité, dans le langage de
la première moitié du XXe siècle, si bien rendu par Hervé Désarbre.
Après le volet
moderne, ce beau concert de la Semaine Sainte se termina, comme il avait
commencé, avec une autre antienne mariale : le Stabat Mater a 10 pour
voix et continuo de Domenico Scarlatti (1685-1757). Déjà mise à rude épreuve,
la Chapelle-Musique du Val de Grâce, dirigée avec tant d'autorité par Étienne Ferchaud, se joua des difficultés inhérentes à la
complexité polyphonique des 10 voix pour conférer à cette page toutes les
nuances requises par le texte, plénitude et émotion en ce samedi de Pâques.
Édith Weber.
Entre espoir et désastre : Les Stigmatisés à l'opéra de Lyon
Franz SCHREKER : Die
Gezeichneten (Les Stigmatisés). Opéra en
trois actes. Livret du compositeur.
Charles Workman, Magdalena Anna Hofmann, Simon Neal,
Markus Marquardt, Michael Eder, Aline Kostrewa, Jan Petryka, Jeff
Martin, Robert Wörle, Falko
Hönisch, James Martin, Piotr Micinski,
Stephen Owen, Caroline MacPhie, Marie Cognard, Didier Roussel, Kwang Soun Kim, Paolo Stupenengo, Celia
Roussel Barber, Karine Motyka, Alain Sobieski, Sharona Appelbaum, Hidefumi Narita.
Orchestre, Chœurs et Studio de l'Opéra de Lyon, dir. Alejo Pé rez.
Mise en scène : David Bösch. Opéra de Lyon.

© S. Tofleth
Prisé en son temps, puis banni comme
représentant de l'« Entertate Musik » (Musique dégénérée), Franz Schreker
(1834-1934) sort peu à peu de l'oubli. On mesure à peine quel foisonnement
artistique s'est emparé de la capitale autrichienne au tournant du siècle, en
peinture, au théâtre, et bien sûr en musique. Comme Zemlinsky et Berg, Schreker s'illustre à l'opéra. Die Gezeichneten,
composé en 1915, créé à Francfort en 1918, déconcerta du fait de son sujet
audacieux. Alviano, un jeune noble laid mais épris de
beauté, a créé une sorte de paradis sur terre, sur une île dénommée Elysium ; mais ses amis l'ont transformée en lieu de
débauche où ils enlèvent des jeunes filles. Une artiste peintre, Carlotta,
d'essence aristocrate (elle est la fille du Podesta Nardi), est attirée par l'étrange Alviano,
par séduction plus intellectuelle que physique. Elle finit par se donner au
jeune et beau Tamare, son exact opposé. Elle mourra
de s'être livrée. Alviano tuera Tamare,
soudain devenu un rival. C'est que les deux protagonistes sont des stigmatisés
du sexe comme de la vie, lui ayant renoncé à tout commerce de la chair, du fait
de sa difformité, elle ne voulant connaître le plaisir de l'amour de peur de
succomber. A travers cette trame d'attirance-répulsion se niche le sujet du
drame de l'artiste, de deux figures singulières qui vont sombrer dans la folie
de leurs propres idéaux. Sur ce texte qu'il a lui-même préparé, Schreker a écrit une musique utilisant sa manière
habituelle : le « son lointain », titre d'un de ses opéras
précédents, pour un discours épousant le vertige des sens, et des mélismes
traités en halo, selon une fantasmagorie sonore sans pareille. Si le dispositif
orchestral est immense et le flux nourri, la sonorité reste d'un lyrisme
transparent.

© S. Tofleth
La
mise en scène de David Bösch joue les contraires
et nous plonge dans les affres de contrées d'une irrémédiable noirceur. Tout à
l'opposé de celle donnée en 2004 au festival de Salzbourg dans le lieu magique
de la Felsenreitschule. En homme de théâtre, et comme
il l'illustra dans sa vision matérialiste de Simone Boccanegra de Verdi,
déjà à Lyon, il force le trait visuel, aidé par des projections fort étudiées
démultipliant l'espace scénique : un palais délabré où évoluent des courtisans
débauchés et éméchés, un atelier d'artiste aux murs peuplés de mains
translucides effrayantes en guise de tapisserie, une île dont l'aspect
paradisiaque est transporté dans quelque jardin aux fleurs vénéneuses, fort
attractives dans leur luminescence argentée. Dès les premières mesures, Bösch fait défiler de manière compulsive des vignettes de
femmes et d'enfants recherchés, « Wanted »,
« Missing ». La torture morale et physique
subie, en cachette, par les femmes, proies des amis d'Alviano,
Bösch la dénonce. On a la nette impression qu'Alviano en est partie prenante, et est plus un serial
killer qu'un homme passionné d'art, et en tout cas pas un observateur
complaisant. Son « procès », au III eme
acte, sera manigancé par quelque inquisiteur ; autre grand spectacle faisant
pendant aux scènes d'orgies du Ier acte ou à la pantomime sexuelle du début du
III ème. Or, apparait vite un écart entre une
musique, certes forte dramatique, mais pas spécialement violente, et une régie
qui elle l'est essentiellement. Tout ce qui dans la musique, si lyrique, est de
l'ordre de l'espérance s'accompagne côté scène de visions de désastre. Le
« son lointain » schrekerien est souvent
comme enfermé. La mise sen scène refuse le côté onirique qu'appelle la musique,
au profit d'un réalisme mortifère. Non que la réalisation technique ne soit pas
à la hauteur : elle est formidablement accomplie. Et la direction d'acteurs
tout aussi pointue, à l'exemple de l'échange entre Alviano
et Carlotta au II ème acte, dans l'atelier de
celle-ci, point névralgique de l'œuvre et moment crucial de la régie, où
transparaît une meilleure adéquation entre volet musical et dramaturgie. Rare,
à l'opéra, est en effet cette déclaration amoureuse d'une femme faite à un
homme. Car cette femme est, selon Bösch, « Non
pas objet, mais sujet de l'amour ». Alviano en
est comme violé dans ses convictions profondes de renoncement au désir sexuel.
Et Carlotta, à cet instant, est-elle sincère ou se paie-t-elle de mots ?

© S. Tofleth
En tout cas l'interprétation est au dessus
de tout soupçon. Charles Workmann trouve le ton juste
et a la présence vocale pour donner à Alviano une
épaisseur frôlant quelque idéal. Un sûr métier lui permet de soutenir le choc
d'endurance requis par un rôle de ténor tendu, à la limite de la tessiture
héroïque. Magdalena Anna Hofmann se tire des pièges de la partie, elle aussi
fort périlleuse, de Carlotta : un grand soprano lyrique poussé à des quintes
extrêmes, où la voix se sort d'affaire, et personnification convaincante de
cette femme ambiguë qui dit n'aimer que la nuit. Simon Neal, hier Le Hollandais
de Wagner, offre de Tamare un portrait façon loubard
sans état d'âme, prêt à tout sacrifier pour posséder ce qu'il cherche et
obtient. La voix de stentor fait le reste. Le beau timbre de basse de Michael
Eder donne au Podesta Nardi
des prestiges royaux, et Markus Marquardt, le Duc
Adorno, puis le Capitaine de justice revu en inquisiteur, distille une vocalité
pas toujours agréable, mais une présence on ne peut plus sulfureuse. Une foule
de petits rôles agrémente la pièce et la distribution alignée est sans faute ;
tout comme les Chœurs maison font fort belle figure, quand bien même accaparés
par un jeu des plus expressionnistes. Alejo Pérez
nous immerge dans la magie sonore irrésistible de Schreker
avec la conviction d'un passionné du « timbre étrange, torturé,
torturant » du compositeur, selon Alain Perroux. L'Orchestre de l'Opéra de
Lyon a rarement été aussi engagé et se meut dans cette orchestration opulente
avec délice.
Jean-Pierre Robert.
Orphée partagé entre présent et
mémoire
Christoph Willibald GLUCK: Orfeo ed Euridice. Azione teatrale per musica. Livret de Ranieri de Calzabigi. Christophe Ainslie
& Victor von Halem,
Elena Galitskaya, Léo Caniard,
Noé Cambriand, Yoan Guérin,
Simon Gourbeix, Tom Nermel,
Cléobule Perrot. Orchestre, Chœurs et Maîtrise de l'Opéra de Lyon, dir. Enrico Onofri. Mise en scène
: David Marton. Opéra de Lyon.

Acte 1 © S.Tofleth
Autre volet du « Festival les jardins
mystérieux », l'Opéra de Lyon présentait Orphée et Eurydice dans
une version pour le moins décoiffante. Sous le
prétexte de « dépasser la légende » », David Marton
prend comme point d'appui de sa mise en scène la phrase que lance Orphée
déplorant la perte d'Eurydice, « Oh, cruel souvenir! ». Il va mêler
présent et passé en dédoublant le personnage titre : un vieil homme « qui
se souvient » et le jeune homme qui agit ; musicalement, une basse et un
contre ténor. En fait de lyre, le vieil Orphée confie à une machine à écrire
Remington ses pensées ; prosaïquement, des textes de Samuel Beckett qui
défilent en fond de scène sur le cyclorama. Ils sont empruntés à l'œuvre « Le
Calmant », issu de Nouvelles et textes pour rien (1945). Outre
qu'il n'est pas toujours aisé à la fois de lire ledit texte et de suivre
l'action, on se perd en conjecture sur le sens de ce procédé ; même s'il est
clair que le bonhomme y étale ses états d'âme éplorés. Le texte dévolu au
personnage d'Orfeo passe sans solution de continuité
de l'un à l'autre, idée en soi
intéressante. La régie propose une foule de symboles : le jeune Orphée
faisant figure de garçon rangé, presque compulsif, le vieil homme, du haut de
son expérience, méditant sur les évènements,
une vielle bâtisse menaçant ruine, au milieu de nul part, celle des
espoirs perdus d'Orphée, des chœurs dansant sur les paroles du héros, ou encore
l'Amour démultiplié en huit garçons, idée qui semble-t-il n'a pour but que
d'annoncer la scène finale : lors qu'on passe à table, les turbulents rejetons
entourent le couple mythique enfin réuni... Les réjouissances finales
réserveront une ultime surprise : choristes et solistes sont réunis au bord du
plateau tandis que la fosse d'orchestre se soulève pour mettre les musiciens au
même niveau : le triomphe de la musique, tant chantée par Orphée ! Reste que
pour dynamique qu'elle soit et pour séduisante que soit sa réalisation, cette
approche n'échappe pas à un sentiment de lassitude. Elle est trop réaliste, la
composante du souvenir trop mise sur un pied d'égalité avec l'action textuelle,
qui est elle-même soulignée dans sa crudité. Elle mériterait à être plus
suggérée. Un moment crucial telle l'aria « Que farò senza Euridice ?
» est ruiné par la vraie-fausse bonne idée de faire défiler devant le jeune
Orphée une théorie de dames, autant d'Eurydice, vêtues de blanc. Malgré ou
peut-être à cause de cet empilement de signifiants, on est vite gagné par une
impression de longueur, paradoxale à l'endroit d'une œuvre qui est en durée la
moitié de celle de l'opéra de Schreker, la veille. On
est à la limite du « d'après... » tant
prônée par moult metteurs en scène actuels, à l'opéra comme au théâtre parlé.
Autre interrogation : pourquoi avoir choisi la version italienne de l'opéra, et
non la version française, qui eût mieux « collé » avec le parti pris
littéraire adopté ?

Victor von Halem © S. Tofleth
Les interprètes se coulent dans ce moule
avec empathie. Et d'abord Victor von Allen qui donna
de si magistrales interprétations du grand répertoire de basse. D'une
formidable présence jusque dans les passages non chantés, il prête une aura
grandiose au vieil Orphée. Même si la voix n'a plus le lustre d'antan, elle
montre encore de la ressource. Son jeune collègue Christopher Ainslie est moins à l'aise. Outre que le timbre de contre
ténor est ingrat, la ligne de chant ne séduit guère : l'air des enfers «
Mille pene, ombre moleste » (Ombres accablées,
je souffre) développe peu de charisme et l'aria fameuse « J'ai
perdu... » peu d'aura, alors que le chanteur
devrait à cet instant « faire pleurer les pierres ». Le monde musical
fourmillant de ce type de voix, le choix paraît curieux. Une belle juvénilité
est gâtée par une apparence un peu sèche dans ce parcours d'épreuve. L'Eurydice
d'Elena Galitskaya est fort agréable à voir et à
entendre, et les huit « Amour » de la Maîtrise de l'Opéra de Lyon
parfaitement en situation. Les Chœurs, très sollicités par la mise en scène,
font montre d'un engagement de tous les instants. La battue d'Enrico Onifri est énergique, un peu anguleuse dans les passages
purement orchestraux (Ouverture, danses de la scène finale), plus apaisée et
attentionnée dans l'accompagnement des arias. La tonalité italienne est
indéniablement là et l'orchestre de Gluck « ne tombe » pas
« dans les bras de Wagner » comme se plait complaisamment à le
fustiger Monsieur Croche alias Claude Debussy dans sa fameuse « Lettre
ouverte à Monsieur le Chevalier C.W. Gluck », mais atteint une plénitude
certaine.
Jean-Pierre Robert.
Promenade russe en compagnie du maestro Gergiev

L'Orchestre
du Théâtre Mariinsky dans sa salle à St Petersbourg / DR
Pour la première incursion de
l'Orchestre du Théâtre Mariinsky à la Philharmonie de
Paris, Valery Gergiev avait concocté un programme
entièrement russe. En amuse bouche, le Concerto pour orchestre N°1 de Rodion Chtchedrine (*1932), que
celui-ci composa en 1963 et dédia à Guenadi Rojdestvensky. Cette miniature d'une dizaine de minutes
requiert un vaste effectif. C'est une pochade basée sur la « Tchastouchka », chanson-blague populaire. D'où son
sous titre de « Couplets polissons ». En fait, il y a là dedans un
mélange d'académisme et de modernité, de l'humour pas spécialement discernable
par une oreille occidentale, mais par contre de la bonne humeur facilement
reconnaissable. D'un seul tenant, le morceau regorge d'énergie et flatte tous
les pupitres de l'orchestre, dont les contrebasses dans un numéro jazzy aux
syncopes dansantes. Cela tient du « barnum » et côtoie le trivial.
Les musiciens du Mariinsky s'en donnent à cœur
joie. Le morceau suivant offre plus sage atmosphère. Les Enfantines que
Modest Moussorgsky compose pour voix de soprano et
piano entre 1868 et 1872, nous transporte dans le monde de l'enfance. Ces
« Sept mélodies sur des poèmes du compositeur », qu'orchestrera
Rimski-Korsakov, sont autant de brèves scènes de théâtre, basées sur des paroles
d'enfant qu'interrompent les interventions de la nourrice. Le réalisme des
textes est soutenu par une écriture très libre bourrée de traits insolites pour
traduire le trivial des paroles (l'histoire du méchant ogre... ou de la tsarine
: « chaque fois qu'elle éternue, les carreaux volent en éclats », ou
la saga du hanneton : « couché sur le dos, les pattes en l'air, il ne
fait plus le méchant »). Anastasia Kalagina leur
prête de doux accents, presque trop, et la voix se perd quelque peu dans le
vaste vaisseau de la Philharmonie. Comme plat de résistance, Valery Gergiev joue les Tableaux d'une exposition du même Moussorgsky dans l'orchestration de Maurice Ravel. Ce sera
un feu d'artifice et on ne mégotera pas son plaisir d'entendre ces brillantes
effluves dans la nouvelle salle. Gergiev mise sur les
contrastes, et très largement : du fulminant (« Gnomus »)
au fort lent (« Il Vecchio Castello »),
sans parler des écarts de dynamiques à l'intérieur d'une même pièce (fortissimo
initial de « Bydlo », suivi d'un envoûtant
pianissimo). Rappelant que l'œuvre est, outre son thème récurrent de la
« Promenade », une alternance de moments mesurés et vifs. Une
succession de portraits saisissants aussi, inspirés d'études ou d'aquarelles du
peintre Victor Hartmann que l'imagination débordante de Moussorgky
a transformés en vrais tableaux animés, et que la main magique de Ravel
enrichit encore d'une palette irrésistible de couleurs. Car on oublie souvent
que le français, s'il a cherché à souligner la modernité de la pièce, a autant
voulu rendre hommage aux qualités d'orchestration de Rimski-Korsakov, main
attitrée de la remodélisation de plusieurs œuvres de
l'auteur de Boris Godounov. L'exécution de Gergiev
met l'emphase sur tout cela avec une patte russe indéniable. Que dire de la
légèreté de « Ballet des poussins dans leurs coques », de la grandeur
de « Samuel Goldenberg et Schmuÿle », ou de
le l'intensité spectrale de « Catacombae ».
Cette vision trouve sa glorieuse épilogue avec
« La Grande Porte de Kiev », et son crescendo aspirant bardé de coups
de gong de plus en plus assourdissants. Le dessert, à l'heure des bis, verra se
succéder le Prélude de Lohengrin, hommage à Christophe de Margerie, ami
du chef d'orchestre et patron de Total, un des sponsors de l'orchestre, puis le
Prélude du dernier acte de La Khovantchina,
proprement magique avec ses traits de
clarinette s'évanouissant dans un souffle.

Le Label Mariinsky
vient de publier les Tableaux d'une exposition dans l'incandescente interprétation de Gergiev, saisie live à Saint-Pétersbourg. Le CD comprend
encore la version originale de l'ouverture Une nuit sur le Mont Chauve,
et le cycle de mélodies Chants et Danses de la mort, par la basse Ferruccio Furlanetto, un des
grands interprètes de Moussorgsky, célébré pour sa
vision du rôle-titre de Boris Godounov (1CD Mariinsky
: MAR0553 ; TT.: 68'28)
Jean-Pierre
Robert.
Castor et Pollux revisité
façon affaires de famille...
Jean-Philipe RAMEAU : Castor et Pollux. Tragédie en cinq actes. Livret de
Pierre-Joseph Bernard, dit Gentil-Bernard. Version de 1754. Antonio Figueroa, Aimery Lefèvre, Hélène
Guillemette, Gaëlle Arquez, Hasnaa Bennani, Dashon Burton, Serguey Romanovsky, Konstantin Wofff. Choeur du Capitole. Les Talens
Lyriques, dir. Christophe Rousset. Mise en scène: Mariame Clément.
Théâtre du Capitole.

Gaëlle
Arquez, Aimery Lefèvre, Antonio Figueroa,
Hélène Guillemette ©Patrice Nin
Troisième opéra de Rameau, Castor et Pollux a, ces temps, la faveur des directeurs d'opéra.
Après le TCE (cf. NL de /2015) et les Opéras de Dijon et de Lille, voici une
nouvelle production au Capitole de Toulouse. On a choisi la version remaniée de
1754, qui omet le prologue et offre de la tragédie en musique une approche plus
compacte du thème de l'amour fraternel, de l'« amitié» au sens qu'avait ce
mot au XVII ème siècle. On sait l'histoire : deux
frères, Castor, Pollux, aiment la même femme, Télaïre, et deux sœurs, celle-ci et Phébé,
le même homme, Castor. Alors que Castor est blessé mortellement, Pollux ira le chercher au royaume des Enfers, acceptant
l'ordre de Jupiter de prendre sa place. Mais le dieu décide finalement de les
unir dans les cieux pour former la constellation des Dioscures. Phébé, en revanche prend leur place aux Enfers. Selon
Christophe Rousset, cette seconde version
« évite toute place à une mythologie inutile ». Elle focalise
sur l'évolution psychologique des deux frères à l'heure du choix, quasi
cornélien chez Pollux. Une aubaine pour un metteur en
scène. Mariame Clément revendique « une lecture
paradoxale et abstraite », et prétend ne rien imposer au spectateur.
Billevesée ! Sa vision est radicalement réaliste : une histoire de famille qui
se trame dans un « lieu familial commun », une vaste maison
bourgeoise de style victorien, rigide et sombre, dans le vestibule de laquelle
trône un escalier monumental. Pour mettre en exergue l'idée de lieu de passage
mais aussi le facteur de l'espace et la métaphore des recherches de tout un
chacun. La nombreuse domesticité de la demeure fera office de choristes. Les
passages de ballet fonctionnent tel un espace où les protagonistes se
remémorent leur passé. De fait, dès l'ouverture, on surprend le jeu des deux
gamins qui deviendront adolescents, puis les adultes de l'histoire. Idem pour
ce qui est des deux sœurs. Une ascension de générations en somme. L'idée n'est
pas saugrenue. Reste que malgré une apparence de fluidité et un achèvement
magistral, elle se développe dans un contexte et une visualisation terriblement
pessimistes et un peu corsetés. Le paradoxe va résider dans le traitement
réservé à Pollux, le rejeton immortel, curieusement
moins choyé par l'entourage familial que son demi frère Castor ; et surtout
dans le fait que ce modèle d'équilibre dramatique (et musical) qu'est la
tragédie lyrique de Rameau est ramenée au ras d'une vision quelque peu terre à
terre. Des images fortes, mais complaisantes, renforcent cette impression
mortifère : tel Castor emmuré dans une chambre mortuaire d'un blanc clinique,
tandis qu'en dessous on véhicule un cercueil et qu'on y dépose son sosie, dont
on a préalablement fait la toilette du mort. Pas de changement de décor pour la
scène des Champs-Elysées, et l'air de Castor revenu des enfers, « Séjour
de l'éternelle paix » sonne en parfait décalage avec le texte musical.
Mais il est de belles et originales images : comme l'échange par les deux
frères de leurs vêtements (« Ornements les plus doux »), acte de leur
réconciliation, après que Pollux eût délivré Castor
de la mort ; et ce trio final des deux hommes vêtus à l'identique (dans le
costume de Pollux), entourant Télaïde,
lequel ensemble ne verra pas le décor changer pour voir apparaître le palais
éclatant de Jupiter célébrant la « fête de l'univers ». Cela nous
sera refusé tout comme le finale poursuivra sur cette tonalité sombre : Phébé, désormais isolée, erre comme égarée.

Acte IV ©Patrice
Nin
Heureusement que bonheur musical il y a.
Grâce à Christophe Rousset et à ses formidables Talens
Lyriques. Le chef ne tarit pas d'éloges sur cet opéra. Et sur le choix de la
version de 1754, musicalement plus achevée encore que celle de 1737: une
musique riche, sensuelle, à l'appui d'un texte ciselé, offrant aux interprètes
des tessitures très longues, pour Pollux en
particulier. Sa direction est très engagée, vive, fébrile parfois, pour
traduire la force rythmique, comme à l'heure du chœur des enfers ou de cette quasi « temporale » du IV éme acte. Les sonorités raffinées dispensées achèvent une manière élégante, et on savoure
les interventions solistes du basson, du contrebasson ou des cuivres à la belle
patine. Les sortilèges de la mélodie ramiste, Rousset
les distille en fin connaisseur et offre une vraie limpidité gallique. Sa
distribution partage une qualité cardinale : la noblesse de la déclamation. Aimery Lefèvre, que sa formation au CMBV prédestine à
pareil emploi, abordé pour la première fois, campe un Pollux
intense : la voix, de type baryton Martin, excelle à traduire l'ambiguïté du
personnage et son cheminement vers l'acte de bonté. Antonio Figueroa,
pour une prise de rôle et une première incursion dans l'univers de Rameau,
offre de Castor un portrait bien taillé. Le timbre qui n'est pas sans rappeler
le type du ténor français baroque, comme son collègue canadien Pascal
Charbonneau, est agréable et la voix bien placée. Avec Télaïre,
Guillemette Laurens, qui fut naguère de l'aventure toulousaine des Indes
galantes, conjugue limpidité vocale et générosité de la femme aimante.
Gaëlle Arquez, Phébé, projette haut et fort, presque
trop, et la composition est impressionnante : de la passion à la rage puis la
folie. Aussi enflammée que sa consœur est placide. Les autres rôles, comme le
Chœurs du Capitole, font œuvre de vaillance et de nuances.
Jean-Pierre Robert.
Les Wiener Solisten Sextett
et le Jugendstil viennois

Juliane
Banse / DR
Voilà un concert à marquer
d'une pierre blanche ! Un programme consacré à la période du Jugendstil viennois concocté par les Wiener Solisten Sextett, une des
formations de chambre de l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Le Sextuor à
cordes, prélude à Capriccio, op. 85, a été conçu par Richard Strauss
comme une réflexion liminaire à son ultime opéra. Il a été créé en 1942 par des membres de ce
même orchestre, dont le fameux quatuor Rosé. Au cours de cette belle méditation
mélancolique et rêveuse, celle de la Comtesse Madeleine en proie au dilemme
d'offrir son cœur à Olivier ou à Flamand, autrement dit de donner préférence à
la musique ou à la poésie, on savoure la manière dont Strauss traite les cordes
: une modulation sans fin, traversée des soubresauts de l'émotion. Sortie de la
fosse d'orchestre, la pièce développe plus d'ampleur sur le podium, surtout
lorsqu'interprétée par les Viennois. Ils vont donner ensuite une rareté, pour
ne pas dire une nouveauté : les Wesendonck Lieder
de Wagner dans une version pour voix et quatuor à cordes due au compositeur
français Christophe Looten (*1958), écrite en 2013.
Une telle transcription de par son intelligence textuelle, offre d'emblée plus
de séduction sonore que la version originale pour piano. Et comparées à la
version pour grand orchestre, entendue généralement, quoique non de la main de
Wagner, à l'exception de l'une d'elles, ces pièces prennent là une couleur
diaphane bienvenue et s'inscrivent dans un climat de grande intimité. On
perçoit la richesse de l'inspiration mélodique, comme décantée, et des
subtilités telles que les traits du violoncelle (Bernhard Hedenborg)
au 3ème Lied, « Im Treibaus », dont la
mélodie évoque l'atmosphère accablée du III ème acte
de Tristan und Isolde. Ce même instrument on
en reconnait la patte au 5ème Lied, « Traüme »
(Rêves). Les quatre cordes enveloppent la voix d'un halo merveilleux. Celle-ci,
Juliane Banse, une soprano attachante qui s'illustra sous les baguettes de
Claudio Ababdo et de Nikolaus
Harnoncourt, délivre une exécution immaculée, même si on la sent à la limite de
la réserve de puissance, dans le 2ème Lied « Stehe
still! » (Reste tranquille!) par
exemple. Elle gourmande le texte avec une rare intelligence et la voix, qui en
telle occurrence n'a pas à lutter contre l'orchestre, est vraiment le primus inter pares. Les deux pièces suivantes ont une
parenté l'une avec l'autre car Maiblümen (Fleurs
de Mai) pour voix et sextuor à corde qu'Alexander von
Zemlinsky (1871-1942) compose en 1898, n'est pas éloignée de La nuit
transfigurée dont Arnold Schoenberg achève la composition l'année suivante.
On a là deux exemples de la modernité naissante qui ouvrira la voie à la
Seconde école de Vienne. La pièce de Zemlinsky, inachevée, offre les
caractéristiques du style de l'auteur : des harmonies irisées et des climats
paroxystiques comme en a produit à l'envi cette période la musique viennoise.
Le chant est serti dans un flux incandescent et translucide. Et la péroraison,
purement instrumentale, est intensément lyrique. Juliane Banse émeut par sa simplicité
et sa belle vocalité. Et aussi par l'image qu'elle offre dans sa robe jaune
poussin et sa chevelure brune abondante, se détachant sur le fond du rideau de
scène fraichement redoré, digne d'une toile de Gustav Klimt ! Avec Verklärte Nacht,
Schönberg a livré une composition qui aura autant fait pour sa réputation que
ses œuvres ultérieures, telles Erwartung ou Pierrot
lunaire, pour ne citer que ces deux-là. On est
fort aise d'en entendre et savourer la version originale pour sextuor à cordes.
Car la perfection instrumentale des six viennois, Rainer Honeck,
Wilfried Hedenborg, violons, Tobias Lea, Sebastian Fürlinger, altos, Sebastian Bru,
Bernhard Hedenborg, cellos,
laisse pantois, comme leur formidable concentration. Des sonorités d'une beauté
spectrale.
Jean-Pierre
Robert.
Un succès du répertoire de l'Opéra Comique de nouveau à l'affiche
Ferdinand HEROLD : Le Pré
aux clercs. Opéra-comique en trois actes. Livret d'Eugène de Planard d'après Chronique du règne de Charles IX de
Prosper Mérimée. Marie Lenormand, Marie-Eve Munger, Jaël Azzaretti, Michael Spyres, Emiliano Gonzales Toro,
Éric Huchet, Christian Helmer. Accentus.
Orchestre Gulbenkian, dir. Paul McCreesh.
Mise en scène : Éric Ruf. Opéra Comique.

©Pierre
Grosbois
Chronique du règne de Charles
IX est le premier ouvrage de Prosper Mérimée à avoir été porté sur
la scène d'opéra, en 1832, bien avant sa Carmen. Il l'a été
successivement par Meyerbeer, avec Les Huguenots et Ferdinand Hérold
pour son Pré aux clercs. Deux œuvres aussi dissemblables que les
différencient les genres auxquels elles appartiennent : le grand opéra pour la
première, l'opéra-comique pour la seconde. Pour faire simple on dira que le Prè aux Clers est
la version soft de cette histoire qui se trame à l'époque de la Saint
Barthélémy, et qui a pour théâtre ce lieu illustre sur les bords de la Seine,
juste en face du Louvre. On y venait se divertir car cette promenade était
agréablement boisée, et aussi pour vider quelque querelle ou duel mortifère. La
proximité du fleuve permettait d'évacuer discrètement les pauvres défaits de
cœur ou d'honneur! Autant Meyerbeer a noirci l'intrigue en opposant deux clans,
huguenots et catholiques, autant Hérold, dans le souci de ne pas choquer le
public de l'Opéra Comique, fort distinct du celui de l'Opéra, fait dans le bon
goût, le demi genre, qui offre ce mélange singulier de chanté et de parlé. Il
adoucit les aspérités du cadre historique et portraiture des personnages somme
toute sympathiques, comme Marguerite de Valois, le Baron de Mergy,
ou encore le cocasse Cantarelli, le bouffon de la
cour. La pièce est distribuée aux voix types requises alors dans un
opéra-comique : trois sopranos, différenciées dans leur tessiture, le grand
soprano lyrique, la soprano plus légère et colorature, et la soprano dite
« à roulades », et trois ténors d'emplois tout aussi différents : le
ténor romantique, le second ténor et le ténor comique, appelé Trial. une basse bouffe complète le panel vocal. La distribution du
spectacle de l'Opéra Comique est plus valeureuse du côté des messieurs que de
leurs consœurs. Michael Spyres, Mergy,
outre une diction irréprochable et une belle distinction, distille les couplets
de la romance « O ma tendre amie! Je suis près de toi ». Emiliano
Gonzalez Toro incarne le vrai-faux méchant de Comminge avec un brin de préciosité mais un timbre
agréable, et Éric Huchet se taille un
franc succès dans le bouffon Cantarelli par un jeu
spirituel, jamais appuyé, et une faconde intarissable. Christian Helmer offre du rôle de l'amoureux Girot
qui a bien les pieds sur terre, les vertus d'une voix de basse fort bien
conduite. Si la Nicette de Jaël
Azzaretti roucoule à souhait et a du piquant, sur les
traces de sa consoeur Petibon,
Marie-Eve Munger, Isabelle de Montal,
est plus à la peine, nonobstant une belle simplicité dramatique, et Marie
Lenormand déploie grandeur et vocalité
satisfaisantes.

©Pierre
Grosbois
Les chœurs Accentus
font un triomphe car ils jouent aussi bien qu'ils déclament le texte. La
musique de Hérold, Paul Mc Creesh la défend avec une
vaillance sonore certaine, un peu envahissante à l'occasion. Mais on lui est
reconnaissant de sa conviction car les pages ne sont pas toujours de la
meilleure veine. Ainsi d'une ouverture offrant plus un collage de phrases
qu'une idée d'ensemble. Les choses s'arrangent à partir du deuxième acte qui
s'ouvre sur une sorte de mini concerto de violon. On admire le sens des ensembles : le grand pezzo concertato qui clôt cet
acte, avec sept solistes et un chœur endiablé, et plusieurs trios fort
habilement troussés, parfaitement
interprétés, tel celui réunissant les deux sopranos et le bouffon, ou celles-ci
et le primo ténor. Éric Ruf ne cache pas avoir voulu
« jouer droit et direct » dans ce qui est « un théâtre du
premier degré ». Il le fait avec tact. Il met en particulier son talent
d'acteur au service des passages parlés qui ne sonnent jamais factices, mais
bien comme sur un plateau de théâtre. Les clins d'œil faciles sont asservis à
une dramaturgie qui ne se départit pas un instant du bon goût, et l'explicatif
n'est pas souligné. La direction d'acteurs est ainsi naturelle et offre
quelques beaux arrêts sur image, rehaussés d'une jolie palette de couleurs ;
celle que procurent des costumes imités d'époque et un cadre décoratif aéré :
quelques platanes aux tons automnaux pour visualiser la fameuse promenade et un
décor de fête neutre pour rappeler que l'action nous transporte au palais du
Louvre.
Jean-Pierre
Robert.
Sur les ailes du chant

Jérôme
Ducros, Mathieu Herzog, Philippe Jaroussky, Pierre Colombet,
Gabriel
Le Magadure, Raphaël Merlin
Philippe Jaroussky
donnait au Théâtre des Champs Elysées le programme de son récent CD, autour des
mélodies de Verlaine, « de Fauré à Ferré ». On a dit à propos du
disque (cf. NL de 4/2015) tout l'intérêt de la démarche rapprochant plusieurs
poèmes de Verlaine mis en musique par divers compositeurs, accompagnés qui au
piano, qui par un quatuor à cordes. Le concert apportait divers éclairages
nouveaux et une solide confirmation. Le cadre relativement intimiste du Théâtre
de l'Avenue Montaigne est on ne peut plus en situation, car si la salle et
surtout sa coupole peinte par Maurice Denis datent des années 1912/1913, les
poèmes de Verlaine et les musiques qui les sous tendent, composés au tournant
du siècle, y sonnent comme chez eux. La combinaison voix et quatuor à cordes
imprime à cette poésie de l'indicible une aura de lumière qu'on n'associe pas
nécessairement à ce répertoire. De fait, l'agencement du programme, quelque peu
différent de celui du disque, confie au quatuor une sorte de fil conducteur
dans le cheminement vocal et même vis à vis du piano. Les six artistes arrivent
ensemble sur le plateau dès le début du concert et restent à leur place quand
bien même ils ne jouent ni il ne chante, ce qui contribue à créer un sentiment
d'unité, rarement atteint au récital, et même à transcender le cadre formel et
formaté de celui-ci. Enfin, on a la confirmation d'une évidence : Philippe Jaroussky et ses amis unissent leur art respectif pour le
plus pur achèvement expressif. Plus qu'une succession de morceaux, aussi beaux
soient-ils, c'est un grand poème qu'ils disent, à plusieurs arborescences
musicales et littéraires. Le concert débute par les premières pages du Concert
op. 21 de Chausson, pour quatuor à cordes et piano. Quelques autres instants
purement instrumentaux viendront émailler la soirée : la Sicilienne op.
78 pour quatuor à cordes de Fauré, le deuxième mouvement du Quatuor de Debussy,
l'Idylle pour quatuor à cordes de Chabrier, ou Clair de lune extrait
de la Suite Bergamasque pour piano de Claude de France. Le chanteur se
lève pour interpréter telle mélodie avec l'accompagnement du seul piano ou
celui des quatre cordes. On entendra tour à tour des extraits des Poèmes
saturniens (1866), de veine mélancolique, dont « Promenade sentimentale »
(musique de Charles Bordes) ou « Chanson d'automne », mise en musique
par Reynaldo Hahn, mais aussi par Ferré. Des Fêtes
galantes, écrites en 1869, et leurs jeux amoureux précieux, mais parés
d'une suprême élégance française, Jaroussky a choisi
« Clair de lune », « Pantomime », « Fantoches »,
« Mandoline » (ce dernier poème enluminé par Fauré, Debussy et Hahn),
« En sourdine », le « Colloque sentimental » (sur des
musiques de Canteloube, et encore de Ferré).
C'est bien sûr La Bonne Chanson, de 1872, qui a le plus inspiré
les musiciens, dont Fauré qui mettra en musique 9 de ses 12 poèmes, comme
« La Lune Blanche » - et sur lequel composera aussi Régine Poldowski, fille du violoniste Wieniaswski.
Des Ariettes oubliées, de 1888, on entendra en particulier
« Green » (Fauré, Caplet).

DR
Debussy, Fauré et Hahn sont les
chantres les plus désignés de Verlaine, avec de
subtiles mais bien réelles différences. On succombe aussi à la manière
de Chabrier, de Déodat de Séverac, de Caplet, voire
de Saint-Saëns (« Le vent dans la plaine »). Plus près de nous, et
dans le domaine de la chanson, ce dont les originales adaptations de Trenet, et
en 1941, celle de la « Chanson d'automne » par Brassens. Partout, la
poésie musicale de Verlaine fait corps avec la musique tout court, car sa
versification, qui fuit le carcan et le corseté, appelle la prosodie du chant ;
ce chant qui est le prolongement naturel de la poétique verlaisienne.
Philippe Jaroussky montre une réelle empathie pour
ces textes et musiques, une intelligence aiguë pour en extraire le suc. La voix, qui s'est
étoffée dans le medium, se coule dans la fluidité de ces morceaux sublimes.
Lorsque la voix s'élève dans l'aigu, c'est comme si quelque ange ravi se
faisait une fête de l'esprit. La diction impeccable triomphe de la ductilité
redoutable de la manière verlaisienne, adoptant le
ton juste, sans jamais verser dans le fabriqué. La simplicité de l'approche est
à l'aune du naturel de la démarche. Ses confrères du Quatuor Ebène déploient
une finesse toute gallique, tandis que Jérôme Ducros maintient une ligne
d'accompagnement vraiment participative. En bis, ils donneront une pochade de
Chabrier, l'air de Poussah, tiré de l'opérette « Fisch-Ton-Kan »
(1873), puis « L'heure exquise » dans la version somptueuse de Reynaldo Hahn, et « Colombine » vue par Brassens,
mettant un point final joyeusement rythmé à une soirée décidément pas comme les
autres.
Jean-Pierre
Robert.
Le cycle Brahms de Orchestre Philharmonique
de Vienne

Christoph Eschenbach / DR
Traditionnel passage bi annuel des Wiener Philharmoniker avenue Montaigne dans un cycle musical
entièrement consacré à Brahms, sous la baguette du chef et pianiste allemand,
bien connu des parisiens, ancien directeur musical de l'Orchestre de Paris,
Christoph Eschenbach. Un programme taillé sur mesure
pour cette prestigieuse phalange historiquement liée au compositeur, comprenant
les Symphonies n° 1, 2, 4 et le Concerto
pour violon, un programme copieux réparti sur deux soirées. Un cycle
marqué, il faut bien l'avouer, par une
certaine déception face à la performance de l'orchestre, somme toute assez
banale compte tenu de la notoriété reconnue de cette formation classée dans le
« top cinq » mondial. Une contre performance à mettre essentiellement
sur le compte de la direction sèche, grandiloquente et emphatique du chef
allemand qui ne parvint jamais à insuffler le souffle et la tension nécessaires
à ce répertoire, à trouver le ton juste et le phrasé adéquat malgré force de
variations de tempo discutables, de rubatos spectaculaires, comme autant
de leurres dérisoires ne réussissant pas
à masquer la faiblesse de l'inspiration et l'archaïsme de la lecture. Une
direction rigide et contraignante qui donnera en permanence l'impression de
museler l'orchestre. Une première soirée comportant les Symphonie n°2, surnommée « La
Viennoise », permit d'emblée de juger de l'excellence des cordes, une
perfection dans le jeu et les couleurs déjà clairement affirmée par les
solistes du Wiener Solisten Sextet lors du concert du
30 mars dernier, dans un concert de musique de chambre, ici même. La petite
harmonie tint correctement son rôle, sans éclat ravageur, ce qui ne fut pas le
cas du pupitre des cuivres, et tout particulièrement des cors aux attaques
imprécises et au son nasillard… La Symphonie
n°4 fut, peut-être, un peu plus réussie, l'orchestre semblant retrouver
plus d'allant, d'envie et d'équilibre. Bref, une soirée assez terne conclue par
ce qui fut, sans doute, le meilleur moment du concert, les Wiener Philharmoniker retrouvant tout leur savoir faire dans une très belle Danse hongroise n°20 qui déclencha
l'enthousiasme du public !

Leonidas Kavakos / DR
Autre temps, autre concert que celui de la
deuxième soirée présentant en première partie le célébrissime Concerto pour violon dont le violoniste
grec Leonidas Kavakos nous donna une interprétation
d'anthologie où rien ne manqua : superbe sonorité, intelligence du phrasé,
tempo retenu, inspiration de la lecture, virtuosité, et cadence classique de
Joachim. Une performance du plus haut niveau portée par un jeu efficace et
discret sachant s'effacer devant la musique pour nous maintenir en haleine et
sous le charme de bout en bout. Une interprétation magnifique suivie de
deux « bis » empruntés à Bach, comme deux moments d'éternité,
suivis d'un long silence avant que la salle ne reprenne son souffle pour des
applaudissements fournis et un triomphe mérité ! Pour conclure ce deuxième
concert, les viennois avaient choisi la Symphonie
n° 1 qui semblait, par son coté un peu rustique et un peu passéiste, mieux
convenir au chef allemand. Une œuvre, à la fois tragique et grandiose,
d'inspiration classique dont la composition s'étala sur vingt ans, encouragée
par Schumann, soulignant l'héritage beethovenien, évoluant par grands plans
sonores sur une ligne mélodique sinueuse et usant largement de la variation,
dont Eschenbach nous livra une vision, somme toute,
assez réussie, avant de conclure encore une fois sur la célèbre première danse
hongroise dont l'effet auprès du public ne se fit pas attendre avec une
standing ovation, peut être un peu abusive ! Aux mauvaises langues de
conclure que le chef allemand n'est jamais aussi bon que dans les
« bis » ! Ce qui est un peu court tout de même.
Patrice Imbaud.
Daniele Gatti et le « National » rendent un très bel hommage à
Shakespeare

DR
Shakespeare
a toujours inspiré les musiciens, compositeurs comme interprètes, Daniele Gatti fait partie de ceux-ci, ayant choisi de
conduire son orchestre dans un court cycle shakespearien comportant deux
concerts (en avril et mai) et un opéra (MacBeth de Verdi tout prochainement). Premier opus ce soir
avec un programme associant Liszt, Strauss et Mendelssohn. Force est de
reconnaitre que la période troublée que nous venons de connaitre au sein de
Radio France n'a en rien entamé la qualité et l'enthousiasme des musiciens et
de leur chef qui nous offrirent un concert de haute tenue musicale, les trois
œuvres judicieusement choisies permettant de mettre en avant toutes les
qualités de sonorité, de timbres et de cohésion de l'Orchestre National de
France. Hommage à Shakespeare, donc, débutant avec Hamlet, dixième poème symphonique de Liszt créé dans sa forme
définitive en 1876. Une partition faite d'ombre et de lumière, à l'image des
deux héros, Hamlet et Ophélie, laissant une large place aux silences suivis
d'attaques acérées, nécessitant précision, cohésion et tension. Suivait Macbeth, premier poème symphonique de
Richard Strauss crée en 1892, dans sa version révisée, par Hans von Büllow qui s'écria à l'issue
de la création : « C'est
vraiment quelque chose de beau ! ». Une partition très contrastée
juxtaposant finesse aérienne et sombre noirceur dans un équilibre délicat,
sollicitant intensément les cuivres, les bois et les cordes dans un dialogue
dément. En deuxième partie Le Songe d'une
nuit d'été de Mendelssohn, dans sa rare version intégrale associant Ouverture (1827) et Musique de scène (1843) deux pièces composées à plus de quinze ans
d'intervalle, la seconde résultant d'une commande du roi de Prusse,
Frédéric-Guillaume IV. Merveilleuse illustration musicale de la pièce de
Shakespeare, pleine de féérie, d'enchantement, de dynamisme, de poésie et
d'humour recrutant l'ensemble des pupitres dans une sublime instrumentation,
toute en légèreté et transparence. Le bruissement mystérieux des cordes, le
chatoiement des bois et les rutilantes fanfares de cuivres entretenant la magie
du récit, admirablement conté par le comédien-metteur en scène Stéphane Braunschweig, et brillamment chanté par le Chœur de Radio
France, ainsi que par la soprano anglaise Lucy Crowe
et la mezzo française Karine Deshayes. Une magnifique
soirée de concert sous la direction précise et engagée de Daniele
Gatti qui semblait ce soir particulièrement motivé et incisif. Au chapitre des
félicitations, une mention particulière pour la petite harmonie et pour
l'excellente prestation, dans l'ineffable mélodie du Nocturne, du premier cor solo qui paradoxalement refusa presque de
saluer sur l'invitation du chef italien ( ?) Bravo à tous! Rendez
vous pris pour Macbeth de Verdi du 4
au 16 mai et pour le second concert de ce cycle le 10 mai avec Berlioz, Strauss
et Prokofiev.
Patrice Imbaud.
Mikko Franck et le « Philhar »
embrasent la Philharmonie de Paris

DR
Un moment d'exception que ce concert de
Mikko Franck et de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, après la longue
interruption que l'on sait… Un souffle épique, une tension palpable, un
embrasement qui saisirent le public de l'immense salle de la Philharmonie de
Paris à l'occasion de cette Symphonie n°
5 de Prokofiev. Une immense fresque musicale de la période de guerre,
composée en 1944, célébrant la victoire et la « grandeur de l'esprit
humain » toute imprégnée de solennité et de lyrisme. Sardonique et
plaintive, majestueuse et monumentale, elle utilise une riche polyphonie
orchestrale, puissante et rythmée, sollicitant généreusement les cuivres. Son
ton est constamment ambigu oscillant entre agressivité et nostalgie laissant
poindre l'amertume du compositeur témoignant, à l'instar de Chostakovitch, des
souffrances endurées sous le régime stalinien. Symphonie peut-être la plus
célèbre de Prokofiev, elle se compose de façon classique de quatre mouvements,
un Andante inaugural et solennel, un Allegro mordant, motoriste, sur un
rythme acéré et envoûtant des cordes, un Adagio
déchirant et glacé, et un finale plein d'espoir en la nature humaine,
scandé par des sonneries de cuivres. Sentant probablement l'intensité
émotionnelle du moment et l'empathie fusionnelle avec ses musiciens, Mikko
Franck, exceptionnellement quitta son fauteuil et descendit de son pupitre à la fin de l'Allegro, pour diriger debout au milieu
de l'orchestre l'Adagio et le Finale, au plus près des cordes. Une
interprétation d'anthologie qui assurément restera dans les mémoires… On en
viendrait presque à oublier la belle interprétation du pianiste autrichien
Rudolf Buchbinder dans le Concerto pour piano n° 1 de Brahms qui ouvrait la soirée. Ce qui
serait un oubli bien injuste. Un concerto composé en 1858, fortement charpenté,
à l'image de son auteur, hésitant entre symphonie et concerto, entre ballade
nordique et sombre méditation, où
instrument soliste et orchestre dialoguent tout au long des trois mouvements,
d'abord de façon majestueuse et assez percussive, puis de manière plus retenue
dans un Adagio rêveur quasi religieux, avant de conclure sur un Rondo plein de
verve auquel Rudolph Buchbinder, injustement méconnu
en France, donna toute sa mesure dans une conclusion triomphale. En
« bis » une très belle et virtuose transcription d'une valse de
Johann Strauss qui entraîna les applaudissements fournis d'un public conquis.
Une belle soirée !
Patrice Imbaud.
Musique
au Musée d'Orsay : Cycle « Suites
Française »
Une série de concerts intitulés
« suites françaises » est proposée à l'amphithéâtre du Musée en
relation avec l'exposition Bonnard. Ce cycle met en regard des œuvres baroques
et des pièces du XIXème et du début du XXème. La France a toujours entretenu
une relation privilégiée avec son passé et ses héros. C'est avec passion que
les compositeurs de ces époques dialoguent avec leurs prédécesseurs.

Trio Chausson
/ DR
Le 31 mars le Trio Chausson avec la mezzo
Marina Domashenko ont interprété le Concerto (Sonate en trio) de
Jean-Sébastien Bach, la Sonate BuWV253 de Dietrich Buxtehude, la Sonate en trio n°1 H525 de Carl Philipp Emmanuel Bach et un arrangement pour voix et trio
avec piano (dû au pianiste du Trio, Boris Larochelambert)
de Shéhérazade de Maurice Ravel. Ce
programme était passionnant et joué avec une belle énergie. La découverte était
la Sonate de Buxtehude de toute beauté, extrêmement sensible. Le Trio Chausson
(Leonard Schreiber, violon, Antoine Landowski, violoncelle, Boris Larochelambert, piano) est enthousiasmant. La transcription
était toute aussi intéressante et la voix de Marina Domashenko
puissante et bien en place. Dommage qu'elle ait ensuite chanté « en
yaourt » les étranges poèmes de Tristan Klingsor mis en musique par Ravel.
On n'a pas compris qu'elle voulait « voir la Perse et l'Inde et puis la
Chine, et Les mandarins ventrus sous les ombrelles » ! Mais sans
faire de sexisme, elle est partie sans donner de bis « la hanche
légèrement ployée ». Le public n'a pas été enthousiasmé. Voilà une grande
voix qui doit travailler son élocution quand elle chante en français; mais des
superbes stars russes ne le font pas non plus. Le concert s'est terminé par un
arrangement pour trio, toujours par le pianiste, de la fameuse Valse de Ravel. C'est dans un
exceptionnel et enivrant tourbillon qu'il s'est achevé avec en bis un extrait
d'une sonate (BWV1038) de JS. Bach. Un
trio à vite découvrir et à suivre dans ses prochains concerts.
Le 7 avril, c'était un concert totalement
français. Au programme un compositeur inconnu Gaspard Le Roux, contemporain de
d'Anglebert, avec un esprit à la Couperin. Olivier Baumont
et Françis Dumont ont interprété à deux clavecins Trois suites de ce mystérieux
compositeur. En regard, Stéphanie-Marie Degand et
Christine Plubeau ont joué à deux pianos Le Ruban Dénoué de Reynaldo
Hahn. Cette idée de l'ancienne programmatrice du Musée, était, sur le papier,
fort intéressante. A l'écoute, disons-le tout net, nettement moins car le
concert était soporifique. Les interprètes ont joué avec beaucoup de sérieux
les pièces pour clavecin et les deux pianistes avec beaucoup de fougue ces
valses aux titres « délicieux ». Une douzaine de valses : même si
certaines ont été écrites pendant que Reynaldo Hahn
était à l'arrière du front, elles n'ont pas grand intérêt. Quand aux Suites
pour clavecin on peut comprendre qu'un grand artiste comme Olivier Baumont puisse aimer ce genre de musique et découvrir des
petits maîtres. Quant à nous, nous sommes resté très
extérieur à ce genre de partition. Mais c'est tout de même bien d'essayer de
sortir des sentiers battus...
Stéphane Loison.
Le Palais Royal au Conservatoire d'Art Dramatique

Vannina Santoni / DR
Le Palais Royal, dirigé par Jean-Philippe Sarcos, a interprété la Troisième symphonie de Beethoven et
quelques airs de Mozart avec la soprano Vannina Santoni.
Il est très difficile de critiquer cette formation et la direction de son chef
dont le travail auprès des jeunes est magnifique. Sarcos
s'assigne une mission : la musique peut changer le monde et spécialement
la Troisième symphonie de Beethoven (elle a été créée à Paris dans ce lieu même)
et tout ce que nous ont légué les compositeurs du passé. Nous ne polémiquerons
avec lui, il en est convaincu et il fait découvrir cette musique à des jeunes
qui pour la plupart n'ont jamais vu d'orchestre en direct. Alors, pour eux,
qu'importe que cette interprétation soit très approximative à cause d'un
orchestre d'intermittents en mal de cachets et qui n'ont pas assez répété. La
grande révélation de la soirée aura été la soprano Vannina Santoni
qui a chanté le difficile air de Fiordiligi « Come Scoglio »
extrait de Cosi fan tutte, un air de
concert avec violon solo (on oublie le violon) « Non Temer Amato
Bene K .490 » et a terminé par l'air de la comtesse « Dove Sono », extrait des Noces
de Figaro. Un programme lourd qu'elle a mené avec brio. Elle a même bissé
« Come Scoglio »,
le public ne voulant pas la lâcher. Vannina Santoni
est corse et russe, d'où son tempérament de feu ; elle chante excellemment
et interprète divinement en vraie comédienne qu'elle est. Elle a du coffre, de
l'énergie, un beau timbre, une voix bien en place, et elle est agréable à
regarder chanter. A 19 ans elle a obtenu son prix avec mention très bien au
CNSMDP. Après plusieurs prix, c'est avec Donna Anna qu'elle a commencée sa
carrière en Italie, rôle qu'elle a repris à Versailles sous la direction de
David Stern ; puis elle a enchaîné les rôles mozartiens. Cette saison
c'est avec Juliette, Adèle, Adina, Suor Angelica et Lauretta qu'on
pourra l'écouter. Nous avons là une belle soprano qui va faire parler d'elle.
Ce qui est toujours émouvant dans les concerts du Palais Royal c'est
l'apparition du chœur de ces jeunes d'origines et d'horizons différents qu'a
réussi à créer Jean-Phillippe Sarcos.
Disséminé dans la salle de concert, le chœur a interprété avec fougue « Che
del Ciel, che degli Dei » de La Clémence de Titus et
« Amanti Costanti »
des Noces de Figaro, sous la baguette dégingandé de ce chef d'orchestre
atypique. Il faut défendre ce genre d'institution si on veut que la musique
classique continue à vivre en France !
Stéphane Loison.
Les débuts du Quatuor Strada aux Pianissimes

Quatuor Strada / DR
Les Pianissimes,
pour leur dernier concert parisien de la saison, ont délaissé le Couvent de
Récollets pour la mythique salle du Conservatoire d'Art Dramatique, rue du
Conservatoire à Paris. Le très médiatisé Adam Laloum et le nouveau Quatuor Strada ont joué le Quintette
pour piano & cordes en fa mineur opus 34 de Brahms. Ils ont
magnifiquement interprété cette œuvre avec toute l'énergie qu'elle demande. Les
envolées romantiques avaient l'air de
plaire aux cinq artistes car ils les ont jouées avec le sourire. Ils avaient du
courage car outre une chaleur étouffante, ils étaient assis sur un plateau peu
stable, sûrement abîmé par tous les futurs comédiens qui prennent leur cours
dans ce théâtre du XVIIIème où toutes les grandes créations parisiennes du XIX ème ont eu lieu (Beethoven, Berlioz, Saint-Saëns…). Le
concert avait pourtant mal débuté avec la
Sonate pour piano n°13 en la majeur D 664 de Schubert. Cette sonate dite
« posthume » n'est pas une grande sonate. Elle avait été dédicacée à
Joséphine von Koller, jeune
fille de son hôte en l'été 1819. Elle est de caractère heureux et demande de la
légèreté dans l'exécution, même si par instant il y a quelques passages
tourmentés (ses rapports vis à vis de la jeune femme ?). Adam Laloum nous
a ennuyé en oubliant cette légèreté. Il sait jouer, on
ne peut pas le lui reprocher. Mais est-ce le trac, une œuvre pas faaite pour lui ? Bref, il était absent (surtout dans
l'Andante) et les passages tourmentés inaudibles tant il y avait des
« forte » incontrôlés. Il s'est rattrapé avec le quintette, mais là
il n'était pas seul. Aurait-il un problème de se retrouver seul en
récital ? Au disque, il est parfait, mais on sait comment sont mixés les
enregistrements aujourd'hui. Le Quatuor Strada dont
c'était la première apparition parisienne, nous a enchanté : Sarah Nemtanu, violon solo de ONF, Lise Bertaud,
qui a déjà une belle carrière d'altiste, Pierre Fouchenneret,
violon ayant participé à de nombreuses formations, et François Salques, naguère le magnifique violoncelliste du quatuor Ysaÿe, ont ébloui par leur qualité sonore et l'entente
qu'ils nous on fait sentir dans le Quatuor
à cordes n°15 en la mineur op 132 de Beethoven. Le molto adagio était
bouleversant ainsi que le silence qui s'en suivit. Ce silence était encore de
la musique. Cette œuvre est au programme du
premier disque des Strada qui va bientôt être édité. Espérons qu'on
retrouvera cette même alchimie.
Les
prochains concerts, pour le 10ème Festival des Pianissimes,
à Saint Germain au Mont d'Or, auront lieu entre le 25 et 28 juin 2015, avec
Roger Muraro, Selim Mazari,
le Trio Dali, le SiriTango Quartet, Aylen Pritchin...
Pour tous renseignements :
www.lespianissimes.com
Stéphane Loison.
Les trente ans de l'orchestre des Pays de Savoie (suite)

Salle de la
Grange au lac / DR
Quel bel endroit pour fêter ses trente ans
que cette Grange au lac d'Évian !
Et comme on s'y sent bien, à ce point entouré de bois ; bois qui apporte
sa chaleur, son odeur, ses qualités acoustiques. Tout y a été pensé pour créer
une ambiance amicale voire familiale : le décor en troncs de bouleau, les
lustres en cristal de Murano, les balcons avec leurs escaliers et leurs
rambardes. Même à sept heures du matin, pour la matinale de Dominique Boutel, on s'y sentait réconforté ! Lors de cette
émission qui, n'ayant pu être diffusée
en direct à cause de la grève, sera retransmise le 20 juin, Nicolas Chalvin a parfaitement dégagé l'originalité de cet
orchestre « des Pays de Savoie » (formation qu'il dirige depuis 6
ans) : son effectif mozartien, son caractère itinérant, bien qu'il ait
désormais trouvé en cette Grange au lac un lieu d'attache, en plus de sa salle
habituelle de répétition au Conservatoire d'art et d'histoire d'Annecy.
Quelle belle idée également de se servir de
cet anniversaire, pour mettre en valeur de jeunes talents suisses et
français ! La Savoie retrouve sa vocation « transfrontalière »,
elle qui posséda autrefois Genève ! Une belle idée et un sacré courage :
pas facile d'accompagner de tout jeunes interprètes, en se mettant au diapason
de leur fougue et de leur énergie. On l'a parfois ressenti, lorsque les cordes
avaient du mal à répondre à la légèreté des solistes : une légèreté qui
requiert une précision accrue dans l'unisson, pas toujours aisée à obtenir en
formation ! Cela dit, l'orchestre a, dans l'ensemble, fort bien rempli sa
mission d'accompagnateur. Et je dois faire amende honorable : ayant écrit
dans ma dernière recension, que ses musiciens ne savaient pas sourire, je dois
avouer que c'est partiellement faux : tous savent parfaitement sourire,
sauf lorsqu'ils jouent (exception faite, toujours, des deux jeunes
violoncellistes si enthousiastes).
Mais parlons des solistes, si bien
introduits par Gaëlle Le Gallic pour son émission
(elle aussi rediffusée le 20 juin) Génération
jeunes interprètes, qu'elle nourrit de son entrain, si communicatif. Elle
l'a précisément partagé, ce 11 avril à 12h 30, avec Charles Siegel (à ne
surtout pas confondre avec le détestable improvisateur Ziegel),
un des présentateurs de la tribune des jeunes interprètes sur RTS. Deux jeunes
instrumentistes à vent pour souffler les 30 (et une) bougies : Mathilde Caldérini et Raphaël Sévère, et deux instrumentistes à
cordes pour se frotter magistralement au public : Nadège Rochat
et Claire Dassesse.
C'est cette dernière qui se produisit
d'abord au violon dans les premier et second mouvement du concerto en la majeur de Mozart. Je dois avouer que
c'est celle des quatre qui m'a le moins convaincu. Non pas que son
interprétation n'ait été de qualité : sonorité ample, phrasé juste.. Simplement, j'ai trouvé son style trop proche des
romantiques.. vibrato
important, contrastes trop prononcés ; en un mot, la perte de la simplicité
mozartienne : Mozart qui, malgré son adhésion récente au Sturm und Drang, ne devait sans doute pas supporter de telles
« boursoufflures » sonores. Ici, le critique musical réclame
instamment le droit d'émettre un avis qui n'engage que lui..
C'est sans doute la fréquentation de mon maître et ami Paul Badura-Skoda
qui m'a toujours amené à déplorer le manque de simplicité qui accompagne
parfois l'interprétation des chefs d'œuvres du compositeur salzbourgeois.

Raphaël Severe / DR
Suivait l'exécution magistrale, par Mathilde
Caldérini, des second et troisième mouvements du
Concerto en mi mineur pour flûte de Mercadante. Il y a fort longtemps que j'ai
repéré le talent de Mathilde, alors qu'elle était mon élève en formation
musicale au CRR de Chambéry puis dans la classe des « SMD » :
Sportifs musiciens ou danseurs du lycée Vaugelas de Chambéry, une classe à
horaires aménagés unique en France, qui prépare au Bac général, et dans
laquelle j'ai eu l'honneur de former à l'écoute et l'analyse bon nombre de
jeunes instrumentistes devenus depuis d'excellents solistes (Lucas Mariani,
Jessica Bessac, Philippe Carrara,
Matthieu Handschuewercker etc.). Mathilde a toujours
eu cette science du phrasé, cette précision technique, cet enthousiasme et
cette candeur qui en fait déjà une grande artiste : le jury du célèbre
concours Kobé ne s'y est pas trompé, lui décernant un
premier prix en 2013. J'envie l'agent qui aura le bonheur d'être choisi par
cette magnifique et fragile petite brune qui n'a pas fini de faire parler
d'elle!
A propos de beauté, c'est désormais sous
les traits de Nadège Rochat que j'en-visage
(en deux mots) de rêver à Euterpe la bien-nommée (le nom de la muse de la
musique signifie en effet, en grec, « qui sait plaire »), tellement
c'est un spectacle ravissant que de voir cette jolie blonde faire corps avec
son instrument. C'est tellement vrai qu'on regrette presque de trouver sur son
visage les signes d'une émotion, légitime, qu'elle ne peut réprimer. De grâce,
Nadège, tentez de rester impassible et l'on aura l'impression que votre âme a
investi votre archet, et se confond avec celle du violoncelle ! Cet archet
(que vous nous avez présenté, malgré son origine
« modeste et chinoise », comme votre archet favori) qui a fait
pleurer et danser les deux derniers mouvements du Concerto pour violoncelle de
Haydn, nous a ébloui. Je n'avais jamais entendu un tel grain de matière sonore
sourdre des crins (asiatiques comme
européens) lors de ces passages « agrestes », si propres à Haydn. Et
cette première note de chaque phrase, couvrant progressivement par son
crescendo régulier le son de l'orchestre ! Un pur délice. Faire corps avec
son instrument, lorsqu'il s'agit d'un si beau violoncelle (du début du XVIIIe
siècle) et qu'on est si jeune, c'est un prodige. Sponsors de tous pays qu'on se
le dise : l'instrument prêté à Nadège est à vendre, et elle ne pourra
l'acquérir sans votre aide !
Enfin Raphaël Sévère arriva. Quel talent se
cache sous cette simplicité, cette spontanéité, cette
apparent immaturité! Il s'agite, se balance, vit sa musique comme
peu le font, et pourtant le son qu'il tire de sa clarinette est d'une
incroyable constance, d'une inénarrable continuité. C'était une sublime
interprétation du Concerto (2e et 3e mouvements) de
Mozart que vous nous avez offert là ! Tout semblait pesé au
milligramme : le début des sons, comme leur entretien, comme leur
amortissement (avec ce geste délicat des doigts si particulier lorsque vous
achevez une phrase) : rien au hasard, et pourtant tout semblant si
naturel, si clair ! Les New yorkais vous ont réservés la meilleure place
aux
Young Concerts Artists
International Auditions. Rien d'étonnant. Tout votre être est
musique lorsque vous jouez ! Je vous prédis une carrière des plus
abouties, pleine d'enregistrements de référence ! Voilà de quoi nous
réconcilier avec les enfants prodiges !

Les sœurs
Bizjak / DR
Pour achever cette journée riche en
émotions, l'orchestre nous proposait à 20H 30 un concert où le public, nombreux
et enthousiaste, put entendre la Pastorale
d'été, peu jouée, d'Arthur Honegger , puis le Concerto en mib
majeur pour deux pianos de Mozart, la suite de L'amour sorcier de De Falla, et enfin le
célèbre Carnaval des animaux de
Saint-Saëns, agrémenté de l'irrésistible texte de Francis Blanche ! Dans
la famille Bizjak, je demande la brune ! Car
c'est sans conteste, pour moi, des deux sœurs serbes, invitées pour la
circonstance, celle qui fait preuve d'un véritable sens du tempo, de la
pulsation. Là où la blonde ne maîtrise pas toujours les envolées techniques
(assez brillantes) où l'engagent ses doigts, la brune est là pour cadrer les
choses, et imposer un discours structuré. Un relent de ce que nous offraient
jadis l'opposition intro/extraversion de Marielle et Katia Labèque !
La fantaisie zoologique nous ayant enfin
permis d'apprécier l'humour discret de Nicolas Chalvin,
grand ordonnateur de cette « folle journée d'Évian », c'est globalement un
très bon souvenir que conserveront de ces manifestations et les auditeurs, et
les membres de l'orchestre (comme le plus vénérable d'entre eux, le
contrebassiste Philippe Guingouain), orchestre ayant
acquis ce jour, en partie grâce à Radio-France, une once
de reconnaissance nationale supplémentaire.
Philippe Morant.
***
L'ÉDITION MUSICALE
CHANT
Guy SACRE : Quatre Exemples tirés des « Nécessités de la vie ». Poèmes de Paul Éluard. Voix moyenne et piano. Symétrie : ISMN 979-0-2318-0021-0
On ne comprendrait rien à ce très court cycle, si on ne lisait d'abord (sur le site de l'éditeur ou sur la partition) le commentaire très clair qu'en fait Guy Sacre. Il n'y a rien à y rajouter sinon que le projet de l'auteur est pleinement rempli et que ces Quatre exemples sont une très belle réussite à faire découvrir sans modération…

MUSIQUE CHORALE
Guy LECLERCQ : Messe brève pour chœur de 4 à 6 voix mixtes et orgue. Assez difficile. Delatour : DLT2364 (version 4 voix).
Dans l'esprit des « messes brèves », cette œuvre comporte simplement les trois pièces : Kyrie, Sanctus et Agnus. On en retiendra la fidélité au texte et à sa prosodie, la brièveté de chacune des pièces, des harmonies fluides créant une grande atmosphère de recueillement même dans le Sanctus, dont les éclats ne nuisent en rien à l'intériorité. C'est une belle œuvre, difficile mais qui mérite qu'on s'y consacre pleinement. Attention : il y faudra un organiste expérimenté.

Guy LECLERCQ : Salve Regina pour chœur mixte à 5 voix et orgue. Moyenne difficulté. Delatour : DLT2493.
L'auteur suit fidèlement le texte par un discours quasi homorythmique avec des harmonies délicates pleines d'intériorité. Cette prière à la Vierge sereine et confiante est à la fois simple et belle. La partie d'orgue n'est pas très difficile.
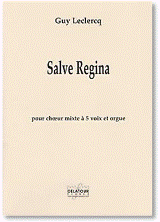
ORGUE
Guy LECLERCQ : Espérance pour orgue. Delatour : DLT2359.
Cette œuvre, à la fois lyrique et brillante ne manque pas de profondeur. On pourra l'écouter intégralement sur le site de l'éditeur (et sur You tube). Elle demande un instrument riche en couleurs et avec, si possible, trois claviers. Les recherches de timbres ne sont pas gratuites et trahissent ces élans d'espérance suggérés par le titre.

Jean-Jacques WERNER : Dans le souvenir de Frescobaldi… 4 courtes inventions pour orgue. Organistes Alsaciens Vol. 31. Assez facile. Delatour : DLT2420.
Canzone, Ricercar, Laude, Méditation : ces quatre courtes pièces sont destinées aux élèves organistes, mais ne sont pas des œuvres « d'étude » : ce sont quatre méditations qui trouveront tout naturellement leur place dans un office. La seule exigence technique est de disposer d'un instrument à deux claviers pédalier. Quant à la qualité de la musique, qu'en dire sinon que c'est du Jean-Jacques Werner ?
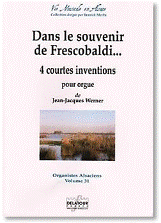
ACCORDEON
Aurélie TOMEZZOLI : Les versants du songe pour accordéon basses standards. Elémentaire. Lafitan : P.L.2811.
Cette petite valse en la mineur est loin de manquer de charme. Un peu rêveuse, comme son titre l'indique, elle déroule sa mélodie légèrement mélancolique sur des harmonies délicates. Il y a beaucoup de plaisir en vue pour ses interprètes.

PIANO
Julian ROWLAND : Argentinian Tango and Folk Tunes pour piano. 28 pièces traditionnelles. 1 vol. 1 CD. Schott : ED 13645.
Cet album est une très belle réussite. Ce parcours à travers le folklore et les airs traditionnels argentin est particulièrement réussi. Il n'y a pas de véritable difficulté technique : il s'agit de sentir le style bien particulier de ces œuvres et pour cela, le CD enregistré par l'auteur du recueil est un modèle de sensibilité et de bon goût. La traduction française de l'ensemble des présentations des œuvres se trouve sur le site de l'éditeur http://schott-music.com/argpiano/

Fazil SAY : Ses. Ballade pour piano op. 40b. Schott : ED 22159.
Fazil Say a écrit Ses, une œuvre pour trois sopranos piano et percussion d'après des textes de poètes turcs. Le poème qui a inspiré la dernière partie de l'œuvre se réfère à l'incendie criminel de l'hôtel Madimak de Sivas le 2 juillet 1993. C'est cette dernière partie que Fazil Say a reprise pour le piano solo et transformée en ballade. C'est dire tout le poids émotionnel qui se dégage de cette œuvre qu'on pourra écouter interprétée par son auteur par le lien : https://www.youtube.com/watch?v=Sp30CVKlpGQ

Antoine REICHA (1770 – 1836) : Sonate en fa majeur dite pastorale. Edition Michael BULLEY. Symétrie : ISMN 979-0-2318-0778-3
Probablement composée autour de 1800, l'œuvre comporte cinq courts mouvements, alternativement vifs et lents, qui s'enchainent. Reicha l'avait qualifiée lui-même de « sonate facile ». Le terme « facile » vise plus la technique du pianiste que le langage employé. Reicha, en effet, ne recule pas devant des enchainements harmoniques hardis. Bien que l'éditeur n'en fasse pas mention, il semble que cette sonate « pastorale » ait aussi des airs de chasse à courre. C'est en tout cas une œuvre fort intéressante à redécouvrir.

Josef SUK : Životem a snem (choses vécues et rêvées), pour piano op. 30. Bärenreiter : BA9561.
Josef Suk, 1874 – 1935, le compositeur (également violoniste, pianiste et organiste), à ne confondre ni avec son père, ni avec son petit-fils, violoniste, tous prénommés Josef, a été élève de Dvorak. Mais il a su ensuite se constituer un langage personnel. On découvrira avec grand plaisir ces dix pièces pour piano qui méritent d'être mieux connues. Composées et publiées en 1909, republiées à Prague en 1963, elles nous sont disponibles maintenant dans cette remarquable édition Urtext qui fait à juste titre la fierté des éditions Bärenreiter. On appréciera particulièrement, outre les qualités intrinsèques de l'édition, la préface et les copieuses et précieuses notes critiques qui l'accompagnent.

Franz SCHUBERT : Sonate en do mineur pour piano. D 968. Urtext. Bärenreiter : BA 10869.
Cette nouvelle édition, réalisée par Walburga Litschauer, bénéficie d'une intéressante préface, et surtout d'abondantes et judicieuses notes pour l'interprétation dues à Mario Aschauer. La partition bénéficie bien sûr de la clarté bien connue des éditions Bärenreiter.

Ludwig van BEETHOVEN : Sonates « quasi una fantasia » op. 27 n° 1 et 2 pour piano.. Urtext. Bärenreiter : BA 10853.
A quoi bon une nouvelle édition de ces sonates tellement connues et tellement éditées, pourrait-on se demander. Ce serait oublier le soin mis à cette publication et surtout les notes d'interprétation de Jonathan Del Mar et Misha Donat. Ce pourra donc être l'occasion de renouveler ses partitions, d'autant que la lisibilité et les « tournes » ont été extrêmement soignées.

Francine AUBIN : Les aventures de Pussy. 15 pièces progressives pour piano. Premier cycle. Sempre più : SP0149.
Ces quinze charmantes pièces nous racontent les aventures et les états d'âme d'une petite chatte bien sympathique. L'ensemble est frais et devrait beaucoup plaire aux jeunes élèves. A travers ces aventures, de nombreux styles et caractères sont étudiés mais jamais on ne penserait à des exercices… Il faut dire que l'auteur à derrière elle une longue expérience de compositrice et de pédagogue !

VIOLON
Claude PASCAL : Cordes à vide. 12 petites pièces pour violon ou alto. 1er recueil : violon. Débutant. Sempre più : SP0147.
C'est une gageure que d'écrire uniquement pour les cordes à vide. Claude Pascal y réussit merveilleusement en variant rythmes, phrasé, expression… Ce recueil est à recommander chaudement aux professeurs qui se refusent à faire un calvaire de l'apprentissage du violon.

ALTO
Claude PASCAL : Cordes à vide. 12 petites pièces pour violon ou alto. 2ème recueil : alto. Débutant. Sempre più : SP0148.
Il s'agit des mêmes pièces que celles pour violon (voir ci-dessus).
CONTREBASSE
Claude-Henry JOUBERT : Quatre fables pour contrebasse avec accompagnement de piano. 1 – La Dinde et les Marrons. Débutant. Lafitan : P.L.2959.
Pianiste et contrebassiste sont invités à nous raconter cette triste histoire… pleine d'humour, comme on s'en doute. On reconnaîtra au passage des allusions à l'ami Pierrot, tristement minoré ! Bref, les deux protagonistes n'hésiteront pas à forcer un peu le trait pour mieux nous faire partager les émotions des marrons et de la dinde…

FLÛTE
Paul STERNE : Pan's Morning pour flûte seule. Assez facile. Delatour : DLT2508.
Assez facile, au sens où elle ne demande pas un grand niveau technique, cette pièce exige cependant une grande maîtrise de l'instrument pour qu'on puisse en goûter toute la poésie, tout le raffinement de timbres et, nous oserons dire, d'harmonie. « Calme, extatique », tel est le caractère que propose l'auteur. On ne peut s'empêcher de penser au Prélude à l'après-midi d'un faune »… Cette pièce pourrait facilement constituer un « bis » dans un récital : elle mérite d'être jouée en concert. On peut l'écouter intégralement sur le site de l'éditeur.
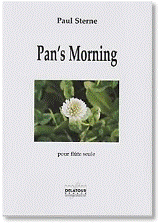
Jean-Christophe ROSAZ : Qì au commencement était le souffle… pour flûte alto en Sol et petite percussion ad libitum. Assez difficile. Delatour : DLT2486.
Le caractère chinois qui donne son titre à la pièce évoque donc le souffle, le souffle créateur que l'on retrouve dans la culture chinoise, mais aussi dans la culture indienne. L'auteur ne parle pas de la culture hébraïque, et pourtant la « Ruah », traduit en grec par le « pneuma », n'est-il pas l'esprit, le souffle créateur qui planait sur les eaux au début de la Genèse et qui donne vie à toute créature ? Peu importe : l'œuvre traduit physiquement l'apparition, la naissance de ce souffle et sa force vitale en faisant éprouver à l'instrumentiste comme à l'auditeur cette genèse du souffle puis du son. Il faudra, en écoutant cette pièce (et en la jouant) se laisser porter par l'esprit-souffle.

André DELCAMBRE : Burlesque pour flûte ut et piano. Préparatoire. Lafitan : P.L.2839.
L'auteur nous propose ici une pièce fort agréable et amusante, tant pour le pianiste que pour le flûtiste. « Avec subtilité et ironie », indique l'auteur. C'est exactement le caractère qu'il faudra donner à l'interprétation. Ce sera aussi l'occasion de prouver que le mineur n'est pas forcément triste…
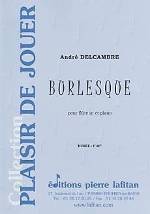
Thierry DELERUYELLE : A la lueur des songes pour flûte ut et piano. Débutant. Lafitan : P.L.2895.
Variés sont les songes, qui permettent en quelques lignes de brosser des tableaux très divers. L'ensemble est poétique mais ne manque pas de piquant. Les rêves se succèdent pour le plus grand plaisir de l'auditeur… et, souhaitons-le, des interprètes !

Jean-Christophe ROSAZ : Ariake pour flûte seule. Assez difficile. Delatour : DLT2473.
L'auteur présente ainsi son œuvre : « La lampe ARIAKE - terme qui désigne la lune pâle encore visible à l'aube - était une lampe traditionnelle japonaise de l'époque EDO (XVII - XIX ème siècles). Elle restait allumée toute la nuit et était faite d'un support cubique ajouré surmonté d'un "boîtier-foyer" que l'on faisait coulisser à l'intérieur de celui-ci pour réduire l'intensité lumineuse.
Cette composition est une évocation poétique de la lampe ariake qui brûle dans la nuit avec ses variations d'intensité et de l'obscurité qui l'entoure jusqu'à ce qu'elle se transforme en rayon de lune au lever du jour. »
Utilisant toutes les techniques contemporaines de la flûte ainsi que la spatialisation de l'interprète, cette œuvre est très délicatement poétique.

Jean-Christophe ROSAZ : Trinity pour 3 flûtes. Moyen. Delatour : DLT2485.
On pourra lire sur le site de l'éditeur la présentation qui est faite de cette œuvre (http://www.editions-delatour.com/fr/3-flutes/2495-trinity-pour-3-flutes-9790232110424.html ). Comment ne pas évoquer le film si beau d'Andreï Tarkovski, Andreï Roublev (1969 en France) et ne pas conseiller de le voir avant d'interpréter cette méditation sur l'icône de la Trinité ? Et bien sûr, il faudra aussi contempler l'icône pour elle-même… Attention, les trois flûtistes devront avoir chacun flûte en ut et flûte basse. Bien sûr il est fait appel aux techniques contemporaines de l'instrument. Une part non négligeable est laissée à l'improvisation des interprètes.

CLARINETTE
Francis COITEUX : Idylle pastorale pour clarinette et piano. 2ème cycle. Sempre più : SP0097.
Cette Idylle a tout à fait l'air d'une mini-sonate. A une introduction « Andante cantabile » succède un « Allegretto scherzando ». Très logiquement, suit un « Lento espressivo », et le tout se termine par un « Allegretto giocoso ». L'ensemble est plein de charme. Piano et clarinette dialoguent avec entrain. Le « Lento espressivo » permettra au clarinettiste mais aussi au pianiste de montrer leurs qualités expressives et leur sens du phrasé. Cette pièce très variée est pleine d'intérêt.

SAXOPHONE
Fabrice LUCATO : Au petit matin pour saxophone alto et piano. Débutant. Lafitan : P.L.2796.
Trois parties, dans cette petite pièce : une première et une troisième construites sur un petit thème varié mélodiquement et rythmiquement, et une partie médiane au rythme plus mélancolique de valse lente. Le tout est fort agréable, la partie de piano assez facile. C'est une invitation à la musique d'ensemble.

TROMPETTE
Alain FLAMME : Boulevard Trompette pour trompette ou cornet ou bugle et piano. Préparatoire. Lafitan : P.L.2887.
Ce boulevard fait vraiment penser à nos grands boulevards parisiens dans une ambiance un peu début de siècle (le XX°, bien entendu). Il nous invite à une promenade aux rythmes variés mais toujours un peu canaille, bien agréable, il faut le préciser ! Il y a donc beaucoup de plaisir en perspective pour les interprètes et leurs auditeurs.

TROMBONE
Pascal CHARTON – Pascal SAINT-LEGER : Brises. Capriccio pour trombone et piano. Supérieur. Lafitan : P.L.2952.
Voici une œuvre aux multiples facettes. Variété des mouvements, souplesse des rythmes, tout se trouve dans ces brises… Notons que la partie de piano n'est pas très difficile, même si l'instrument est un partenaire à part entière. Quant au trombone, il devra faire montre autant de ses qualités de vélocité que de celles de chanteur… de charme !

Marc LYS : Cool Lys pour trombone et piano. Fin 2éme cycle. Sempre più : SP0128.
Sur un rythme de bossa-nova, l'auteur nous déroule un thème un peu dégingandé et narquois, un peu mélancolique aussi, qui a belle allure. La partie de piano n'est pas franchement facile : le duo est un vrai duo où le piano n'est pas simple accompagnateur mais donne la réplique à son partenaire. L'ensemble est plein de charme narquois, dans l'esprit du titre...

Pascal PROUST : Totems pour trombone et piano. Fin premier cycle. Sempre più : SP0120.
Après une introduction de piano, un thème se déploie moderato puis s'augmente jusqu'à une nouvelle intervention du piano qui conduit à une cadence lento qui débouche sur un joyeux allegro moderato détaché pour finir en s'évanouissant. Ces totems sont variés et bien agréables.

COR
André DELCAMBRE : Chti Romance pour cor fa ou mib et piano. Préparatoire. Lafitan : P.L.2946.
Une très jolie mélodie, très mélancolique, se déroule sur un accompagnement de piano qui la soutient et parfois lui répond. L'ensemble crée une ambiance un peu brumeuse, peut-être celle du Nord ? Mais l'ensemble est fort beau et devrait toucher les jeunes interprètes et leur public.
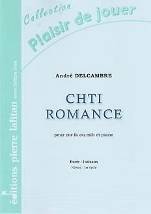
Marc LYS : Cool Lys pour cor et piano. Fin 2éme cycle. Sempre più : SP0138.
C'est la version pour cor de la pièce pour trombone recensée plus haut.
SAXHORN – TUBA – EUPHONIUM
Marc LYS : Cool Lys pour euphonium et piano. Fin 2éme cycle. Sempre più : SP0139.
C'est la version pour euphonium de la pièce pour trombone recensée plus haut.
Pascal PROUST : Les sapins beaux musiciens pour saxhorn ut ou sib (ou euphonium) et piano. Fin 1er cycle. Sempre più : SP0115.
C'est bien agréable, les compositeurs qui se réfèrent à Apollinaire ! On ne peut que conseiller à l'élève de lire le poème Les sapins auquel se rapporte le titre avant de jouer cette œuvre pleine de poésie. Les différents paysages se succèdent dans des ambiances variées et dans des harmonies délicates. C'est une fort jolie pièce.
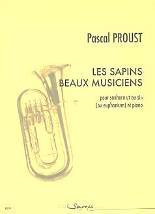
PERCUSSIONS
Guy LECLERCQ : Ondes pour marimba. Moyen avancé. Delatour : DLT2361.
Voici une pièce qui mérite bien son nom. Ondes (stationnaires ou fuyantes), ondulations, résonnances, sensations de rebonds… L'interprète aura tout intérêt à écouter la version qui se trouve sur le site de l'éditeur. Quoi qu'il en soit, disons que le tout est fort agréable à entendre et ne manque pas d'intérêt.
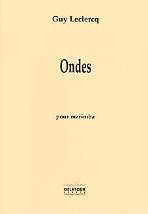
André GUIGOU : Espace pour caisse claire et piano. Préparatoire. Lafitan : P.L.2868.
Cette pièce a la particularité de ne pas être un solo de caisse claire avec accompagnement de piano, ou un morceau pour piano avec rythmique de caisse claire. Les deux instruments sont pleinement utilisés avec toutes leurs possibilités. Un vrai dialogue s'instaure entre eux, ce qui n'était pas gagné d'avance. C'est de la vraie musique de chambre où chacun peut s'exprimer.

Wieslaw JANECZEK : Train de loin pour batterie et piano. Préparatoire. Lafitan : P.L.2914.
Tandis que la main gauche du piano martèle la plupart du temps un rythme obsédant, la batterie au grand complet déploie à son tour ses obsessions. Rythme de train sur une voie ferrée ? Echo d'une « vraie » locomotive (à vapeur, bien entendu) et de ses halètements ? Peu importe, mais cette pièce trépidante soutien jusqu'au bout l'intérêt. Il y faudra cependant un pianiste aguerri rythmiquement. Et il faudra mener le train sans répit jusqu'au bout…

MUSIQUE DE CHAMBRE
Guy LECLERCQ : Bichromie pour guitare et quatuor à cordes. Moyen avancé. Delatour : DLT2357.
« Bichromie est née d'une commande d'élèves en écriture musicale pour leur examen de musique de chambre dans le niveau perfectionnement. Le résultat obtenu fut la mention TB à l'unanimité. » Disons tout de suite qu'elle le mérite. Parler d'atonalité de veut pas dire grand-chose : certes, nous sommes au-delà de la tonalité, mais dans des effets de timbres et de chatoyances tantôt plus lyriques, tantôt plus rythmiques. C'est une œuvre bien séduisante.
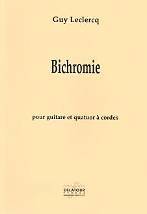
Alexandre OUZOUNOFF : Nervure pour flûte et percussion. Assez difficile. Delatour : DLT2511.
« Nervures » s'est imposé à moi avec la vision d'une énergie sans faille guidée dans des méandres de verdure, une pulsion de vie qui explose sous conduite, un trait qui illustre l'ordre dans cette géométrie complexe. » C'est ainsi que l'auteur présente cette œuvre, fruit d'une collaboration avec Meili Chuang, professeur de percussion au Conservatoire de Versailles. La place des percussions est particulièrement importante. L'œuvre joue sur les oppositions de timbres et de rythme des différents instruments mis en œuvre.
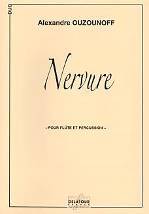
MUSIQUE D'ENSEMBLE
Guy LECLERC : Jeux pour orchestre de cordes et percussions. Moyen. Conducteur. Delatour : DLT2360. Matériel : DLT2360E (E-score en PDF).
Cette commande du Conservatoire de Dijon et d'Hélène Bouchez, professeur au CNSM de Lyon est destinée à exploiter le contraste et les résonnances entre jeux d'attaque des cordes et rythmique des percussions. Il y a exploitation d'un thème lyrique souvent utilisé en canon et une cellule de cinq notes, le tout mis en œuvre dans une suite de variations aux atmosphères diverses.
Daniel Blackstone.
PSAUMES POLYPHONIQUES
Jean SERVIN : Psalmi Davidis 1579 (edited by James PORTER. Turnhout, BREPOLS, Tours, Université François Rabelais, Centre d'Études Supérieures de la Renaissance, Collection « Épitome musical », (www.brepols.net ), 2014, cxxviii + 775 p. – 115 €.
À l'époque humaniste, soucieux de retourner ad fontes (aux sources grécolatines), les poètes ont cultivé le latin classico-humaniste et se sont inspirés des structures strophiques et des schèmes métriques pratiqués, entre autres, par Horace (Odes), Catulle, Martial, Virgile. C'est le cas des paraphrases néolatines de Psaumes réalisées par l'humaniste écossais George Buchanan (1506-1582) et mises en musique par Jean Servin (v. 1530-apr. 1596), actif à Orléans et à Lyon, également auteur de nombreuses chansons en style polyphonique traditionnel, mais marquées par l'influence italienne madrigalisante. Le Recueil intitulé : Psalmi Davidis a G. Buchanano versibus expressi, nunc primum modulis IIII, V, VI, VII et VIII vocum, a I. Servino decantati, a été publié à Lyon par Charles Pesnot qui, vraisemblablement, souhaitait le vendre en France lors des Foires du livre lyonnaises. Ces Psaumes sont dédicacés au Roi Jacques VI d'Écosse, ancien élève de George Buchanan. L'imposant volume comprend d'abord une très substantielle Introduction (en anglais et français) concernant l'environnement historique, la biographie de J. Servin, la description matérielle des Psalmi Davidis en 5 Cahiers séparés à raison d'un par voix : superius, contratenor, tenor, bassus, quinta pars (voix ajoutée à certains Psaumes), y compris les lieux de conservation. Tous les cahiers séparés ne nous sont pas parvenus, comme il ressort du Tableau I (p. li) indiquant ceux qui subsistent, avec diverses mentions : emplacement, cahier, provenance, cote, reliure et décoration, foliotage, marques distinctives. James Porter décrit les contextes de leur composition, leur contenu, leur organisation. Il précise la répartition des voix (Tableau II) et donne les modèles métriques exploités par George Buchanan : strophes sapphique, alcaïque, asclépiade ; vers hexamètre, dimètre iambique, entre autres. Sur le plan prosodique, Jean Servin respecte scrupuleusement la quantité des syllabes (longues ou brèves), le rythme et l'accentuation des mots. Il utilise fréquemment les procédés rhétoriques, quelques tournures madrigalesques, la modalité, les techniques du cantus firmus et du faux-bourdon. Ces compositions n'ont pas une finalité fonctionnelle et ne sont donc pas destinées au chant d'assemblée. Comme le conclut James Porter, avec ces Psaumes : « il s'agit d'une œuvre profondément émouvante et qui, de par son caractère humaniste et son habileté artistique, transcende les limites du temps ».
L'essentiel de cette remarquable publication est donc la reproduction des Psaumes, non pas en cahiers séparés et en notation blanche comme dans l'original, mais restitués sur portées (3 à 8 voix). Au gré des Psaumes, Jean Servin fait appel aux entrées successives, imitations, mélismes, notes de passage, au style allégé et, pour une meilleure intelligibilité du texte, au style note contre note, homorythmique et homosyllabique, par exemple à la mesure 47 du Psaume XXI (Domine, in virtute tua selon la Vulgate) : Quod hoste victo rex triumphat selon Buchanan, sur les paroles : Et vota supra et ante vota hunc omnibus… à 3 temps (p. 321). Pour évoquer la joie, il utilise des mélismes expressifs et pratique en général la traduction musicale figuraliste des images et des idées du texte. Ces 772 pages de Psaumes transcrits en notation moderne — si bien gravés et mis en partition par James Porter dans le cadre de la Collection Épitome musical, émanant du Centre d'Études Supérieures de la Renaissance (Université François Rabelais de Tours) — constituent un « monument de la culture huguenote [et humaniste] achevé en des temps agités et dans un contexte qui n'était pas toujours favorable à ce genre de musique ». Les spécialistes de la littérature néolatine du XVIe siècle, les chefs d'ensembles vocaux, choristes, musicologues et théologiens apprécieront à sa très juste valeur cet impressionnant volume (étayé de trois portraits : George Buchanan, King James VI, Simon Goulart ; de pages de titre, dédicace…). Bel exemple d'interaction entre Réforme et Humanisme évoquant une étape particulière de l'histoire des mentalités littéraires et des sensibilités religieuses.

Édith Weber.
***
LE COIN BIBLIOGRAPHIQUE
John Eliot GARDINER : Musique au château du ciel. Un portrait de
Jean-Sébastien Bach (traduit de l'anglais par Laurent Cantagrel
et Dennis Collins), Paris, FLAMMARION (www.editions.flammarion.com ), 2014, 747 p. – 35 €.
Publié en 2013,
sous le titre : Music in the Castle
of Heaven, ce livre est dédié « Aux
compagnons de voyage dans les paysages de Bach ». John Eliot Gardiner —
qui, dès son jeune âge, est fasciné par Bach, contemple deux portraits
authentiques, joue ses œuvres et, par la suite, en tant que chef incontesté,
les inscrira à ses programmes — fait bénéficier son lectorat de sa vaste
érudition, de son esprit d'analyse très poussé et de sa grande intelligence
musicale. Au cours d'un périple dans la longue durée, il transmet aux mélomanes
du XXIe siècle sa passion pour le « cinquième Évangéliste », révèle
le vrai personnage sans complaisance, relate sa vie au quotidien, présente
aussi sa généalogie, évoque ses relations avec ses contemporains (supérieurs
hiérarchiques, compositeurs, élèves…). Grâce à l'exploitation minutieuse de
nombreuses sources authentiques d'archives, l'auteur, d'une manière quasi
fusionnelle, rend Bach toujours actuel et présent, tout en le replaçant dans
l'Allemagne à l'aube du Siècle des Lumières (Aufklärung). Le récit très vivant
décrit le maître dans sa Componirstube
(sic) au milieu de ses outils de travail : pile de papier à musique ;
plume spéciale à cinq becs pour tracer les portées musicales ; plumes de
différentes tailles (plus grandes pour les parties de clavecin), plumes
d'oie ; grattoirs, crayons à papier, couteaux pour les tailler, boîte de
sable pour sécher l'encre. Le processus compositionnel comporte les premiers
jets et les différents stades : inventio, elaboratio et executio. Bach n'est pas épargné par les difficultés
avec les copistes (lenteur, maladresses), par les problèmes de rapports avec
ses poètes et librettistes ou encore l'obligation de respecter strictement le
calendrier liturgique. À sa table de travail, malgré le bruit environnant de la
salle de classe à proximité, le Cantor doit faire preuve de concentration
extrême mais aussi d'économie, vu le coût élevé du papier, toutefois c'est
« l'habitude de la perfection » (p. 577 sq) qui s'impose constamment à
lui.
Ce maître-livre
fournit de précieux renseignements sur les Églises leipzicoises,
lieux de rencontre pour tous les habitants et « lieu central de la vie
sociale » et, entre autres, sur ses principes compositionnels. En fait,
Bach n'est pas que « compositeur d'Église », même s'il ne
s'enthousiasme pas pour « l'opéra sous sa forme conventionnelle ».
John Eliot Gardiner fait observer que le contexte des activités publiques du
Cantor comporte différents aspects : commerciaux, politiques, sociaux et,
bien sûr, liturgiques. L'ouvrage — étayé de nombreux documents et
d'illustrations recherchées et variées : portraits, gravures, lieux,
monuments, lettres, témoignages et même la Bible
d'Abraham Calov (avec traduction allemande et
commentaire de M. Luther), annotée par le compositeur et portant sa signature
en bas à droite — comporte également une indispensable Chronologie et un Index
(noms, occasionnellement matières : formes, œuvres, mouvements d'idées).
Il faut souligner le grand mérite des traducteurs qui se sont attaqués à un
volume imposant (747 p.) et si dense, même s'ils n'échappent parfois pas à
quelques inévitables anglicismes ou « faux amis », par exemple :
famous,
dans ce contexte, signifie « célèbre » (et non fameux) et, « réalisations » conviendrait mieux qu'accomplissement, mais il ne s'agit que
de quelques broutilles par rapport à l'ampleur de leur travail.
En tant qu'homme,
Cantor, Directeur de la Musique, et compositeur, hier comme aujourd'hui, J. S.
Bach s'adresse à un public réceptif ; John Eliot Gardiner, à un public comblé,
car les lecteurs ont vraiment l'impression de vivre dans la sphère du Cantor,
dans sa vie quotidienne professionnelle, scolaire, ecclésiale, familiale ;
d'une page à l'autre, leur curiosité est constamment aiguisée grâce à ce
concentré d'informations exploitées en parfaite connaissance de cause par un
auteur imprégné de la musique de Bach se situant « dans la position
d'exécutant et de chef d'orchestre face à un ensemble instrumental et
vocal ». Un livre « pas comme les autres » et d'une rare
pénétration psychologique.

Édith Weber.
Jean GUÉRARD : Léonce de Saint-Martin à Notre-Dame de Paris (1886-1954), Paris, Les Éditions de l'officine (www.leseditionsdelofficine.com
), 2005, 328 p. 22, 50 €.
La vie de Léonce de
Saint-Martin, jalonnée par de nombreuses difficultés familiales et contrariétés
professionnelles surmontées avec courage, est présentée à l'appui de documents
de première main par Jean Guérard — d'abord maîtrisien, puis élève du célèbre organiste — ayant
participé de près aux diverses activités liturgiques et artistiques à
Notre-Dame de Paris. Il est donc particulièrement qualifié pour rédiger cette
page d'histoire événementielle de Paris, de sa Cathédrale et de Léonce de
Saint-Martin, son organiste actif pendant vingt ans, de 1934 à 1954. Après sa
Licence en Droit, successivement organiste de la Cathédrale Sainte-Cécile à
Albi, dès 1920 suppléant de son maître, Louis Vierne (1870-1937), enfin
organiste titulaire de l'orgue prestigieux de Notre-Dame de Paris, il est
devenu l'un des grands représentants de l'école d'orgue française, à côté de
Marcel Dupré, d'Alexandre Cellier, d'Olivier Messiaen parmi d'autres.
Structuré en deux
parties : « De Sainte Cécile d'Albi à Notre-Dame de Paris » et
« L'organiste et son œuvre », cet ouvrage, de lecture agréable, écrit
en un style alerte, évoque la Grande Guerre et les conditions de travail, le
destin qui se profile, les succès mais aussi les années difficiles (1930-1933)
et surtout les controverses autour de sa nomination en 1937 : pétition des
Amis de l'orgue, lettres, intrigues ; il est alors qualifié de
« petit amateur », « self-made
man », frappé d'ostracisme, mais Georges Migot et Alexandre
Gretchaninov (p. 84) manifestent leur joie et l'assurent de leur soutien.
Léonce de Saint-Martin réagira « en travaillant
d'arrache-pied » : travail technique, le matin ; composition,
l'après-midi. Lors de concerts en France et à l'étranger, il s'imposera comme
« Grand musicien doublé d'un prestigieux organiste » ; la presse
relève ses qualités : « virtuosité éblouissante, maîtrise totale de
son art » (p. 113). Jean Guérard fait allusion à
ses leçons, à ses amis : notamment le Chanoine Roussel, le Pasteur Georges
Marchal, le critique José Bruyr, le compositeur
Georges Migot et, par la suite, François Carbou,
jeune collégien et auditeur assidu. L'organiste de Notre-Dame donnera son
dernier concert à Moulins. Il meurt en 1954, après avoir appliqué le programme
qu'il fixait à ses élèves : « jouer de l'orgue… c'est commenter la liturgie
du haut de la tribune, tout comme un prédicateur le ferait de la chaire »
(p. 121).
La seconde partie
brosse, au chapitre XI, un tableau de la liturgie des dimanches (antérieure au
Concile de Vatican II), comprenant la Messe
basse et la Grand' messe
(solennelle), avec bref prélude, Kyrie,
Sanctus et Agnus en grégorien ou en plain-chant de Henry Du Mont (1610-1684), Credo et Gloria en alternance entre la Maîtrise et le Grand orgue. Les
fidèles chantaient peu. Léonce de Saint-Martin insiste sur le fait que l'orgue
est « au service de l'Église, et non de l'organiste ». En mars 1940,
patriote, il a établi un parallèle entre la Résurrection du Christ et celle de
la France, associé Hymnes sacrées et la mélodie de La Marseillaise. Au fil des pages, le lecteur revit de nombreux
événements : débâcle, occupation… jusqu'au débarquement et le vibrant Te Deum de la victoire. Il assiste à la
genèse de ses nombreuses œuvres de circonstance, de musique pure, de musique
d'orgue pour la liturgie et d'œuvres chorales, y compris des transcriptions. Le
chapitre XIX : « Le lyrisme religieux » évoque son inspiration
mariale et mystique. L'auteur précise que, pour chaque temps liturgique, pour
chaque fête, parfois chaque dimanche, le compositeur formulait un « thème
central » et sélectionnait ses textes à partir de trois critères :
d'ordre musical (enchaînement des tonalités, variété des rythmes et des
registrations…), d'ordre acoustique (en fonction de la dimension de la nef et
de la facture de l'instrument) ainsi que de pratique liturgique, et évitait
« la succession de morceaux courts qui enlèvent
de la grandeur à l'office » (p. 142). Lors des Messes, Vêpres,
Complies, Salut au Saint Sacrement, il improvisait des interludes très
appréciés et « vivait son rôle d'organiste de toute son âme », tirant
le meilleur parti des 90 jeux du célèbre Cavaillé-Coll. À son Catalogue (p. 247 sq.) particulièrement imposant sont jointes la liste des œuvres
pour les Offices de Notre-Dame (conservées à la Bibliothèque Nationale)
classées d'après les temps liturgiques et une Discographie (p. 257 sq.)
signalant, entre autres, des enregistrements (1966, 1972) d'André Charlin.
Chaque chapitre est
suivi d'une Chronologie faisant état
de ses activités extra-liturgiques (récitals, inaugurations, hommages, examens,
conférences…). À la fin du livre, figure un « Cahier Photos » (p. 275
sq.) très révélateur :
lieux, photos de famille, extraits de correspondances, partitions manuscrites,
programmes. Tous ces documents authentiques associés à l'expérience vécue par
l'auteur ayant accompagné son maître pendant de si longues années contribueront
à mieux faire connaître « la vie et l'œuvre de ce musicien hors du commun
qui tint la charge d'organiste avec courage et brio tout au long d'une période
difficile ».

Édith Weber.
Louis SAUVÉ : Émile BOURDON (1884-1974), organiste et compositeur,
Préface de Marie-Claire Alain. Paris, Les éditions de l'officine (www.leseditionsdelofficine.com
), 2004, 342 p. – 22, 50 €.
Le titre
significatif du chapitre IV : « Non à l'oubli !... » est
explicité et réalisé en trois autres chapitres dans lesquels Louis Sauvé situe
son « oncle Émile » par rapport à son environnement familial, à
l'éveil de sa vocation, à ses années d'études au Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris et surtout dans le contexte de la « Belle
Époque », en France et à Monte-Carlo, puis au milieu de ses élèves,
collègues et amis. Le récit de « son neveu », le Docteur Louis Sauvé,
est garant d'authenticité. Il appartenait à la regrettée Marie-Claire Alain de
préfacer cet ouvrage en connaissance de cause, car son père Albert Alain et
Émile Bourdon — condisciples dans la classe d'orgue d'Alexandre Guilmant —
étaient liés par une longue amitié. Elle le qualifie de « grand
artiste », « remarquable compositeur » et « personnalité
marquante de l'école d'orgue française du XXe siècle ».
L'auteur, qui a
regroupé et « restauré » les œuvres du compositeur et organiste, a eu
l'occasion de lui « tirer les jeux » et ainsi d'être témoin de son
évolution artistique. En un style alerte et vivant, il présente cette
monographie qui se lit d'un seul trait, car la curiosité du lecteur est
constamment en éveil. Au fil des pages, Émile Bourdon sera introduit dans son
intimité familiale, ses études au Collège Stanislas, puis au CNSM où il a
brillamment suivi les classes de Charles-Marie Widor, Albert Lavignac, Alexandre Guilmant, Georges Caussade (harmonie,
orgue contrepoint), avant que sa carrière ne soit interrompue par la maladie,
un long séjour en sanatorium et la quête d'une tribune. Finalement,
Charles-Marie Widor et Marcel Dupré réussiront à faire créer le premier poste
d'organiste à la Cathédrale de la Principauté de Monaco où le Prince Albert Ier
le nommera titulaire en juillet 1922. Son Carnet-calendrier et d'autres documents précisent ses
fonctions d'organiste et de maître de chapelle ; le déroulement des
Messes : messes matinales (vers 8 h.), grandes messes (à 9h. 30 ou 10 h.)
entièrement chantées, messes de 11 h… pour des rémunérations ridicules. Il organise
et donne des Concerts, des Récitals radiodiffusés, mène une vie d'organiste au
service d'une Cathédrale « huppée » (p. 63) et attache une grande
importance aux chants liturgiques. Parallèlement, pendant trois ans, il
enseigne au Conservatoire de Nice (harmonie, contrepoint, orgue) et à
l'Académie de Musique de Monaco. Ses activités se situent à une « période
cruciale » de l'Église qui a connu la Séparation de l'Église et de l'État
(1905), puis le Concile de Vatican II (1962-1965), les réformes liturgiques,
mais qui a aussi été une « époque bénie pour les Arts » (p. 77) avec
notamment Igor Stravinsky, Bela Bartok,
Nadia Boulanger, maître de chapelle au Palais de la Principauté…
Ayant bénéficié
d'une éducation dans une famille catholique et aisée, Émile Bourdon, organiste
« profondément chrétien mais sans bigotisme », s'est imposé par sa
vaste culture générale (littérature, histoire, botanique…), mais encore par sa
grande méticulosité et son souci constant de perfection associé à une grande
modestie. Il a côtoyé les grands noms du monde musical et ecclésiastique, par
exemple l'Abbé Henry Carol (futur Chanoine) et a subi « les chamailleries chanoinesques ou grotesques » (p. 187), un organiste de Cathédrale n'étant pas
maître chez lui : il dépend du Chapitre (son employeur) et surtout du
maître de chapelle : voilà sa grandeur et sa servitude. Toutefois, il
bénéficie d'un Orgue Cavaillé-Coll prestigieux, restauré en 1952 par le facteur
Puget de Toulouse, lui permettant de donner de nombreux Concerts et de se livrer
à de mémorables improvisations.
L'importance de son
œuvre a longtemps été ignorée, et c'est le grand mérite de Louis Sauvé d'avoir
regroupé de nombreuses partitions de son oncle, puis, entre autres, de Carolyn Shuster-Fournier, alors jeune organiste et musicologue
américaine intéressée par les œuvres d'Émile Bourdon qu'elle étudia dès
1998 ; d'autres interprètes ont participé à la diffusion et à une
meilleure connaissance de son esthétique. Le Répertoire des œuvres (p. 295-311), présenté dans l'ordre
chronologique, est particulièrement éloquent, de même que la Bibliographie avec des auteurs familiers
(Alexandre Cellier, Norbert Dufourcq, Bernard Gavoty, Félix Raugel…) et les Documents complémentaires sont
particulièrement révélateurs, de même que certains souvenirs anecdotiques pris
sur le vif concernant, entre autres, la vie quotidienne en vacances avec la
famille Alain au chalet de Combloux. De nombreuses citations et photos
agrémentent cet ouvrage dont des titres courants auraient
facilité la consultation. Un Index des
noms aurait encore davantage révélé l'ampleur de son rayonnement. Quoi
qu'il en soit, Louis Sauvé a signé une importante page de l'histoire du XXe
siècle française et monégasque, institutionnelle, artistique et religieuse.
Grâce à l'Association Émile Bourdon (créée en 1999) et à ce remarquable hommage
de son neveu, édité en 2004 — soit 30 ans après la mort de son oncle — :
son œuvre le suivra encore au XXIe siècle : Non à l'oubli !... Oui à la mémoire de cet « artiste qui
a fait le plus grand honneur à la Principauté ».
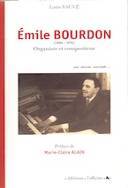
Édith Weber.
Élise PETIT, Bruno GINER : Entartete Musik.
Musiques interdites sous le IIIe Reich, Paris, Bleu Nuit Éditeur (www.harmattan.fr ), Collection : Horizons (n°49), 2015, 176 p. – 20 €.
Sous le IIIe Reich,
l'idéologie nazie s'en est aussi prise à la « musique dégénérée » et
visait les musiciens, compositeurs, chefs d'orchestre, interprètes, éditeurs,
metteurs en scène, comédiens, chanteurs, poètes, acteurs, journalistes
d'origine juive ou étrangère, ceci au nom de la « pureté de la
race ». Le régime soutenait la tradition musicale allemande et rejetait
entre autres le jazz, le cabaret, certaines chansons, l'atonalité et,
évidemment, la musique non-allemande. Cet ouvrage, bien documenté, dresse,
exemples à l'appui, un bilan concernant cette pénible période de l'histoire
musicale allemande. Les auteurs évoquent d'abord le contexte historique et
politique sous la République de Weimar. Toutefois, dès 1920, un nouveau parti
émerge : le NSDAP (Parti national socialiste des travailleurs allemands)
dont Adolf Hitler prendra la direction. À cette époque, les « Années de
Weimar » connaissent un « foisonnement musical » autour de Max
Reger, Hans Pfitzner… dans le sillage de l'art académique et postromantique.
Berlin devient un centre important et accueille les cubistes, futuristes et
expressionnistes autour de Jascha Horenstein,
Hans Eisler, Hans Heinz Stuckenschmidt ainsi que des
membres du mouvement Dada (Zürich). Les grands orchestres sont dirigés par des
chefs prestigieux : Bruno Walter, Karl Böhm, Hermann Scherchen, Fritz Busch, entre autres. Toutefois, le Parti communiste
s'efforce de raviver la notion de classe
et veut choquer « le bourgeois ». La voie est alors ouverte à l'art
prolétarien et au chant de combat. Par ailleurs, la musique atonale,
dodécaphonique et sérielle est pratiquée par les disciples de Schönberg :
Alban Berg et Anton Webern. Les compositeurs spéculent aussi sur les
intervalles plus petits que le demi-ton. Lors de la République de Weimar, vers
1920, les jeunes apprécient dans les cafés, cabarets et dancings, le foxtrot,
le charleston ; la musique américaine est importée dans les spectacles de
divertissement et le jazz influencera la musique savante. La « Nouvelle
objectivité » (Neue Sachlichkeit)
réagit contre la subjectivité romantique du XIXe siècle et l'expressionnisme
des années 1920. Parmi d'autres tendances, la Gebrauchsmusik (musique utilitaire, fonctionnelle), la
musique d'accompagnement de films, le Zeitoper (Opéra d'actualité) coexistent. À partir de 1933 —
année fatidique —, comme l'esthétique
académique « ne rime donc pas obligatoirement avec l'idéologie
nazie », mise au pas, censure et répression s'instaurent et de nombreuses
œuvres, par exemple de Paul Hindemith, seront interdites. Puis les mesures
d'épuration s'accélèrent. Goebbels, chef de la propagande, entretient la
terreur, supprime la liberté d'expression et la liberté de la presse. Des
listes noires de personnalités du monde littéraire, artistique et journalistique
sont établies. Les Nazis ont pour objectif de « sauvegarder l'esprit
allemand et la langue allemande ». Pour eux, il s'agit donc d'épurer les
fonds de bibliothèques et de faire disparaître des ouvrages « nocifs et
indésirables ». Des tonnes de livres seront brûlées, par exemple de Stefan
Zweig, Bertolt Brecht…
Après un aperçu des
institutions culturelles instaurées par le régime nazi, les auteurs consacrent
entre autres un chapitre à l'épuration des musiques
dégénérées (entartete Musik), d'après le titre de l'Exposition
(Munich, 1937), avec des artistes décrétés décadents
et dégénérés tels que Paul Klee, Vassily Kandinsky, Marc Chagall… qualifiés d'« esprits
malades et malsains ». Des Revues musicales seront aussi attaquées,
l'objectif étant de forger une musique « purifiée ». Il s'agissait
donc de « nazifier » la musique (cf.
Chapitre 6) et de maintenir certains compositeurs comme, par exemple,
Wagner, musicien « populaire » qui aurait puisé son inspiration dans
le « sang et le sol germaniques » et qui s'adresse à l'âme allemande.
Anton Bruckner, bien qu'autrichien, représente précisément l'âme allemande par
le truchement d'éléments populaires et folkloriques introduits dans sa musique.
Parmi les autres compositeurs mis à l'honneur par le régime, figurent J. S.
Bach, Franz Schubert, Robert Schumann, Max Reger, également Hans Pfitzner
(1869-1949), « antisémite farouche et opposant parmi les plus agressifs à
la modernité en musique », auteur de la Cantate Von deutscher Seele
(1921) exaltant l'âme germanique. Vers 1936, à l'occasion des Jeux Olympiques,
l'Allemagne assiste à un renouveau de la création musicale destinée évidemment
à promouvoir les idées nazies et la grandeur du Reich. D'autres noms sont
retenus : Carl Orff, Werner Egk, Ernst Pepping ;
Richard Strauss et Hans Pfitzner figurent sur la « liste spéciale des
artistes irremplaçables ». L'Opéra, vecteur de propagande, sera également
nazifié en prônant le héros national-socialiste, l'honneur, l'amour et le
sacrifice pour la Patrie. Dès 1934, des représentations ont lieu à la Volksoper (Opéra
populaire) de Berlin. À noter la création de l'hymne national : le Horst Wessel Lied
qui, après le Procès de Nuremberg, sera interdit en 1945. Le chapitre 7,
particulièrement révélateur, retrace « quelques parcours de compositeurs
dégénérés » dont un grand nombre a été déporté ou a dû fuir l'Allemagne.
Il s'agit de compositeurs juifs, communistes, modernes, étrangers emprisonnés
ou partis en exil. C'est le cas notamment des « modernistes » :
Paul Hindemith, exilé en Suisse et aux États-Unis dès 1938 ; Anton Webern,
en exil « intérieur » à Vienne ; Ernst Krenek, exilé aux
États-Unis en 1938 ; des « juifs modernistes » : Alexander von Zemlinsky exilé aux États-Unis en 1938 ; Arnold
Schönberg, exilé dès 1933 en France et aux États-Unis ; Ernst Toch, exilé dès 1933 en Angleterre et aux États-Unis ;
Pavel Haas, déporté en 1941 et mort à Auschwitz en 1944 ; des « juifs
modernistes politiques » : Hanns Eisler,
exilé en 1933 en Europe et aux États-Unis, Louis Saguer
(assistant de ce dernier), exilé en France en 1933, Kurt Weill, représentant
emblématique de la modernité weimarienne, exilé en France — où il sera
accueilli par la Princesse de Polignac — et en Suisse dès 1933, et tant
d'autres compositeurs…
Le livre, à l'appui
d'une remarquable documentation, est très révélateur des partis-pris
esthétiques et idéologiques sous le IIIe Reich. Il
évoque un très regrettable passé de l'histoire de la musique allemande, mais
ces compositeurs prétendus « dégénérés » ont réussi à l'étranger et
ont laissé des œuvres remarquables. Cette compilation révélant des compositeurs
interdits est accompagnée d'un Tableau synoptique : Événements historiques du IIIe Reich ; Musique &
musiciens ; Repères artistiques ; Repères historiques très éclairant,
d'une Bibliographie sélective
indispensable à la compréhension du caractère idéologique ainsi que d'une Discographie sélective. Les auteurs
concluent ainsi : « Il semble aujourd'hui indispensable (…) de relier l'éclectisme de la création musicale qui prévaut en
ce début de XXIe siècle à celles des directions multiples et kaléidoscopiques
de la République de Weimar et de sa richesse culturelle tuée dans l'œuf. »
(p. 162-163). Dont acte.

Édith Weber.
Jean-Luc
Caron, Carl Nielsen, Paris, 1 vol Bleu Nuit
Éditions, 2015,178 p, 20€
À Jean-Luc Caron, spécialiste sans rival en
France de la musique scandinave, nous devions déjà de nombreuses études sur
Grieg, Sibelius ou Nielsen, le plus souvent sous forme d'articles destinés à
l'excellente revue du Net, ResMusica. Dans ce dernier
ouvrage, reprenant, peaufinant et complétant ses acquis, il nous offre la
monographie, depuis si longtemps méritée, du grand compositeur danois Carl
Nielsen (1865-1931). Singulier destin que celui de cet enfant qui, né dans un
milieu modeste où la carrière musicale n'était pas de mise, sut pourtant se
hisser, par l'exercice d'une volonté sans faille et grâce à des dons hors pair,
au statut de grand musicien. C'est au sein du vaste courant nationaliste de la
fin du XIXe siècle, à la suite donc des glorieux exemples de l'Italien Verdi,
de l'Allemand Wagner, du Russe Tchaïkovski, et parallèlement à ceux du
Norvégien Grieg ou du Finlandais Sibelius, que s'inscrit le destin artistique
du chantre danois. Indépendamment de la sûreté de la documentation et de la
qualité de l'analyse, le livre de Jean-Luc Caron vaut par le souffle
vigoureusement romanesque que l'auteur confère à sa chronique. La chronique
d'un garçonnet aux dons surprenants mais tardivement exploités, aux capacités
musicales évidentes mais lentes à s'approfondir, à l'enfance pauvre mais non
dénuée de lumineux moments de bonheur. Peut-être, pour promener le miroir du
romancier au long de cette destinée, fallait-il un auteur, musicologue et
médecin, qui, en d'autres temps, sur d'autres terres, avait approfondi une
pénétrante réflexion sur la vie, la mort, la si difficile accession au bonheur…
(Mort et bonheur, Paris, 1981). C'est ainsi que, sous la plume de Jean-Luc
Caron, le petit aspirant à la musique militaire parcourt ce stupéfiant cycle de
métamorphoses qui, de la ferme familiale au Conservatoire de Copenhague, de la
salle de concert du parc Tivoli aux plus prestigieux auditoriums du monde,
finit par lui assurer une gloire internationale à laquelle rien n'avait pourtant
semblé l'appeler. Danois tendant à l'universel, classique épris de modernité,
humaniste sans illusions, Car Nielsen est surtout célèbre pour ses concertos et
ses symphonies ; on en trouvera, dans ce livre, une convaincante
présentation, à mi-chemin entre analyse intuitive et commentaire savant. Mais
dans son pays, c'est surtout par sa saisissante production vocale (dont l'opéra
Maskarade) que Nielsen reste ancré dans toutes
les mémoires. De cette singulière dichotomie, l'auteur rend compte au prix d'un
balancement dialectique dont on ne saurait trop louer la pertinence et
l'efficience. Fidèle à l'esprit de la collection Horizons, cet ouvrage propose
enfin le catalogue du compositeur, un tableau synoptique le situant en son
siècle, appareil documentaire complété par une orientation bibliographique et
une sélection discographique incitant à la découverte sonore d'une contribution
majeure à l'histoire musicale du monde.

Gérard Denizeau.
Richard
WAGNER. L'Anneau
du Nibelung. Traduction d'Henri Christophe. 1 Vol Symétrie, 2015,
403 p. 13,80€.
Les opéras de Richard Wagner ont longtemps
été donnés en France dans leur version française s'appuyant sur des traductions
souvent fantaisistes justifiant ce jugement de Romain Rolland :
« Elles ne sont ni françaises, ni même intelligibles dans aucune
langue ». Jugement sévère s'il en est, pourtant non exempt de vérité, à
l'origine de nombreux malentendus concernant la personnalité et l'œuvre du
maître de Bayreuth. La première
exécution intégrale de la Tétralogie
en France aura lieu à l'Opéra de Lyon en Juin 1911 dans une traduction qui
« sonne allemand » et néanmoins très discutée d'Alfred Ernst,
qualifiée de charabia par Saint- Saëns. Quelques
années plus tard Jacques d'Offoël, en 1905, réalise
sa propre traduction en dehors de toute perspective scénique. médée et Frida Boutarel
proposent également leur version, en 1914, où semblent prévaloir simplicité du
discours et respect de l'intégrité musicale. Ainsi se pose de façon
particulièrement claire la question de la légitimité de la traduction, et par
là même, la question du public à qui elle s'adresse, ainsi que celle du support
auquel elle est destinée. Henri Christophe, à travers cette traduction, se
propose de retrouver l'écriture obsessionnelle, pulsionnelle qui fait fi du
mètre, des vers et des rimes pour retrouver la prosodie sauvage, chaotique et
anarchique originelle du texte wagnérien, hérité de la Edda scandinave. Cette traduction, datant de 1991, a été réalisée à
l'occasion de la diffusion par la télévision franco-allemande (Arte) de la
fameuse Tétralogie donnée à Bayreuth
en 1976 (Boulez/Chéreau) à l'occasion du centenaire du festival. Il s'agit donc
d'une version élaborée pour la lecture et non pour le chant, pour l'écran de
télévision et non pour la lecture livresque, pour l'image télévisuelle et non
pour le surtitrage théâtral, au mieux pour un public
bilingue capable de « reconnaitre l'original qu'il entend à partir de la
traduction simultanée qu'il lit( !) ». Tout cela répondant, par
ailleurs, à un nécessaire impératif de concision où le discours est riche de
tout le jeu de scène, rendant inutile toute didascalies. D'un point de vue
formel, le langage wagnérien utilise le vers iambique, non utilisé en métrique
française, préférant toutefois à la rime peu nombreuse, l'emploi abondant
d'assonances et d'allitérations pour une prosodie très rythmée et d'emblée
mélodieuse, dans un discours souvent elliptique mêlant prolepses et analepses. Une traduction qui répond à ces impératifs et
qui, au-delà du mot, cherche à retrouver le rythme et les émotions du poème
wagnérien d'origine, et ce n'est pas là le moindre de ses mérites.

Patrice Imbaud.
Cécile Auzolle : Vers l'étrangeté, ou l'opéra selon Philippe Boesmans. 1 vol Actes Sud, 2014, 349p, 23€
Philippe Boesmans
(*1936) est une des figures les plus attachantes de la scène lyrique actuelle.
La création française, fort applaudie, de son septième opus Au Monde, à
l'Opéra Comique en février dernier (cf. NL de 3/2015) rappelle opportunément
pourquoi. Le succès de la musique de Boesmans tient à
son accessibilité, car « son art intègre les conventions de l'art lyrique
dans une écriture souple privilégiant le confort des chanteurs pour favoriser
leur investissement théâtral » (p.214). Il n'appartient à aucune école,
mais semble se nourrir de bien des influences. Son attirance pour la vocalité
le distingue de ses collègues. Ses personnages sont d'ailleurs écrits pour des
voix particulières (Mireille Delunsch, la reine
Marguerite de Yvonne, princesse de Bourgogne, Patricia Petibon, La Deuxième Fille de Au Monde). Il pense
théâtre plus que bel canto. C'est que le compositeur belge prend toujours pour
point de départ le théâtre, Shakespeare pour Wintermärchen
(Contes d'hiver), Witold Grombowicz
pour Yvonne princesse de Bourgogne, August Strindberg dans le cas de Julie,
et Joel Pommerat et sa
pièce Au Monde. La rumeur dit qu'il s'intéresse maintenant à Feydeau...
C'est en 1983 que se produit le basculement et qu'il se prend de passion pour
un genre qu'il croyait, comme beaucoup alors, voué à une mort certaine. Le
livre de Cécile Auzolle est précisément conçu comme
un opéra dont chacun des actes révèle une étape d'un cheminement peu commun. Si
l'auteure interroge l'intéressé, elle fait aussi parler ceux qui dans son
entourage, ont eu un rôle essentiel. Boesmans est
remarqué très tôt par les grands décideurs du monde lyrique, de La Monnaie de
Bruxelles en particulier, où seront créés la plupart de ses ouvrages scéniques
: Gérard Mortier, Bernard Foccroule, Peter de Caluwe. Quoique ce soit une rencontre avec Patrice Chéreau
qui ait été l'étincelle. L'acte Ier voit la création de La Passion de Gilles
(La Monnaie, 1983), pas précisément le type de sujet recommandable, mais
une œuvre écrite de telle façon qu'elle questionne et finit par retenir
l'intérêt. A l'acte II, apparaît un personnage qui va jouer un rôle
déterminant, Luc Bondy (*1948), un homme de théâtre ; car « comment
travailler à un opéra, aventure multidisciplinaire s'il en est, sans avoir une
bonne connaissance de ces disciplines ? » (p.173). La rencontre avec
Mortier avait été décisive. Elle continuera de porter ses fruits, même après
qu'il eût quitté La Monnaie pour le Festival de Salzbourg. Son successeur
Bernard Foccroule lui commande Reigen
(La Ronde), d'après Schnitzler, qui marquera le début de sa tenure à
Bruxelles, en 1993. Le rôle assigné à l'orchestre s'affirme. L'acte III,
« le plus boesmanien », selon l'auteure,
voit la création, en 1999, de Wintermärchen (Contes
d'hiver), puis de Julie (2005), à Bruxelles puis ensuite à Aix.
Julie ou « la revanche de Iokanaan », car
« Salomé hante Julie » : comme le
fille de Judée, Julie est la proie de Jean, et les protagonistes de l'opéra de
Strauss/Wilde apparaissent en filigrane dans l'œuvre de Boesmans,
qui sera mise en scène par Bondy. Avec l'acte IV, l'auteure souligne combien le
souci du public est une priorité pour le compositeur, le fait d'être compris.
Pourtant Yvonne, princesses de Bourgogne (2009, Opéra Garnier) livre un
théâtre « de grâce et d'étrangeté ». Le deuxième tableau de cet acte,
en cours d'élaboration, sera Au Monde
(2014, Bruxelles) qui s'inscrit dans le pensée théâtrale si particulière de Pommerat, un huis cols familial avec un substrat de mystère
insondable comme chez Maerterlinck. « L'opéra
doit être un peu étrange, les situations, pas trop. Car c'est l'étrangeté qui
donne la poésie à la vie », résume Boesmans à
l'épilogue de cette présentation de son œuvre opératique ! Ce livre se lit avec
plaisir non seulement parce qu'il est bien écrit, et qu'il retrace l'histoire
de trois décennies de musique d'opéra, un genre qui ne s'est jamais si bien
porté, mais d'abord parce qu'il relate sans fard les préoccupations d'un homme
sincère qui aime mettre en musique le théâtre, nul doute de la vie.

Jean-Pierre Robert.![]()
***
LE BAC DU DISQUAIRE
Georg Philipp TELEMANN : Ouvertures & Concerti pour Darmstadt. Zefira Valova, violon. Les Ambassadeurs, flûte & dir. Alexis Kossenko. 1CD ALPHA. Distribution OUTHERE MUSIC (www.outhere-music.com ) : ALPHA 200. TT : 70' 07.
Alexis Kossenko et l'Ensemble « Les Ambassadeurs » ont regroupé des chefs-d'œuvre de Georg Philipp Telemann (1681-1767), né à Magdebourg 4 ans avant Jean Sébastien Bach et mort à Hambourg 17 ans après lui. Ce bel hommage, comprend l'Ouverture pour 2 cors de chasse, 2 hautbois, Dessus, Haute-Contre, Taille, Basson e Basse (TWV 55:F3), avec un titre français et la mention : « Par Mons. Telemann », en 8 mouvements : Ouverture très développée et Fanfare encadrant des danses : Rondeau, Sarabande, Menuet, Gigue… Les instrumentistes réussissent à différencier les atmosphères de ces pièces, tour à tour, enlevées, bien rythmées ou méditatives. Dans cette œuvre, les hautbois sont très sollicités, mais jamais au détriment de l'ensemble. Le Concerto pour violon en la mineur (TWV 51:a1) est prévu pour un violon (concerto), deux violons (ripieno), une viole et un violone. Il est de structure tripartite : Adagio, Allegro-Adagio et Presto. L'interprétation s'y distingue par son expressivité. Il est suivi par le Concerto pour flûte traversière en Ré majeur (TWV51:D1) en 4 mouvements contrastés : Lent-Vif-Lent-Vif, tour à tour nostalgique ou énergique. Celui pour flûte traversière et violon en mi mineur (TWV52:e3), en 4 mouvements brefs, permet d'opposer, d'une part, les sonorités de la flûte traversière, du violon concertant et, d'autre part, celles du concerto grosso avec clavecin. Zefira Valova, violon solo, joue un instrument de Tomaso & Lorenzo Carcassi (Florence 1760) et Alexis Kossenko, flûte traversière, une copie de flûte de J. J. Quantz (Potsdam 1740) par Martin Wenner. L'Ensemble « Les Ambassadeurs » convie les auditeurs et discophiles à un festival de sonorités et une musique fort agréable à entendre. Il s'affirme comme un vrai sélectionneur et un remarquable ambassadeur de chefs-d'œuvre de Telemann.

Édith Weber.
Jean Sébastien BACH : 6 Suites a violoncello solo, Sonate à cembalo è viola da gamba, Wieland Kuijken, viole de gambe. 3CDs ARCANA. Distribution OUTHERE MUSIC (www.outhere-music.com ) : A 383. TT : 3h 30.
Wieland Kuijken, Premier Prix de Violoncelle du Conservatoire de Bruxelles (1962) et gambiste, poursuit sa carrière dans différents ensembles belges et, depuis 1988, est directeur du Collegium Europae. Il se produit sur des instruments historiques : Violoncelle attribué à Andrea Amati et Basse de viole Nicolas Bertrand (v. 1705) ou modernes, tel que Violoncelle piccolo (Tokyo, 2001). Comme il le relève (en 2015) : « les Suites pour violoncelle seul accompagnent toute la vie d'un violoncelliste, depuis le temps de ses études. Personnellement, je les ai travaillées au Conservatoire, bien sûr, mais je jouais déjà de la viole de gambe que j'ai toujours pratiquée, notamment dans l'Ensemble Alarius que nous avions fondé à Bruxelles. » Après avoir donné quelques précisions organologiques sur l'instrument dû à Andrea Amati et d'ordre terminologique, il signale que cela lui a pris plus de trente ans [sic] pour se familiariser avec ce violoncelle et qu'il « ignore complètement comment Bach ou tel ou tel de ses interprètes pouvaient jouer ces Suites, comment lui-même pouvait vouloir qu'on le joue ». Bach, alors Konzertmeister à la Cour de Cöthen, a composé, entre autres, ses 6 Suites pour violoncelle seul à l'époque des 6 Concertos brandebourgeois. L'ancienne viole de gambe, commençant à disparaître, a été relayée par le violoncelle à ses débuts. Bach y perçoit immédiatement un intérêt pédagogique et recherche les possibilités polyphoniques et expressives de cet instrument. D'abord perdues puis recopiées, ces « Suites a Violoncello Solo senza Basso » (BWV 1007-1012) n'ont pas été éditées avant le début du XIXe siècle. Elles reposent traditionnellement sur des danses : Allemande, Courante, Bourrée, Sarabande, Gigue… Certaines ont subi l'influence française et notamment celle des luthistes. Pour attaquer ces œuvres si redoutables, l'instrumentiste doit faire preuve d'une parfaite maîtrise technique — y compris celle de l'archet —, soigner tout particulièrement la qualité du son et du timbre, le phrasé, la respiration et la conduite polyphonique. Il doit, bien entendu, avoir assimilé le discours musical et rhétorique de cette musique abstraite et absolue, nécessitant une grande force de concentration. Par son jeu extrêmement raffiné mettant notamment en valeur les contrastes entre consonances et dissonances, par son intelligence musicale, cette version des Suites pour Violoncelle seul force l'admiration. En outre, Wieland Kuijken interprète — à la viole de gambe et soutenu par Piet Kuijken au Clavecin Anthony Sidey (Paris 1995) — les Sonates en Sol Majeur (BWV 1027), Ré Majeur (BWV 1028) et sol mineur (BWV 29). 3 CD, 3 heures trente minutes de musique, 6 Suites et 3 Sonates : quelle inégalable performance personnelle, mais aussi familiale…

Édith Weber.
Jean Sébastien BACH : Musikalisches Opfer. Ensemble Aurora. 1CD ARCANA. Distribution, OUTHERE MUSIC (www.outhere-music.com ) : A 384. TT : 62' 20.
L'Ensemble Aurora — qui, pour ce CD, regroupe E. Gatti (violon et maestro di concerto), Marcello Gatti (flûte traversière), Gaetano Nasillo (violoncelle) et Guido Morini (clavecin) : soit 4 instruments aux sonorités diversifiées — interprète d'abord une des œuvres instrumentales les plus célèbres de Jean Sébastien Bach : L'Offrande musicale - Das musikalische Opfer (BWV 1079). Sa genèse est bien connue : au printemps 1747, Bach rend visite à son fils Carl Philipp Emanuel engagé à la Cour de Frédéric II. Jean Sébastien demande au souverain, excellent flûtiste et mélomane averti, de lui donner un thème sur lequel il improvisera des ricercar, canons et sonate. L'œuvre, selon la rhétorique en usage, est structurée en 4 parties : 1. Préambule I (Exordium I) suivie d'une brève narration (Narratio brevis) 2. Longue narration (Narratio longa), puis conclusion (Egressus) 3. Préambule II (Exordium II Insinuatio) avec Argumentation : preuve et réfutation (Argumentatio : Probatio ac Refutatio) 4. Péroraison (Peroratio…) en guise de conclusion. Pour élaborer cette Offrande, Bach fait appel à plusieurs principes compositionnels et formes : ricercar à 3 et 6 voix (recherche tributaire du procédé de l'imitation), canons à 2 et 4 voix sur le thème royal selon différentes techniques : par mouvement rétrograde, cancrizans (à l'écrevisse), par mouvement contraire, par augmentation ; il compose également une Fugue canonique à la quinte (epidiapente). La Sonate sur le sujet royal pour flûte traversière, violon et continuo est structurée en 4 parties, faisant alterner mouvements lents expressifs et mouvements vifs bien enlevés (selon l'esthétique italienne). Les discophiles trouveront les commentaires percutants de Gilles Cantagrel qui signale que : « En tête de l'œuvre, une inscription latine manuscrite donne le titre du premier morceau en même temps qu'elle indique sans ambiguïté l'objet de l'œuvre entière : Regis Iussu Cantio Et Reliqua Canonica Arte Resoluta (Morceau réalisé par ordre du roi, et autres morceaux résolus suivant l'art du canon) ». Cette inscription forme en acrostiche le mot R I C E R C A R. L'enregistrement comprend en outre la Sonate en Sol Majeur pour violon et basse continue (BWV 1021) et la Sonate en Trio en Sol Majeur pour flûte, violon et basse continue (BWV 1038). Contrairement aux effectifs habituellement plus étoffés, l'Ensemble Aurora s'impose par sa transparence et son sens de la construction avec des entrées canoniques précises. Sa réalisation pour 4 instruments aux sonorités bien différenciées propose une autre écoute de l'Offrande musicale. Royal.

Édith Weber.
« Pianoforte italiano ». Adalberto Maria Riva, piano. 1CD VDE GALLO (www.vdegallo.ch ) : CD 1456. TT : 62' 46.
Cette réalisation concerne la musique italienne du XVIIIe siècle à la fin du XXe siècle. Le pianiste milanais Adalberto Maria Riva, virtuose, soliste international, lauréat de plusieurs Concours internationaux, conférencier et enseignant, s'adapte à tous les styles. Il interprète des formes traditionnelles : les Sonates en ré mineur (K 9) et en Sol Majeur (K 201) de Domenico Scarlatti (1685-1757) ; la Sonatina canonica sui Capricci di Paganini composée par Luigi Dallapiccola (1904-1975) ; la Toccata en La Majeur de Domenico Paradisi (1707-1791). Figurent également au programme des Danses : Italienne et Sicilienne d'Ottorino Respighi (1879-1936), d'après d'anciennes pièces pour luth ; les Preludi autunnali de Gian Francesco Malipiero (1882-1973), en 4 mouvements contrastés de caractère très varié : caressant : Lento, ma carezzevole ; jovial : Ritenuto, ma spigliato ; méditatif et triste : Lento, triste ; rapide : Veloce. Il s'impose comme un parfait virtuose dans la redoutable étude de bravoure La Roche du Diable d'Adolfo Fumagalli (1828-1856). Le remarquable pianiste a sélectionné un piano à queue Fazioli qui se distingue par sa grande puissance sonore, son équilibre. L'enregistrement (juillet 2013) bénéficie de l'acoustique exceptionnelle du Théâtre municipal de Cassano Valcuvia (Lombardie). Au cours des 18 pièces, l'interprète fait preuve d'une excellente sonorité, d'une remarquable maîtrise technique : traits brillants, précision d'attaque, transparence, nuances. Il restitue aussi bien l'énergie et l'élan requis que l'expressivité et l'émotion dans les mouvements lents.

Édith Weber.
« Musique romantique d'Italie ». Jean-Claude Bouveresse, violon, Bénédicte Péran, piano. 1CD VDE GALLO (www.vdegallo.ch ): CD 1365. TT : 66' 24.
Réalisée par Jean-Claude Bouveresse, Premier Prix de violon du Conservatoire Royal de Bruxelles qui joue sur un violon de Francesco Ruggieri (école de Crémone, 1673) et Bénédicte Péran, diplômée du même Conservatoire, cette petite Anthologie offre un aperçu de musiques pour violon et piano composées au XIXe siècle ainsi qu'un arrangement d'Ottorino Respighi (1879-1936) de la Sonate en Ré Majeur d'Antonio Vivaldi (1678-1741), en 4 mouvements : Moderato-Allegro moderato-Largo-Vivace, baignant dans une atmosphère assez romantique.La Sonate en Fa Majeur de Gaetano Donizetti (né à Bergame en 1797 et mort dans cette ville en 1848) — musicien prolifique surtout célèbre pour ses opéras, marquant le début de la musique romantique en Italie — comprend deux mouvements : Maestoso très expressif contrastant avec un Allegro pétillant. Celle en mi mineur, op. 55, d'Antonio Bazzini (né à Brescia en 1818-mort à Milan en 1897) — surtout connu comme étant l'un des meilleurs violonistes de concert de son temps, influencé par Paganini — frappe par le caractère bien enlevé de l'Allegro, expressif de l'Andante et très vif du Finale. Enfin, la Sonate n°1 en mi mineur op. 29 de Ferrucio Busoni (1866-1924), composée à l'âge de 24 ans, comporte un mouvement central encadré par deux Allegro énergiques. Cette réalisation se termine aux accents de la Gondoliera, op. 29 (1894) pour violon et piano de Giovanni Sgambati (né à Rome en 1841-mort dans cette ville en1914), pianiste virtuose, chef d'orchestre de réputation internationale. Cet élève et ami de Franz Liszt (dont il a dirigé des œuvres) a subi l'influence de la musique romantique allemande. Les deux interprètes spéculent sur son caractère chantant et berceur ; le violon se distingue par une extrême justesse, une belle sonorité n'excluant pas les coups d'archet énergiques ; le piano assurant l'assise rythmique avec des accords percutants, assume à la fois un rôle d'accompagnateur et de soliste dans les transitions et commentaires préparant l'entrée du violon. Tous deux font preuve d'un solide sens de la dynamique, de l'équilibre et d'un bel esprit d'équipe.

Édith Weber.
Robert STARK / W. A. MOZART : Quintettes, Serenade, Danses, Pièces lyriques pour ensembles de clarinettes. Stak Ensemble. 1CD VDE GALLO (www.vdegallo-music.com) : GALLO CD 1425. TT : 48' 30.
Pour le Stark Ensemble — constitué de musiciens italiens : Luigi et Laura Magistrelli (clarinettes en Si b), Carlo Dell'acqua et Remo Pieri (Cor de basset), Fausto Saredi (clarinette basse), de réputation internationale —, Robert Stark a, en première partie, réalisé quelques arrangements d'œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), notamment des mouvements lents particulièrement expressifs dont le paysage sonore pourrait surprendre certains puristes. La seconde partie comprend, uniquement pour clarinette et piano (Claudia Bracco), des pièces lyriques telles que Ständchen (Sérénade), Wünschen (Vœux), Botschaft (Message)…, ainsi qu'une Valse Caprice pour Quatuor de clarinettes. Un programme certes inattendu à écouter par et avec curiosité.

Édith Weber.
Émile WALDTEUFEL : Valse avec les Impressionnistes. Dominique My, Ensemble Fa. 1CD JADE (www.jade-music.net ) : 699 859-2. TT : 64' 19.
Émile Waldteufel (alias Charles Émile Lévy Waldteufel), né en Strasbourg en 1837, élève du Conservatoire de Paris, contemporain de Jules Massenet et Georges Bizet, a été Directeur de la musique de danse de la Cour impériale de Napoléon III et pianiste attitré de l'Impératrice. Il est mort à Paris le 12 février 1915. Ses Valses, qui ont remporté un grand succès aussi bien à Paris qu'à Londres et Berlin, ont marqué la Belle Époque. Émile Waldteufel les compose généralement d'abord pour piano, toutefois Paul Méfano (né en 1937) les a orchestrées pour une formation originale : 2 violons, alto, violoncelle, flûte, clarinette, piano et accordéon, ce qui permet d'éviter les lourdeurs des versions symphoniques traditionnelles, et il en a confié l'interprétation à Dominique My et l'Ensemble Fa. Ses versions sont marquées par une certaine modernité qui ne nuit pas à la facture mélodique, à l'élan ou encore à l'atmosphère sentimentale. Qui ne connaît pas la Valse Les patineurs (1882) d'ailleurs reprise pour illustrer de nombreux films ? L'enregistrement comporte également Amour et printemps, Roses et marguerites, Les sirènes, la Valse de la poupée, Les violettes et Madeleine interprétées avec plus de finesse et de dépouillement que d'habitude. Les œuvres du « Strauss français », avec son sens de la mélodie dans le sillage de Charles Gounod ou encore de Georges Bizet, symbolisent toute une époque de salles de bals, de bals en plein air ou de salons privés. Au XXIe siècle, cette version rafraîchie sera encore appréciée des danseurs et mélomanes.

Édith Weber.
Gabriel MARGHIERI : Par-dessus l'abîme. Marie Eumont, Catherine Roussot, sopranos, Isabelle Deproit, mezzo. Ensemble vocal du CNSMD de Lyon, Chœur Atelier. 1CD VDE-GALLO (www.vdegallo-music.com) : CD 1444. TT : 72' 24.
Gabriel Marghieri (né en 1964) — élève du Chanoine Henry Carol (Monaco), de René Saorgin, Marie-Claire Alain, Premier Prix d'Orgue du CNSM, compositeur, soliste de réputation internationale — précise la genèse de son œuvre Par-dessus l'abîme, en ces termes : « Le Cardinal [Barbarin] m'avait demandé d'écrire une œuvre qui marquerait le début de la troisième année 2011-2012, celle de l'esprit. » Il définit ainsi sa motivation : « Plutôt que de chercher à écrire une histoire sacrée ainsi que font nombre d'oratorios (Israël en Égypte…, Paulus, Le Messie, les différentes Passions, Jeanne au Bûcher…), j'ai opté pour une sorte de parcours spirituel, parcours qui ne serait pas obligatoirement celui d'un saint ou d'un héros de la Chrétienté, mais qui pourrait être celui de tout un chacun, le vôtre, le mien ». Il souligne que « l'itinéraire ira du doute ou de la révolte devant Dieu qui semblera, au choix, absent, incompréhensible ou lointain, jusqu'à la paix apportée par le Christ lors de sa Passion et de sa Résurrection en passant par les pierres d'achoppement inévitables que sont, dans toute existence humaine, l'amour, l'absence, le mal, la souffrance… Ainsi le corps, l'âme, l'esprit seront concernés tour à tour ou bien ensemble ».
Pour ce faire, il a judicieusement sélectionné des textes marquants de Rainer Maria Rilke (1875-1926), André Suarès (1868-1948), Paul Claudel (1868-1955), Jules Supervielle (1884-1960), Charles Péguy (1873-1914) entre autres, mais aussi Saint Augustin (354-430). Il fait appel à un chœur, à deux récitants, à un ensemble instrumental original : piccolo, flûte, hautbois, clarinette, saxhorns ténors, tubas (basse et contrebasse), harpe, piano, orgue, percussions, sans oublier quelques bruits de la nature : orage, galets entrechoqués, appels d'oiseaux… et y ajoute « la nature et son prolongement symbolique dans le spirituel ; les beautés de la Création, dans lesquelles trouver les signes du divin et des raisons d'émerveillement, par exemple le thème de l'eau qui irrigue tout l'ouvrage ». L'ambitus va du tuba contrebasse jusqu'au piccolo auxquels sont associées les voix si agréables des Récitants : Clémentine Allain et Damien Robert. L'attention des auditeurs est constamment sollicitée par cet environnement sonore exceptionnel, mais aussi par la signification intellectuelle et spirituelle des textes. La démarche esthétique, particulièrement intéressante, porte bien la marque de notre temps, avec l'alternance entre musique et texte, entre les deux récitants et avec des atmosphères favorisant le caractère descriptif très suggestif et, tour à tour, méditatif, mystérieux, contemplatif, si prégnant. Cette réalisation est à l'honneur de l'Ensemble vocal du CNSMD de Lyon, du Chœur Atelier et des solistes Marie Eumont et Catherine Roussot (soprani) et Isabelle Deproit (Mezzo), des Éditions VDE GALLO et surtout de Gabriel Marghieri. Disque à découvrir et à réécouter pour en saisir toute la richesse.

Édith Weber.
« Pot pourri Clarinet Recital ». Luigi Magistrelli, Laura Magistrelli, clarinettes, Noemi Guerriero, cor de basset, Sumiko Hojop, Marina Degli'Innocenti, pianos. 1CD VDE-GALLO (www.vdegallo-music.com). CD 1450. TT : 77' 50.
Le programme de ce digest pour clarinettes s'étend de Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) à Willy Hess (1906-1997), en passant, entre autres, par Niels Gade (1817-1880), Claude Debussy (1862-1918), Igor Stravinsky (1882-1971). Illustrant différentes formes : Fantaisie, Rhapsodie, Étude, Sonate pour différentes formations : clarinette et piano, clarinette solo, duo (2 clarinettes) et également clarinette et cor de basset, il réunit des compositeurs d'origines danoise, italienne, française, russe et suisse. Tout ceci justifie bien le titre de Pot pourri. Curieusement : pas de texte d'accompagnement en français, mais seulement en anglais et italien. Les interprètes sont Luigi Magistrelli et Laura Magistrelli (clarinettes), Noemi Guerriero (cor de basset) et, au piano : Sumiko Hojo et Marina Degl'Innocenti. Les amateurs de clarinette apprécieront, par exemple : le Duo for two Clarinets en Ut Majeur (C.P.E. Bach), avec son Adagio sostenuto évocateur contrastant avec l'Allegro d'esprit classique, voire préromantique ; les Fantasy Pieces op. 43 (N. Gade), d'abord nostalgique (Andante) s'opposant à l'animation de l'Allegro vivace, la langoureuse Ballade moderato et l'Allegro molto vivace particulièrement primesautier. La musique italienne est représentée notamment par Introduction, Thème et Variations pour clarinette et piano (G. Rossini) — primitivement pour clarinette et orchestre — où, au milieu de réminiscences d'airs d'opéras, le piano exerce un rôle à la fois concertant et de soutien de la clarinette. Enfin, La Suisse est présente avec 4 mouvements de la Suite Pittoresque op. 115 pour clarinette et cor de basset, du musicologue, compositeur et bassoniste suisse, Willy Hess (1906-1997). La musique française figure avec la Première Rhapsodie pour clarinette et piano (Cl. Debussy) et la Sonate pour deux clarinettes (Fr. Poulenc) en 3 mouvements : Presto (expressif et animé)-Andante (rêveur et nostalgique) et Vif (espiègle et virevoltant), ainsi que sa Sonate pour clarinette et piano en 3 mouvements qui pose un point d'orgue éblouissant sur ce pot pourri inouï.

Édith Weber.
Richard FLURY : Skizzenmappe aus dem Bucheggberg 50 Romantische Stücke. Margaret Singer, piano. 1CD GALLO (www.vdegallo-music.com ). 1460. TT : 77' 35.
Ce second disque consacré au musicien suisse Richard Flury (cf. Lettre d'information, mars 2014) — né en 1896, mort en 1967 — permet d'entendre des miniatures descriptives composées en 1949. Au chapitre Bucheggbergisches de son livre de Souvenirs (Lebenserrinerungen) paru en 1950, il s'exprime ainsi : « déjà, jeune garçon, j'aimais les petites vallées et les collines qui se sont gravées dans ma mémoire comme l'idéal de paysages… familiers » avec de grands arbres, des forêts, des villages idylliques… des ruisseaux, un vieux moulin qui, pour lui, font fonction d'association d'idées et d'impressions nées lors de balades dans la nature. Ce disque évoque entre autres, quelques thèmes : Repos du soir, Promenade, Tombe, Brasserie, Récolte, Valse, Récréation, sans oublier la belle paysanne, le moulin, l'organiste, la visite du pasteur, Rêverie, le rémouleur ou encore Noël. Le programme comprend également deux Intermezzi et deux Préludes datant de 1921, ainsi que cinq Préludes (1931). L'excellente pianiste Margaret Singer rend toutes les nuances descriptives et sentimentales voulues par le compositeur, avec une technique pianistique à toute épreuve : sens du rythme, transparence, attaque précise de ces pièces si variées dans un style certes influencé par la tradition postromantique, mais avec quelques audaces harmoniques marquant son époque.
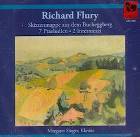
Édith Weber.
Pour les enfants
« À dos de dromadaire 2. Trésors de l'Évangile. 21 chants ». 1CD VDE GALLO (www.vdegallo.ch ) : CD 1430. TT : 39' 30.
Le deuxième volume de la Collection « À dos de dromadaire » comprend 21 chants sur des thèmes bibliques. Certains sont dotés d'un « postlude instrumental que l'on peut utiliser en le passant en boucle, pour répéter ou accompagner les chants ». Les amateurs de musique des années 1950 à consonance religieuse retrouveront les signatures de Claude Fraysse, Noël Colombier, Michel Wackenheim… et les interprétations de Philippe Corset (cf. Lettre d'information, novembre 2014). Quant aux textes, ils évoquent la nuit de Noël, la route d'Emmaüs, le Mont des Oliviers (Gethsémané), entre autres. À noter un Gloria de Taizé sur un texte de Jacques Berthier. Les textes sont rimés, certains chantés en alternance. Ce disque est agrémenté de deux dessins un peu naïfs (petit oiseau sur le dos d'un dromadaire…) de Catherine Pouly. Quant à la musique : même si elle coule de source, elle manque quelque peu de distinction.

Édith Weber.
« Il Pianto d'Orfeo. The birth of opera ». Œuvres de Luigi ROSSI, Tarquinio MERULA, Emilio DE' CAVALIERI, Giulio CACCINI, Claudio MONTEVERDI, Alessandro PICCINNI, Jacopo PERI, Andrea FALCONIERI, Antonio SARTORIO, Stefano LANDI. Deborah York, soprano, Lambert Colson, cornetto, Nicolas Achten, baryton, harpe théorbe, clavecin, ceterone et direction. Scherzi Musicali. 1CD Deutsche Harmonia Mundi (distribution Sony classical): 88843078722. TT. :73'22.
Ce CD est conçu comme un opéra qui a pour thème... la naissance de l'opéra. Un voyage musical autour du mythe d'Orphée, et essentiellement des compositeurs Giulio Caccini, Jacopo Peri et Claudio Monteverdi, les créateurs du genre au seiciento. Mais d'autres musiciens s'étaient penchés sur ce sujet. Ainsi le Prologue du présent programme donne-t-il à entendre une courte Sinfonia de Luigi Rossi (c. 1598-1653) et une aria de Tarquinio Merula (1595-1665). Le Ier acte ou « L'amour d'Orphée et d'Eurydice » est décliné à travers une pièce instrumentale d'Emilio de' Cavalieri où l'on savoure la franche sonorité du cornetto de Lambert Colson, et des arias de Caccini, de Luigi Rossi et de Monteverdi. On admire les diverses manières d'interpréter le « recitar cantando ». « La mort d'Eurydice » est le sujet de l'acte II, introduit par la Toccata XIII d'Allessandro Piccinni (1566-c.1638), enluminée par le théorbe de Nicolas Achten, suivi du beau lamento de Monteverdi « Tu se' morta ». On entend encore le même texte, « non piango e non sospiro », mis en musique par Caccini et Peri. A l'acte III, titré « Weep at my lament », on retrouve également un texte identique, « Funeste piagge », adapté par Caccini et par Peri. Puis « La suave melodia » d'Andrea Falconieri, introduite par le cornetto, est suivie d'une belle digression au clavecin. Dans les deux pièces d'Antonio Sartorio (c. 1630-1680) on décèle un langage déjà plus « moderne ». Enfin, la grande lamentation de l'Orfeo de Montervedi « Possente spirto » offre un style orné avec ses effets d'écho, et l'aura particulière du ceterone, de la famille des chittarone ou guitares baroques, enrichi dans le registre basse. L'acte IV « Devez-vous me perdre pour m'aimer trop » s'ouvre sur une sinfonia de Monteverdi et se distingue par la pièce instrumentale « Orphée aillant(!) perdu sa femme », de Luigi Rossi. L'épilogue est bâti sur deux pièces de Landi et de Rossi. péroraison sur la tristesse d'Orphée. Au fil de ces pièces, l'ensemble belge Scherzi musicali fait montre d'une précision remarquable dans les intonations, sous la direction de son mentor Nicolas Achten, chanteur qui conjugue les talents de claveciniste, de harpiste, de théorbe. La voix est pure et expressive tout comme celle de Deborah York dans les arias de soprano. A noter qu'ils se produiront à Paris, le 11 juin prochain, dans le cadre du premier festival de musique classique francophone belge « BE Musique », au centre culturel Wallonie-Bruxelles (cf. supra in Agenda).
![]()

Jean-Pierre Robert.
« Sémélé ». Marin MARAIS : Sémélé, tragédie sur un livret de Antoine Houdar de la Motte. André Cardinal DESTOUCHES : Sémélé: Cantate à voix seule avec symphonie sur un texte de Antoine Houdar de la Motte. Georg Friedrich HAENDEL : Concerto grosso op. 3 n°4, « Tra le fiamme », cantate sur un texte de Benedetto Pamphili. Semele, opéra sur un livret de William Congreve (extraits). Theodora, oratorio sur un livret de Thomas Morell (extraits). Chantal Santon Jeffery, soprano, Mélodie Ruvio, alto. Les Ombres, dir. artistique : Margaux Blanchard & Sylvain Sartre. 1CD Mirare : MUR 260. TT.: 78'.
Ce disque convie à un autre voyage imaginaire musico-littéraire : une mise en perspective du mythe, cette fois, de la trop séduisante Sémélé. Ou un « pasticcio » en forme de mini tragédie lyrique, que les présents interprètes ont d'ailleurs donné en concert à Saint-Étienne et à Montpellier, avant de l'enregistrer. Trois compositeurs sont réunis pour vénérer Sémélé. Marin Marais (1656-1728) écrit en 1709 la « tragédie » éponyme sur un livret de Antoine Houdar de La Motte, une courte pièce dont l'Ouverture est précédée d'une amusante marche de fifres, et qui comprend un « air des guerriers » et une imposante Chaconne. La partie chantée est réduite à un seul air. La « cantate à voix seule avec symphonie » de André Cardinal Destouches (1672-1749), sur un texte du même Houdar de La Motte (1719) aborde le mythe de manière différente, sur le mode plus intime de la cantate française, en l'occurrence pour voix d'alto et un effectif réduit au violon et à la basse continue. Le timbre grave bien projeté de Mélodie Ruvio fait merveille dans ces airs, dont « Est-il destin plus heureux » au cours duquel Sémélé se félicite de renoncer à la vie par pur amour de soi. L'opéra Semele de Georg Friedrich Haendel (1743) renferme des pages mémorables dont « Oh sleep », sur le seul accompagnement de la guitare baroque, et surtout « Endless pleasure », où la contemplation de sa propre beauté semble enivrer le personnage : sûre de son potentiel de séduction, elle le célèbre avec ravissement. On peut entendre aussi le dialogue entre Iris et Juno. D'autres pièces du saxon ont été ajoutées pour corser la dramaturgie ; tels que le Concerto grosso op. 3 N° 4, vécu comme un intermède, un air tiré de L'Allegro, Il Penseroso ed il Moderato (1740), « Sweet bird » arrangé pour flûte solo, clavecin et basse continue. La cantate « Tra le fiamme », de 1707, sur le mythe d'Icare, est formée de quatre arias dont « Voli per l'Aria », preste comme l'air et offrant des vocalises (avec flûte piccolo) à perdre haleine. Enfin deux extraits de l'oratorio plus tardif Theodora (1750) parachèvent ce programme inventif. Les Ombres, ensemble à géométrie variable, se signale par la clarté des plans (soulignée par une prise de son exemplaire) et une empathie avec ces musiques, il est vrai, porteuses d'émotion. Les voix sont à l'unisson de leurs collègues instrumentistes, dont l'alto impressionnante Mélodie Ruvio.

Jean-Pierre Robert.
Michel-Richard de LALANDE : Leçons de Ténèbres. Miserere. Sophie Karthäuser, dessus (soprano). Ensemble Correspondances, dir. Sébastien Daucé. 1 CD Harmonia Mundi : HMC 902206. TT.: 76'23.
A côté de ses grands motets, Michel-Richard de Lalande (1657-1726), cultiva l'art de la petite forme. Les œuvres les plus emblématiques de cette manière sont assurément les trois Leçons de Ténèbres. Écrites pour les offices de la Semaine Sainte, elles devaient trouver un grand écho et attirer un public nombreux qui se pressait au Concert Spirituel : on rapporte que l'affluence était telle que le concert en devenait un événement quasiment mondain. On y venait pour se sanctifier ; un peu comme en d'autres temps, on se pressera à l'église Saint Sulpice pour écouter les sermons hautement vertueux du prêtre des Grieux immortalisé par l'Abbé Prévost. De Lalande théâtralise la spiritualité de l'office et son credo est d'émouvoir par la beauté des voix pour édifier le croyant et l'amener à une plus intense vie religieuse. Les trois Leçons, de 1730, cultivent ainsi un art de l'ambiguïté : le beau pour approfondir l'affliction. Ces pièces forment un ensemble en trois volets. La « Troisième Leçon du mercredy » Saint est introduite par un répons : la déploration de la voix soliste suit divers modes, soit réfléchi, soit plus animé, pour décrire la déploration ou l'aspiration aux beautés divines. La « Troisième Leçon du Jeudy » Saint fait précéder chaque couplet d'une vocalise ; l'atmosphère est presque joyeuse « il m'a conduit, et il m'a amené dans les ténèbres, et non dans la lumière », comme encore à l'heure de ces paroles « il a brisé mes os ». La « Troisième Leçon du Vendredy » Saint transporte l'auditeur par un chant immaculé et une expression méditative. Ces pièces sont précédées ici du Miserere. La force du présent disque réside dans une interprétation hautement pensée de la part du chef Sébastien Daucé et de son ensemble Correspondances, lequel se hisse d'emblée auprès des plus grands : pureté céleste des six dessus, sopranos, et des trois bas-dessus, mezzos, beauté extatique de la soliste Sophie Karthäuser qui épouse une mélodie linéaire ponctuée d'intervalles expressifs. On savourera aussi la finesse de la basse continue et une prise de son d'un parfait naturel, conférant à ces pièces leur idéale pureté. Un coup de maître !
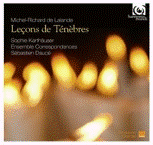
Jean-Pierre Robert.
Wolfgang Amadé MOZART : Concerto pour hautbois et orchestre K 314. Joseph HAYDN : Sinfonia Concertante Hob. I/1905. Lucas Macías Navarro, hautbois, Gregory Ahss, violon, Konstantin Pfiz, violoncelle, Guilhaume Santana, basson. Orchestra Mozart, dir. .Claudio Abbado. 1 CD Claves : 50-1302. TT.: 40'44.
Voilà une surprise à laquelle on ne s'attendait pas : deux interprétations de Claudio Ababdo captées live en mars 2013, lors d'une tournée en Espagne de l'Orchestra Mozart. Cet orchestre il l'aimait par dessus tout et les musiciens le lui rendaient bien. Il les conduit ici dans deux pièces concertantes de Mozart et de Haydn. Le Concerto pour hautbois K 334, que Mozart écrit en 1777, est si célèbre qu'il n'est besoin de s'étendre sur ses qualités. Il suffira de dire qu'elles sont ici magnifiées par une exécution hautement musicale. L'allegro aperto est pris par le chef avec une sereine grâce, dont on détache la finesse des traits des violons. L'adagio sertit la mélodie du soliste dans un accompagnement pensé et la cadence est d'une grande profondeur. L'allegretto respire le bonheur de jouer, dans un tempo pas spécialement preste, et le thème emprunté à l'air de Blondchen de l'Enlèvement au sérail s'en trouve plein d'esprit, même si le clin d'œil au personnage grotesque d'Osmin, lors de la reprise, est seulement esquissé. Lucas Macías Navarro, aujourd'hui premier pupitre au Concertgebouworkest, après l'avoir été au Gustav Mahler Chamber Orchestra et à l'Orchestre du Festival de Lucerne - c'est dire ses liens avec Abbado - trace une interprétation d'un absolu naturel. La Sinfonia Concertante de Joseph Haydn (1752), est de facture classique même si sa distribution instrumentale ne manque pas d'attrait, violon, violoncelle, hautbois et basson. Mozart sera plus audacieux dans sa propre œuvre concertante à quatre solistes, puisqu'elle ne convoque que des vents. Chacun ici se partage la conduite de l'action et on joue tantôt en répons, tantôt à l'unisson. La présente lecture du premier mouvement est une affaire sérieuse, contrairement à la manière coutumière du compositeur, et la cadence, habile digression à partir des divers thèmes, prospère haut la main. A l'andante les quatre solistes chantent dans l'esprit d'une tendre rêverie. Abbado pacifie le con spirito final : en préambule, le violon ouvre le bal par une sorte de question auquel répond l'orchestre. Le mouvement se déroule joyeusement et les interventions du basson, jusque là discrètes, révèlent finalement quel esprit humoristique animait le Papa Haydn. Les solistes donnent le meilleur en pareille conduite. Quarante minutes de bonheur. Qui illustrent ce mot du chef autrichien Joseph Krips « Ohne Liebe man keine Musik machen » (Pas de musique sans amour). C'était sûrement aussi la devise de Claudio Abbado.

Jean-Pierre Robert.
Wolfgang Amadé MOZART : Sonates pour piano N° 11 en la majeur, K 331, N° 17 en Si bémol majeur, K 570, et N° 18 en Ré majeur, K 576. Menahem Pressler, piano. 1CD La dolce Volta : LDV19. TT.: 61'20.
A 90 ans passés, Menahem Pressler est plus actif que jamais. Sa carrière de soliste bat son plein et ses rencontres avec les studios tout autant. Il a décidé d'entreprendre l'enregistrement de l'ensemble des Sonates pour piano de Mozart. « Une véritable mission... qui ne cesse de me questionner et qui parfois me paraît vertigineuse », confie-t-il, « une nécessité intérieure » pourtant. Il a choisi de le commencer par la Sonate K 331 et les deux dernières K 570 & 576. La Sonate en La majeur, K 331, une des premières qu'il ait jouée : « l'impression de l'avoir toujours connue par cœur ». Il voit dans l'andante grazioso « un air d'amour où la main droite serait la soprane ». On perçoit à travers ce jeu simple et souple un Mozart heureux, qui avec l'opéra contemporain L'Enlèvement au sérail est satisfait de s'être dégagé du carcan salzbourgeois. De subtiles variations de tempos apportent une vie exceptionnelle à cette exécution. Le Menuetto est affirmé dramatiquement et l'« alla turca » final d'une aisance qui en ferait presque oublier son habile construction. Il n'y aura point d'affèterie dans le développement du thème des janissaires emprunté à l'opéra, lequel en acquiert une profondeur insoupçonnée. La Sonate K 570 en Si bémol majeur, dont « la simplicité n'est qu'apparente », nous mène en pareil ravissement ; témoin l'allegro et sa thématique inventive sous des dehors de facilité. Le piano prend des couleurs orchestrales à l'adagio, aux sombres moirures. On admire la plénitude du chant de la main droite sur quelques accords d'appui de la main gauche. La légèreté d'opéra bouffe du rondo final apporte un contraste bienfaisant avec ses notes pointées dans une manière de danse dont l'ordonnancement varie au fil du discours. Avec la Sonate K 576, en Ré majeur, dite « La chasse » ou « de la trompette », rappelle Menahem Pressler, du fait de sa curieuse fanfare introductive, on entend la détresse de Mozart en bute aux difficultés financières que l'on sait en cette terrible année 1789. Le pianiste souligne l'extrême difficulté contrapuntique du premier mouvement, en particulier le développement fugué du premier thème, et on savoure la volubilité de la main droite. L'adagio, « une des pages les plus parfaites » qu'ait écrites Mozart, nous plonge dans le tréfonds de la détresse. Sous son amabilité de ton, le finale est un abîme de la pensée. A travers une démarche extrêmement fluide, appert une dramaturgie de tous les instants ; le discours mobile de la main droite ne peut cacher une solide architecture. Et quelle fin toute en douceur ! Menahem Pressler ne nous livre-t-il pas là une interrogation existentielle ? Il possède cette musique comme peu, avec laquelle il a vécu toute une vie ; le jeu est structuré et combien aisé : l'expression de l'âme Mozart. Pour l'île déserte assurément.

Jean-Pierre Robert.
Wolfgang Amadé MOZART : Kleine deutsche Kantate K 619 et Lieder. Richard STRAUSS : Lieder. André PREVIN : Sallie Chisum remembers Billy the Kid. 4 Songs for soprano, cello and piano. Vocalise for soprano, cello and piano. Barbara Bonney, soprano. Franz Bartolomey, violoncelle. André Prévin, piano. 1CD Mozarteum Stiftung (distribution : Belvedere) : 10156. TT.: 80'
De ses archives, la Fondation Mozarteum extrait ce récital donné lors de la Semaine Mozart de janvier 2000. Quel plaisir de retrouver le timbre cristallin et le talent expressif de Barbara Bonney, une figure bienaimée qui fit les beaux soirs de Salzbourg des années durant ! Le programme qui réunit des morceaux à égale proportion de Mozart, Richard Strauss et André Prévin, s'ouvre par la rare Kantate K 619, de 1791, célébrant le panthéisme franc maçon. Trois autres airs, K 523, K 530 et K 596 suivent et les deux airs en français K 308 « Dans un bois solitaire », et K 307 « Oiseaux, si tous les ans ». De Richard Strauss, Barbara Bonney livre un bouquet de six mélodies connues, sur les terres d'Elisabeth Schwarzkopf. La voix glorieuse de la soprano américaine, parfaitement « chauffée » à ce point du récital, distille ces trésors sans afféterie et avec une belle ductilité, que l'on retrouve dans l'accompagnement de Prévin. Dans « Ruhe », de 1894, c'est l'impression de plénitude intérieure. Avec « Morgen » op 27/4, le pianiste nous conduit vers les cimes et la voix nous y maintient. « Wagenlied » op 41/1, sous un poème de Richard Dhemel, irrigue comme une eau claire un chant dans la meilleure veine straussienne. Avec « September », de 1948, sur un poème de Hermann Hesse, c'est le le triomphe du mélodisme de la dernière période. La péroraison pianistique ne fait pas oublier la version orchestrée enluminée de la mélopée envoûtante du cor. « Zuignung » de 1885, la fameuse « dédicace », morceau en guise de remerciement, là encore immortalisé par Schwarzkopf, est tout aussi attractif. Les pièces d'André Prévin (*1929) sont une découverte. « Saillie Chisum remembers Billy the Kid » (1995) est un petit tableau évocateur où la ligne de chant, lyrique, se déploie sur un accompagnement syncopé, lequel est développé entre les strophes. Les 4 Songs pour soprano, cello et piano (1994) prennent un tour mystérieux du fait de l'intervention du violoncelle et de l'inspiration pianistique originale. Ainsi du premier chant « Mercy » introduit par le violoncelle qui lance la mélodie sur une succession d'accords du piano ; la voix s'inscrit habilement dans cet écrin. « Stones » est jazzy et « Shelter » paradisiaque, enfin « The Lacemaker » résume toutes ces qualités et s'enrichit d'une péroraison instrumentale savante. « Vocalise » (1995), sans texte, propose la même combinaison instrumentale. Une prouesse que Barbara Bonney se fait un plaisir de nous faire déguster. Au fil de ces pièces elle nous laisse admirer l'intelligence du texte et un charisme totalement dénué de maniérisme.

Jean-Pierre Robert.
Gioachino ROSSINI : Petite Messe solennelle (édition critique de Davide Daolmi). Julia Lezhneva, Delphine Galou, Michael Spyres, Alexander Vinogradov. Christophe Henry, orgue. Accentus. Orchestre de chambre de Paris, dir. Ottavio Dantone. 1CD Naïve : V 5409. TT.: 77'.
« Un petit requiem profane » disait Rossini de sa Petite Messe solennelle. Composée entre 18621et 864, elle appartient aux « pêchés de ma vieillesse ». Si le compositeur a abandonné la scène lyrique depuis des lustres, après son magnifique Guillaume Tell, le style opératique n'est pas mort pour autant. Témoin le « Domine deus » et bien des interventions des solistes vocaux. Ce qu'Olivier Dantone saisit par une direction alerte. Le « Kyrie » offre ainsi une scansion très italienne. Le « Gloria », la séquence la plus développée, contraste par son attaca glorieuse. Le trio du « Gratias agimus tibi » introduit par la basse, réunit avec celle-ci la contralto et le ténor. Le « domine deus », confié au ténor, s'engage comme une aria de bravoure. Le profane éclate tout autant dans le « qui tollis » (soprano-contralto) avec son accompagnement de harpe séraphique. Le Credo débute par un passage très allant que le « Crucifixus » nimbe de quelque douleur ressentie au 2 ème degré tandis que le « Resurrexit » retrouve le ton du début et que la séquence s'achève en une fugue entrainante. Intermède purement instrumental, le « preludio relogioso », confié à l'orgue, poursuit dans la même tonalité claire. Le grand orgue de la basilique de Saint-Denis sonne beau! Le « Sanctus » offre, enfin, le recueillement qui sied à une telle cérémonie. Mais avec le « O salutaris » on est proche, là encore, d'une aria d'opéra, et l'« Agnus dei » se présente dans ses premières mesures comme un cabalette (contralto) sur un contrepoint des chœurs, pour progresser grandiose. Dantone allège la texture et ne renie pas ce qui ressortit au climat séculier. La clarté des chœurs Accentus est une merveille. Les solistes sont à la hauteur : Alexander Vinogradov déploie une basse héroïque et Delphine Gallou offre un timbre sombre de mezzo. Mais le contraste n'est pas très marqué avec la soprano Julia Lezhneva, dont la voix (peut-être pas au mieux ce soir là) s'est élargie et navigue désormais entre soprano et mezzo. Michael Spyres est un ténor stylé, dans une partie plus effacée ici. Capté live lors de Festival de Saint-Denis 2014, l'enregistrement, fort réverbéré, est presque trop ample mais d'une indéniable immédiateté quant aux voix.

Jean-Pierre Robert.
« The Hungarian connection ». Johannes BRAHMS : Quintette pour clarinette et cordes, op. 115. Deux valses en la majeur. Eduard REMÉNYI/Johannes BRAHMS : danse hongroise N°7. Miska BORZÓ/ Johannes BRAHMS : Danse hongroise N°1. Léo WEINER : Két Téfel: deux mouvements. Danses de Transylvanie. Andreas Ottensamer, clarinette, Leonidas Kavakos, Christoph Koncz, violons, Antoine Tamestit, alto, Stephan Koncz, violoncelle, Ödön Rácz, contrebasse, Oszkár Ökrös, cymbalum, Predrag Tomić, accordéon. 1CD Universal DG : 481 1409. TT.: 61'.
Ce disque génère des sentiments paradoxaux en termes d'interprétation. Andreas Ottensamer est un immense artiste : sa clarinette solaire a enluminé les concerts du Berliner Phiharmoniker lors du récent Osterfestspiele de Baden-Baden. Mais sa lecture du Quintette de Brahms laisse perplexe. On sait que le compositeur, séduit par la sonorité du clarinettiste Richard Mühlfeld, s'empresse d'écrire plusieurs pièces à son intention, dont le présent Quintette, devenu un des monuments du répertoire chambriste, aux côtés de celui de Mozart. Andreas Ottensamer et ses amis, non des moindres, abordent l'allegro de manière très mesurée et se lancent aussitôt dans des ralentissements très accentués, en particulier à la partie médiane du mouvement, et cela perdure jusqu'à la fin du morceau. Ce qui ne prépare pas le nécessaire contraste avec l'adagio. Celui-ci est pris, de fait, encore plus lentement : O temps suspend ton vol ! Mais à vouloir trop insister, on perd l'esprit et le discours se traîne au point de diluer les sombres accents de Brahms. Le deuxième thème, bien hongrois, n'a pas assez de vigueur alors que le soliste s'offre le luxe de ppp vaporeux ; et cela progresse paresseusement. A l'andantino, la première phrase de l'introduction est de nouveau indolente, les autres à peine plus vives et le soliste d'une discrétion qui confine à l'immatériel. Le finale sera de la même eau, les variations peu différenciées et la thématique distordue. On se demande qui du soliste ou de ses compères a décidé d'adopter pareils tempos. Le reste du programme justifie mieux le titre de « Ungarian connection » car tant les Valses de Brahms avec leurs relents de czardas et l'usage gratifiant du cymbalum, que les diverses Dans Hongroises de Reményi et de Borzó sont ici dans le ton, celui de l'improvisation : la 7 ème avec son introduction virtuose énergique, dans l'arrangement adroit de Stephan Koncz, entre accélérations et ralentissements ; la n° 1, fondée sur une divine Czardas, contrastant également les tempos. Les pièces de Léo Weiner (1885-1960), un compositeur hongrois naguère défendu par son compatriote Georg Solti, séduit par des tunes originaux et irrésistibles. Enfin, quelques Danses de Transylvanie concluent le CD tout en rythmes magyares.

Jean-Pierre Robert.
Robert SCHUMANN : Quatuors op 41/1 en la mineur, N°41/2 en fa majeur, N° 41/3 en la majeur. Quatuor Hermès. 1CD La Dolce Volta : LDV17. TT.: 74'46.
Le Quatuor Hermès, formé en 2008, s'affirme dans la cour des grands. Leur premier disque chez La dolce Volta rapproche les trois quatuors de l'opus 41 de Schumann. Une somme, et un challenge ! Car cette trilogie, composée en six semaines à l'été 1842, Schumann la conçoit comme un parangon de dépouillement dans sa portée philosophique, où plane l'ombre de Beethoven. Y règnent une grande plénitude et en même temps une émotion souvent cachée dans ses mouvements lents, comme une belle audace compositionnelle, usant de la double tonalité et ne minimisant pas les sforzandos jusqu'à la dissonance. C'est dire que s'y confronter requiert plus que de la compétence, une sûreté de ton. Les Hermès se distinguent par un jeu d'une absolue fraîcheur et d'une maturité enviable. La plénitude sonore impressionne comme la cohérence des choix d'accents. L'op. 41 N° 1, en la mineur, s'ouvre par un andante espressivo qui manie cet esprit de confidentialité qu'on retrouvera dans l'entier cycle. Le scherzo presto, presque arraché par les Hermès, s'orne d'un trio un brin mélancolique. L'adagio est d'une expressivité teintée de clarté et nullement embourbé dans un romantisme souligné, ce à quoi se refuse Schumann. Le presto est décidé, techniquement tracé avec assurance. On remarque la finesse du premier violon, Omer Bouchez, ce à quoi se mesure pour beaucoup la classe d'un quatuor à cordes. L'op. 41 N° 2 signale une écriture vocale, nettement en évidence à l'andante vivace puis à l'andante quasi variazioni qui suit, un dédale des plus ardus - la musique pure - avec de brusques ruptures. Les Hermès trouvent leur chemin. Tout comme dans la fluidité et l'esprit du scherzo, et de ce qui est cousin de la manière nocturne de Mendelssohn. Le trio est pacifié pourtant. La vive scansion du finale, typique de Schumann, parachève une exécution passionnante. On mesure le profit que les Hermès ont pu tirer des conseils des Artemis et des Ysaÿe. Toutes ces qualités se vérifient dans l'exécution du dernier quatuor de l'op. 41, le plus riche d'invention des trois. Après quelques phrases d'introduction, le molto moderato combine un thème confortable et des accents énergiques. La spontanéité de la vision des quatre interprètes et son équilibre les placent haut parmi leurs grands confrères. L'ombre de Mendelssohn plane aussi dans les variations de l'assai agitato, tempétueuses ou élégiaques. L'adagio évolue tel un Lied aux sombres accents, en particulier de l'alto de Yung-Hsin Lou Chang. Le finale est peu résistible jusque dans sa robuste coda : la joie de vivre, et une jeune fougue maîtrisée.

Jean-Pierre Robert.
Robert SCHUMANN : Concerto pour violon et orchestre en ré mineur. Trio pour piano, violon et violoncelle N° 3 op. 110. Isabelle Faust, violon, Jean-Guihen Queyras, violoncelle, Alexander Melnikov, piano. Freiburger Barockorchester, dir. Pablo Heras-Casado. 1CD Harmonia Mundi : HMC 902196. TT.: 61'.
Cet intelligent couplage est le premier d'une série de trois CD qui seront consacrés par les mêmes interprètes aux concertos de Schumann et à des œuvres de musique de chambre en relation avec eux. Le présent CD rapproche ainsi le concerto pour violon et le trio n°3 op. 110. Schumann achève son concerto de violon en Ré mineur en 1853. Il ne sera publié qu'un siècle plus tard, en 1937, et créé alors par Georg Kulenkampf et Karl Böhm. Puis Yehudi Menuhin et John Barbirolli le joueront l'année suivante. Il offre un exemple intéressant du style tardif très innovant du compositeur, et qui accorde une réelle prédominance au soliste. Au premier mouvement, la forme sonate fusionne avec la fantaisie et conduit à un style rhapsodique. Le soliste progresse de manière très libre. Le « Langsam » (lentement) est discret et rêveur, et le violon inscrit sa ligne intimement imbriquée dans la matière orchestrale : une méditation intérieure. Le finale « Lebhaft, doch nicht zu schnell » (vif mais pas trop vite) s'enchaîne directement et introduit une nouvelle thématique. Là encore, le mouvement, un rondo de sonate, progresse en une fusion soliste-orchestre typique de cette dernière manière du musicien. La sonorité feutrée du Freiburger Barockorchester, sous la direction toute en nuances de Pablo Herras-Casado, influence-t-elle la manière dont Isabelle Faust joue la pièce ? Elle est d'un romantisme effleuré, volontairement non brillante. Le Trio N° 3 op. 110, écrit pour Clara, est tout aussi singulier, empli de fougue. Le « Bewegt » (mouvant) introduit un thème ondoyant, sorte de mélodie continue qu'avivent des climats changeants. On remarque quelques originalités dans la composition, sauts d'intervalles, jeu en pizzicatos. Au deuxième mouvement, marqué « assez lentement , la mélodie est soudain interrompue par de violents accents fiévreux, que les trois interprètes soulignent volontiers. La scherzo « Rasch » (vif) et fort rythmé, dans lequel le Trio apporte une note joyeuse. Au finale « kräftig, mit humor » (avec force et humour), l'audace du discours prend tout son sens, inattendu dans ses traits véhéments et capricieux, ses envolées engagées et sa conclusion déclamatoire. Isabelle Faust, Jean-Guihen Queyras, violoncelle, et Alexander Melnikov, clavier, qui n'en sont pas à leur première collaboration, montrent une idéale fusion dans une exécution que colore la sonorité particulière du pianoforte.

Jean-Pierre Robert.
« Révolution ». concertos pour flûte et orchestre de François DEVIENNE, Luigi GIANELLA, Christoph Willibald GLUCK, Ignaz PLEYEL. Emmanuel Pahud, flûte. Kammerorchester Basel, dir. Giovanni Antonini. 1CD Warner classics : 0825646276783. TT.: 73'10.
Après ses interprétations des concertos de l'époque de Frédéric II (« Le Roi Flûtiste ») Warner, 2012), Emmanuel Pahud s'attaque à un autre âge d'or de la flûte : la période de la fin du XVIII ème et du début du XIX ème en France. Ce CD se veut un hommage à Jean-Pierre Rampal qui exhuma et aimait tant jouer des pièces faisant cohabiter des talents bien différents. François Devienne (1759-1803), surnommé le « Mozart français », a composé 12 concertos pour la flûte qu'il jouait lui-même en virtuose. Le Concerto N° 7, joué ici, est un morceau phare du répertoire de l'instrument. L'allegro débute fort prestement, comme furieux, sous les doigts de Giovanni Antonini et se montre plein d'éclat avec Pahud, qui épouse la noblesse de ton de l'adagio et de sa riche thématique couronnée d'une superbe cadence. La belle mélopée aérienne du rondo allegretto se confronte à un orchestre déchaîné, mais le soliste brille au fil d'innombrables traits virtuoses que Pahud distille avec un art consommé. Luigi Gianella (1778-1817) était également un flûtiste de renom. Son Concerto N° 1, de 1800, est brillant : d'une introduction orchestrale véhémente, quasi arrachée, le soliste dispense sur un thème archaïsant, revenant en boucle, une belle volubilité. L'adagio creuse le contraste, du fait de la délicatesse de la ligne au son d'un orchestre chambriste. Le finale est théâtral par l'utilisation humoristique des bois, une des spécialités de l'auteur, et sa manière de ritournelle cocasse. On a intercalé un concerto du Chevalier Gluck, dans un souci d'équilibre : le grand style classique fait en effet la différence, mais le finale est aussi enjoué. Le Concerto B106 d'Ignaz Pleyel (1757-1831), qu'il écrit en 1799, est la reprise d'un concerto conçu pour clarinette, de deux ans antérieurs. Il est, selon Pahud, « à la fois classique et dramatique, particulièrement développé et d'une virtuosité instrumentale redoutable ». En effet, le premier mouvement, introduit puissamment, presque démonstratif, avec des crescendos d'envergure, offre au soliste matière à briller, car l'inspiration est extrêmement variée, paraissant sans limite. Il s'achève dans une cadence ébouriffante, d'une fantaisie tout sauf cartésienne! L'adagio débute par une mélodie expressive de la flûte, tournée vers un passé galant. L'instrument est traité avec de longues tenues. Le finale magnifie le soliste et s'affirme allègre dans une ritournelle qui va s'amplifiant. La maitrise d'Emmanuel Pahud laisse sans voix, qui offre en même temps une élégance toute gallique. La battue extrêmement articulée de Giovanni Antonini complète la faconde du soliste. Une petite merveille de disque!

Jean-Pierre Robert.
Félicien DAVID : Le Désert. Ode-symphonie en trois parties pour récitant, ténor, chœur d'hommes et orchestre. Poésie d'Auguste Colin. Cyrille Dubois, Zachary Wilder, ténors, Jean-Marie Winling, récitant. Accentus. Orchestre de chambre de Paris, dir. Laurence Equilbey. 1 CD Naïve : V 5405. TT.: 45'01 (version sans récitant), 49'12 (avec récitant)
Enregistré dans la foulée du concert donné en mai 2014 à la Cité de la musique (cf. NL de 06/2014), cette exécution de l'Ode-symphonie Le Désert de Félicien David (1810-1876) mérite de figurer dans la discothèque de tout amateur de belle musique du XIX ème siècle. Le genre mixte illustré par cette pièce de 1844 peut se rapprocher de celui qu'introduit Berlioz, en 1839, avec son Roméo et Juliette. La pièce magnifie l'esthétique, non pas de la pure contemplation, mais de l'observation attentive d'un paysage et des hommes qui le peuplent, comme le ferait un peintre dans une toile de maître. L'impression d'exotisme est bien présente même si pas toujours spécialement authentique. Pourtant, à la différence de Ravel qui a mieux décrit une Espagne seulement imaginée qu'un vrai natif ibère, David a puisé ses impressions, ses sensations, à un Orient où il vécut des années durant. La première partie, La marche d'une caravane, introduit le mystère avec « l'entrée au désert » comme la vie même (« la tempête au désert ») . Une halte nocturne, sujet de la deuxième partie, se distingue par quelques joyaux musico-poétiques, tel que « l'hymne à la nuit » : « Ô nuit, ô belle nuit, ta fraîcheur nous réjouit » chante le ténor dans un air d'une profondeur ensorcelante. La « fantaisie arable » fait office d'intermède avec sa « danse des almées ». A laquelle fait écho « la rêverie du soir », inspirée d'une mélodie des bateliers du Nil, là encore dans un air élégiaque du ténor sur une scansion élastique des cordes. La voix si joliment timbrée de Cyrille Dubois fait ici merveille. Le lever du jour forme le titre de la dernière partie, qui s'ouvre par « le lever du soleil », là encore à l'atmosphère vraie, volutes de cordes divisées au son filé, dessins de la clarinette puis du hautbois et du basson. Pur ravissement. Le « chant du muezzin » suit, où la voix du ténor Zachary Wilder est poussée à ses limites, mais quelle prouesse dans les vocalises ! « Le départ de la caravane » libère une marche joyeuse agrémentée du solo du hautbois et de tenues des cors. Enfin, le « chant du désert », reprise par le chœur du chant de la marche entendue précédemment, conduit l'œuvre à son apothéose. Laurence Equilbey et ses forces, Accentus pour les chœurs, et l'Orchestre de chambre de Paris, démontrent un sens aigu de la fascination qu'exerce cette musique. A découvrir.

Jean-Pierre Robert.
« Bewitched ». Francesco GEMINIANI & Georg Friedrich HAENDEL. Robin Johannsen, soprano. Les Passions de l'Âme, dir. Meret Lüthi. 1 CD Deutsche Harmonia Mundi (distribution : Sony Music) : 88843040882. TT : 60'08.
Une fresque musicale, typiquement baroque, retraçant dans le cadre magique d'une forêt enchantée, les aventures amoureuses d'Armida et Rinaldo, oscillant entre amour et devoir. Une musique de scène construite sur un livret de Servandoni utilisant les compositions de Francesco Geminiani (1687-1762) pour la partie purement instrumentale, suivant le schéma du concerto grosso, et la cantate de Georg Friedrich Händel (1685-1759), Dietro l'orme fugaci extraite d'Armida abbandonata, pour la partie vocale. La partie instrumentale se chargeant de décrire les ambiances, la partie vocale exprimant les conflits de l'âme. Le présent enregistrement présente la version de concert du jeu de pantomime qui fut créée le 31 mars 1754 au Grand Théâtre du Palais des Tuileries. Un enregistrement original, parfaitement joué par l'ensemble baroque suisse les Passions de l'âme, bien chanté par la soprano américaine Robin Johannsen, qui ravira tous les amateurs de musique baroque.

Patrice Imbaud.
Jean-Sébastien BACH. L'art du Choral. Chœur La Camerata Baroque. Daniel Meylan, orgue & direction. 1 CD Éditions HORTUS 112.TT : 66'54.
Un bel enregistrement qui au-delà de ses qualités musicales indiscutables, présente un intérêt didactique en nous plaçant au cœur du choral luthérien. Un florilège de quatorze chorals extraits des grands recueils (Klavierubung, Orgelbüchlein, Chorals de Leipzig et Choral Schünler) démontrant l'absolue maitrise du Cantor dans ce genre musical. Le choral luthérien est une forme musicale directement issue du protestantisme permettant au fidèle d'exprimer sa foi au travers du chant, au sein même de la liturgie. A cet effet et afin d'en saisir toute la dimension émotionnelle et spirituelle, chaque choral est, ici, précédé d'une version chorale introductive. Le célèbre « Allein Gott in der Höh' sei Ehr » BWV 715 (A Dieu seul dans les cieux soit la gloire) ouvre et clôt ce beau disque. L'interprétation de Daniel Meylan sur l'orgue Ahrend de l'église des Jésuites de Porrentruy en Suisse, tout comme celle de la Camerata Baroque qu'il a fondée en 1992 sont des modèles d'équilibre, de joie et de sérénité. Superbe

Patrice Imbaud.
BACH & BEETHOVEN. Quasi una Fantasia. Audrey Vigoureux, piano. 1 CD Évidence : EVCD010. TT : 45'30.
Quasi una Fantasia, voilà une bien belle manière, choisie par la pianiste Audrey Vigoureux, de mettre en avant l'improvisation et la liberté pianistiques à travers un programme judicieusement emprunté à Beethoven et Bach. Un album tirant son nom de la Sonate n° 13 de Beethoven, composée entre 1800 et 1801, qui constitue un irremplaçable témoignage des dons d'improvisation de Beethoven pianiste. Une sonate fantasque progressant au gré de l'humeur du compositeur entre virtuosité, méditation et noirceur. La Sonate n° 31, plus tardive, composée entre 1821 et 1822, est l'avant dernière sonate de Beethoven et, probablement, la plus chantante de toutes, comme un hommage rendu à la voix. Jean-Sébastien Bach complète ce disque avec les Fantaisies & Fugues BWV 904 & 906 comme une façon claire d'opposer, mais aussi de réunir la liberté, l'audace, l'intuition de la Fantaisie et la rigueur de la Fugue. Une synthèse, ou mieux une fusion parfaitement réussie dans la lecture de ces quatre œuvres, entre déclamation passionnée et contrainte structurelle, sous les doigts d'Audrey Vigoureux qui nous ravit par son jeu plein d'entrain, d'inspiration, de fluidité et de souplesse. Un beau disque.

Patrice Imbaud.
« Danses ». RAVEL, BORODINE, GRIEG, BARBER : pièces pour piano à quatre mains. Duo Jatekok, piano à quatre mains. 1 CD MIRARE : MIR 261. TT : 70'.
Un premier CD mais un coup de maitre que cet enregistrement du duo Jatekok, constitué de deux jeunes et talentueuses pianistes, Adélaïde Panaget et Naïri Badal, ayant fait le choix rare de jouer à quatre mains. Un choix judicieux musicalement et pertinent économiquement ! Une collaboration déjà ancienne remontant à l'époque de leurs études au Conservatoire, encouragée par la regrettée Brigitte Engerer. Un programme construit autour de la danse regroupant un florilège d'œuvres miniatures, courtes, de différents compositeurs : les Danses polovtsiennes de Borodine, la Rhapsodie espagnole de Ravel, Valses-Caprices et Danses norvégiennes de Grieg, avant de conclure sur Souvenirs de Barber. Un beau programme composé d'œuvres connues le plus souvent dans leur version orchestrale, mais composées, pour nombre d'entre elles initialement pour deux pianos (Ravel) ou pour quatre mains (Grieg et Barber). Un jeu pianistique éblouissant et jubilatoire (Jatekok signifie « jeu » en hongrois), une vivacité et un dynamisme communicatifs, une entente et une cohésion parfaites. Un très beau disque !

Patrice Imbaud.
« Voyage ». Lavinia Meijer, harpe. 1CD Sony Classical : 88875046402. TT : 60'05.
Un nouvel opus de la harpiste néerlandaise, d'origine coréenne, Lavinia Meijer, dans la droite ligne de son précédent enregistrement « Passagio ». Un disque conçu comme un voyage musical conduisant de Debussy à Yann Tiersen en passant par Satie et Ravel. Des œuvres originales pour harpe et des transcriptions effectuées par l'artiste elle-même dans le souci constant de mettre en valeur son instrument. Un choix judicieux d'œuvres, Clair de lune, La fille aux cheveux de lin, Bruyères et Danses pour harpe et orchestre à cordes de Claude Debussy, Introduction et Allegro de Maurice Ravel, Gymnopédie et Gnossiennes d'Erik Satie, enfin différentes plages tirées de la bande son du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, composées par Yann Tiersen. Une interprétation magnifique par sa sonorité délicate et son phrasé d'une juste et émouvante langueur. Un très beau disque, vraiment !
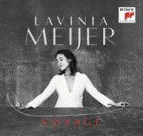
Patrice Imbaud
Maurice RAVEL : L'œuvre pour piano. Jacques Rouvier & Théodore Paraskivesco, piano. 2CDs Calliope : CAL1521. TT : 68'51 + 73'49.
Pour le 140e anniversaire de la naissance du compositeur français, le label Indésens-Calliope réédite l'intégrale de l'œuvre pour piano de Maurice Ravel (1875-1937), gravée en 1974 et 1975, par les pianistes Jacques Rouvier et Théodore Paraskivesco. Enregistrements de référence entièrement remastérises pour une écoute optimale. Un programme copieux comprenant Ma Mère l'Oye (1908-1910) Habanera (1895-1897) Gaspard de la nuit (1908) Pavane pour une infante défunte (1899) Jeux d'eau (1901) Menuet sur le nom de Haydn (1909) Valses nobles et sentimentales (1911) Miroirs (1904-1905) Sonatine (1903-1905) Le Tombeau de Couperin (1914-1917) Prélude (1913) A la manière de Borodine (1912) A la manière de Chabrier (1912) et Menuet antique (1895). Autant de pièces comme autant d'atmosphères différentes, de souvenirs rêvés d'Espagne, de pastiches, d'évocations féériques du monde enfantin, de mélanges de grâce et de mélancolie, de mélodies et de dissonances, de virtuosité, de volupté et d'amitiés perdues. Une richesse musicale incomparable du maitre français parfaitement rendue par le jeu superlatif de Jacques Rouvier alliant souplesse, fluidité et inspiration. Un enregistrement de référence assurément !

Patrice Imbaud.
« Orient – Occident ». Arvo PÄRT. Jaan RÄÄT. Dimitri CHOSTAKOVITCH. Éric Aubier, trompette. Roustem Saïtkoulov, piano. Orchestre des Pays de Savoie, dir. Nicolas Chalvin. 1 CD Indésens : INDE070. TT : 58'10.
Un magnifique album qui présente des œuvres de deux compositeurs estoniens contemporains, Arvo Pärt (*1935) et Jaan Räät (*1932), auxquelles s'associe le célèbre Concerto n°1 pour piano, trompette et orchestre à cordes de Dimitri Chostakovitch. Une façon de rendre hommage et de reconnaitre la filiation et une sorte d'héritage entre le maitre russe et les deux compositeurs estoniens. Le concerto de Chostakovitch date de 1933, défini par le compositeur comme le reflet d'une époque héroïque, animé et plein de joie de vivre. Le Konzert für Trompete, Klavier und Orchester de Jaan Rääts est une œuvre moins connue faite de collages juxtaposant ruptures et déferlantes d'un piano très percussif d'où émergent les appels ardents et répétés de la trompette poussée au bout de ses possibilités expressives. Une musique violente et angoissante qui avance dans une marche inexorable et désespérée laissant sourdre néanmoins au travers d'une nébuleuse tourmentée quelques instants de sérénité extatique. Le Concerto piccolo über B.A.C.H für Trompete, Streichorchester, Cembalo und Klavier d'Arvo Pärt réaffirme clairement une double parenté avec Bach, bien sûr, mais également avec Chostakovitch, par son caractère ambigu d'ironie oppressante et d'humour grotesque. Cantus in Memory of Benjamin Britten atteste de façon sublime de la vive admiration d'Arvo Pärt pour le compositeur britannique par cette prière poignante et élégiaque dont les spires ascendantes, s'élevant vers le ciel, sont ponctuées par le glas de la cloche en « La 442 » fondue sur mesure par une fonderie savoyarde pour l'Orchestre des Pays de Savoie. Ce disque se conclut sur une pièce d'Arvo Pärt faisant la synthèse d'un Orient mélodique et d'un Occident harmonique, Orient & Occident für Streichorchester qui donne son nom à l'album. Un programme original, une interprétation ne souffrant aucun reproche, une belle réussite. Un disque coup de cœur !
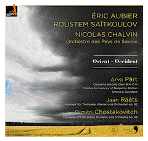
Patrice Imbaud.
Alfredo CASELLA : Concerto pour violon en la mineur op. 48. Mario CASTELNUOVO-TEDESCO : Concerto pour violon en sol mineur N°2 « I Profeti ». Domenico Nordio, violon. Orchestra della Svizzera Ilaliana, dir. Tito Ceccherini. 1 CD Sony Classical : 88875038722. TT : 69'05.
Deux compositeurs italiens du XXe siècle, peu connus du grand public, au programme de ce CD original. Alfredo Casella (1883-1947), pianiste et compositeur, élève de Gabriel Fauré au Conservatoire de Paris, fut secrétaire de la Société Musicale Indépendante fondée par Ravel en France, avant de retourner en Italie où il créa la Société Italienne de Musique Moderne. Fervent défenseur de Stravinski et Schönberg, il composa son Concerto pour violon et orchestre en 1928, une œuvre brillante, virtuose et contrastée marquant son retour à la tonalité. Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968), également pianiste et compositeur, fut élève de Casella. Ses origines juives l'obligèrent à émigrer en 1939 aux États-Unis. Son Concerto pour violon n° 2 dit « I Profeti » fut composé en 1931, dédié à Heifetz, créé par Toscanini et le New York Philharmonic le 13 avril 1933. La référence aux prophètes de ce concerto marque l'attachement du compositeur florentin à ses racines juives, chacun des trois mouvements qui le constituent portant le nom d'un prophète, Isaïe, Jérémie et Élie. Deux œuvres post romantiques, tonales, une très belle musique reposant sur une riche ligne mélodique, parfois orientalisante, rythmées et virtuoses, aux couleurs chatoyantes chargées d'émotion, portées magistralement par le violon de Domenico Nordio et l'orchestre de la Suisse italienne dirigé par Tito Ceccherini. Formons le vœu que le violoniste italien puisse inspirer nombre de ses collègues, ouvrant ainsi la voie à un renouvellement du répertoire violonistique souvent limité à quelques œuvres phares inlassablement rabâchées à longueur de concerts… A découvrir absolument !

Patrice Imbaud.
***
MUSIQUE ET CINEMA
ENTRETIEN
Le compositeur Cyrille Aufort

DR
Titulaire
de plusieurs Premiers Prix du Conservatoire National de Musique de Lyon et de
Paris, ce musicien d'à peine quarante ans a tout d'abord composé de la musique
pour des documentaires et des courts-métrages. Il a fait ses premières armes
dans le cinéma en qualité d'orchestrateur. Il a collaboré avec Alexandre Desplat (Otage),
Yvan Cassar (Massaï, Quartier VIP,
l'Odyssée de l'Espèce), avant de se voir confier la composition de la
musique originale de longs métrages, Ombline, de Stéphane Cazes, L'âge de
Raison de Yann Samuell, 9A de Reza Rezaï
ou Hell de
Bruno Chiche, et de téléfilms tels que La
Maison Tellier d' Elisabeth Rappeneau.
Il a composé pour le magnifique documentaire de Jacques Perrin L'Empire du Milieu, une belle
composition musicale. C'est parce que nous avons apprécié la musique de l'Homme Idéal (Cf. NL de 4/2015), que
nous sommes allés le rencontrer dans son petit studio en banlieue parisienne,
surplombant le parc de Sceaux. Il nous a reçu de
manière décontractée entre deux compositions.
Quelle est votre actualité ?
Juste
après L'Homme Idéal je viens de finir
la musique du film de Luc Jacquet qui s'appelle La Glace et le Ciel.
Après La
Marche de l'Empereur il doit aimer les terres glaciales ? Comment
l'avez-vous rencontré ?
Je
cois que c'est par le supervisor musical, Varda Kakon. J'ai fait des essais sur ce qu'il m'a donné et puis
ça lui a plu.
Quelle est l'histoire ?
C'est
l'histoire de Claude Lorius, glaciologue français,
qui a mis en évidence le lien entre la concentration atmosphérique en gaz à
effet de serre et l'évolution du climat.
Est-ce un film écolo ?
Oui et non.
Un biopic alors?
Il y
a beaucoup d'archives. Le film raconte sa vie à partir de sa première expédition
en antarctique jusqu'à ce qu'il découvre le taux de CO2 et d'autres gaz dans
les carottages et leurs rapports avec les variations climatiques ; ça
remet au centre ces gens qu'on n'entend pas souvent, qui sont des
scientifiques, et qui ont passé 50 ans de leur vie sur ce problème. Enfin un
vrai film écologique.
Que pensez-vous du pouvoir de cet
intermédiaire entre le réalisateur et le compositeur qu'on appelle supervisor musical et dont on ne connaît pas trop ni son
origine ni ses talents?
On
pourrait appeler cela un producteur musical. A la base c'est aider le
réalisateur, qui n'a pas forcément une idée musicale, à trouver la bonne
personne ; ensuite il gère la production musicale.
C'est comme le directeur de casting ;
il faut être bien avec lui pour qu'il vous propose.
Il y
a des réalisateurs qui ne savent pas à qui s'adresser, qui ne savent pas quel
type de musique il faut pour leur film. C'est un conseiller, il donne des idées
de compositeurs, puis après il y a toute la production musicale dont s'occupe
le supervisor. La musique est un domaine très
particulier, il y a les questions de droits, de cessions, celle aussi de
trouver un orchestre….Chez les américains ça existe depuis longtemps.
Comment vous l'aviez rencontré ?
Elle
avait apprécié la musique de Splice et c'est à
cette occasion qu'on s'était rencontré.
Votre parcours s'est fait à travers des supervisors ?
Non,
chaque rencontre est unique. Il y a des gens qui appellent mon agent, d'autres
qui vont sur mon site et quelques fois des appels d'offre. C'est très varié.
En lisant des interviews que vous avez
données, on voit que vous avez toujours voulu écrire de la musique de
film ; Y'a-t-il des musiques ou des compositeurs qui vous ont impressionné
; ne me dites pas John Williams !
Je
suis venu à la musique de film par l'orchestre ; avant d'entrer au
conservatoire, quand j'ai décidé de faire des études d'écriture, ce qui
attirait le plus mon oreille c'était l'orchestre. J'ai fait un peu de violon et
le 2ème Concerto de Prokofiev. C'est là où j'ai découvert l'orchestre. La
première musique de film qui m'a marquée c'est Alexandre Newsky. Je devais avoir 17, 18
ans, c'est mon premier coup de cœur ; très musique classique.
Vous avez travaillé quand même pour la variété ?
Effectivement,
quand j'ai quitté le conservatoire, les premières choses que j'ai faites sont
des arrangements pour la variété.
C'est une bonne école, non ?
Très
bonne parce que vous devez vous intégrer dans un discours qui est présent, avec
une chanson qui est là, avec des accords qui sont là, une mélodie, et il faut
arriver à se placer dans le peu de place qui vous reste. De plus, les chanteurs
n'aiment pas se trouver avec un langage très classique ; donc ça apprend à se casser la tête pour trouver
des solutions. Et puis j'ai appris mon métier au studio.
A un moment vous avez eu des velléités de composer.
Cela c'est fait
petit à petit.
Si on écoute vos musiques on peut dire que
vos arrangements ont une pâte classique. On retrouve cette manière d'écrire
dans, par exemple, la Maison Tellier
ou dans le dernier film qui vient de sortir Un
Homme Idéal.
C'est
difficile d'avoir du recul sur son travail, je suis incapable de vous répondre.
J'écris ce que j'entends. Après, bien sûr, il y a une discussion avec le
réalisateur ; je ne commence jamais en me souvenant de ce que j'avais fait
avant.
Est-ce que vous composez toute la
partition, comme un vrai compositeur ?
J'écris
tout, mais si demain je suis débordé je prendrai un orchestrateur. C'est un
problème de timing. Ce qui a changé par rapport aux années 70, c'est qu'il y a
l'informatique. Aujourd'hui vous faites des maquettes qui vont se rapprocher,
avec des faux sons d'orchestre, un petit peu plus du produit fini enregistré.
Et donc aujourd'hui, par rapport à il y a vingt ans, le réalisateur peut
écouter et mettre son nez dans la musique, ce qui n'était pas possible avant.
Je ne sais pas ce que pouvait faire écouter Jerry Goldsmith au réalisateur de
la Planète des Singes avant que cela
soit enregistré ; c'est une musique très abstraite. Si je devais donner ma
musique à un orchestrateur, il y aurait toutes les lignes pour les instruments,
tout y serait. Les compositeurs sérieux donnent des choses complètes. Cela
n'empêchera pas l'orchestrateur de mettre ses idées, car c'est très frustrant. Souvent
les orchestrateurs mettent ce qu'on appelle des « you
parts », des choses qui sont d'eux, et ils mettent en face un petit trait
qui veut dire que ce sont des choses optionnelles, non prévues par le
compositeur.
Goldsmith c'est quelqu'un que vous appréciez ?
Ah
oui, c'est idiot de le dire : c'est mon idole. C'est vraiment un des
compositeurs de cinéma pour qui j'ai le plus d'admiration. Ce n'est pas
seulement un compositeur, c'est un film maker, un homme de cinéma ! Il a
écrit des choses incroyables, il a tout balayé avec une inventivité
stupéfiante. La place de la musique dans la Planète
des Singes est impressionnante. Je l'ai découvert avec Alien, puis j'ai écouté beaucoup
de ses musiques, Papillon, Capricorne
One. Il y a toutes les époques, il y a tous les grands thèmes chez lui. Il
a ce savoir faire orchestral qu'ont tous les gens de cette époque là, des
compositeurs assez incroyables. Avec Basic
Instinct c'est lui qui a amené cette esthétique qui a été pillée pendant
des années, ce truc un peu modale, assez simple, assez chromatique dans la
ligne mélodique ; mais à l'image c'est assez fascinant. Il a touché à tous les
genres, avec du jazz, des synthés, Chinatown,
Tora Tora….
Vous avez une belle culture cinématographique ?
Non,
j'ai des lacunes, mais j'adore le cinéma des années 70, Peckinpah,
Friedkin, les films de Pakula
The Parallax View, Klute, Les Hommes du Président, j'adore ce style de film.
Vous écoutez vos confrères ?
Ah
oui, oui, lorsque je regarde un film je suis très attentif à la musique et
j'apprécie les bonnes idées. J'achète beaucoup de musique en CD ou par
internet. Si je trouve une musique de Goldsmith, que je n'ai pas, j'achète quel
que soit le film !
Ils vont inspirent, ils vous donnent envie
d'écrire ?
Me donnent envie
certainement, m'inspirent inconsciemment peut-être.
Cette normalisation de la musique aux
États-Unis n'est pas très inspirante quand même ?
Oui,
il y a cette musique Blockbuster, mais Hollywood fait aussi un autre cinéma. Desplat a un réel talent : Imitation Game, je l'ai beaucoup apprécié.
Il y a une différence entre l'orchestrateur et
l'arrangeur.
Effectivement
l'orchestrateur c'est celui qui reprend les sketches et doit faire le vrai
score pour qu'il soit joué par les musiciens ; l'arrangeur est quelqu'un
qui à partir d'une partie de piano va arranger, orchestrer bien sûr, mais c'est
lui qui va écrire les lignes de contrechants, qui va choisir les timbres. Il y
a effectivement des compositeurs qui ne donnent que le thème et c'est
l'arrangeur qui fait tout.
On ne citera pas de nom. Sur Royal Affair,
comment s'est passée votre collaboration avec Gabriel Yared
?
Superbe
film ! On s'était rencontré plusieurs fois, il aimait bien ce que j'avais
fait pour L'Empire du Milieu et il
avait un problème de planning. Il a écrit les thèmes principaux, moi j'ai fait
des thèmes annexes et puis on s'est partagé les différentes séquences sur le
film. Quand il a proposé mon nom à la production il se trouve que le
réalisateur avait vu Splice
une semaine avant ; donc il a dit oui tout de suite.
Splice a été pour vous une belle expérience...
Oui,
Oui, j'ai eu une très jolie relation avec le réalisateur Vincenzo
Natali. C'était passionnant d'écrire le score pour ce
film ; ce qui est intéressant dans ce métier ce sont les rencontres humaines
variées. Il faut essayer de pénétrer l'univers du réalisateur, comprendre ce
qui l'émeut et puis aussi l'entraîner sur mon terrain.
Vous avez composé surtout des musiques romantiques,
dramatiques.
Effectivement
les films auxquels j'ai participé ne sont pas des comédies. J'aime le post
romantisme, Rachmaninov c'est tout ce que j'affectionne. Peut-être que ça se
retrouve inconsciemment dans ma façon de traiter les lignes. Le réalisateur de l'Homme Idéal me disait souvent : c'est
trop fleur bleue ; pour lui ça voulait dire romantique. Vincenzo me l'avait
fait remarqué en revoyant le film après coup.
Ce sont des musiques qui sont très présentes.
C'est
vrai qu'elles le sont. Dans Splice il y a
beaucoup de musiques. Dans L'Age de
Raison elles sont un peu plus derrière. Mais effectivement dans la plupart
elles le sont.
Avec votre musique pour L'Homme Idéal avez-vous eu des
retombées ?
C'est
un peu court, le film est sorti il y a à peine un mois. A part vous et vos
confrères qui ont apprécié mon travail, professionnellement pas encore.
Vous êtes arrivé au début de la production ?
Non,
le film était en montage, comme souvent d'ailleurs. Yann Gozlan est un féru de musique, il adore les grands
scores, on a beaucoup de points communs, c'est assez rare qu'un jeune
réalisateur ait cette culture. Il déteste ce qui est un tripatouillage de sons,
il voulait du langage ; c'est quelqu'un qui apprécié Komeda,
la musique de Rosemary's baby. Il adore Goldsmith. Je ne connais
pas beaucoup de réalisateurs qui citeraient Komeda
(NDLR : mort à 37 ans, compositeur
jazzman qui a écrit toutes les musiques des films de Polanski). Il avait
envie de quelqu'un qui écrit de la musique et non qui bidouille les sons.
Lorsqu'on a peu de temps, comme sur ce film, il faut que le réalisateur vous
fasse confiance. C'est son deuxième film et à un moment c'est le stress ;
elle échappe totalement au réalisateur. Les trois premières séquences que j'ai
faites c'était toutes les grosses ellipses, les ostinatos quand il écrit le
livre, le sostinato lorsqu'il a le succès. Cette
pulsation lui a plu, ensuite je suis entré dans les morceaux de tension. On a
eu beaucoup de discussions, beaucoup d'essais, que j'ai remaniés car il les
trouvait trop romantiques pour le coup ;
il voulait une vraie descente aux enfers, que la musique appuie sur ce
style.
Y'avait-il des musiques pour le pré montage ?
Peu,
il y avait des musiques de Prisoners, mais il
en était très détaché. J'espère qu'on retravaillera ensemble.
En 2010 vous êtes allé à Aubagne, vous
aviez été choisi pour animer la master class. Comment
se passe ce genre d'événement ?
Quand
on m'a présenté le projet, c'était assez obscur pour moi : il y a une dizaine
de musiciens à chapeauter et en dix jours il faut faire un ciné concert de 45
musiques, une composition collective. Je trouvais le projet amusant sans
comprendre comment cela pouvait se faire. Et finalement il y a un truc qui se
passe avec les jeunes étudiants, chacun apporte ses idées et il y a une musique
qui se construit sur dix jours C'est crevant parce qu'il faut monter un
programme mais c'est assez passionnant.
Vous avez encore des contacts avec ces étudiants ?
Avec
quelques uns, Fabien Cali par exemple : il vient de composer la musique du
documentaire Terre des Ours de
Vincent Remy Boubal qui
fait beaucoup de choses à la fois pour la télé et le cinéma.
Un agent c'est important pour un compositeur ?
C'est
essentiel ; c'est important pour moi de ne pas parler d'argent avec les
productions ; et puis si vous n'avez pas d'agent vous passez votre vie au
téléphone au lieu d'écrire de la musique ou d'attendre un projet. Et puis il
gère vos contrats.
Vous avez fait des musiques pour l'image,
qu'on trouve en CD chez Cézanne music Library.
Ce
sont des musiques des téléfilms, ils les remixent, c'est un travail de
librairie.
Pour terminer parlez-moi de votre
collaboration avec l'orchestre de Basse Normandie ?
J'écris
pour un ciné concert une fois par an, l'orchestre joue en direct face à un film
muet. C'est du boulot mais c'est super, ça donne une certaine liberté de
création, on est seul face à des images, on n'a pas le réalisateur sur le dos,
on fait ce qu'on veut, on invente. Il ne faut surtout pas faire du mickeymousing. C'est très agréable à écrire, j'en ai fait
plusieurs, j'ai fait des Chaplin et le plus long que j'ai composé c'était Le Vent de Victor Sjöstrom ; il y avait une heure seize de musiques, un vrai
mélo !
Cyrille
gentiment m'a raccompagné en voiture à la gare et on a continué à parler de
cinéma et de musiques de films. Un vrai fondu du Septième art ce talentueux
compositeur !

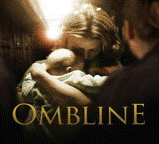


https://www.youtube.com/watch?v=skz1zUc512U
https://www.youtube.com/watch?v=gQ8VnFzYqHQ
Propos recueillis
par Stéphane Loison.
BO en CDs
FURYO: Réalisateur : Nagisa Oshima. Compositeur :
Ryuichi Sakamoto. 1CD Milan Music : n° 399 709-2
Oshima –Bowie – Sakamoto
trois stars pour un film mythique et un tube planétaire :« Merry Christmas Mr.Lawrence ».
La sortie de ce disque correspond à l'exposition sur cet icône qu'est Bowie à
la Philharmonie de Paris, qu'on peut voir jusqu'à la fin du mois. La
cinémathèque vient de faire un hommage au réalisateur Oshima
par une rétrospective à la cinémathèque de Paris. Sakamoto a écrit cette
musique en 1983, c'était sa première musique de films. Dès les années 78, il
s'intéresse à la musique électronique et s'est produit avec son groupe Yellow Magic Orchestra. C'est
avec Furyo
qu'il se fait connaître au monde occidental. Il a reçu un BAFTA pour sa
composition. En 1984, il reçoit l'Oscar pour Le Dernier Empereur de
Bertolucci avec qui il collaborera plusieurs fois. De nombreux réalisateurs ont
fait appel à lui tels qu'Almodovar, Brian de Palma, Stone, Schlöndorff. Soyons
clair, pas pour le meilleur. Sa musique a assez mal vieilli par l'emploi
d'instruments plus guère utilisés. Mais en ces temps de revival, ils reviennent
à la mode (voir les musiques de Rob). Aujourd'hui il a un statut de star du rock
japonais et jouit d'une très large audience à travers le monde. Ses
compositions sont un mélange de musique classique occidentale, de sonorités
traditionnelles japonaises et de musique électronique. Furyo est un album pour
nostalgique mais qui s'écoute.

https://www.youtube.com/watch?v=iKXr3OSLVWs
IT FOLLOWS : Réalisateur :David Robert Mitchell. Compositeur : Disasterpeace. 1CD Milan Music :399
688-2
Après une expérience sexuelle apparemment
anodine, Jay se retrouve confrontée à d'étranges
visions et l'inextricable impression que quelqu'un, ou quelque chose, la suit.
Abasourdis, Jay et ses amis doivent trouver une échappatoire à la menace qui
semble les rattraper... Ce film sans prétention aux allures de teen movie avec de jolies filles,
des adolescents binoclards sympas est une sorte de cauchemar éveillé, non dans
le style Freddy, mais plutôt dans un univers à la Carpenter, Linch avec des clins d'œil
au cinéma classique fantastique – Tourneur et la scène de la piscine -.
Dans le film de genre on peut se permettre d'être expérimental et c'est ce
qu'ose David Robert Mitchell. Qui suit ? Qui sont ces sortes de Zombis qui
lorsque vous avez fait l'amour vous veulent du mal ? Quel rapport
existe-il avec le sexe et ces suiveurs ? Tout le film réside dans ces interrogations.
Mitchell met en scène ici des angoisses typiquement juvéniles, associées à la
sexualité et à un mal être existentiel. Dans « It Follows »
c'est le morbide qui domine plus que l'horreur. Tout cela est fort bien
maîtrisé par ce jeune réalisateur et la direction d'acteur est exemplaire. La
musique écrite par Disasterpeace augmente ce climat
d'angoisse. Rich Vreeland,
de son vrai nom, est un jeune américain qui a écrit de la musique pour des jeux
vidéo. Avec ses nappes de musiques, il compose une partition totalement en
accord avec ce qui se passe à l'écran et même ajoute à la dramatisation alors
que l'image est presque banale. Il annonce le drame avec ce double discours.
C'est une musique synthétique qui rappelle celle de Carpenter, une musique anxiogène
expérimentale. C'est du beau travail et son écoute ne laisse pas indiffèrent ;
on peut se faire son petit film angoissant rien qu'à l'entendre. Un disque de
bonne facture. « It Follows » a reçu le
prix du jury de la Critique Internationale et Prix de la Jeunesse
Denis-de-Rougemont au Festival International du Film fantastique de Neuchâtel
2014.

https://www.youtube.com/watch?v=7dwvCkaTBz0&list=PLbRpHkuMazSLFsP80IeevRHNMrH6noa7-
DRACULA : Réalisateur :
Terence Fisher. Compositeur : James Bernard. 1CD Dust
Bug Records (Réédition)
Le compositeur anglais James Bernard était le
compositeur attitré de la fameuse maison de production Hammer
qui est aujourd'hui portée aux nues et dont les films sont considérés ; alors
que dans les années 70, c'était du cinéma Z. Bernard a composé pour
pratiquement tous les films de Terence Fisher, un des meilleurs réalisateurs de
la Hammer. Ce film de 1958 est un pur chef d'œuvre
baroque et Christopher Lee restera le Dracula pour des siècles et des siècles
malgré Belà Lugosi et Gary Oldman. Toute une génération le vénère aujourd'hui à cause
du « Seigneur des Anneaux »
et de son rôle de Saroumane, encore un être au
pouvoir terrifiant ! La musique est très orchestrale, toujours dans
l'énergie, avec profusion de cuivres, de glissandos de cordes. Trilles de
flûtes et tambour en sourdine, et cuivres aux lointains annoncent
immanquablement l'arrivée du Prince des ténèbres. Le générique de fin est
toujours, dans ce genre de film, une petite mélodie très bucolique avec
clarinette, flûte et violon. Le cauchemar est terminé…jusqu'au prochain réveil
de Dracula ! Le cauchemar continue pour notre plus grand plaisir.

https://www.youtube.com/watch?v=c41qUVJ8fqk
L'ASTRAGALE
: Réalisation : Brigitte Sy.
Compositrice : Béatrice Thiriet. 1CD Cristal records (par téléchargement).
Une
nuit d'avril 1957. Albertine, 19 ans, saute du mur de la prison où elle purge
une peine pour hold-up. Dans sa chute, elle se brise l'os du pied :
l'astragale. Elle est secourue par Julien, repris de justice, qui l'emmène et
la cache chez une amie à Paris. Pendant qu'il mène sa vie de malfrat en
province, elle réapprend à marcher dans la capitale. Julien est arrêté et
emprisonné. Seule et recherchée par la police, elle se prostitue pour survivre
et, de planque en planque, de rencontre en rencontre, lutte au prix de toutes
les audaces pour sa fragile liberté et pour supporter la douloureuse absence de
Julien…Ce remake du roman d'Albertine Sarrasin – Marlène Jobert
mise en scène Par Guy Casaril 1968 - a trouvé en
Leïla Bekhti et Reda Kateb
le couple qu'il fallait. Le film en noir et blanc est subtilement mis en scène
et servi par une musique simple, discrète et juste. Béatrice Thiriet a eu l'idée de prendre un violon comme instrument
principal (joué magnifiquement par Laurent Korcia)
car le personnage d'Albertine Sarrazin était violoniste. Pour la réalisatrice
cette musique était le nerf de la guerre, explique-t-elle dans une interview.
La compositrice a écrit une mélodie romanesque pour piano – violon, une
identification à ce couple qui vit une passion amoureuse. Cette petite mélodie
entêtante correspond bien à l'ambiance de ce joli film, émouvant, sincère,
pudique, peut-être un peu trop sage. On entendra aussi une adaptation de la
Sicilienne de Bach, une musique intemporelle comme les belles histoires
d'amour. Béatrice Thiriet prouve encore une fois
qu'elle a beaucoup de talent. Un film à voir et une musique à écouter.

https://www.youtube.com/watch?v=HWM_uz3wxOw
LES
FEUX DE LA CHANDELEUR / LA VIEILLE FILLE. Musiques composées et
dirigées par Michel Legrand. Livret de 8 pages, notes internes français-anglais
par Nicolas Magenham. 1CD Music Box Records
- Référence : MBR-064
En collaboration avec Warner Chappell Music
France, Music Box Records met à l'honneur, pour la première fois, le
compositeur mythique Michel Legrand, dans un album regroupant deux films
français de 1972 mettant en vedette Annie Girardot, alors au sommet de sa
popularité.
La
Vieille fille,
de Jean-Pierre Blanc, raconte l'histoire d'un couple qui commence à s'aimer
sans se l'avouer, dans la douceur des grandes vacances. Annie Girardot y donne
la réplique à Philippe Noiret. Film au ton atypique dans le paysage du cinéma
français d'alors, la musique de Legrand l'est tout autant. Le compositeur
privilégie l'intériorisation, reflétant ainsi la timidité maladive du
personnage principal, et rassemble une série d'instruments discrets et
raffinés, mais qui ont cependant chacun une couleur bien affirmée
(glockenspiel, célesta, harpe, clavecin, etc.). Cette musique, d'une étrange et
douce mélancolie (mais aussi à l'occasion dissonante et pop), comporte de
belles marches harmoniques descendantes qui illustrent l'enfoncement du
personnage d'Annie Girardot dans le mutisme et la réserve. La musique a plus
d'intérêt que le film.
Les
Feux de la Chandeleur
relate la séparation de Marie-Louise et d'Alexandre (Jean Rochefort) dans une
petite ville de province. Les années passent, mais Marie-Louise vit de plus en
plus dans l'espoir d'une réconciliation, un espoir qui la rendra folle et
finira par la tuer. Michel Legrand ne cherche pas ici à esquiver le premier
degré et à atténuer l'aspect mélodramatique du film de Korber.
Il offre une partition où dominent des cordes déchirantes qui interprètent un
thème d'une tristesse infinie. Mais derrière le mélodrame, le film raconte
également la chronique d'une vie provinciale sur plusieurs années, ce que le
compositeur illustre en utilisant une batterie et une basse jazzy, dont la
nonchalance et l'aspect rassurant contrastent avec l'ampleur de l'orchestre
symphonique. Le score comporte également des morceaux pop très seventies, ainsi
qu'un clin d'œil amusant à la comédie musicale. Une consécration internationale
grâce à Jacques Demy.
Entre
l'exaltation romantique des Feux de la Chandeleur et la
délicatesse mélancolique de La Vieille fille, cet album
propose donc un portrait riche, complexe et quasiment schizophrénique du
compositeur Michel Legrand en ce début des années 70. Le cinéma français n'est
pas brillant en ces années là mais Legrand est au sommet de sa création.

https://www.youtube.com/watch?v=NueR8ryw-lA
Stéphane
Loison.
***
LA VIE DE L’EDUCATION MUSICALE
Si vous souhaitez promouvoir
votre activité, votre programme éditorial ou votre saison musicale dans L’éducation musicale, dans notre Lettre
d’information ou sur notre site Internet, n’hésitez pas à me contacter au 01 53
10 08 18 pour connaître les tarifs publicitaires.
maite.poma@leducation-musicale.com
|
Les projets d’articles sont à envoyer à redaction@leducation-musicale.com
Les livres et les CDs sont à envoyer à la rédaction de l’Education
musicale : 7 cité du Cardinal Lemoine 75005 Paris
Tous les dossiers de l’éducation musicale
·
La librairie de L’éducation
musicale
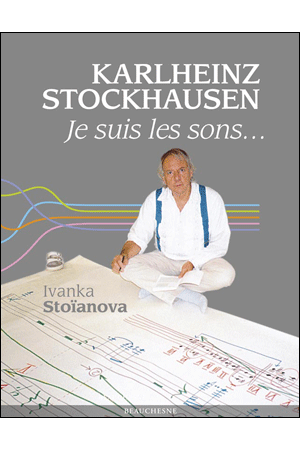 |
Ce livre, que le compositeur souhaitait publier dans sa maison d’édition à Kürten, se propose de présenter les orientations principales de la recherche de Karlheinz Stockhausen (1928-2007) à travers ses œuvres, couvrant sa vie et ouvrant un accès direct à ses écrits. Divers domaines investis par le plus grand inventeur de musique de la seconde moitié du xxe siècle sont abordés : composition de soi à travers les matériaux nouveaux ; découvertes formelles et structures du temps ; musique spatiale ; métaphore lumineuse ; musique scénique ; l’hommage au féminin de l’opéra Montag aus Licht ; Wagner, Stockhausen et le Gesamtkunstwerk, œuvre d’art total. Les témoignages des femmes qui l’ont accompagné dressent un portrait vif et saisissant de l’homme, artiste génial qui aimait plus que tout la musique et la recherche compositionnelle au nom du progrès de l’être humain...(suite) | |
 |
Analyses
musicales
XVIIIe siècle – Tome 1
L’imbroglio
baroque de Gérard Denizeau
BACH
Cantate BWV 104 Actus tragicus : Gérard Denizeau Toccata ré mineur : Jean Maillard Cantate BWV 4: Isabelle Rouard Passacaille et fugue : Jean-Jacques Prévost Passion saint Matthieu : Janine Delahaye Phœbus et Pan : Marianne Massin Concerto 4 clavecins : Jean-Marie Thil La Grand Messe : Philippe A. Autexier Les Magnificat : Jean Sichler Variations Goldberg : Laetitia Trouvé Plan Offrande Musicale : Jacques Chailley
COUPERIN
Les barricades mystérieuses : Gérard Denizeau Apothéose Corelli : Francine Maillard Apothéose de Lully : Francine Maillard
HAENDEL
Dixit Dominus : Sabine Bérard Israël
en Egypte : Alice Gabeaud
Ode à Sainte Cécile : Jacques Michon L’alleluia du Messie : René Kopff
Musique feu d’artifice : Jean-Marie Thill |
|
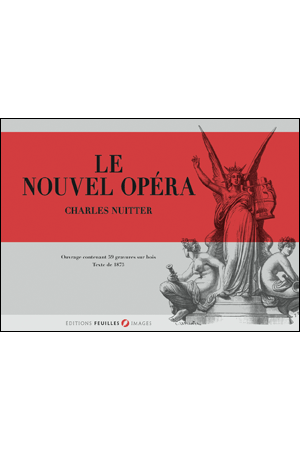 |
Publié l'année même de son ouverture, cet ouvrage raconte avec beaucoup de précisions la conception et la construction du célèbre bâtiment. |
|
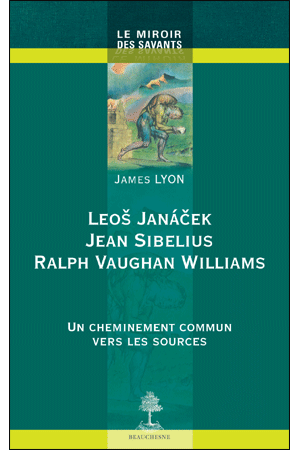 |
Pour la première fois, le Tchèque Leoš Janácek (1854-1928), le Finlandais Jean Sibelius (1865-1957) et l'Anglais Ralph Vaughan Williams (1872-1958) sont mis en perspective dans le même ouvrage. En effet, ces trois compositeurs - chacun avec sa personnalité bien affirmée - ont tissé des liens avec les sources orales du chant entonné par le peuple. L'étude commune et conjointe de leurs itinéraires s'est avérée stimulante tant les répertoires mélodiques de leurs mondes sonores est d'une richesse émouvante. Les trois hommes ont vécu pratiquement à la même époque. Ils ont été confrontés aux tragédies de leur temps et y ont répondu en s'engageant personnellement dans la recherche de trésors dont ils pressentaient la proche disparition. (suite). |
|
 |
Ce guide s’adresse aux musicologues, hymnologues, organistes, chefs de chœur, discophiles, mélomanes ainsi qu’aux théologiens et aux prédicateurs, soucieux de retourner aux sources des textes poétiques et des mélodies de chorals, si largement exploités par Jean-Sébastien Bach, afin de les situer dans leurs divers contextes historique, psychologique, religieux, sociologique et surtout théologique. Il prend la suite de La Recherche hymnologique (Guides Musicologiques N°5), approche méthodologique de l’hymnologie se rattachant à la musicologie historique et à la théologie pratique dans une perspective pluridisciplinaire. Nul n’était mieux qualifié que James Lyon : sa vaste expérience lui a permis de réaliser cet ambitieux projet. Selon l’auteur : « Ce livre est un USUEL. Il n’a pas été conçu pour être lu d’un bout à l’autre, de façon systématique, mais pour être utilisé au gré des écoutes, des exécutions, des travaux exégétiques ou des cours d’histoire de la musique et d’hymnologie. » (suite) |
|
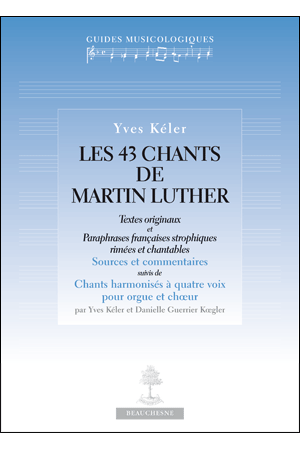 |
Cet ouvrage regroupe pour la première fois les 43 chorals de Martin Luther accompagnés de leurs paraphrases françaises strophiques, vérifiées. Ces textes, enfin en accord avec les intentions de Luther, sont chantables sur les mélodies traditionnelles bien connues. Aux hymnologues, musicologues, musiciens d'Eglise, chefs, chanteurs et organistes, ainsi qu'aux historiens de la musique, des mentalités, des sensibilités et des idées religieuses, il offrira, pour chaque choral ou cantique de Martin Luther, de solides commentaires et des renseignements précis sur les sources des textes et des mélodies : origine, poète, mélodiste, datation, ainsi que les emprunts, réemplois et créations au XVIè siècle... (suite) |
|
 |
Mozart aurait-il été heureux de disposer d'un Steinway de 2010 ? L'aurait-il préféré à ses pianofortes ? Et Chopin, entre un piano ro- mantique et un piano moderne, qu'aurait-il choisi ? Entre la puissance du piano d'aujourd'hui et les nuances perdues des pianos d'hier, où irait le cœur des uns et des autres ? Personne ne le saura jamais. Mais une chose est sûre : ni Mozart, ni les autres compositeurs du passé n'auraient composé leurs œuvres de la même façon si leur instrument avait été différent, s'il avait été celui d'aujourd'hui. Mais en quoi était-il si différent ? En quoi influence-t-il l'écriture du compositeur ? Le piano moderne standardisé, comporte-t-il les qualités de tous les pianos anciens ? Est-ce un bien ? Est-ce un mal ? Qui a raison, des tenants des uns et des tenants des autres ? Et est-ce que ces questions ont un sens ? Un voyage à travers les âges du piano, à travers ses qualités gagnées et perdues, à travers ses métamorphoses, voilà à quoi convie ce livre polémique conçu par un des fervents amoureux de cet instrument magique.
|
|
Prix de souscription jusqu'au 30 juin 2015: 23 euros
|
Au travers du récit que James Lyon nous fait de l’existence de Dickens, il apparaît bien vite que l’écrivain se doublait d’un précieux défenseur des arts et de la musique. Rares sont pourtant ses écrits musicographiques ; c’est au travers des références musicales qui entrent dans ses livres que l’on constate la grande culture musicale de l’écrivain. Il se profilera d’ailleurs de plus en plus comme le défenseur d’une musique authentiquement anglaise, forte de cette tradition évoquée plus haut. Et s’il ne fallait qu’un seul témoignage enthousiaste pour décrire la grandeur musicale de l’Angleterre, il suffit de lire le témoignage de Berlioz (suite). |
***
NUMÉRO SPÉCIAL BAC 2015
178 pages - 19 euros
Le numéro de référence
Voir sur le site les PLUS du BAC 2015
|
|
PARU
Baccalauréat 2015. Épreuve de musique LIVRET DU CANDIDAT
144 pages - 9,50 euros … ce volume dédié aux candidats, de tous bords et de toutes formations, leur proposant certes des informations complètes sur les œuvres choisies, mais avec un accès aussi convivial que possible, sous forme de tableaux, de couleurs – tout ce qui permet de retenir les choses plus rapidement et efficacement – et également des conseils et exercices pratiques concernant les modalités de l’épreuve. Bien joli de dire aux futurs bacheliers qu’on leur demande de comparer. Encore faudrait-il donner des exemples de comparaisons, proposer des principes et des corrigés types. Quid des annales ? Des corrigés accessibles ? C’est cette tâche que nous avons décidé de confier à Philippe Morant, professeur agrégé d’Éducation musicale et chant choral…Consulter un extrait du Livret du Candidat Bientôt sur le site les PLUS DU LIVRET DU CANDIDAT 2015 |
·
Où trouver le numéro du Bac ?
Les analyses musicales de L'Education Musicale






