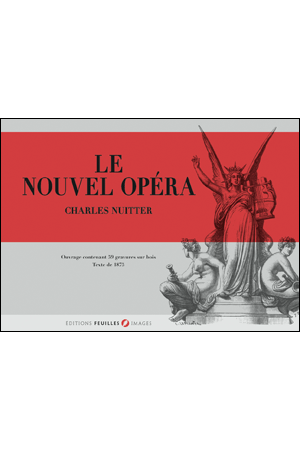FOCUS SUR LA MUSIQUE NOUVELLE - LUCIANO BERIO : TRANSCRIPTIONS ET RÉÉCRITURE. D'UNE ŒUVRE À L'AUTRE
LA VIE DE L’EDUCATION MUSICALE
À RESERVER SUR L'AGENDA
9, 11, 12, 14, 15 / 12
Événement : Manfred à l'Opéra Comique

Le rêve d'opéra de Robert Schumann, déjà
amorcé avec Genoveva, se
concrétiserait-il dans Manfred ? Ce « poème dramatique en trois
parties de Lord Byron avec musique », créé par Liszt, en 1852, à Weimar,
en est bien proche, même s'il oscille entre singspiel et musique de scène,
comportant morceaux chantés et mélodrame. Pour célébrer le héros byronien,
solitaire, maudit pour avoir tué la belle Astarté qu'il adorait, cherchant
l'oubli dans le suicide, Schumann mêle tonalités magiques, ranz alpin et autres
chants des esprits infernaux. Rarement donnée, eu égard à son caractère
composite, cette œuvre atypique, mais très attachante, connaît une nouvelle
production à l'Opéra Comique, qui fait
figure d'événement. L'équipe artistique s'est inspirée d'une version montée à
la Scala de Milan dans les années 1970. Nul doute que Georges Lavaudant, pour la mise en scène, et Emmanuel Krivine, à la tête de son orchestre de la Chambre
Philharmonique, sauront trouver le ton juste pour narrer le destin tourmenté du
héros romantique par excellence.
Opéra
Comique, les 9, 11, 12, 14 décembre 2013, à 20H, et le 15 décembre à 15H.
Location : Billetterie, 1, place Boieldieu,
75002 Paris ; par tel : 0825 01 01 23 ; en ligne : www.opera-comique.com
12 / 12
Dame Felicity Lott aux Lundis musicaux du Palais-Royal

© DR
Dame Felicity Lott est de retour sur une scène parisienne. Celle qui fut
une inoubliable Belle Hélène et autre désopilante Grande Duchesse de Gérolstein, nous revient pour un récital aux Lundis
musicaux du Théâtre du Palais-Royal. Cette manifestation s'inscrit dans une
programmation ambitieuse qui se promet de réunir quelques unes des plus grandes
voix du moment ; remise en selle d'une série initiée naguère par Pierre Berger.
La chanteuse anglaise, parisienne d'adoption, se livrera à un de ses exercices
favoris : revisiter le répertoire du Lied romantique, de Schumann, Hugo Wolf, Richard
Strauss. Et bien sûr l'univers secret de Reynaldo Hahn dont elle sait distiller comme personne les délicieux accents. Outre,
cette fois, un clin d'œil à Ben Britten. Au piano, son accompagnateur de
toujours, Maciej Pikulski.
Une soirée d'élégance vocale à n'en pas douter. A noter que suivront, les mois
à venir, des récitals de Dmitri Hvorostovsky (20/1), Max-Emanuel Cencic (10/2), Waltraud Meier
(24/2), Elina Garanca (7/4), Sumi Jo (12/5) et Anna Prohaska (22/6).
Théâtre
du Palais-Royal, le 12 décembre 2013, à 20H.
Location : au théâtre, 38, rue
Montpensier, 75001 paris ; par tél.: 01 42 97 40
00; en ligne : www.theatrepalaisroyal.com ou
resa@theatrepalaisroyal.com
13 / 12
L'Orchestre du Capitole se réjouit de musique française

Alain Altinoglu / © DR
Comme au bon vieux temps de Michel Plasson, l'Orchestre national du Capitole s'adonnera, à
l'occasion de son concert du 13 décembre prochain, à un répertoire qui lui est
cher. Cette fois sous la direction d'Alain Altinoglu.
Saint-Saëns et Ravel se partageront l'affiche. Le deuxième concerto pour piano,
op. 22, de l'auteur de Samson et Dalila, créé à la Salle Pleyel en 1868,
se signale par son premier mouvement andante introduit par une cadence du
soliste, et sa facture de quasi improvisation, comme par son brillant finale
presto, sur un rythme de tarentelle. Il sera interprété par le jeune et
talentueux Romain Descharmes. Quant à la symphonie
chorégraphique Daphnis et Chloé, on sait que Maurice Ravel y célèbre la
couleur au fil d'une orchestration brillante, « moins soucieuse
d'archaïsme que de fidélité à la Grèce de mes rêves », dira-t-il. Ce dont
Alain Altinoglu, fin maître de grandes fresques
françaises, devrait être le serviteur de choix.
Halle
aux Grains, Toulouse, le 13 décembre 2013, à 20H.
Location : Théâtre du capitole, Place du
Capitole, et Halle aux Grains, 1, place Dupuy, 31000 Toulouse ; Service
Location, BP 41408, 31014 Toulouse cedex 6 ; par tel : 05 61 63 13 13 ; en ligne : www.onct.toulouse.fr
13 & 14 / 12
Marc Chagall, la couleur des sons : récital de Mikhaïl Rudy

Le pianiste Mikhaïl Rudy
renouvelle une expérience dans laquelle il est passé maître, l'association
musique et images. Cette fois pour un récital sur un film d'animation conçu à
partir de dessins préparatoires et d'esquisses inédites de Marc Chagall pour le
plafond de l'Opéra Garnier. « Marc Chagall aimait écouter de la musique
pendant qu'il peignait... J'ai eu envie d'animer les personnages du plafond de
l'Opéra, de les voir valser sur la musique de Ravel, de faire s'envoler les
amants de Tristan et Yseult vers leur amour absolu, ou encore de faire briller
les mille couleurs de feu d'artifice de Debussy au son de mon piano ». Le
récital égrènera des pièces de Gluck, Mozart, Wagner, Debussy et Ravel,
révélant l'harmonie secrète des scènes imaginées par Chagall et le désir de
mouvement qui s'en dégage. L'interprète souligne le lien organique qui existe
entre peinture et musique, le film étant conçu non pas comme un simple
prétexte, et le piano comme pur accompagnant, mais l'un et l'autre agissant en
symbiose. Où la peinture devient musique.
Maison de la musique de
Nanterre, 8, rue de Anciennes-Mairies, 92000 Nanterre,
le 13 décembre 2013, à 20H30, et le 14 à 16H30.
Location : par tel au 01 41 37 94 21 ; en ligne : www.nanterre.fr
ou www.fnac.com
13, 14, 19 / 12
Un samedi à Montmartre...

Francis Poulenc/ DR
Les hommages rendus à Francis
Poulenc ne sont pas si nombreux, en particulier dans la capitale, pour qu'on ne
s'empresse pas de souligner celui qu'organise le CRR de Paris. « Un samedi
à Montmartre » convoquera des musiques de Poulenc, Honegger, Debussy,
Tailleferre et Milhaud, sur des textes de Cocteau, Radiguet et Poulenc, pour
une soirée festive, le 13 décembre prochain. La grande violoniste Fanny Clamagirand sera entourée d'Alain Carré, récitant, et de
Hugues Leclère, piano. A noter que le lendemain, 14
décembre, le concert des jeunes du conservatoire et de la maîtrise de Paris
offrira des pièces de Poulenc (Concerto pour deux pianos et orchestre,
et L'Embarquement pour Cythère, dans l'orchestration due à Élodie
Soulard), outre des œuvres de Nicolas Bacri (Quatre Alleluia pour maîtrise et orchestre) et de
Rossini (Soirées musicales, dans les arrangements de Benjamin Britten).
De même, le 19 décembre, une autre séance permettra d'entendre la pièce « Sécheresse »
de Poulenc, aux côtés d'œuvres des étudiants des classes d'écriture et du
concert des ensembles vocaux.
Auditorium Marcel Landowski,
CRR de Paris, 14, rue de Madrid, 75008 Paris, les 13, 14 et
19 décembre 2013, à 19H. Entrée libre.
Jean-Pierre
Robert.
La Semaine Mozart de Salzbourg 2014

Imaginant l'improbable rencontre, en
octobre 1762, à Vienne, entre le tout jeune Mozart et Christoph Willibald Gluck, qui y créait son Orfeo ed Euridice, Marc
Minkowski a choisi, en ouverture de sa deuxième saison de directeur musical de
la Semaine Mozart, de représenter cette « Azione teatrale per musica ».
Outre le clin d'œil à l'Histoire puisqu'on célébrera, en 2014, le tricentenaire
de la naissance du musicien, cette reprise manifeste combien la musique
dramatique, et même celle de Mozart, doit aux innovations prônées par le grand
réformateur de l'opéra italien. La mise ne scène en sera confiée à Ivan
Alexandre (23 & 31/1). Côté concerts, la programmation promeut l'idée essentielle de considérer l'œuvre de Mozart
en relation avec celle de ses pairs. Cette année, le focus est porté sur Carl
Philip Emanuel Bach, dont l'oratorio La Résurrection et l'Ascension de Jésus,
dans l'arrangement qu'en réalisa Mozart en 1788 pour sa représentation à
Vienne, sera donné par René Jacobs et le Freiburger Barockorchester (24/1). Des pièces du « Bach de
Berlin » émailleront plusieurs concerts : sonates pour violon et piano,
fantaisies pour fortepiano. Il en sera tout autant de
ces autres compositeurs qui ont admiré le maître de Salzbourg, tels Richard
Strauss ou, plus près de nous, l'estonien Arvo Pärt. Du premier seront donnés aussi bien les Métamorphoses que les Quatre derniers Lieder, le Sextuor de Capriccio, ou
encore le Concerto pour hautbois (interprété par François Leleux).
Du second, on créera la version orchestrale de Littlemore Tractus, spécialement commandée pour le festival 2014 par la Fondation Mozarteum (29/1), aux côtés de diverses pièces vocales et
de pièces chambristes.
Au centre des débats bien sûr, Wolfgang Amadé Mozart sera honoré de diverses manières. Andras Schiff, un artiste adulé
ici, donnera, l'espace de trois concerts, avec son ensemble de la Cappella
Andrea Barca, pas moins des six concertos pour piano de l'année 1784, mis en
regard avec des pièces composées en cette même période si prolifique, tels que
le quintette pour piano et cordes, le quatuor KV 458 et diverses sonates pour
le clavier (24, 25 et 26/1). Au chapitre des intégrales, Renaud Capuçon et se amis donneront les six quintettes à cordes
(29 & 31/1), tandis que Fazil Say, au piano, et
Kristian Bezuidenhout, au fortepiano,
s'attaqueront à la totalité des Sonates pour clavier (28, 29, 30, 31/1). Daniel Barenboim, avec les Wiener Philharmoniker,
livrera sa vision des trois dernières symphonies (1/2). Le chef-pianiste protée
jouera aussi des sonates de Mozart et de Schubert (30/1). Marc Minkowski
alternera pièces de Gluck et de Mozart, symphoniques et vocales, avec Sonya Yoncheva et Rolando Villazón
(26/1), comme d'ailleurs Louis Langrée et la Camerata Salzburg (27/1). Ivor Bolton, avec l'Orchestre du Mozarteum, associera
Mozart à Muzio Clementi dont seront jouées quatre symphonies (28/1 & 2/2). Les Viennois
prodigueront encore leurs félicités lors de deux autres concerts, dirigés, respectivement, par Paavo Järvi (25/1) et le maestro Minkowski, qui
concrétisera sa première rencontre avec l'illustre phalange (29/1).

Marc Minkowski et
Matthias Schulz, directeur du festival/© DR
Sans compter divers autres moments de
musique de chambre, il faut citer, au chapitre des raretés, les concerts au
Musée - à la Résidence, dans la maison natale ou dans la Wohnhaus de Mozart - où l'on jouera les instruments originaux du musicien, saisis dans
un cadre intimiste. Le Mozart Children's Orchestra,
dirigé par Minkowski, se produira de nouveau dans des œuvres de Mozart, CPE
Bach et Pärt. Enfin, un hommage au grand pianiste
autrichien Alfred Brendel sera rendu le 27 janvier, jour de l'anniversaire de
la naissance de Mozart : dans la grande salle du Mozarteum,
celui-ci se verra remettre la médaille d'or Mozart pour sa carrière. L'occasion
d'une fête réunissant de nombreux amis musiciens. Un tel éclectisme signe la
singularité de ce festival salzbourgeois d'hiver, où les concerts s'enchaînent
souvent à raison de trois par jour, en matinée, en milieu d'après midi et en
soirée, pour le plus grand bonheur de nombreux mélomanes enthousiastes et
avertis.
Divers
lieux, du 22 janvier au 2 février 2014.
Renseignements et location : Kartenbüro der Stiftung Mozarteum Salzburg, Mozart-Wohnhaus, Theatergasse 2, 5020 Salzburg, Autriche ; par tel :
00 43 662 87 44 54 ; Fax : 00 43 662 87 31 54 ; en ligne : tickets@mozarteum.at ou www.mozarteum.at
Jean-Pierre Robert.
***
L’ARTICLE DU MOIS
FRANCIS POULENC ET L'IDÉAL DE LA MUSIQUE DE CHAMBRE : LES ULTIMES SONATES POUR INSTRUMENTS A VENT ET PIANO
« Je viens de finir deux sublimes
(naturellement) sonates venteuses, l’une pour clarinette et piano, l’autre for oboe and piano. »(1) Ainsi Francis Poulenc
annonce-t-il en 1962, quelques semaines avant son décès, la prochaine création
de deux sonates pour instrument à vent et piano. Cinq ans après une première
sonate pour bois – la flûte – et piano, ces deux pièces constituent l’aboutissement
stylistique d’un compositeur revenu, comme aux premiers temps, au répertoire
intimiste de la musique de chambre, après trente-cinq ans d’une production plus
tournée vers la voix et la scène. Pièces majeures de sa production, ancrées
depuis plus d’un demi-siècle dans le répertoire des instrumentistes à qui elles
sont destinées, ces ultimes compositions de Poulenc forment un groupe homogène,
d’une richesse et d’une profondeur stylistique aussi touchantes qu’accessibles, véritable fierté de leur créateur. Attiré dès ses premières
compositions par les instruments à vent, en témoignent la Sonate pour deux clarinettes (1918), la Sonate pour clarinette et basson (1922) ou la Sonate pour cor, trompette et trombone (1922) qui n’ont pas leur
pendant chez les cordes, Poulenc referme la boucle quatre décennies plus tard
en une sorte de triptyque, qu’aurait probablement complété, si une crise
cardiaque n’avait pas terrassé l’artiste en plein élan, une Sonate pour basson et piano dont il
avait esquissé les premiers traits à la fin de l’été 1957.
Si ses premières
œuvres affirment un langage à part dans l’esthétique de Poulenc, un langage
contrapuntique tout en dissonances inattendues, ses dernières grandes sonates
se situent plutôt dans un esprit qui rappelle les sonates du milieu du XVIIIe siècle,
à l’image de celles de Debussy. Bien loin néanmoins de tout « retour
à », postérieures de quarante ans à celles de son aîné, ces trois sonates
témoignent, en une synthèse contrastée d’un style longuement mûri, d’un rapport
presque affectif du compositeur au genre de la sonate.

© DR
Cette contribution
aux hommages à Francis Poulenc, l’année du cinquantième anniversaire de sa
disparition, est ainsi l’occasion d’interroger la relation si particulière du
compositeur au genre de la sonate et, par ce biais, de retracer une trajectoire
musicale tournée dès ses débuts vers les instruments à vent. Au-delà des
questions purement instrumentales, le corpus homogène que forment les trois dernières
sonates pour instrument à vent et piano se révèle d’une incroyable richesse
stylistique au miroir de laquelle se dévoilent les profondes affinités
esthétiques et se dessine l’idéal instrumental recherché d’un compositeur en
pleine maturité.
Poulenc
et le genre de la sonate : une affinité stimulante
Parmi les genres
purement instrumentaux sans référence extra-musicale, hors pièces pour piano
seul, Poulenc s’est plus spécifiquement tourné vers le répertoire
« savant » de la musique de chambre. Quant au domaine symphonique, en
dehors des concertos qui allient un grand ensemble instrumental à un soliste,
ce n’est que tardivement que Poulenc vient à l’orchestre pour l’orchestre, sans
support narratif. Nous sommes en 1947 et il s’agit alors d’une commande de
symphonie par la BBC. Intimidé par un genre qu’il n’aurait jamais osé aborder
de lui-même, il intitule modestement son œuvre Sinfonietta, malgré les
dimensions finalement imposantes qu’il donne à sa pièce. À la fin des années
1950, alors que sa notoriété dépasse très largement les frontières et qu’il est
connu jusqu’au cœur des États-Unis, alors qu’il s’est forgé un langage
particulièrement adapté à son écriture pour la voix et pour la scène, c’est par
la sonate qu’il revient à un style tout à la fois épuré, harmoniquement
personnel, fraîchement mélodique et magnifiquement expressif. Si le genre de la
sonate ne se place pas en fil conducteur sous-jacent de sa production
instrumentale, son déploiement en début et fin de carrière lui donne une
importance majeure, véritable fondement de sa construction musicale.
À l’époque de ses
premières œuvres pour vent, la démarche créatrice de Poulenc s’inscrit dans un
paysage où la sonate stimule la plupart de ses contemporains, français en
particulier. La référence à une forme façonnée au XVIIIe siècle
correspond parfaitement à cette simplicité que recherchent Debussy ou Ravel. La
brièveté des formes, le retour à un langage fortement tonal, tout du moins une
pensée structurée par un parcours tonal clair, ainsi que la complicité intime
du simple duo répondent à l’immédiateté que prône notamment le Groupe des Six.
Le tableau suivant propose un panorama comparatif de l’œuvre de Poulenc et de
la production de sonates contemporaines de Debussy à Prokofiev et Hindemith,
pour la plupart connues et appréciées de Poulenc. Cette chronologie dessine les
cadres dans lesquels s’inscrivent les pièces de chambre de Poulenc et met en
valeur la démarche singulière d’un compositeur qui revient en fin de vie à un
genre dont l’attrait n’a plus rien à voir avec celui qu’on lui portait quarante
ans plus tôt.
|
Les
œuvres pour instrument à vent dans l’œuvre de Poulenc – quelques repères
|
Principales
sonates et autres œuvres contemporaines de chambre
|
1915
|
|
Debussy : Sonate pour violoncelle et piano
|
1915
|
|
Debussy : Sonate pour flûte, alto et harpe
|
1917
|
|
Debussy : Sonate pour violon et piano
Fauré : Sonate pour violon et piano n° 2
Fauré : Sonate pour violoncelle et piano n° 1
|
1918
|
Sonate pour deux
clarinettes (publiée en 1919 chez Chester)
|
Honegger : Sonate pour violon et piano n° 1
Milhaud : Sonate pour flûte, clarinette, hautbois et piano
|
1919
|
|
Honegger : Sonate pour violon et piano n° 2
Stravinsky : Trois Pièces pour clarinette seule
|
1920
|
|
Honegger : Sonate pour violoncelle et piano
Kœchlin : Sonate pour deux flûtes
|
1921
|
|
Fauré : Sonate pour violoncelle et piano n° 2
Bartók : Sonate pour violon et piano n° 1
|
1922
|
Sonate pour
clarinette et basson
Sonate pour cor,
trompette et trombone
(toutes
deux publiées chez Chester en 1924)
|
Ravel : Sonate pour violon et violoncelle
Bartók : Sonate pour violon et piano n° 2
Milhaud : Sonatine pour flûte et piano
|
1923
|
Les Biches
|
Stravinsky : Octuor pour instruments à vent
|
1926
|
Trio pour hautbois,
basson et piano
|
|
1927
|
|
Ravel : Sonate pour violon et piano n° 2
Milhaud : Sonatine pour clarinette et piano
|
1928
|
Concert champêtre
|
|
1932
|
Concerto pour
deux pianos et orchestre
|
Prokofiev : Sonate pour deux violons
|
1936
|
Litanies à la
Vierge noire
|
Hindemith : Sonate pour flûte et piano
|
1938
|
Concerto pour
orgue
|
Hindemith : Sonate pour hautbois et piano
Hindemith : Sonate pour basson et piano
|
1939
|
Sextuor pour flûte,
hautbois, clarinette, basson, cor et piano
|
Hindemith : Sonate pour clarinette et piano
Hindemith : Sonate pour cor et piano
Hindemith : Sonate pour trompette et piano
|
1941
|
|
Hindemith : Sonate pour cor anglais et piano
Hindemith : Sonate pour trombone et piano
|
|
|
|
1943
|
Sonate pour
violon et piano
|
Prokofiev : Sonate pour flûte et piano (2e Sonate pour violon et piano)
Hindemith : Sonate pour saxophone alto et piano
|
1948
|
Sonate pour
violoncelle et piano
|
|
1949
|
Concerto pour
piano et orchestre
|
|
1946
|
|
Prokofiev : Sonate pour violon et piano n° 1
|
1947
|
Sinfonietta
|
|
1954
|
|
Milhaud : Sonate pour hautbois et piano
|
1953
|
Dialogues des Carmélites
|
Stravinsky : Septuor pour clarinette, cor, basson,
piano, violon, alto et violoncelle
|
1955
|
|
Hindemith : Sonate pour tuba basse et piano
|
1957
|
Sonate pour flûte
et piano – « à la mémoire de Madame Sprague-Coolidge »
(publiée chez Chester en 1958)
Élégie pour cor et piano
|
|
1958
|
La Voix humaine
|
|
1962
|
Sonate pour
hautbois et piano – « à la mémoire de Serge Prokofiev » (publiée chez Chester en
1963)
Sonate pour
clarinette et piano – « à la mémoire d’Arthur Honegger » (publiée chez Chester en 1963)
|
|
Dans les années
1920, le genre s’impose ainsi comme vecteur privilégié de la génération
debussyste et du courant néoclassique incarné par les membres du Groupe des
Six. On doit ainsi plusieurs sonates à Debussy, Milhaud et Honegger. Dans un
tout autre style, Fauré apporte au genre trois nouvelles sonates pour violon et
violoncelle. Quant à Ravel, il concentre en deux ans – 1921 et 1922 – deux
pièces majeures du répertoire pour cordes. Outre-Rhin, Hindemith compose avec
une impressionnante régularité dix sonates avec piano, toutes dédiées à un
instrument différent. C’est à cette même époque que voient le jour les sonates
de Prokofiev pour violon et pour flûte. Enfin, les pièces pour instruments à
vent de Stravinsky, d’une influence décisive sur l’écriture de Poulenc, sont
d’exactes contemporaines de ses premières œuvres. On observe aussi l’intérêt
porté aux vents, les cordes ne s’imposant pas outre mesure dans le corpus
considéré. Paradoxalement, les sonates de maturité de Poulenc prennent place
dans un contexte peu favorable au genre de la sonate, les nouvelles générations
se tournant, après 1950, vers d’autres types de formes, d’effectifs, de
questionnements. Attiré au plus profond de lui-même par le cadre extérieurement
rigoureux de la sonate, allié à la sonorité chaude et colorée des instruments à
vents, Poulenc revient, au sommet de sa maturité, à un genre qu’il chérit
depuis toujours, sans se préoccuper de ce qui serait alors ou non « à la
mode ».
Ce constat nous
éclaire sur l’engagement personnel de Poulenc envers un genre dont il forge un
idéal esthétique à travers la fusion des bois et du piano. Œuvres fortes, ces
pièces le sont particulièrement aussi par leurs dédicaces. Tandis que les
œuvres des années 1910 et 1920 étaient plutôt dédiées à ses amis d’alors, les
sonates pour vent et piano, les deux dernières surtout,
constituent a posteriori un véritable
témoignage de reconnaissance et d’admiration envers leurs dédicataires. En
1919, Poulenc découvre l’œuvre de Prokofiev. Il est alors saisi par le
dynamisme, la couleur et la puissance de l'écriture de celui-ci, et son
admiration pour lui ne faiblira jamais. C’est en son hommage qu’il écrit la Sonate pour hautbois et piano. Arthur
Honegger, l’ami de longue date et fidèle compagnon du Groupe des Six, hélas
disparu en 1955, est quant à lui dédicataire de sa jumelle pour clarinette. À
l’opposé de toute annotation mondaine ou amicale anecdotique, ces deux
dédicaces scellent pour l’éternité une amitié et une reconnaissance
personnelle. Elles montrent aussi tout le poids que Poulenc accorde à ces
sonates, dignes d’un hommage à deux grands contemporains admirés, reconnus,
déjà passés à la postérité. La « Déploration », poignante lamentation
qui clôt la Sonate pour hautbois, aussi bien que l’« Allegro tristamente » ou
la « Romance » de la Sonate
pour clarinette, forment un puissant hommage aux compositeurs, autant que
la « Déploration », ultimes mesures de toute une vie, sonne comme un
testament musical personnel doublé d’un tombeau, à la manière de ceux de Rameau
ou de Couperin, à la musique française telle qu’idéalisée par Poulenc.
« J’ai
les bois dans le sang »(2)
« J’ai trouvé
les éléments d’une Sonate pour hautbois. Le premier temps sera élégiaque, le
second scherzando et le dernier une sorte de chant liturgique. Je crois que
l’orientation du côté des bois est la solution pour moi actuellement. »(3)
14 juillet 1962, à Pierre Bernac
« Après avoir écrit une Sonate pour clarinette et piano, j’en
achève une pour hautbois et piano !!! Tu sais que les vents me sont plus
favorables ! »(4)
1er novembre 1962, à Pierre Bernac
Si les bois
inspirent particulièrement Poulenc au tournant des années 1950-1960, ce
penchant plus généralement étendu aux instruments à vent n’est pas le fruit
d’un revirement stylistique ou d’une nouvelle pensée de l’écriture. Bien plus,
il s’agit là de l’expression d’un goût profond pour la sonorité des vents, qui
remonte aux premières expériences d’un jeune compositeur d’à peine vingt ans en
1918. Parmi la quinzaine de pièces de musique de chambre que compte l’œuvre de
Poulenc, huit d’envergure sont destinées aux instruments à vent accompagnés ou
non du piano (six sonates, un trio et un sextuor), auxquelles s’ajoute l’Élégie pour cor et piano. De leur côté,
les cordes ne sont à l’honneur – et ce tardivement – qu’à l’occasion de deux
sonates, l’une pour violon (1943) et l’autre pour violoncelle (1948),
précédées, dans les années 1930, par deux pièces brèves, la Bagatelle et le Presto pour violon et piano, la seconde n’étant en fait que la
transcription par Jascha Heifetz du Presto en si bémol majeur pour piano.
Au catalogue de
Poulenc, la musique de chambre sous-tend, en trame de fond, toute l’œuvre du
compositeur. Le Trio pour hautbois,
basson et piano (1926) et le Sextuor pour flûte, hautbois, clarinette, basson, cor et piano (1932) forment ainsi un
fil conducteur, dédié aux vents, qui relie la première Sonate pour deux clarinettes au corpus des trois dernières sonates.
En marge des œuvres d’envergure, ce trio de sonates pour vents, précédé d’une
sonate pour violon et d’une autre pour violoncelle, est annoncé par une Élégie pour cor et piano que Poulenc termine à la fin de l’année
1957, en mémoire du corniste britannique Dennis Brain.
Sa Sonate pour clarinette à peine
achevée, celle pour hautbois en bonne voie également, Poulenc projetait d’en
terminer une autre pour basson. Ainsi, confie-t-il en entretien avec Stéphane Audel, il aurait « épuisé le jeu des instruments à
vent »(5). Plus qu’un projet, il s’agissait d’une sonate ébauchée en même
temps que la Sonate pour flûte et piano.
Dès ses premières
œuvres, Poulenc se révèle un maître de l’équilibre entre les instruments,
équilibre qu’il exprime par un jeu contrapuntique dont il doit le savoir-faire
à l’enseignement de Charles Kœchlin. Prolongement de l’enseignement théorique
reçu, Stravinsky est alors un modèle à suivre tant sur la gestion du
contrepoint que sur la manière de développer l’écriture des vents. La Sonate pour clarinette et basson,
instaurant selon les propres mots de Poulenc un contrepoint « divertissant »(6),
n’est pas sans évoquer l’Octuor de
son aîné. L’adjonction du piano, dès le Trio de 1926, offre à Poulenc de nouvelles perspectives. Avec la Sonate pour flûte, il atteint un sommet
d’équilibre entre l’instrument et son partenaire. Jamais le piano ne s’efface
devant l’accompagné, jamais non plus la flûte n’est reléguée au second plan. À
son ami Pierre Bernac, satisfait de ses deux derniers opus de 1962, Poulenc promet qu’il
leur fera bon accueil parce que l’ensemble y est, avant tout, « très bien
équilibré instrumentalement »(7). Beaucoup plus à l’aise avec l’écriture
monodique des vents qu’avec la complexité des quatre cordes du violon ou du
violoncelle, Poulenc pense avant tout la sonate en terme de fusion de timbres et de mélodies.
Au-delà de la partition,
support essentiel mais insuffisant pour que l’œuvre prenne corps, Poulenc a
toujours su s’entourer d’interprètes réputés qui portèrent sa musique sur le
devant de la scène, de son vivant comme au-delà de sa mort. C’est rien moins
qu’à Benny Goodman et Leonard Bernstein que revient l’honneur posthume de créer
à New York, le 10 avril 1963, la toute récente Sonate pour clarinette et piano. Et la même année, c’est le très
renommé Pierre Pierlot accompagné du tout aussi célèbre pianiste Jacques
Février qui assurent la création de la Sonate
pour hautbois et piano au Festival de Strasbourg, comme projeté l’année
précédente par le compositeur. Le 17 juin 1957, Poulenc avait lui-même dévoilé
à Strasbourg sa Sonate pour flûte et
piano aux côtés de Jean-Pierre Rampal, sous l’œil paralysant d’Arthur
Rubinstein présent au concert. Dans la foulée, en 1958, Jean-Pierre Rampal
avait participé à la création américaine de l’œuvre à Washington, accompagné du
pianiste Robert Veyron-Lacroix. En inscrivant
définitivement l’œuvre à son répertorie, le flûtiste promettait un avenir
durable à cette sonate, qui reste aujourd’hui, aux côtés de celles de Debussy
et Prokofiev, l’une des plus jouée à la flûte, tout comme ses cadettes le sont
pour la clarinette et le hautbois.
Entre
classicisme sous-jacent et expression d’une maturité stylistique : un
triptyque haut en couleurs
« Je remercie
Dieu […] de m’avoir redonné un équilibre intellectuel que j’avais perdu autant
et plus que la santé. En travaillant à cette Sonate de flûte j’ai l’impression de retourner très loin en arrière
avec la technique en plus bien sûr. C’est une sonate de dimension debussyste.
C’est la mesure française. Comme le critique de Turin avait raison après la Sonate pour violoncelle d’écrire :
' On s’étonne que l’auteur des Biches emprunte la forme de la Schola d’Indyste.' Avoir la
forme de son langage c’est le plus difficile. C’est ce qu’avait Webern au plus
haut point (comme Mallarmé) et que n’a pas encore Boulez. » (8)
En 1915, Debussy
projette un ensemble de six sonates dont seules trois, signées du très engagé
« Claude Debussy, musicien français », verront le jour. Dans un élan
patriotique, le compositeur souhaitait renouer avec les formes traditionnelles
des Concerts de Rameau et le « bon goût » de Couperin. Comme
son aîné, Poulenc revient lui aussi aux formes traditionnelles du XVIIIe siècle
en trois mouvements, tout autant dans ses sonates de jeunesse que dans ses
grandes partitions pour instruments à vent. Des genres savants qu’il aborde,
seule la Sonate pour violoncelle et
piano, qu’évoque Poulenc à Bernac, compte quatre
mouvements, à laquelle s’ajoutent la Sinfonietta et la Sonate pour deux pianos. La plupart de
ses œuvres de musique de chambre, et tout particulièrement les sonates de sa
dernière période créatrice, s’inscrivent dans la tradition d’un genre
pré-mozartien et renouent, par leur clarté formelle et leur concision
thématique, avec les modèles de l’époque de Scarlatti plus qu’avec les exemples
de la première école viennoise ou ceux de la fin du XIXe siècle.
La simplicité des formes, dépourvues de développements et de toute référence
cyclique à la Vincent d’Indy, semble le support idéal à l’expression d’une
sorte de renouveau du genre.
Ainsi que l’analyse
le compositeur lui-même en dissociant le style plus complexe de ses deux
sonates pour cordes des trois suivantes, Poulenc affirme avec ferveur
l’esthétique française de ses dernières sonates pour vents. Chacune d’entre
elles présente une architecture claire et équilibrée référant aux formes simples,
tripartites ou véritables rondos, ainsi qu’un langage harmonique épuré de
dissonances rugueuses. Renouant avec un socle tonal fort, elles ne prétendent
pourtant pas à une nouvelle modernité. Bien au contraire, Poulenc revient dès
la Sonate pour flûte et piano à un
style épuré, concis, empreint d’une liberté de ton et de forme que permettent
les cadres non rigides d’une structure en trois mouvements, non subordonnée à
l’alternance exclusive Vif-Lent-Vif. La construction inverse et hautement
dramatique de la Sonate pour hautbois et
piano en est la preuve.
Proches par leur
esprit, par leur durée aussi bien que par l’équilibre des instruments dont
jamais aucun ne prend le pas sur l’autre, les trois sonates se nourrissent de
tournures mélodiques communes, de motifs et de figures d’accompagnement
similaires. À la manière du collage ou de la citation, Poulenc a toujours aimé
se réapproprier des thèmes pré-existants de ses
contemporains ou des maîtres du passé, autant qu’il a pratiqué l’auto-citation. Comme à son habitude, la thématique des
trois sonates est nourrie d’emprunts à ses propres œuvres. La
« Cantilène » de la Sonate pour
flûte et piano est esquissée dans le Concerto
pour orgue de 1938 tandis que son finale montre en plusieurs endroits
quelques échos tout droit tirés des Dialogues des Carmélites, comme ses deux
autres sonates qui portent aussi des évocations de La Voix humaine. Par ailleurs, Poulenc unifie ses œuvres autour
d’un faisceau de réminiscences variées qui les structurent à grande échelle et
guident l’écoute de l’auditeur. On a ainsi plaisir à trouver des rappels du
premier mouvement en fin de la Sonate
pour flûte ou à réentendre certains motifs de l’« Allegro »
initial de la Sonate pour clarinette dans son finale.
Après les deux
sonates pour cordes dont l’esprit rhapsodique ne laissait prévoir le virage
stylistique des sonates ultérieures, le retour à une certaine simplicité se
manifeste d’emblée par le choix de sa thématique. Chacune des trois sonates
s’ouvre sur des thèmes aux carrures franches, soutenues par des mélodies
aisément mémorisables. Plus que dans les œuvres instrumentales précédentes,
Poulenc revient à une structure thématique ancrée sur celle de ses
prédécesseurs, cette fois-ci plutôt de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
C’est l’époque du Concerto pour deux
pianos, dont les échos mozartiens retentissent dès les premières notes du
« Larghetto ». À l’instar des modèles classiques, le finale de la Sonate pour flûte et piano, le scherzo
de la Sonate pour hautbois et piano et la « Romanza » de la Sonate pour clarinette et piano s’ouvrent sur des thèmes dont la répétition immédiate du motif initial rappelle
de nombreux thèmes de Mozart ou de Haydn. De son côté, le dynamisme du premier
thème de la Sonate pour flûte et piano doit autant à la fraîcheur mélodique d’une ligne entre diatonisme et
chromatisme qu’à sa structure symétrique et carrée de type
antécédent-conséquent, ponctuée de sa demi-cadence au ton principal et de sa
cadence parfaite à la tierce inférieure. Poulenc s’appuie sur ce même moule
dans la « Cantilène », dans le premier mouvement de la Sonate pour hautbois et piano et, après
les quelques mesures d’introduction, opte pour un premier thème non clos mais
évoquant la même structure dans l’« Allegro tristamente »
de la Sonate pour clarinette.
Tout en contrastes,
l’écriture de ces trois sonates est tour à tour élégiaque, lyrique, fantasque,
mélancolique ou sérieuse. Du « Presto giocoso » de la Sonate pour flûte, du scherzo de la Sonate pour hautbois à la
« Déploration » qui en constitue le troisième mouvement, parfois même
en l’espace de quelques mesures – remémorons-nous les interventions qui
ponctuent la cantilène centrale de la Sonate
pour flûte –, Poulenc nous promène de l’insouciance à la gravité.
L’alliance des contraires, si subtilement perceptible, dans les alternances
majeur/mineur du premier mouvement de cette même sonate ou dans la cohabitation
de lignes discrètement chromatiques alliées à des phrases aux réminiscences
presque belliniennes, atteint des sommets d’expressivité
en une fusion des opposés si souvent recherchée par Poulenc. Quant à
l’« Allegro tristamente » de la Sonate pour clarinette, par l’alliance
même des contraires annoncée en son titre, et dont la poignante répétition d’un
motif arpégé, au centre du mouvement, sert au mieux l’expression de tristesse à
la mémoire d’Arthur Honegger, il reflète, à lui seul, les multiples facettes de
Poulenc et la force expressive qu’il souhaite avant tout donner à ses dernières
œuvres. « Je crois que c’est très touchant » écrit-il à Simone Girard
le 3 juillet 1959 (9).
***
« Francis
Poulenc est la musique même, je ne connais pas de musique plus directe, plus
simplement exprimée et qui va droit au but avec tant de sûreté. Il a repris
dans la musique de chambre la forme des sonates courtes, telle que la concevait
Scarlatti, et où les éléments sont réduits au minimum. Sa Sonate pour clarinette et basson est une merveille de précision, de
gaieté, de charme et de grâce, et sa Sonate
pour cor, trompette et trombone est un véritable chef-d’œuvre. »(10)
Ces compliments que
Milhaud adresse à Poulenc à propos de ses toutes premières œuvres résument
l’attrait du compositeur vers les potentialités qu’offrent l’écriture des
instruments à vent, et son aisance lorsqu’il les combine aux rouages de la
sonate « classique » revisitée. Ces quelques lignes, publiées en
1927, semblent tout aussi pertinentes pour ses trois dernières sonates. Les
œuvres ont certes gagné en longueur et en profondeur, elles montrent un langage
radicalement différent des premiers essais et témoignent d’un aboutissement
esthétique plus que d’une quête stylistique qui était celle des premières
années, mais elles restent d’un abord immédiat, d’une fraîcheur de ton et d’une
variété de caractères qui dégagent autant de charme et de grâce que Milhaud
n’en avait ressenti à l’écoute des pièces de jeunesse. L’alliance des timbres,
les jeux de sonorités, le lyrisme simple des lignes, servis par un cadre formel
clair et équilibré résument les conceptions esthétiques du compositeur, ses
influences ainsi que ses affinités avec un genre hérité des premiers maîtres
classiques. Leur ancrage fort dans le répertoire des concertistes confirme que
Poulenc avait trouvé dans l’alliance de la sonate et des bois un support idéal
à la direction qu’il souhaitait voir prendre par la musique à l’aube de la
seconde moitié du XXe siècle.
Muriel Boulan*.
*Professeur agrégée
à l’Université Paris-Sorbonne, Docteur en Musicologie.
(1) Lettre inédite à Doda Conrad, 17 novembre 1962, citée dans Carl B. Schmidt, The Music of Francis Poulenc (1899-1963),
A Catalogue, Oxford, Clarendon Press, 1995, p. 509.
(2) Lettre inédite de Poulenc à Simone
Girard, 2 août 1962, citée dans Lacombe,
Hervé, Francis Poulenc, Paris,
Fayard, 2013, p. 779.
(3) Francis Poulenc, Correspondance,
1910-1963, réunie, choisie, présentée et annotée par Myriam Chimènes,
Paris, Fayard, 1994, Lettre 62-13 à Pierre Bernac, 14
juillet 1962, p. 996.
(4) Ibid.,
Lettre 62-24 à Pierre Bernac, 1er novembre
1962, p. 1004.
(5) Francis Poulenc, Moi et mes
amis, préface de Stéphane Audel, 1963, dans
Francis Poulenc, J’écris ce qui me chante, écrits et entretiens réunis, présentés et
annotés par Nicolas Southon, Paris, Fayard, 2011,
p. 849.
(6) Francis Poulenc, Correspondance,
op. cit, Lettre 22-26 à
Charles Kœchlin, début septembre 1922, p. 175.
(7) Lettre inédite de Francis Poulenc à
Pierre Bernac, 8 novembre 1962, citée dans Carl B. Schmidt, op. cit., p. 511-512.
(8) Francis Poulenc, Correspondance,
op. cit., Lettre 57-11 à Pierre Bernac, 8 mars 1957, p. 864.
(9) Francis Poulenc, Correspondance,
op. cit., Lettre 59-18 à
Simone Girard, 3 juillet 1959, p. 923.
(10) Darius Milhaud, Études,
Paris, Éditions Claude Aveline, 1927, p. 19.
FOCUS SUR LA MUSIQUE NOUVELLE
Luciano BERIO :
Transcription et réécriture. D’une œuvre à l’autre
« La
musique se trouve traduite seulement quand nous nous trouvons obligés, pour une
raison ou une autre, de passer d’une expérience musicale spécifique à sa
description verbale, du son d’un instrument au son d’un autre, de la lecture
silencieuse d’un texte musical à son exécution. En réalité ce besoin est si diffus, présent et permanent que nous sommes
tentés de penser que l’histoire de la musique est en effet une histoire de
traductions. Mais peut-être toute notre histoire, et le devenir de notre
culture, est une histoire de traductions. C’est une culture qui veut posséder
tout et donc traduit tout : toutes les langues, les choses, les concepts,
les faits, les émotions, l’argent, le passé, le futur et, naturellement, la
musique. La traduction implique interprétation. Les soixante-dix sages
d’Alexandrie qui ont traduit la Bible en grec ' ont inventé '
l’herméneutique. » (L. Berio)(1).
La traduction d’une expérience humaine en une
autre, d’un texte musical à un autre, d’un instrument à un autre, d’un contexte
à un autre - ce sont les versions multiples de la transcription qui définissent
l’essence même de l’art de composer pour Berio. A l’exemple de quelques
œuvres-clés de son catalogue, précisons trois aspects importants de sa démarche
de transcription(2) :
-
La
première version de Sequenza III est la
version préalable, la version préparatoire en collaboration avec Cathy Berberian, à partir de laquelle le compositeur va élaborer
la version définitive, publiée, de la pièce ;
-
La pièce Rounds pour clavecin sera traduite, transcrite en Rounds pour piano pour
déployer les particularités typiques de l’instrument à résonance;
-
Sequenza X pour trompette et résonances au piano sera
la partie soliste mise en contexte - celui de la texture orchestrale qui
l’enveloppe - dans Kol od.
I. Sequenza III
Devenue déjà classique pour l’art vocal de notre temps, Sequenza III (1965/1966) pour voix de femme sur un texte de Markus Kutter est une encyclopédie cohérente des émissions vocales
inspirées par un texte et par la transcription musicale du rire.
« Derrière Sequenza III, précisait
Berio, se dissimule le souvenir de Grock, le dernier grand clown. »(3)
Portrait particulier de la voix de Cathy Berberian à
qui la pièce est dédiée, Sequenza III est l’anamorphose vocale d’un texte, mais aussi l’écriture musicale des
émotions : dans la première version de Sequenza III, les émotions mises en séquence par le compositeur sont en réalité une
sorte de programme d’action ou d’improvisation vocale de la part de
l’interprète. Cathy Berberian invente, improvise,
propose des versions différentes à partir desquelles le compositeur fera son
choix pour la version définitive. La première version – ou l’avant-version - c’est l’esquisse, la suggestion
compositionnelle initiale, la version première et sommaire à partir de laquelle
seront proposées plusieurs versions ou transcriptions, jusqu’à la variation ou
la transcription finale, publiée, la seule que les auditeurs connaissent. La
transcription fait donc partie intégrante du travail compositionnel, du
cheminement du compositeur vers la version définitive de son œuvre.
« Le thème fondamental de Sequenza III, précise Berio, c’est le rire, le rire
développé dans l’écriture. Car en fait, il n’y a pas tellement de différence
entre une femme californienne qui rit à pleine voix et une soprano léger coloratura. Chez une chanteuse, la voix est, bien sûr,
posée de façon professionnelle. Mais c’est la même impulsion, la même mécanique
de l’appareil phonatoire. »(4) Tout en restant lié à la quotidienneté
banale et chargé de connotations circonstancielles, le rire dans toute sa
diversité est transformé par Berio en matière sonore-bruiteuse intégrable à
l’interprétation musicale d’un texte au contenu relativement précis. Le
développement du thème du rire vise l’exploration d’une gamme émotionnelle
particulièrement vaste - celle qui est la base même de la première version de Sequenza III - qui offre, à travers sa
complexité et son ambiguïté, des instances multiples de lecture ou
d’interprétation de la part de l’auditeur.
Sequenza III compose plusieurs modalités de comportements : le comportement
vocal conventionnel qui est lié à l’articulation habituelle dans la mise en
musique d’un texte ; ce même comportement transformé par fredonnements,
chuchotements, sons nasalisés, etc. ; les bruits qui n’impliquent pas
d’émission vocale comme les claquements de langue, de dents, de doigts, les
battements de mains ; les émissions vocales non admises traditionnellement
dans la musique (rire, toux, halètement, bruits de souffle) ; et encore
les mouvements corporels qui transforment le son émis (main devant la bouche,
par exemple) et les mouvements corporels qui n’agissent pas sur le son-bruit
(déplacements sur scène, gestes corporels). La combinaison des comportements
différents et les modalités du rire en fonction des émotions indiquées par le
compositeur définissent la corporéité directe
de la prestation vocale et mettent en évidence
l’importance du corps dans la prestation musicale. Les indications verbales en
ce qui concerne les émotions à extérioriser - après avoir servi à élaborer à partir de la toute première version de
la pièce sa transcription définitive - ne doivent pas définir, lors de
l’exécution, un jeu théâtral d’ordre représentatif, mais servir tout simplement
d’indicateur pour l’élaboration rythmique ou agogique de l’émission vocale.
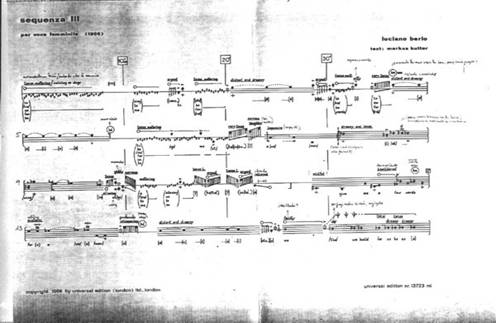
© DR
II. Rounds :
D’un instrument à l’autre
La pièce de Luciano
Berio Rounds est connue en deux versions : pour clavecin, c’est la première version de 1965, créée en
1965 à Bâle par Antoinette Vischer, la dédicataire de la pièce (UE 13716), et
pour piano, de 1967, créée en 1968 à New York par Joel Spiegelmann (UE 13794). Il s’agit donc d’une
« traduction » d’un instrument à l’autre, qui implique nécessairement
la modification, l'interprétation, la transcription : la
transformation de la pièce pour clavecin en pièce pour piano. Les deux versions
de Rounds ont une durée indicative de
4 minutes.
Le titre Rounds signifie :
1/ round (adjectif) - rond, circulaire
2/ to
round - tourner en rond, décrire un cercle : to go round in circles, tourner en rond ; to turn round and round - tournoyer
3/ to round - arrondir, rendre rond,
s’arrondir, devenir rond.
Le titre renvoie à une orientation
essentielle pour les recherches compositionnelles des années 1960-70 :
o
en
finir avec le fonctionnalisme formel hérité du classicisme et du romantisme et
annuler toute directionnalité d’ordre narratif,
téléologique, en finir avec « la flèche du temps » unidirectionnelle,
conforme à notre habitude de lecture-écoute allant nécessairement de gauche à
droite(5). A la place de l’énonciation directionnelle, on érige ici en principe
formateur essentiel au niveau de la macro- et de la micro-structure le principe symétrique et circulaire : la forme globale reprend, tout en
le modifiant considérablement, le principe chargé d’histoire de la forme
tripartite symétrique de type A B A1
o
en finir
avec la tradition du thématisme, du leitmotivisme et,
par conséquent, du fonctionnalisme et du centralisme d’ordre thématique : l’évolution microstructurale dans la pièce repose sur
le retour modifié de caractères musicaux ouverts, c’est-à-dire reconnaissables
comme « les mêmes », mais jamais identiques. Il s’agissait en fait
d’introduire le maximum de différence dans le répété pour renoncer définitivement
au thématisme, au leitmotivisme, au développement
thématique et, par conséquent, au fonctionnalisme et du centralisme de
l’univers tonal : des œuvres comme le monodrame atonal Die Erwartung (1908) de Schœnberg avait déjà montré le chemin dans ce sens.
La version de Rounds pour clavecin est
typique de la recherche des formes dites ouvertes des années 60 : elle comporte
nécessairement « des versions différentes toutes vraies », selon la
très célèbre formule de Mallarmé reprise souvent par Boulez, à travers les
possibilités différentes de lecture du texte. La copie, la répétition stricte
en musique est déjà transcription minimale. Mais lire (ou copier) dans le sens
inverse et en miroir est une transcription qui introduit nécessairement beaucoup
de différences qui peuvent rendre le texte initial parfaitement méconnaissable.
Tourner la page à 180 degrés signifie pratiquement suppression de l’unidirectionnalité et dérivabilité, mais uniquement
visuelle, des parties l’une par rapport à l’autre. Lire de gauche à droite ou
de droite à gauche, en plus à l’envers (dans une version miroir) renvoie, bien
sûr, aux traditions polyphoniques et surtout aux recherches formelles des
compositeurs de l’avant-garde des années 1950/60 : Rappelons Zyklus (1959) pour un percussionniste de
Stockhausen qui prévoit précisément la lecture de gauche à droite et l’inverse
en miroir)(6), Refrain (1959) pour 3 instrumentistes (piano, célesta,
vibraphone), la Troisième sonate (1957…) pour piano de Boulez, Circles (1960) de Berio, etc. Ce type de recherche
formelle allant vers les formes dites ouvertes(7) est nécessairement lié, à
l’époque, à la recherche d’une suppression de la téléologie et, par conséquent,
d’une réalisation visuelle de la partition la plus adéquate au projet formel de
l’œuvre. D’où aussi l’aspect visuel de la partition de Rounds de Berio
pour clavecin comportant une seule feuille lisible à l’endroit et à
l’envers : on retourne la page A à 180
degrés pour lire la partie B, puis on la retourne de nouveau à 180 degrés pour lire la ré-exposition A1 modifiée, c’est-à-dire jouée plus rapidement.
La version pour piano de Rounds renonce par contre à l’ouverture(8) et à
la recherche visuelle particulière de la pièce pour clavecin : ici la
forme tripartite est écrite intégralement et de façon tout à fait
précise selon le principe ancien des formes Da capo. La partie de la ré-exposition A1 n’est pas ré-écrite non plus, le compositeur
précise seulement que cette ré-exposition à distance
dans le temps de la même musique doit être jouée plus vite, la noire = 72 (et
non pas à 60 comme au début).
Rappelons que Rounds a existé aussi,
mais de façon très éphémère, dans une version avec voix : Rounds with voice, celle de Cathy Berberian : la création a été enregistrée sur disque (Wergo) par Antoinette Vischer (clavecin) et Cathy Berberian et s’inscrit dans les recherches des formes dites
ouvertes des années 60 et des techniques de transcription tant aimées par
Berio.
Les deux versions connues de Rounds témoignent
de la recherche d’un élargissement considérable des techniques instrumentales.
En ce sens elles s’inscrivent dans le courant des recherches instrumentales des Sequenza :
-
Dans la
version pour clavecin, la recherche
compositionnelle va dans le sens du caractère percussif de l’instrument sans
résonance, caractère exacerbé par l’utilisation des clusters et, plus
encore, des pédales ajoutant nécessairement du bruit lors du jeu. L’exploration
des régistrations et du timbre luthé permet un
élargissement maximal de la palette des timbres. A ceci s’ajoute nécessairement
le comportement gestuel spectaculaire - « théâtral » - de
l’instrumentiste jouant sur les deux claviers et sur les pédales. Rappelons
qu’il s’agit de l’époque de l’expérimentation dans le domaine du « théâtre
instrumental » : Rounds pour clavecin, mais encore Circles de Berio renvoient de façon explicite à
cette orientation. Il s’y ajoute l’aspect visuel spécifique de la partition.
-
Dans la
version pour piano de Rounds on va dans le sens d’une exploration de la
résonance de l’instrument, amplifiée par l’utilisation des pédales. Les
différences dynamiques et de registre, ainsi que les sons tenus et les
résonances des ostinati de hauteurs (intervalles ou
clusters) permettent un traitement proprement spatial de l’instrument. Les sons
ou intervalles tenus ou les clusters dans un registre déterminé sont
nécessairement les agents les plus efficaces de la structuration spatiale. Il
s’agit de recherche dans le sens d’une sorte de « piano-espace »(9).
Dans la version pour piano, le compositeur renonce pratiquement à toute
ouverture de l’œuvre de par l’intervention relativement libre de l’interprète : il s’agit ici
d’interpréter une partition, écrite de façon tout à fait précise dans ses
moindres détails. La dimension « théâtre instrumental » est aussi
totalement mise entre parenthèses. La mise en page de partition devient tout à
fait conventionnelle.
Une lecture-écoute analytique de la pièce pour piano Rounds permet de constater qu’il s’agit de structure ternaire de type A B A1 avec partie centrale qui renvoie à la tradition des formes tripartites
à partie centrale développante B et partie ré-expositionnelle modifiée A1
L’expérience de Rounds dans ses deux
versions renonce donc à la centration autour d’une composante thématique
prépondérante, ébranle considérablement le fonctonnalisme formel conventionnel(10) et supprime l’unidirectionalité causale du processus, tout en maintenant la dérivabilité des caractéristiques
musicales. La répétition n’est plus une répétition d’éléments fixes ou de
parties successives identiques, mais reprise différente de totalités ouvertes
multidimensionnelles. La différence profonde nomadise, se déplace d’un niveau à
l’autre, chaque niveau comprenant des moments privilégiés qui lui sont propres.
La transcription chez Berio vise la répétition dynamique, intensive,
pluridirectionnelle, spatiale. On tourne, on retourne, on inverse et on
renverse, on invente en permutant les éléments des cycles ouverts au niveau de
la microstructure (Cf. Rounds I ou A), on lit en sens inverse et
en miroir tout en modifiant la texture (Rounds II ou B), on
accélère le mouvement pour ne pas fermer le cercle, mais le laisser ouvert,
pour effectuer une nouvelle transcription et éviter la symétrie statique dans
la reprise à distance de A1. Les deux
petites pièces Rounds s’inscrivent parfaitement dans la recherche
formelle fondamentale pour Berio : celle d’un processus formel ouvert(11),
libéré de la directionnalité univoque que l’on
retrouve – dans des transcriptions différentes de la même idée – dans Circles (1960) pour voix de femme, harpe et 2
percussionnistes, dans Rounds pour clavecin (1965) et pour piano (1967),
dans l’action musicale en deux parties et 5 cycles Outis (1996). Ces trois œuvres témoignent
différemment de la même préoccupation formelle fondamentale pour Berio, que
l’on peut sommairement définir comme :
-
une
dissolution du centre thématique, de la figure-origine ;
-
une
pulvérisation de la linéarité causale ;
-
une
ouverture intrinsèque fondée sur le jeu de répétition et différence au niveau
de la micro- et de la macrostructure de l’œuvre.

© DR
III. D’une formation à
l’autre : Sequenza X et Kol od
Berio a souvent transcrit sa propre musique
pour déployer « les virtualités cachées »(12) du matériau musical.
Toutes ses pièces pour différentes formations intitulées Chemins, ainsi
que Kol od, Récit et Corale sont pratiquement des
transcriptions de ses pièces pour instruments seuls Sequenza(13).
Sequenza X (1984) pour trompette en do avec résonances facultatives au piano et Kol od (Chemins VI)
(1996) pour trompette et orchestre de chambre seront l’exemple de transcription
fondée sur la mise en contexte nouveau, sur l’extension de la pièce initiale Sequenza pour instrument soliste en pièce pour le
même soliste et orchestre.
Sequenza X est la seule des Sequenza qui
nécessite deux instrumentistes(14) : le soliste trompettiste, bien sûr, et
un pianiste qui doit jouer (sans taper sur les touches du clavier, mais en les
appuyant) une partie constituée d’accords qui mettent en résonance certains
sons de la partie soliste. Kol od sera, précisément l’amplification : le
développement et l’instrumentation de ce « double » en résonances de
la partie soliste qui témoignent de l’intérêt
très personnel de Berio pour les procédés de la musique spectrale.
Sequenza X (1984) pour trompette en do existe en deux versions : la version pour trompette seule et la version avec les résonances au
piano. Cette dernière comprend en fait l’extension timbrale et les résonances au piano de la partie soliste. Le trompettiste qui se trouve
pour jouer tout près du grand piano à queue, parfaitement accordé et à
couvercle tout à fait ouvert, joue à certains endroits de la pièce, indiqués
par flèches dans la partition, dans le piano, contre les cordes qui se mettent
en vibration et en résonance en fonction du jeu muet du pianiste. (Il est déjà
sur scène devant le clavier avant la sortie du trompettiste.) Le piano doit être
un peu amplifié, selon les indications du compositeur, et le microphone – placé
sous l’instrument. Les haut-parleurs doivent rester invisibles pour les
auditeurs.(15)
Sequenza X est un nouvel exemple dans l’œuvre de Berio d’extension de la technique
d’un instrument mélodique, allant dans le sens d’une polyphonisation de l’écriture. Après les Sequenzas I, V,
VI, VII, VIII et IX pour instruments monodiques (respectivement pour
flûte, trombone, alto, hautbois, violon et clarinette), le compositeur invente
ici des modalités de polyphonisation – c’est-à-dire
d’extension de la linéarité en espace pluridimensionnel – sur la base des
possibilités naturelles et des procédés spécifiques nouvellement inventés du
jeu de trompette. Les procédés de Flatterzunge,
de « doodle » Zunge / « doodle-tonguing »,
de ventil-tremolo, d’ouverture et de fermeture
de l’instrument avec la main, de sons répétitifs émis le plus rapidement
possible, etc. sont utilisés non seulement pour leur qualité timbrale spécifique, mais encore en tant que modalité
d’élaboration de différentes voix d’une texture polyphonique. En fait, tous les
paramètres du son - la hauteur, la durée, l’intensité, le timbre, le lieu de
production du son - sont pratiquement mis au service de la spatialisation inscrite
dans la partition : la hauteur, à travers les différents registres, les ostinatide hauteurs fixes, les sons longuement
tenus, etc. ; la durée, à travers l’utilisation de caractères ou de
groupes rythmiques individualisés ; l’intensité, à travers l’utilisation
de dynamiques très diversifiées ; le timbre, à travers les modes
d’attaques particuliers et les techniques spécifiques déjà énumérées ; et
le lieu de production du son, dans ou à l’extérieur de la caisse de résonance
du piano. Il ne s’agit pas en l’occurrence de multiphonie complexe (les haut-parleurs servent uniquement à rendre plus audibles dans la
salle les résonances du piano), mais de spatialisation de la texture
instrumentale, de polyphonisation – de multiplication
des lignes mélodiques inscrites dans la partition monodique et de résonances,
de mise en espace spectral des sons joués par le trompettiste.
Kol od : le titre en hébreu a une signification
double : « fin quando » -
« jusqu’à ce que », ce sont les premiers mots de l’hymne national
israélien dont les cinq premières notes sont dissimulées dans la partition. Et
puis, en changeant l’orthographe en hébreu, mais sans changer la
prononciation et donc le phonisme de la parole :
« voce ancora » / « encore de la
voix », donc aussi « più voce » / « plus de voix ». La
pièce est dédiée au célèbre chef d’orchestre et mécène suisse Paul Sacher « avec
affection profonde et admiration » à l’occasion de son 90 ème anniversaire. Kol od(Chemins VI) reprend intégralement Sequenza X : il s’agit d’une mise en
contexte nouveau – orchestral – de la pièce pour trompette et résonances au
piano. Toutes les parties de l’orchestre de chambre - comportant piccolo, 2
flûtes, hautbois, petite clarinette en mi b, 2 clarinettes en si b, clarinette
basse en si b, saxophone soprane en si b, saxophone alto en mi b, basson, 2
trompettes, 2 cors en fa, trombone, basse tuba, célesta, accordéon, 4 violons,
3 altos, 3 violoncelles et 2 contrebasses – sont déduites, issues de la musique
de la Sequenza pour trompette. Elles sont en quelque
sorte l’extension ou l’élaboration musicale de la partie soliste avec ses
résonances. L’accordéon reprend de façon explicite les résonances du piano. Les
bois et les cordes effectuent une extension de ces résonances, tout en inventant
des traits mélodiques issues de la partie soliste qui
produisent un enrichissement considérable de la texture orchestrale. Enfin, les
cuivres médiatisent entre la partie soliste en la multipliant par des
interventions similaires et les résonances différemment colorées. A 6 reprises,
l’orchestre intervient avec des interludes relativement courts et denses,
toujours directement liés au matériau musical de la partie soliste, en
contribuant à la diversité et à la cohérence de l’œuvre dans sa totalité, tout en
modelant un geste formel global inévitablement plus riche que celui de la Sequenza X. Dans Kol od, le compositeur développe des situations où
l’instrument soliste génère des caractéristiques qui sont confiées
immédiatement ou à distance dans le temps à l’orchestre de chambre qui, à son
tour engendre la partie soliste qui suit. En ce sens, la partie soliste –
pratiquement préexistante – se trouve produite dans la continuité dans le
contexte orchestral : elle n’est plus matière préalable fixe, mais conséquence,
résultat d’un processus.
Kol od témoigne, de façon explicite, de
préoccupations essentielles pour Berio : celle de la transcription dans sa
version de mise en contexte et déploiement orchestral d’une pièce pour soliste,
et celle de la spatialisation dans la version polyphonisée de la matière monodique, mais encore dans le déploiement spatial des résonances
spectrales dans la texture orchestrale. La constellation des trois pièces Sequenza X pour trompette seule, Sequenza X pour trompette et résonances au
piano et Kol od (Chemins VI) pour trompette et orchestre de chambre témoigne de
l’importance de la transcription - réécriture dans la recherche
compositionnelle de Berio et dans son cheminement d’une œuvre à l’autre.
Au sujet de ses pièces Sequenza VI pour alto, Chemins II pour alto et neuf instruments et Chemins
III pour alto, neuf instruments et orchestre, Berio disait - mais c’est
valable aussi pour Sequenza X et Kol od :
« Ces trois pièces se rattachent l’une à l’autre comme les différentes
couches d’un oignon : distinctes, séparées et pourtant collées l’une à
l’autre, chaque couche nouvelle
créant une surface nouvelle, bien que rattachée à la précédente, et chaque
couche ancienne assumant une nouvelle fonction dès qu’elle est recouverte… »(16).
La métaphore de Berio traduit de façon imagée sa propre conception de la
recherche compositionnelle en tant que réécriture ouverte, à la fois non
centrée et multiple. Elle renvoie à son « artisanat furieux », à son
art exceptionnel de traduire : de transcrire et de réécrire différemment,
c’est-à-dire d’enrichir indéfiniment une altérité à laquelle on s’identifie, de
laquelle on s’inspire ou que l’on démolit pour construire du différent et du
nouveau. Toujours amoureusement et avec humilité, dans « un acte
transparent d’amour et d’apprentissage »(17).
Ivanka Stoianova.
(1) L . Berio - « Tradurre la musica / Lezioni americane», in Un ricordo al futuro, Einaudi,Torino, 2006, p. 29 :
« La musica viene tradotta, apparentemente, solo quando ci troviamo costretti, per una ragione o per altra, a passare da una specifica esperienza musicale alla sua descrizione verbale, dal suono di uno strumento a quello di un altro, dalla lettura silenziosa di un testo musicale alla sua esecuzione. In realtà questo bisogno è cosi diffuso, presente e perrmanente che siamo tentati di pensare che la storia della musica sia, in effetti, una storia di traduzioni. Ma forse tutta la nostra storia, e il divenire della nostra cultura, è una storia di traduzioni. E una cultura che vuole possedere tutto equindi traduce tutto : tutte le lingue, le cose, i concetti, i fatti, le emozioni, il denaro, il passato, il futuro e, naturalmente, la musica. » (L. Berio).
(2) Cette présentation ne prétend pas à exhaustivité, compte tenu du fait que toutes les œuvres de Berio – pour instruments et voix, pour grand orchestre, électroniques, les œuvres destinées à la scène – utilisent des procédés de transcription d’œuvres d’autres auteurs ou de Berio lui-même.
(3) Interview I. Stoianova - L. Berio du 23 .03.1978.
(4) Ibid., 23. 03. 1978.
(5) La recherche dans le sens d’une suppression de la téléologie conventionnelle et d’une certaine ouverture est vivante aussi au cours des années 80 : Ainsi le Klaviertrio (Trio pour violon, violoncelle et piano) de Berat Furrer intitulé Retour an dich (1986) repose aussi sur la technique des retours modifiés, sur le « tournoyer », le « kreisen » : le compositeur joue avec le même et le différent pour obtenir l’impression de « Schwerlosigkeit » / d’apesanteur. Et il retourne vers une ancienne pratique des parties séparées sans partition globale, ce qui implique en l’occurrence plus d’écoute mutuelle, plus de décisions sur le champ et, par conséquent, plus de liberté lors de l’exécution.
(6) La partition est un cahier à spirale que l’on doit lire dans l’ordre des pages à partir d’un moment librement choisi jusqu’à ce qu’on arrive au point de départ. On peut aussi retourner le cahier et lire en version miroir. – Cf. K. Stockhausen – « N°9 : Zyklus für einen Schlagzeuger (1959) », in K. Stockhausen – Texte zu eigenen Werken,, zur Kunst Anderer, Band 2, DuMont Schauberg, Köln, 1964, S. 73-100.
(7) Cf. U. Eco - L’opera aperta, Einaudi, Milano, 1962.
(8) Dans le sens des œuvres ouvertes des années 60. Pour inventer par la suite une ouverture intrinsèque inscrite dans l’écriture.
(9) Ce terme a été souvent utilisé par la suite par le compositeur et pianiste français Michael Levinas.
(10) Les fonctions formelles de début et de fin, de partie introductive, d’élaboration médiane et de conclusion-fin sont tout de même présentes dans Rounds. Le compositeur cherchera à supprimer ces distinctions formelles dans les cycles de son « azione musicale » Outis.
(11) Il est évident que cette notion d’ouverture n’a rien à voir ni avec les formes dites ouvertes de par la permutation de leurs composantes formelles des années 60-70, ni avec l’idée de l’infini de la pièce, c’est-à-dire de la non-limitation dans le temps de sa mise en évidence sonore.
(12) Interview I. Stoianova - L. Berio du 23 .03.1978.
(13) Voir L. Berio Chemins I sur Sequenza II (1965) pour harpe et orchestre ; Chemins II sur Sequenza VI (1967) pour alto et 9 instruments ; Chemins II B (1970) pour orchestre ; Chemins II C (1972) pour clarinette basse et orchestre ; Chemins III sur Chemins II (1968-73) pour alto et orchestre ; Chemins IV sur Sequenza VII (1975/2000) pour hautbois et orchestre de chambre ; Chemins V sur Sequenza XI (1992) pour guitare et orchestre de chambre ; Chemins VI / Kol od (1996) sur Sequenza X pour trompette et orchestre de chambre ; Chemins VII / Récit (1996) sur Sequenza IXb pour saxophone alto et orchestre ; Corale sur Sequenza VIII (1981) pour violon, deux cors et cordes ; Voci (Folk Songs II) (1984) pour alto et deux groupes d’orchestre.
(14) Cette idée est déjà présente, sous une autre forme et, très probablement non sans l’influence de Stimmung de Stockhasuen, dans Sequenza VII (1969) pour hautbois, dédiée à Heinz Holliger : Conformément à la dédicace, toute la pièce est centrée autour de si (h de H. Holliger), qui devrait – éventuellement – être joué ppp par un autre instrumentiste tout le long de la pièce. Une telle version n’est pratiquement jamais jouée, étant donné que le monologue du hautbois revient systématiquement su le son centralisateur si.
(15) Voir L. Berio, Sequenza X per tromba in do (e risonanze di pianoforte) (1984), Universal Edition, N° 18200, Vienne,
1984.
(16) L. Berio, Interview I. Stoianova – L. Berio du
19.06.1979.
(17) L. Berio – « Tradurre la musica », in Un ricordo al futuro / Lezioni americane, Einaudi, Torino, 2006, p. 34.
***
Le Reniement de Pierre, autre création mondiale de Jean-Jacques
Werner

Georges DELVALLÉE et
Jean-Jacques WERNER (Photo : Frédéric Werner)
Après deux récentes
premières mondiales à l’École Alsacienne et à l’Église Notre-Dame-des-Champs (à
Paris), une troisième œuvre de Jean-Jacques Werner : Le reniement de Pierre (2013) a été créée le 27 octobre 2013 en l’Église Saint-Germain-des-Prés. Ce mémorable concert a
débuté par la Fantaisie Improvisation sur Ave maris stella de Charles Tournemire (1870-1939),
ayant permis à Georges Delvallée de plonger les
auditeurs dans une atmosphère tour à tour mystique, plus animée, massive et
énergique, se terminant dans le calme sur une longue tenue apaisante. Carole
Marais (mezzo), accompagnée avec infiniment de sensibilité à l’orgue, a interprété le Lied der Ruth (Chanson de
Ruth) du Tchèque Petr Eben (1929-2007), dont
l’introduction tourmentée, grave, dramatique, plaintive spécule sur les
nuances. Pour sa part, l’excellent organiste a eu raison de choisir Trois Pièces pour orgue (op. 14) de
Maurice Emmanuel (1862-1938) : 1. Dans
un style pastoral ; 2. Andante
sur O Salutaris et Adoro te devote ;
3. Finale, successivement mystique
avec chant et contrechant, faisant appel à l’extrême aigu puis au grave, enfin
massif avec de grands accords plaqués. Lors de nombreux Festivals, Carole
Marais et Georges Delvallée révèlent ensemble des
pages contemporaines méconnues, et Jean-Jacques Werner n’aurait pu trouver
meilleur duo pour rendre avec tant d’intelligence musicale le récit du Reniement de Pierre (Évangile de Luc, chapitre 22, versets 54
à 62), moment descriptif, poignant et lourd d’émotion. Interprètes et auditeurs
ont ainsi pu être confrontés à l’incohérence, la faiblesse et la lâcheté
humaines. L’œuvre s’ouvre sur une vaste progression avec des intervalles
disjoints, devient énigmatique puis théâtrale dans l’extrême aigu. Répliques,
interrogations et hésitations s’enchaînent dans le dialogue entre le Christ et
Pierre. Le compositeur, recherchant les effets de contrastes et les dissonances
à bon escient, a introduit un cluster générant un long suspense, et réalisé une
œuvre d’une très haute spiritualité. Avec sa grande maîtrise, G. Delvallée a interprété — à l’Orgue Haerpfer-Ermann (1973) —l’Alleluia n°4 extrait de L’Orgue mystique de
Charles Tournemire, dans l’optique du retour aux sources grégoriennes et à la
sensibilité catholique du début du XXe siècle. L’œuvre très brillante et d’une
belle envolée termina cet inoubliable concert en apothéose.
Édith Weber.
Le Livre de Notre Dame

© DR
Belle affluence pour le concert donné en la
cathédrale Notre-Dame, à l'occasion de la création du Livre de Notre-Dame, par
le chœur d'enfants de la Maîtrise. Rappelons que l'association Musique Sacrée à
Notre-Dame de Paris avait passé commande à quinze compositeurs d'une messe brève
et de douze motets, dans le cadre des célébrations des 850 ans de l'édifice.
L'idée était aussi d'enrichir le répertoire d'œuvres contemporaines pour chœurs
d'enfants. Quinze visions signées de compositeurs d'esthétiques très
différentes, mais unies par un même désir de célébrer Notre Dame, en suivant le
cursus de l'année liturgique. Quinze pièces de difficulté variable, quoique
conçues pour pouvoir être appréhendées par de jeunes chanteurs, écrites sur des
textes latin ou français, et même pour l'une d'elle, en hébreux (Bruno Ducol), par des musiciens qui, pour certains, ont peu
l'habitude de pratiquer la musique liturgique. Les trois séquences de la messe
brève étaient introduites par un Kyrie dû à Édith Canat de Chizy, faisant intervenir une voix soliste. Le
Sanctus, sous la plume féconde de Thierry Escaich,
est jubilatoire, avec des effets de démultiplication des voix. L'Agnus Dei, de
Nicolas Bacri, qui réclame un large effectif, est
fervent, se concluant sur une longue tenue vocale. Des motets, extrêmement
variés, on retiendra « Du fond de l'abîme » de Jean-Pierre Leguay, immensément habité, le Tantum ergo, de Vincent Bouchot, le plus développé, le motet pour la Pentecôte de
Benoît Menu, le benjamin, qui emprunte au Veni Creator, ou le Motet à la Vierge, de Michèle Reverdy,
communiquant une étonnante impression d'espace. Durant ces soixante quinze
minutes de musique chorale, sur le seul accompagnement de l'orgue, le chœur
d'enfants de la Maitrise de Notre-Dame accomplit des merveilles, passant avec
une rare aisance d'un style à l'autre. Nul doute fruit de l'intense travail de
préparation effectué sous la conduite d'Émilie Fleury, chef du chœur d'enfants.
A la hauteur de l'enthousiasme de ses « maîtrisiens »
« à devenir le temps d'un concert des apôtres de la musique
contemporaine », souligne-telle. Sans parler de l'aspect exaltant de
l'entreprise. Cela faisait chaud au cœur de voir cette pléiade de jeunes
chanteurs s'attaquer avec tant de conviction à des pièces aussi ardues et
surtout dissemblables. Indéniablement, un fabuleux couronnement à leur cursus
d'études. Et en ce lieu chargé d'histoire séculaire, berceau de l'École de
Notre-Dame et de ses grandes polyphonies. L'orgue de chœur était tenu
alternativement par un des titulaires de Notre-Dame, Yves Castagnet,
signataire au demeurant du dernier motet « O Notre-Dame du soir », et
par Denis Comtet, titulaire du
Grand orge de Saint François Xavier à Paris. La présence de la plupart
des auteurs ajoutait à l'événement : une nouvelle pierre au prestigieux édifice
que constitue l'histoire musicale de la Cathédrale de Paris.
Jean-Pierre Robert.
Du très beau travail d'orchestre : Riccardo Chailly et le Gewandhaus

Riccardo Chailly dirigeant le Gewandhausorchester Leipzig / DR
On l'a déjà relevé, mais cela se confirme
de fois en fois, l'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig
et Riccardo Chailly constituent l'une des
associations les plus inspirées du moment. Après une intégrale des symphonies
de Beethoven, exceptionnelle à plus d'un titre, les voilà à présent, l'espace d'une mini tournée entre Londres, Vienne et Paris, installés
dans un cycle Brahms. Leur deuxième concert, salle Pleyel, réunissait la
symphonie N°2 et le second concerto pour piano. La deuxième symphonie, op. 73,
qu'on a un peu vite qualifiée de « pastorale », est, entre les mains
du chef italien, marquée au coin de l'équilibre entre tradition et liberté.
Tradition, car cette phalange, rien moins que somptueuse, offre un son fourni,
mais jamais épais, des solistes émérites, le cor solo, la petite harmonie, et
une flexibilité du jeu, qui la placent parmi le peloton de tête des grandes
formations européennes. Liberté, car Chailly fuit
toute emphase, pour une approche claire, élégante ; ce qui ne n'enlève rien à
l'architecture d'ensemble, mais lui confère une sveltesse avenante et rend
justice à la transparence d'une orchestration qu'on a, en douce France,
longtemps voulu considérer comme indigeste. Ainsi du premier mouvement qui se
défie du climat grave qui lui est souvent associé. Le chant des violoncelles à
l'adagio est quasi envoûtant, l'allegretto grazioso est proche de la valse
viennoise, et la fougue du finale, proprement irrésistible. Il n'est rien de
nécessairement « italien » dans l'approche du maestro, sauf peut-être
l'extrême scansion insufflée à ce finale, allegro con spirito,
se concluant par une coda jubilatoire. Non, et c'est là que la tradition
rejoint le liberté, le chef conçoit son Brahms comme
marqué au coin de la pondération. Et la magie opère indéniablement. Pareille
séduction distingue l'exécution du Deuxième concerto pour piano, ciselée comme
un bijou, pensée de poésie de bout en bout. Sa texture symphonique est bien
connue. On savait les affinités du maestro Chailly avec cette pièce, comme avec le premier concerto, depuis qu'il les grava pour
le disque, en des interprétations de référence, distinguées par le jeu
souverain de Nelson Freire (Decca). Le bonheur est ici tout aussi palpable.
Rarement aura-t-on assisté à exécution plus nuancée que celle du jeune prodige
russe Arcadi Volodos, dont
le toucher, d'une étonnante flexibilité, passe du forte énergique,
quoique non exagérément percussif, au quadruple piano, d'une phénoménale
douceur. Ainsi, de l'entrée patte de velours du piano, à l'andante, sur le
thème initié par le violoncelle solo, ou plus avant, à la partie centrale, lors
du dialogue avec les clarinettes. Volodos distille la
poésie au-delà des notes, tandis que Chailly installe
un climat d'une ineffable beauté. Ils suspendent le temps, tenant la salle en
haleine. Certes, le tempo s'étire quelque peu, mais comment résister à un tel
attrait sonore, qui ne souffre au demeurant de nulle affectation ? La touche
personnelle du pianiste libère la dramaturgie d'une pièce aux multiples
facettes, de la bravoure à la confidence, de la structuration charpentée où le
soliste est intimement mêlé à l'orchestre, à l'atmosphère chambriste, de la
profondeur abyssale à la ballade enjouée, comme au finale allegretto grazioso,
dansant, quasi turbulent à travers le dialogue clavier-orchestre.

Arcadi Volodos / ©DR
Jean-Pierre Robert.
Au cœur de la musique de piano espagnole

Luis Fernando
Pérez / ©DR
« La Folle nuit à Gaveau », c'est
un peu de La folle journée nantaise à Paris. En fait un concentré de ladite
manifestation puisque les concerts sont, pour l'essentiel, dévoués au piano, et
à la pléiade d'interprètes de l'écurie René Martin et de son label de disques Mirare. Parmi eux, le récital du pianiste espagnol Luis
Fernando Pérez, découvert il y a quelques années à Nantes, est à marquer d'une
pierre blanche. Comme naguère avec la grande Alicia de Larrocha,
la symbiose entre une musique et un interprète fascine. Concert marathon s'il
en est, puisque Pérez avait choisi de donner Iberia d'Isaac Albéniz.
Composées entre 1905 et 1908, à la fin de sa vie, ces « douze impressions
pour piano » sont une évocation de l'Andalousie. Prisées par Debussy et
par Messiaen, elles forment un tableau sonore d'une étonnante vivacité, baigné
des couleurs, des rythmes et des accents ibériques. D'une virtuosité quasi
lisztienne, c'est une musique débordant de rythme, pouvant aller jusqu'au
fracas sonore, mais tout autant emplie d'une poésie impressionniste et de parfums
odorants. L'œuvre est inscrite dans quatre cahiers, eux-mêmes constitués de
trois pièces. Chacune porte un titre évocateur, soit d'un lieu (Cadiz, Almería,
Málaga ou Jerez), ou d'une danse flamenca (Rondena, Triana, El Polo), ou encore d'une scène : « Corpus
Christi en Sevilla » décrit la procession de la Semaine Sainte dans la
cité andalouse, rythmée par les tintements de cloches. « Lavapiés », du nom d'un quartier populaire de Madrid,
et seule pièce non andalouse de l'ensemble, est si animée qu'elle est, selon
l'auteur, « presque injouable ». « Eritana »,
une taverne en bordure de Séville, de sa joyeuse effervescence, apporte une
conclusion brillantissime à cette heure et demi de
musique incandescente. Les deux derniers cahiers offrent une virtuosité encore
plus démonstrative que les deux premiers, quelque chose de plus moderne aussi.
Luis Fernando Pérez, qui remet sur le métier ce monument, par lequel il avait
attiré l'attention et s'était fait connaître au disque, dès 2007, en habite les
moindres recoins et se joue de la complexité ahurissante de ces pièces. De leur
compacité, de leur rugosité parfois, qui requièrent une énergie peu commune.
Mais aussi de l'hypnose qui appert de certaines combinaisons sonores,
d'incessantes variations de tempos, entre extrême agitation et calme magique de
l'évocation. « Les résonances sont très importantes », souligne-t-il.
On perçoit dans certaines pièces un vraie densité
orchestrale. Son toucher phénoménal lui permet une gamme de nuances infinies. Devant une salle enthousiaste, qu'il remercie « pour
son silence », il donnera généreusement pas moins de 25 minutes de bis,
dont « Clair de lune » de Debussy « composé la même année que
'Corpus Christi' », et une incantatoire et envoûtante « danse rituelle du
feu » de Manuel de Falla.
Jean-Pierre Robert.
Aïda enfin de retour dans la Grande boutique
Giuseppe VERDI : Aïda.
Opéra en quatre actes. Livret d'Antonio Ghislanzoni d'après Auguste Mariette. Orsaka Dyka,
Marcelo Alvarez, Luciana D'Intino,
Carlo Cigni, Roberto Scandiuzzi, Sergey Mursaev, Oleksiy Palchykov, Elodie Hache.
Orchestre et Chœur de l'Opéra national de Paris, dir.
Philippe Jordan. Mise en scène: Olivier Py.

© ONP / Elisa
Haberer
Aïda serait-il un opéra mal compris ?
Considéré comme le modèle de l'opéra à grand spectacle, à l'aune de ses défilés
et autre scène du triomphe, atypique dans son exotisme, on en vient souvent à
éluder sa dimension théâtrale vraie : une lutte entre passion amoureuse et
devoir patriotique, à l'intérieur d'une joute triangulaire mettant aux prises
un homme, Radames, et deux femmes, Amnéris et Aïda. L'œuvre entretient avec la France un rapport particulier. On sait que Verdi
n'entra pas sans hésitation dans le projet d'écrire un opéra festif qui marque
l'inauguration du canal de Suez, se refusant « de composer des morceaux de
circonstance ». S'il l'adopta, après moult réflexions et pressions, c'est
convaincu de la validité « théâtrale » du sujet, tel que présenté par
l'égyptologue Auguste Mariette. D'où l'étrangeté du dilemme auquel est
confronté tout metteur en scène : ne pas sombrer dans le gigantisme pompier des
tableaux d'ensembles d'une Égypte reconstituée, qui réduirait la force des
scènes intimistes, où s'affrontent des personnages de chair et de sang, sans
pour autant réduire la puissance évocatrice des premiers. Olivier Py semble vouloir tourner le dos à la grandiloquence qui
fait fureur aux arènes de Vérone ou autre Palais omnisport de Bercy. Il
transpose donc, et à l'époque de la création de l'opéra, en cette fin de XIX ème siècle, dans une l'Italie secouée de grandes mutations.
Et en fait un opéra de luttes entre forces institutionnelles et personnages
broyés autant par celles-ci que par leurs propres passions. L'emprise des
appareils est soulignée : l'armée bien sûr, omniprésente et batailleuse, mais
aussi les prêtres, pas moins querelleurs. Fasciné par le religieux, Olivier Py va jusqu'à imaginer ces derniers en membres du clergé,
soutane noire et aube à dentelles, leur chef Ramfis,
affublé du costume d'évêque, mimant quelque office chrétien lors de la scène du
Jugement. Les démonstrations de foule prennent une autre allure, entre
totalitarisme politique et intégrisme religieux. Mais cela suffit-il à
concilier les contraires, et à bien faire la part entre drame essentiel et
faste qui colle à l'œuvre ? Pas si sûr. Paradoxalement, la magnificence de la
décoration, faite d'un jeu de façades habillées d'or, qui se métamorphosent en
autant de formes différentes, de celle austère de quelque palais plus français
que latin, à la réplique du monument à Victor Emmanuel II, ornant le Capitole à
Rome, ne crée d'effet ni de solennité ni d'intimité ; quand ces constructions
rutilantes n'aveuglent pas le spectateur à la faveur de leurs déplacements
incessants, frappées par un faisceau de lumière intempestif. Elle capte
l'attention au risque de la disperser dans une suite de visions souvent absconses.
Et le fond noir, à la Soulages, s'il met en valeur cette dorure éclatante, n'en
renforce pas la signification. La direction d'acteurs est, curieusement, de la
part de cet homme de théâtre, placide dans les ensembles et peu habitée lors
des échanges intimistes : les nombreux duos se trouvent comme perdus sur le
vaste plateau. La dispersion semble même participer d'une volonté délibérée :
celle de jouer sur la distance qui sépare physiquement les personnages, souvent
disposés chacun sur un plan différent, comme à la première scène. Ce qui nuit à
la lisibilité de l'action et contredit toute idée de proximité dramatique.
Quelques passages réussis, comme le dialogue serré opposant Amnéris et Aïda, au II ème acte, ou l'échange pathétique de
la dernière scène, réunissant Radames et Aïda, ne
parviennent pas à gommer l'impression d'une dramaturgie sans âme. Et on
n'échappe pas aux tics et marottes taraudant les régisseurs du moment : femmes
de ménage polissant inlassablement les façades, soldats en treillis pistolet ou
mitraillette au poing... La vraie théâtralité, tant recherchée par Verdi ici,
se serait-elle laissée piéger par un parti pris
décoratif envahissant, ce que l'on reproche précisément à la manière péplum de
traiter cet opéra ?

© ONP / Elisa
Haberer
L'impression mitigée touche pareillement
l'aspect musical du spectacle. Une chose est incontestable pourtant : la somptuasité orchestrale. Philippe Jordan imprime à
l'Orchestre de l'Opéra un vrai son verdien. Et une palette sonore toujours
attractive, combinant vérité dramatique et lyrisme épanoui. La science des
coloris, à la petite harmonie en particulier, n'a d'égale que l'aptitude à
brosser une atmosphère évanescente (Ouverture, début de l'acte du Nil) ou d'une
poignante intensité (scène finale). Voilà encore un succès sans réserve à
porter au crédit d'un chef décidément éclectique dans ses choix, sûr dans ses
interprétations. La contribution du Chœur se distingue pareillement, dans une
partie essentielle ici. C'est du côté des solistes, que le bât blesse souvent.
De la distribution, seuls Marcelo Alvarez et Luciana d'Intino défendent les vraies valeurs verdiennes. Le Radames du premier est fermement pensé et a grande allure,
justement dégagé de tout côté histrion. Les nuances pianissimos sont respectées
scrupuleusement, et l'approche intensément vécue, contribuant, par exemple, à
faire du dernier tableau un moment de pur frisson théâtral. La seconde campe
une Amnéris grandiose, impérieuse, et n'était une
tendance à poitriner une partie tirée vers le
mezzo-contralto, là où l'auteur souhaitait une voix plus claire, en impose
indéniablement. Roberto Scandiuzzi, Ramfis, ménage un beau timbre de basse profonde, même si
peu aidé par l'appréhension du rôle qui lui est imposée, au premier degré du
fanatique religieux. Mais ni Carlo Cigni, Roi un peu
fade, ni Sergey Murzaev, Amonastro tonitruant et bien peu crédible, n'ont de classe.
Surtout, l'Aïda d'Oksana Dyka pose problème : cette jeune interprète venue de l'Est possède une voix immense
qu'elle ne discipline pas. Le matériau, comme brut, la contraint de passer en
force, là où il faut de la nuance. L'air « Ritorna vincitor », au Ier acte, est asséné, et plus
tard, dans celui du Nil, le contre ut final se solde par sa robustesse et non son
aspect éthéré. Autant dire que l'effet ppp est escamoté.
L'interprétation est dépourvue d'aura. A l'heure du bilan, se pose la question
de savoir si cette pièce emblématique, non donnée depuis plus de quarante ans
sur la scène de l'Opéra, dispose d'une production à la hauteur des
attentes.
Jean-Pierre Robert.
Le vrai du vrai de la musique de chambre

© DR
Pour fêter son 90 ème anniversaire, le pianiste Menahem Pressler avait
convié quelques amis, et un public nombreux, renforcé de quelques collègues
musiciens, pour un concert marathon à la Salle Pleyel. Une forme d'hommage,
comme on n'en avait plus entendu depuis des lustres. Quelle soirée ! On
craignait que l'immense écrin ne dilue la finesse d'un jeu d'une sobriété
légendaire. Inutile appréhension : plus que le lieu, ce qui importe c'est la
concentration qui préside à l'interprétation, et la réceptivité du public. Sans
doute captivé par ce qui lui était offert, l'auditoire retenait son souffle.
Menahem Pressler et consorts nous ont conviés à une
vraie leçon de musique de chambre. Il est difficile de croire que ce toujours
jeune nonagénaire fut, cinq décennies durant, l'âme du Beaux Arts trio et de
mémorables concerts ! C'est nul doute dans le sillage de ceux-ci que se situait
le présent programme qui convoquait des compositeurs chers au cœur du musicien,
Schubert, bien sûr, et avant tout, mais aussi Dvořák.
Grande mise en doigts, la Fantaisie pour piano à quatre mains, où le
pianiste est rejoint par sa consœur Wu Han, livre une belle fluidité et un
thème mélancolique revenant en boucle dont Schubert a le secret. Plus tard,
quelques mélodies tirées du Winterreise nous
plongent au plus profond de la dramaturgie schubertienne, magnifiquement
chantées par le ténor Christoph Prégardien : la
douceur miraculeuse de l'accompagnement en fait presque oublier combien le
texte est habité. Mais ce sont les deux grands quintettes qui vont porter le
concert à son zénith assénant cette évidence que la combinaison piano-cordes
n'est pas aussi délicate qu'on le pense, tout n'étant qu'affaire d'équilibre à
trouver entre ces frères non ennemis ; ce à quoi Pressler s'emploie depuis toujours avec une rare élégance. Le Quintette « La
Truite » de Schubert respire bonheur et bonne humeur. Les arabesques du
piano se fondent idéalement dans le tissu des cordes, les membres du Quatuor
Ébène et la basse Benjamin Berlioz prodiguant un jeu perlé eux aussi : vigueur
tempérée du scherzo, joie sans ombre du finale allegro giusto,
mélange de sérénité et de douleur sous-jacente à l'andante, où les transitions
se font miraculeuses. Le Quintette op. 81 pour piano et cordes de Dvořák s'inscrit dans la lignée de son illustre
prédécesseur. Là aussi, l'entente entre les partenaires est pur régal :
fraîcheur mélodique de l'allegro initial, bouleversant andante bercé au rythme
de Dumka, contrastes du scherzo Furiant, preste et aérien, dramatisme du finale
bondissant de joie. A l'heure des bis, l'altiste des Ébène prend la parole pour
dire combien tout musicien doit à ce géant. Comme présent, les Ébène lui
offrent le mouvement lent du Quatuor de Debussy, compositeur adoré de Menahem Pressler : instants de beauté absolue. En guise de
remerciement, celui-ci confie, dans une désarmante modestie, nimbée de ce merveilleux sourire qu'on lui
sait légendaire, n'avoir jamais cherché qu'à faire de la musique correctement,
et joue un morceau de Chopin empli de mélancolie optimiste. Épilogue d'un
précieux moment de musique de chambre, comme on en voudrait plus souvent.
Jean-Pierre Robert.
Jeunes talents surprenants

L'Ensemble
Les Surprises / © Bertrand Pichène
Dans le cadre somptueux de la Chambre du
Prince de l'Hôtel de Soubise, l'association « Jeunes talents » présentait l'Ensemble Les Surprises.
L'occasion pour celui-ci de jouer le programme de son récent disque, publié
sous le label Ambronay, collection Jeunes ensembles
(cf. infra). Le lieu n'est pas le fruit du hasard, car ce bel hôtel du Marais,
qui abrite aujourd'hui les Archives nationales, possède une riche histoire
musicale : d'abord Hôtel de Guise, il logea Marc-Antoine Charpentier, puis
Gossec et le Chevalier de Saint-Georges. Et c'est pour Le Concert des amateurs,
qui s'y produisait, que Josef Haydn écrira ses six Symphonies Parisiennes.
« Rebel de père en fils » fournit une thématique originale : hommage
à une fameuse dynastie de musiciens violonistes, dont le père Jean-Féry (1666-1747), élève de Lully, sera le professeur du
fils, François (1701-1775), célèbre pour ses compositions menées en commun avec
François Francoeur (1698-1787). Autrement dit la redécouverte d'un répertoire
quelque peu tombé dans l'oubli, et l'instant de retrouver le goût des concerts
privés du XVIII ème. De fait, le
« Concert », au sens de programme, concocté par Les Surprises et leur
fondateur, le claveciniste Louis-Noël Bestion de Camboulas, s'attache à faire revivre l'opéra joué en
formation de chambre, comme il se pratiquait dans les salons du siècle des
Lumières. Sont proposés des extraits du Ballet de la Paix (1738) et de Scanderberg (1735), de François
Rebel/François Francoeur, précédés de la Symphonie chorégraphique Les
Caractères de la Danse, de Jean-Féry Rebel
(1715). Au fil de ces morceaux, et de leur enchainement ingénieux, quoique
conçu différemment de celui du disque, on admire une agilité instrumentale
aboutie, flûtes graciles, basson cuivré, théorbe coloré, cordes sveltes, dont
la viole de gambe de Juliette Guignard. Comme l'habileté de ces jeunes
musiciens à trouver le vrai style pour donner vie à ces morceaux si
différenciés. Les larges extraits de l'opéra Le Ballet de la Paix offrent
des univers contrastés, vocaux et instrumentaux. On est séduit, dans la vaste
Chaconne, par exemple, par l'alternance de phases animées et réfléchies, et
quelques effets de surprise, dans le traitement des bois notamment, et la
thématique fantasque qui réserve soudain un petit refrain entraînant. Le deux chanteurs sont au diapason de l'excellence,
dont Étienne Bazola superbe voix de baryton. Les savoureux « Tambourins », tirés de la
même pièce, donnés en bis, prolongeront une soirée aussi attrayante
qu'enrichissante.
Jean-Pierre Robert.
Maurizio Pollini : de Chopin à Debussy

© DR
A l'été indien d'une immense carrière,
Maurizio Pollini soulève toujours les foules. La mise
en route est certes plus lente que jadis : les deux premiers morceaux de Chopin
laissent sur sa faim. On se perd en conjecture sur le choix singulier, pour
débuter le concert, du Prélude op. 45, le 25 ème, qui
n'offre ni mélodie, ni rythme de nature à passionner, mais une singulière
instabilité tonale. La Ballade N° 2, op. 38 est prise à une vitesse excessive et une tendance à bouler le tempo, qui brouillent les
lignes. A moins que le pianiste ne cherche à illustrer toute la modernité des
rafales digitales de cette pièce, qu'entrecoupent pourtant les épisodes plus
élégiaques d'évocation du lac des Willis, imaginée par le poète Mickiewicz. La
Sonate N° 2 retrouve enfin la vraie manière pollinienne : un premier mouvement où le terme d'agitato paraît, ici, un euphémisme, tant
la vélocité s'affirme, haletante, sans rémission. La danse macabre du scherzo
est grandiose dans ses résonances graves. La Marche funèbre laisse percevoir un
balancement lancinant de cloche sourde, tandis que lors de la méditation qui
lui fait pendant, les arabesques de la main droite tissent une coulée sereine
d'une sidérante beauté. L'énigmatique dernier mouvement, hallucinante
digression plus que finale de sonate, déroule dans sa brièveté et sa compacité
comme une succession de vagues déferlantes, où l'on entrevoit çà et là une
bribe d'organisation. Est-ce ce que Cortot voyait comme un « murmure du
vent sur les tombes » ? L'art de Pollini est là
: des contrastes exacerbés, de dynamique comme de tempos, mais une souveraine
maîtrise de l'âme de cette pièce. La patte du grand virtuose est là, encore
bien présente. Ce qu'on vérifiera dans les deux bis de fin de concert,
impérieux et magistraux. Avant ce bouquet final, Pollini aura donné le Premier Livre des Préludes de Debussy. Le seul des deux qu'il ait jamais abordé, même au disque (DG). Vision
paradoxalement moins « moderne » qu'attendue de la part du pianiste
qui a tant côtoyé les musiciens contemporains. Le rapprochement avec Chopin
n'est pas fortuit. Pollini se livre au jeu des
couleurs et des associations de timbres si caractéristiques de ces pièces qui
font appel parfois aux modes archaïques. A l'assortiment des contrastes aussi,
sinon des oppositions : la délicatesse de morceaux comme « Danseuse de
Delphes » ou « La Fille aux cheveux de lin », la virtuosité
d'autres, tel « Le vent dans la plaine ». On savoure au fil de ces
quarante minutes de musique pure, l'alchimie d'impressions quasi visuelles par
endroit, comme la diversité des climats évoqués : l'atmosphère figée de
« Des pas sur la neige », la furia de « Ce qu'a vu le vent
d'ouest », le presque grotesque de « La Sérénade interrompue »,
le majestueux climat de « La cathédrale engloutie », ou le
surréalisme de l'ultime « Minstrels ».
Jean-Pierre Robert.
Magistrale exécution de Roméo et Juliette de Berlioz

Valery Gergiev / DR
Valery Gergiev et
ses forces londoniennes s'embarquent dans une nouvelle aventure, et un
challenge audacieux puisque s'agissant d'un cycle Berlioz. Et commencent par Roméo et Juliette. Précédé de deux exécutions au Barbican de Londres, leur concert à la Salle Pleyel livre toute la magie d'une œuvre
singulière. La facture hybride de cette « symphonie dramatique » ne
se laisse pas aisément décrypter. On a dit qu'elle se rapprochait de la
Neuvième de Beethoven, du fait qu'elle requiert le concours du chœur et de
solistes. Mais cette référence est bien faible à rendre compte de l'originalité
de ce qu'il faut bien appeler une pièce sui generis, sortie de la fertile
imagination de Berlioz : « une musique instrumentale qui mettait en scène
non pas tant un programme qu'un texte dramatique », selon David Cairns. Ce
qui est plus surprenant encore, c'est le traitement de l'action où quoiqu'il
soit fait appel à des solistes vocaux, aucun n'est dévolu aux amants
malheureux. Il valait mieux, pour décrire le vrai récit d'amour « recourir
à la langue instrumentale, langue plus riche, plus variée, moins
arrêtée », dira l'auteur dans ses Mémoires. On rejoint là une autre
singularité : la construction même, en sept parties dont les trois centrales
sont purement instrumentales. Une symphonie dans la symphonie, en somme. Au
récitatif choral est confiée une sorte de commentaire des événements, alors que
deux des solistes, n'intervenant qu'en première partie, évoquent, pour la
mezzo, l'extase amoureux, et pour le ténor, une ballade légèrement grotesque,
annonçant le fameux scherzo de la reine Mab. Un des exemples du jeu de
références avouées ou simplement implicites qui parcourent l'œuvre dans ses
diverses séquences. Le troisième soliste, la basse incarnant Frère Laurent, ne
s'exprime qu'en dernière partie. Tout cela confère à Roméo et Juliette une étrangeté certaine. Mais c'est, sans doute, l'orchestration qui réserve le
plus d'étonnement quant à son inventivité : traitement particulier des bois,
recours aux percussions exotiques, telles les cymbales antiques, cuivres
rehaussés d'ophicléides, utilisation importante de la harpe. Valery Gergiev s'est déjà confronté à Berlioz, et à une pièce non
des plus aisées, puisque s'agissant de Benvenuto Cellini, encore
dernièrement à Paris (cf. NL de 7/2013). Ce langage foisonnant semble lui être
parfaitement familier, tant il en pénètre les arcanes. Sa vison unit ampleur et confidence, souci pour le détail et volonté de libérer
les déferlements exubérants. Un chef
russe dirigeant un orchestre anglais, dans un registre on ne peut plus
gallique, la combinaison n'est pas banale. Mais le LSO possède de longue date
cette musique, et ce concert se veut un vibrant hommage à feu son
chef-Président, Sir Colin Davis, chantre berliozien s'il en fut. On est fier de ce jeu immaculé, si idiomatique dans le ton et
l'expression, de ces inflexions incisives des cordes, de la plénitude des
cuivres, et de la phénoménale plastique de la petite harmonie. Gergiev exige de ses musiciens une concentration palpable
pour créer l'atmosphère, insuffler joie ou tristesse, jouer de l'éphémère des climats, pesants ou aériens, sans jamais souligner le trait.
La densité qu'il obtient, et qui conduit la salle à retenir son souffle,
procède moins de l'insistance à déployer la luxuriance de l'orchestration qu'à
trouver la vraie et subtile couleur de la syntaxe harmonique unique de Berlioz.
Si le LSO Chorus fait impression, les jeunes interprètes des Guildhall Singers emportent la palme de la justesse de ton et de la
parfaite diction française. Olga Borodina fait sonner
de son timbre plantureux les « Strophes », et Kenneth Tarver apporte au « Scherzetto »
les vertus d'une voix de ténor agile. Evgeny Nikitin déçoit cependant dans l'« Air » du finale
par une intonation quelque peu aléatoire par endroit. Légère ombre sur une
exécution d'anthologie où se mesurait le sens de l'occasion.
Jean-Pierre Robert.
Daniele Gatti & le
National : Une bien belle entame ! Intégrale des symphonies de
Tchaïkovski.

© DR
Après une très belle Ouverture-Fantaisie de Roméo et Juliette, une première symphonie
« Rêve d’hiver » d’une
impressionnante expressivité, le chef italien poursuivait au TCE, à la tête de
l’Orchestre National de France, sa pertinente lecture des symphonies de
Tchaïkovski (1840-1893) avec, cette fois, les deuxième et troisième symphonies,
peu connues du public car rarement données, contrairement aux symphonies
suivantes (4e, 5e & 6e) regroupées sous le terme de trilogie du
« fatum ». Des œuvres comme un miroir de l’âme russe, versatile,
passant volontiers sans transition de l’épanchement mélancolique à la verve la
plus insouciante et la plus débridée. Des contrastes qui en représentent toute
la difficulté d’interprétation, laquelle ne doit en aucun cas sombrer dans la
fureur, ou à l’inverse, s’épancher dans la boursouflure sirupeuse d’un
romantisme exacerbé. La Symphonie n° 2,
composée en 1872, en Ukraine, d’où son nom de « Petite Russienne », fut remaniée par le compositeur en 1879. Contrairement à la
première symphonie mélancolique, il s’agit là d’une pièce joyeuse, sans aucun
dramatisme, riche en thèmes populaires sur lesquels se construisent les quatre
mouvements. Daniele Gatti la mena de manière
incisive, sans concession romantique excessive, à la tête d’un
« National » totalement engagé faisant montre d’une précision
rythmique, d’une cohésion et d’une motivation communicative qui maintiendra
l’attention du public de bout en bout, depuis l’appel du cor introductif
jusqu’au final rythmé par les timbales. La Symphonie
n° 3 dite « Polonaise »,
composée en 1875, est probablement la moins caractérisée du corpus symphonique
de Tchaïkovski, un manque d’unité expliquant, peut-être, qu’elle soit la moins
jouée. Construite en cinq mouvements sur des rythmes de danse, notamment une
polonaise au cinquième mouvement d’où son nom. Une œuvre d’interprétation
difficile, nécessitant une attention soutenue et un discours tendu de façon à
éviter tout éparpillement. Gatti en fit une véritable démonstration
orchestrale, précis dans les attaques, travaillant les timbres, en donnant une
lecture fluide faisant passer les thèmes d’un pupitre à l’autre sans lourdeur
ni rupture, avant de conclure sur un énergique dernier mouvement. Un finale
qui, avec l’andante central, constituent les deux mouvements les plus réussis
de cette œuvre, considérée comme transitoire avant la démonstration symphonique
de la trilogie du « fatum ». Mais ceci est une autre histoire dont le
prochain épisode se déroulera en avril et mai prochain. Rendez vous pris !
Patrice Imbaud.
La Sokhievmania continue !

Tugan Sokhiev / DR
Tugan Sokhiev n’en finit pas de séduire les foules, non seulement
par ses qualités musicales indéniables, maintes fois confirmées face à de prestigieuses
phalanges internationales, mais également par son
charisme, son élégance, et son empathie envers le public et les musiciens, à
l’origine d’un plaisir de jouer qui transcende la salle. Chacun de ses passages
à Paris est donc un évènement attendu, le dernier en date ne faisant pas
exception à la règle. A la tête de son Orchestre du Capitole de Toulouse, il
entama ce concert, salle Pleyel, par une petite pièce de concert charmante,
souvent donnée, Le Lac enchanté d’Anatoli Liadov (1855-1914) composé en 1909,
reprenant quelques bribes d’un projet ancien d’opéra (Zoriouchka) que l’indolence et
l’inappétence au travail du compositeur ne permirent jamais d’achever, muselant
ainsi définitivement l’altérité opératique créatrice du compositeur…La postérité
ne retint donc que cette délicate esquisse qui nous plonge dans l’atmosphère
féérique et crépusculaire d’un matin de début du monde, face à un lac
immobile…Occasion d’un beau travail orchestral sur les différents timbres de
l’orchestre, sans sacrifier l’unité et la cohésion de l’ensemble, dans une
lecture à la fois délicate, expressive, chargée d’émotions et d’images. Vint
ensuite le Concerto pour violon d’Aram Khatchaturian (1903-1978), composé en 1940,
créé la même année par David Oïstrakh, dédicataire de l’œuvre. Coloré et
énergique, il valut à son auteur le Prix Staline en 1941. Il est structuré en
trois mouvements : un premier mouvement très virtuose au plan
violonistique, un second qui constitue le sommet de l’œuvre par son caractère
poignant et élégiaque, et un dernier nous contant une fête arménienne dans
toute sa joie ensoleillée et débridée. Le jeune et talentueux violoniste
arménien Sergey Khatchatryan en donna une vision sans reproche, magnifique, toute en ressenti dans l’andante
central, avant de conclure dans un feu d’artifice superbement soutenu par
l’orchestre. Après la pause, un exercice d’orchestre avec les Variations Enigma d’Edward Elgar (1857-1934) composées en 1898-1899 : Une œuvre surprenante
composée par un compositeur autodidacte, emblématique de la musique anglaise du
début du XXe siècle, jusque-là quelque peu somnolente depuis Purcell et
Haendel. Le thème, à l’origine de ces quatorze variations, reste encore une
énigme, jamais révélée par le compositeur, mais plus intéressant est le
développement orchestral qui donne lieu à un véritable exercice d’orchestre
sollicitant tous les pupitres, bois, cordes, cuivres. Une mention particulière
pour le magnifique Adagio de la
neuvième variation dont les cordes toulousaines donnèrent une sublime interprétation, ainsi que la très élégiaque douzième variation menée
par le violoncelle solo, et la Romance de la treizième variation conduite par le chant douloureux et nostalgique de la
clarinette. Un finale flamboyant en forme de pot pourri, mêlant les influences
wagnérienne, brahmsienne et tchaïkovskienne, qui
enthousiasma la salle ! En bis, « Salut
d’amour » d’Edward Elgar. Une bien belle soirée !
Patrice Imbaud.
The Cleveland Orchestra & Franz Welser-Möst : Apollinien ! Mais…

Franz
Welser-Möst / DR
Pour son passage à Paris, brève étape d’une
tournée européenne, le Cleveland Orchestra, fameuse phalange américaine parmi
les « Big Five » (aux côtés des Orchestres
de Boston, Chicago, Philadelphie et New York), conduite par son directeur
musical, avait choisi de confronter, au cours de deux concerts, salle Pleyel,
des œuvres de Beethoven et de Chostakovitch. Si les raisons d’un tel choix de
programme ne paraissent pas, de prime abord, évidentes, force est de
reconnaitre que les deux compositeurs ne furent pas traités avec un semblable
bonheur ! La lecture, plus dans la note que dans l’esprit, qu’en fit le
chef autrichien favorisant largement le compositeur allemand. Si la qualité
superlative de l’orchestre ne se discute pas, c’est bien l’interprétation des
différentes œuvres du compositeur russe qui est en cause, Franz Welser-Möst ne trouvant jamais le ton juste, nous présentant un
Chostakovitch totalement édulcoré, sans ce caractère ambigu, ironique,
dramatique, pesant et subversif qui en fait toute la grandeur, toute
l’originalité, toute la modernité, tout l’intérêt musical et historique. Point
d’ironie sarcastique dans cette vision bien léchée, trop policée, pour tout
dire apollinienne, sans la moindre trace de dionysiaque ! Un Chostakovitch revu et corrigé par Jdanov, loin de tout formalisme
subversif !
Le programme du premier concert débutait
par la Messe en ut, op. 86 de
Beethoven (1807) dont l’interprétation valut surtout par la qualité conjointe
du chœur et de l’orchestre, plus que par celle des solistes, assez peu
sollicités (Luba Orgonasova, Kelley O’Connor, Herbert Lippert et
Ruben Drole). Le chef autrichien sut faire valoir
toutes les nuances du chœur dans une lecture à la fois précise et équilibrée, pleine d’allant mais sans
véritable ferveur. Faisant suite à cette œuvre, en deuxième partie de concert,
la Symphonie n° 6 de Chostakovitch,
composée en 1939, dont Welser-Möst ne sut rendre toute la souffrance ni le deuil :
« Le droit à la douleur est vraiment
un droit…j’étais au bord du suicide…envahi par la peur » affirma le
compositeur dans ses Mémoires à
propos de cette symphonie dont la signification profonde, intime, ne fut que
tardivement révélée. Une œuvre certes déroutante, inhabituelle, car construite
en trois mouvements assez disparates, reliés par la tension tragique permanente
qui la parcourt et les tons mineurs qui lui confèrent son unité. Un manque de
dramatisme évident dans le discours confinant quelquefois au non sens par le
caractère parfois pastoral que le chef autrichien imprima à son interprétation,
confirmé par le choix de tempos trop lents, notamment dans le premier mouvement
où s’élèvent la marche funèbre du cor anglais et la complainte tragique du
picolo. Le deuxième mouvement ne fut pas plus satisfaisant par son manque, là
encore, d’ambigüité et d’ironie sarcastique. Seul, le dernier mouvement, parut
plus dans l’esprit de l’œuvre, retrouvant un aspect grinçant qui perdurera
malgré la bruyante coda. Le dialogue entre bois et cordes, mené par le violon
solo, ne parvenant pas, malgré une joie
contrainte, à masquer ou à faire oublier la désolation de cette symphonie.
Une impression, on l’aura compris pour le
moins mitigée, qui se confirmera lors de la deuxième soirée, non pas tant dans
la Symphonie n° 4 de Beethoven (1806)
qui fut menée avec élégance et même un certain brio par Welser-Möst, sans toutefois ce petit supplément d’âme qui fait le
propre des grandes interprétations, que dans l’effrayante Symphonie n° 8 de Chostakovitch, traitée, ici, de façon totalement
insipide. Une lecture propre, précise, riche en couleurs et nuances de
Beethoven mais, qui malgré les qualités indéniables des musiciens, tous
pupitres confondus, ne réussit jamais à nous intéresser vraiment, confinant
progressivement sinon vers l’ennui, du moins vers une indifférence polie. La
symphonie de guerre (1943) du compositeur russe perdit toute pertinence, dans
cette vision d’une platitude accablante : quid du parcours catastrophique
et du pathos terrifiant du premier mouvement, qui devient ici une immense
fanfare ? Quid de l’humour grinçant du deuxième, où les dissonances des
bois semblent bien timides? Quid du cynisme désabusé et de la violence du
troisième, ici partiellement gommés ? Quid de la marche funèbre du
quatrième où disparait toute désolation ? Seul, le finale parut plus
réussi, cordes et cuivres concluant cette œuvre terrifiante sur une bien
illusoire sérénité ! Mais ne boudons pas notre plaisir devant la très
belle sonorité de cette prestigieuse phalange américaine, sa cohésion, la
qualité instrumentale de ses participants, avec une mention particulière pour
la petite harmonie où la clarinette solo (Franklin Cohen), la flûte solo
(Joshua Smith) et le cor anglais (Robert Walters) se montrèrent excellents de
bout en bout.
Pour les amoureux frustrés de
Chostakovitch, rappelons l’intégrale au disque de Kyrill Kondrashin, qui demeure une des références absolues,
par la pertinence de son interprétation des quinze symphonies du maître russe.
Patrice Imbaud.
Myung-Whun Chung & le « Philhar » : l’état de grâce !
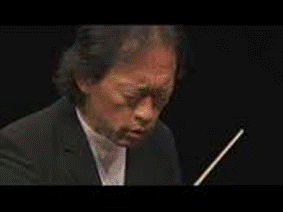
Myung-Whun Chung / DR
Impressionnant Myung-Whun Chung, dirigeant sans partition, planté sur son
estrade, la tête légèrement inclinée en avant, les yeux mi-clos. Seuls quelques mouvements limités
des bras et de la tête résument sa gestuelle d’une sobriété ascétique. Un
concert dont le programme, Debussy, Messiaen, Saint-Saëns, semble taillé sur
mesure pour le chef coréen dont on connaît les affinités pour la musique
française et Messiaen en particulier. En ouverture de soirée, la courte Rhapsodie pour clarinette de Claude
Debussy, pièce de concours, secondairement orchestrée en 1911. Occasion pour
Nicolas Baldeyroux, première clarinette solo, de
sortir du rang et de faire montre de tout son talent et de sa virtuosité en
tant que soliste dans cette courte œuvre d’une grande liberté et d’une grande
poésie où le chant de la clarinette dialogue avec l’orchestre. Une prestation
musicale exemplaire dans tous les registres, un son rond, des articulations
claires, et un triomphe à la clé ! Vint ensuite une œuvre de jeunesse
d’Olivier Messiaen (1908-1992) L’Ascension,
quatre méditations symphoniques datant de 1933, dont le chef coréen fit une
immense prière, très intériorisée, voyant se succéder la « Majesté du
Christ » saluée par les cuivres retentissants, puis les « Alléluias
sereins » avec son solo de cor anglais, auquel répondront cordes et petite
harmonie, puis l’ « Alléluia sur la trompette », pour conclure
sur la « Prière du Christ montant vers son Père » faite d’un
long crescendo des cordes, s’élevant dans une extrême lenteur vers des espaces
éthérés. Un long silence, bien inhabituel, salua cette exécution exemplaire
avant que ne s’élèvent les applaudissements de la salle. Après la pause, la
monumentale Symphonie n° 3 de
Saint-Saëns, déjà donnée, hasard du calendrier, il y a quelques semaines par
l’Orchestre de Paris (cf. NL de 11/2013).
Véritable cathédrale musicale, Myung-Whun Chung, en fit, là encore, une lecture très
introvertie, tendue, d’une rare profondeur, équilibrée, habitant les silences
d’une tension palpable, menant un « Philhar »
extrêmement motivé et engagé, répondant avec maestria à chacune des
sollicitations du chef. Une œuvre d’exception, utilisant un instrumentarium inhabituel, avec orgue et piano, en forme de vaste méditation parcourue par le
thème cyclique du Dies irae grégorien, subissant nombre de métamorphoses lors des quatre mouvements,
groupés deux à deux : Un crescendo orchestral empreint d’un sentiment
d’urgence, un deuxième thème d’une sublime douceur où orgue, bois et cordes se
répondent, un scherzo interrompu par un long silence suspendu, avant que ne
s’élève un accord fortissimo de l’orgue marquant le début du monumental finale
nous entraînant dans un déchainement orchestral, véritablement d'apocalypse.
Une interprétation d’anthologie qui restera dans les mémoires !

Nicolas Baldeyroux / DR
Patrice Imbaud.
Tragédie chez les druides
Vincenzo
BELLINI : Norma. Opéra en deux actes
(1831). Livret de Felice Romani, d’après la tragédie d’Alexandre Soumet. Elena Mosuc, John Osborn, Enrico Iori,
Sonia Ganassi, Gianluca Floris, Anna Pennisi. Orchestre & Chœur de l’Opéra de Lyon, dir. Evelino Pidò.
(Version de concert).

Evelino Pidò / DR
Décidément le Théâtre des Champs-Elysées
semble s’être fait la tribune de tout ce que l’univers opératique compte de
prêtresses, furies, druidesses, prophètes ou autres oracles communiquant avec
l’Au-delà ! Après la trilogie consacrée à Médée, puis La Vestale de Spontini, tout récemment, c’était au tour de Norma d’occuper la scène du théâtre de l’avenue Montaigne, en
version de concert, nous débarrassant du même coup de toute mise en scène
délétère ou sans attrait, comme ce fut, hélas, si souvent le cas, ici ou
ailleurs… Norma, l’opéra des opéras
belcantistes, dont la difficulté vocale est désormais mythique, chanté avec
plus ou moins de bonheur par les plus grandes divas dont les prestations ont
été quelquefois embellies par une postérité généreuse et bienveillante : Giuditta Pasta, qui créa le rôle
le 26 décembre 1831 à la Scala, Maria Malibran, Rosa Ponselle et plus proches de nous, Maria Callas, Joan Sutherland, Montserrat Caballe, pour n’en citer que quelques unes… Car Norma pose un énorme problème de casting,
du fait bien sûr, des difficultés vocales, meurtrières des voix, mais également
dans la répartition des tessitures, soprano et mezzo, entre les deux rôles
féminins principaux, Norma et Adalgisa. Ce soir, la
distribution attribuait Norma à la soprano roumaine, Elena Monsuc qui vient de chanter le rôle à Berlin, et remplaçait Carmen Giannattasio,
tandis qu’Adalgisa était confié à la mezzo Sonia Ganassi. Choix pertinent, confirmant Norma dans sa fureur,
ses excès et son sacrifice spectaculaire, laissant à la jeune prêtresse Adalgisa une prestation plus sereine et effacée
correspondant bien au livret. L’Orchestre et le Chœur de l’Opéra de Lyon
retrouvaient à sa direction un vieux complice, en la personne du chef italien Evelino Pidò, spécialiste reconnu de
ce répertoire bel cantiste. Dès l’ouverture le ton
fut donné : une énergie à revendre, une phalange réactive, une direction
tendue, acérée, pour le moins exubérante et extravertie, variant et majorant
les tempos, faisant valoir tous les contrastes et nuances, sachant entretenir
la tension dramatique et faire respirer l’orchestre avec les chanteurs. Elena Monsuc s’empara du personnage de Norma avec vaillance,
sincérité, et même un certain courage, nous gratifiant d’un très beau « Casta Diva », à la fois lumineux et
pathétique. On regrettera toutefois, un vibrato assez marqué, parfois gênant,
se confondant avec les ornementations de la partition. Une prestation d’une
belle tenue qui se prolongera tout au long du drame avec, cependant, une
fatigue vocale qui ne tardera pas à se faire sentir, durcissant le timbre et
resserrant les aigus. Sonia Ganassi ne démérita pas,
non plus, grâce à sa tessiture étendue et sa vocalité facile. Seuls certains aigus, là encore, apparurent quelque
peu forcés, notamment dans le grand duo du deuxième acte « Deh ! Conte… Mira, o Norma ». Paradoxalement, dans cet
opéra de femmes, ce furent les hommes qui se montrèrent les plus convaincants.
John Osborn (Pollione)
entama son premier air « Meco all’altar di venere »
très orné, et poursuivit avec une émission aisée, un timbre lumineux et un
superbe legato. Enrico Iori fut tout aussi remarquable, campant un Oroveso plein
d’autorité scénique et vocale, dans chacun de ses airs. Bref, une belle soirée
d’opéra, qui sans rester dans les mémoires, n’en fut pas moins une indiscutable
réussite dont témoignèrent les applaudissements fournis de la salle.
Patrice Imbaud.
« Allegro barbaro » au Musée d'Orsay et le Quatuor Voce

Comme souvent, au Musée d'Orsay, un cycle
de concerts est proposé parallèlement à une exposition consacrée à un mouvement
artistique pictural. “Allegro Barbaro”, qui fait référence à une œuvre de Béla
Bartók, est le titre d'une exposition exceptionnelle sur l'art en Hongrie au
début du XXème siècle : « Béla Bartók et la modernité hongroise
1905-1920 ». De nombreux jeunes peintres hongrois sont venus se nourrir
artistiquement à Paris, la ville culturelle par excellence à l'époque. Refusant
l'art académique, ces artistes font référence aux nouveaux maîtres de la
modernité. Alors que la Hongrie peinait encore à s'accommoder de
l'impressionnisme, plusieurs d'entre eux se joignent au groupe des Fauves! Pour
les peintres, comme pour certains compositeurs, le folklore est conçu comme une
alternative à l'académisme. Une manière de renouveler le langage. C'est à
Budapest, au début de ce siècle, que la modernité hongroise va naître et que
les écrivains, les peintres, les musiciens vont se rencontrer. Bartók va se
libérer de l'influence de Debussy et posera les bases d'une écriture dissonante,
concentrée et radicale. Un cycle de musiques autour de Bartók et de la création
musicale entre 1848 et 1914 est donc offert à l'auditorium du Musée d’Orsay
jusqu'au 21 janvier 2014.
Pour le concert d'ouverture, le jeune
Quatuor Voce a joué deux quatuors composés à près de cent ans d'écart.
Curieusement, celui de Beethoven paraissait plus moderne. Ce quatuor n°14, op.
131 (1826), est singulier par sa forme, et comme dit le compositeur, “ fait de
pièces et de morceaux”. Après cette œuvre impossible d'écrire, se serait
exclamé Schubert ! C'est une œuvre complexe en sept mouvements enchaînés et
d'une grande difficulté d'exécution du fait de sa non homogénéité.
L'architecture parait bigarrée. Comment l'aborder ? C'est ce qu'on se demande à
l'écoute de le proposition que nous a faite le Quatuor
Voce. Cette formation composée de jeunes musiciens a remporté de nombreux prix,
et crée régulièrement la musique de compositeurs contemporains (Bacri, Mantovani...). Face à
cette œuvre il semblait un peu dérouté. Peut-être le trac vis à vis du premier
concert de la série ? L'heure ? Le public ? Le début “adagio ma non troppo e molto espressivo” est compliqué à mettre en place
car il détermine toute la suite de l'exécution du quatuor. Dès le départ les
Voce sont parti un peu trop vite. Les attaques étaient dans l'à peu près,
l'altiste très en dedans et la violoncelliste pas en place, bref nous nous
étions dans l'expectative d'une version acceptable. Comment se rattraper
ensuite, tel est le problème à résoudre ? Chauffé, le quatuor Voce offrira
quand même un dernier mouvement “allegro” superbe, qui réveilla le public. Mais
il n'aurait pas dû débuter par cette œuvre. Venait ensuite le Premier Quatuor
de Bartók (1910). De forme plus traditionnelle, trois mouvements, eux aussi
enchaînés, dans la lignée du classicisme viennois, avec des mélodies faciles à
retenir, une expressivité toute romantique, cette œuvre est assez sombre.
Bartók venait de rompre sa relation amoureuse avec la violoniste Stefi Geyer, ce qui donne un premier mouvement nostalgique
quasi funèbre. Seuls, au départ, s'expriment les deux violons. Chacune des
violonistes, qui au demeurant alternent leur rôle de premier et de second
violon selon les œuvres, est très à l'écoute de l'autre et donne une belle
homogénéité à l'interprétation. Les Voce sont plus dans leur élément.
L'altiste, Guillaume Becker, révèle une
belle sonorité, la partition lui donnant le beau rôle. La violoncelliste est
plus en retrait, ce qui n'altère en rien la musicalité et la belle façon dont est interprétée ce quatuor de Bartók. Le public, qui
s'était assoupi durant le Beethoven, s'avère plus à l'écoute et ne boude pas
son plaisir. Le quatuor Voce lui a offert un bis magistral avec le finale d'un
quatuor de Brahms.
A noter que Le Quatuor n°14 de Beethoven
est au centre du film “Quatuor” de Yaron Zilberman, ou comment résoudre les problèmes existentiels
entre les membres d'un quatuor et comment interpréter cette œuvre complexe
lorsque le violoncelliste n'a plus les moyens suffisants pour le jouer... De
même, David Raskin, compositeur de la musique, entre
autres, du chef-d’œuvre d'Otto Preminger “Laura”, a utilisé l'adagio de ce même
quatuor pour le film d'Abraham Polonsky “L'Enfer de la Corruption”.
Stéphane Loison.
***
L’EDITION MUSICALE
FORMATION
MUSICALE
Freddy
Roux : Rhytm’n Jazz. Rythmes à lire et à jouer pour
instrumentistes et chanteurs. Billaudot : G 8670
B.
Nous avons dit dans une
précédente recension tout le bien que nous pensions de ce travail qui s’adresse
à la fois aux élèves de conservatoires et aux autodidactes ou aux musiciens de
culture classique voulant s’initier aux phrasé et aux rythmes spécifiques du
jazz. On lira avec profit les judicieux et copieux conseils d’utilisation
prodigués par l’auteur, et qui se poursuivent tout au long du recueil.
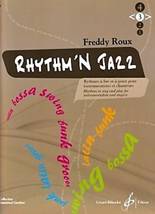
PIANO
SCHUBERT : Sonate en si bémol Majeur D 960. Bärenreiter Urtext :
BA10860.
Cette sonate composée en
1828 est sans doute sa dernière œuvre instrumentale. On lira avec beaucoup
d’intérêt la préface et les copieuses notes consacrées à l’interprétation de
cette œuvre. Walburga Litschauer examine tous les points délicats de l’interprétation (rythme, tempos,
ornements…) et permet ainsi de ne pas trahir le compositeur. Et bien sûr, on
bénéficie de la clarté d’édition de la partition qui en facilite tant la
lecture et l’exécution.

MENDELSSOHN : Overture to a Midsummer Night’s Dream.Op. 21. Pour piano à quatre mains. Editée par Maurice Hinson et Allison Nelson. Alfred : 42005.
Il est tout à fait
intéressant de pouvoir jouer dans une édition critique cette version à quatre
mains réalisée par Mendelssohn lui-même et qu’il a interprétée avec sa sœur Fanny. Les indications historiques données par les éditeurs sont
tout à fait intéressantes. Inutile
de préciser qu’il s’agit d’une partition difficile…

MOSZKOWSKI : Spanish Dancesop. 12
pour piano à quatre mains. Editées par Maurice Hinson et Allison Nelson. Alfred : 42006.
Œuvre de jeunesse de Moszkowski, ces Danses n’en sont pas moins fort
intéressantes. Plus brillantes que difficiles, elles peuvent constituer un bien
agréable moment tant en concert qu’en audition d’élèves (avancés, cependant…).
On lira avec intérêt la préface très documentée des éditeurs.

KUHLAU : Six sonatinasopus
55 pour piano. 1 vol. 1 CD. Alfred : 41423
On aurait tort de mépriser
les sonatines de ce compositeur trop peu connu malgré sa présence dans les Classiques favoris ou peut-être à cause
de cela. Cette édition est claire, très bien faite et comporte l’enregistrement
intégral des sonatines par le pianiste Jëno Jandó.

Carol MATZ : Famous & Fun Christmas Duets. Book 2. 7 duos pour piano à quatre mains. Alfred : 41466.
Ne nous y trompons pas : le niveau
« élémentaire » indiqué sur la partition est l’équivalent d’un milieu
de premier cycle dans nos nomenclatures, et cela pour les deux parties. Ce sera
une bonne occasion d’initier de jeunes pianistes au plaisir de la musique
d’ensemble avec des airs bien connus (ou qui méritent de l’être…) de noëls
anglo-saxons.

CHOPIN : 24 études op 10 & op 25. Edité
par Willard A. Palmer. 1 vol. 1 CD. Alfred :
41493.
Voici une édition de
travail des Etudes tout à fait claire
et où les indications d’interprétation sont précises. On pourrait presque
dire : un peu trop. Mais tout ceci est judicieusement tempéré par le CD
enregistré par Idil Biret,
pianiste turque élève de Nadia Boulanger, Jean Doyen, Cortot, Wilhelm Kempff…
Cette remarquable interprétation ne suit évidemment pas à la lettre les
indications de la partition, ce qui est une source de réflexion et de richesse
pour les interprètes.

CHOPIN : 19 Nocturnes pour le piano. Edité par Willard A. Palmer. 1 vol. 2 CD. Alfred : 41435.
Comme pour les Etudes, l’édition de Willard A. Palmer est extrêmement détaillée et précise. Là encore le remarquable
enregistrement joint à la partition, par la même pianiste que les Etudes, permettra aux élèves de
comprendre la distance existant entre une partition, si bien faite soit-elle,
et une véritable interprétation. Idil Baret nous
livre ici une vision à la fois infiniment poétique et en même temps très
pudique de ces Nocturnes, bien dans
l’esprit de Chopin. A écouter sans modération…

Valérie
ROUSSE, Joël LITTORIE : Couleurs
caraïbe pour piano. Niveau débutant à Préparatoire 2. Lemoine : 29012
H.L.
Les auteurs proposent ces Couleurs Caraïbe pour différents
instruments, mais ne nous y trompons pas. Il ne s’agit en aucun cas de
transpositions, mais chacun des recueils contient des œuvres originales pour
chaque instrument. Les sept pièces pour piano présentées sont aussi variées que
possible, tout en gardant malgré tout une unité de style. Elles devraient
procurer beaucoup de plaisir à leurs interprètes. Les six recueils proposés
pour six instruments différents devraient permettre d’organiser, pourquoi pas, une
soirée « caraïbe » interclasses. Ce serait l’unité dans la diversité…

Hywel DAVIES, Nicholas HARE, Christopher
NORTON, Alfred RICHTER : Rachmaninoff, 29 favourite themesarrangés
pour un pianiste de moyen niveau. Boosey &
Hawkes : ISBN 978-0-85162-655-0.
On peut discuter à
l’infini du bienfondé de ces arrangements. Ils ont l’immense mérite de faire
découvrir aux pianistes des œuvres qu’ils ne connaissent pas forcément. Et
comme ces arrangements sont bien faits et très respectueux des œuvres originales,
ils en permettent ensuite un accès plus fructueux. Ce copieux volume permet
ainsi de voyager à travers les œuvres les plus célèbres du compositeur et de le
découvrir sous ses aspects les plus divers. Sans être toujours faciles, ces
arrangements sont quand même abordables pour de bons amateurs.

Arletta
ELSAYARY : Demi-teinte pour
piano. Préparatoire. Lafitan : P.L.2572.
Arletta Elsayary nous propose une pièce pleine de charme et de
fantaisie. Un début un peu chaloupé en do Majeur se continue par un do mineur
plus jazzy pour revenir au do majeur primitif dans le même style désinvolte. On
ne peut qu’être séduit par cette œuvre : ce devrait être le cas de ses
jeunes interprètes.
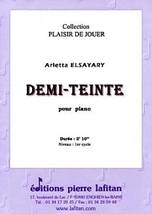
Arletta
ELSAYARY : Orage et Beau Fixe. Pièce
en deux mouvements pour piano. Elémentaire. Lafitan :
P.L.2573.
L’orage est tumultueux,
comme il se doit, le beau-fixe berceur. On retrouve dans cette pièce toute la
grâce et le bon goût de son auteur. Nul doute que les jeunes interprètes se
plairont à peindre ces deux charmants tableaux.

Christine
MARTY-LEJON : Le lac gelé pour
piano. Débutant. Lafitan : P.L.2588.
Cette charmante pièce
mettra en jeu les qualités expressives des très jeunes pianistes dans un
discours délicat et évocateur. Il reviendra aux professeurs d’aider les
interprètes à se faire une image mentale de ce lac gelé sur lequel évoluent
sans doute gracieusement des patineurs. La construction A B A favorise
d’ailleurs cette mise en image.

Rose-Marie
JOUGLA : Oiseaux sur un arbre de
neige pour piano. Difficile. Delatour :
DLT2227.
Bien sûr, la référence à
Debussy et à ses sonorités est explicite. On écoutera avec plaisir la pièce
intégralement enregistrée sur le site de l’éditeur. Difficile, cette pièce
l’est autant par la technique que par la délicatesse demandée par
l’interprétation. Mais comment ne pas être séduit par ces sonorités…

Matthieu STEFANELLI : 4 Illusions pour piano. Delatour : DLT1839.
Illusion I : « Mirage »,
Illusion II : « Kaléidoscope », Illusion III : « Origami » Illusion IV :
« Reflets… Réfractions » : De ces quatre Illusions, la première est un hommage à Maurice Ohana, la seconde à Witold Lutoslawsky, la
troisième à Toru Takemitsu et la quatrième à Henri Dutilleux. De niveau difficile, elles font appel aux
techniques contemporaines du piano, en harmonie avec le langage des différents
compositeurs évoqués.

Rose-Marie
JOUGLA : Toccata taquine pour
piano. Delatour : DLT2230.
Difficile, certes,
demandant une technique pleinement maitrisée, cette toccata est pleine de grâce
lutine. Ecrire ainsi de la musique tonale qui ne soit le pastiche de personne
et qui suscite in intérêt qui ne faiblit pas du début à la fin était une
gageure remarquablement tenue. Au-delà de l’exercice technique, voici de la
vraie musique qu’on écoutera sans modération sur le site de l’éditeur.

GUITARE
Valérie
ROUSSE, Joël LITTORIE : Couleurs
caraïbe pour guitare. Adaptation guitare : F. Rochard.
Niveau Préparatoire et au-dessus. Lemoine : 39032 H.L.
Ces trois pièces pour
guitare, de difficulté diverse, invitent à la danse et au quadrille… La couleur
« caraïbe » est bien au rendez-vous. Tout cela est bien plaisant et
devrait réjouir les interprètes.
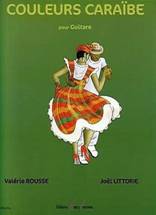
UKULELE
Colin TRIBE : English Folk Tunes for Ukulele. 37 pièces traditionnelles. 1 vol. 1
CD. Schott : ED 13569.
Ces airs sont notés en
notation traditionnelle et en tablature. Les pièces destinées à différents
niveaux sont présentées et commentées avec des conseils d’exécution et
d’interprétation. Le CD contient l’enregistrement intégral des trente-sept
pièces. C’est une musique et un instrument à découvrir ! On lira avec
intérêt l’article de Wikipédia, très bien documenté,
qui lui est consacré ainsi bien sûr que la présentation générale présente dans
ce volume.
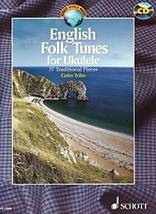
VIOLON
Valérie
ROUSSE, Joël LITTORIE : Couleurs caraïbe pour violon et piano. Niveau Préparatoire 1 & 2. Lemoine : 29030
H.L.
Les pièces Couleurs caraïbe composées pour le
violon font spécifiquement appel à la technique de cet instrument. Les coups
d’archet sont soigneusement noter pour permettre à l’interprète de donner tout
leur caractère à la mazurka, le calypso et le quadrille proposés. Il y a là
beaucoup de plaisir en perspective pour nos jeunes instrumentistes.

Claude-Henry
JOUBERT : Concerto « Les
cigognes » pour violon avec accompagnement de piano. Fin de premier
cycle. Lafitan : P.L.2545.
Comme à l’accoutumée,
voici une pièce qui n’engendre pas la mélancolie ! Sur le thème bien connu
du Hans em Schnokeloch, C.-H. Joubert a bâti une touchante
histoire de cigogne qui permettra au violoniste de jouer sur toutes les
palettes de son instrument. Le pianiste n’y tient d’ailleurs pas seulement un
rôle d’accompagnement, et violon et piano devront nous raconter cette histoire
de concert… On pourrait fêter les retrouvailles des cigognes en les accompagnant de plats alsaciens arrosés d’une manière
que nous n’osons évoquer plus explicitement.

Rose-Marie
JOUGLA : Tango 13 pour violon et
piano. Difficile. Delatour : DLT2229.
Susceptible d’être dansé,
ce Tango est introduit par un long prologue du piano dans un style de prélude
libre, puis le piano devient en quelque sorte la basse rythmique du tango. Un
intermède lyrique permet au violon et au piano de s’exprimer plus librement,
puis le tango reprend selon les canons rythmiques et harmoniques de ce style. La
pièce est entièrement enregistrée sur le site de l’éditeur. L’ensemble est très
agréable et plein d’intérêt.

VIOLONCELLE
Rose-Marie
JOUGLA : Quatre notes s’amusent pour
violoncelle et piano. Débutant. Delatour :
DLT2236.
Cette pièce est la version
pour violoncelle d’une pièce pour violon. Cette promenade sur les cordes à vide
n’a rien de monotone, et le délicat accompagnement de piano lui donne beaucoup
de charme. Peu de notes, mais beaucoup de vraie musique.

FLÛTE
Valérie
ROUSSE, Joël LITTORIE : Couleurs
caraïbe pour flûte et piano. Niveau préparatoire 1 à élémentaire 1.
Lemoine : 29031 H.L.
Une Fantaisie valse, une Fantaisie
quadrille et Mazouk fantaisie, telles sont les trois
« couleurs » proposées aux jeunes flûtistes. Cette musique
entraînante et très typée devrait beaucoup plaire aux jeunes flûtistes.
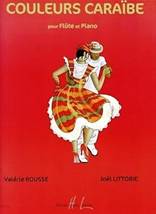
Hywel DAVIES : Folk roots pour flûte avec accompagnement
de piano. 1 vol. 1 CD. Boosey & Hawkes :
ISBN 978-0-85162-920-9.
Destiné à des flûtistes de
niveau moyen, cet album progressif fournit tous les éléments nécessaires pour
comprendre et interpréter ces quinze pièces. Le CD, après une première plage
permettant d’accorder l’instrument, comporte pour chacune la version intégrale,
le play-back et un play-back dans un mouvement plus lent pour la mise en place.
Ajoutons que l’ensemble est vraiment très agréable et très poétique : il
permettra de faire connaître ce merveilleux répertoire et de développer le sens
musical des élèves. Quant aux accompagnements, ce sont de petites merveilles.
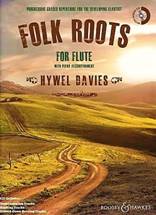
Patrick STEINBACH : The Irish Flute Book. 20 Famous Tunes
from Ireland arrangés pour Flûte, flûte à bec ou Tin Whistle. 1
vol. 1 CD. Schott : ED 21646.
Ces pièces de difficulté
moyenne sont du véritable folklore irlandais avec tout le charme et le
dynamisme qu’on lui connait. Le CD présente à la fois interprétation et
play-back. La partition contient la partition de flûte surmontée de la notation
des accords qui permet, si on n’utilise pas le play-back, de faire accompagner
ces pièces par divers instruments.
CLARINETTE
Valérie
ROUSSE, Joël LITTORIE : Couleurs
caraïbe pour clarinette et piano. Niveau Préparatoire 1 à Elémentaire 1.
Lemoine : 29011 H.L.
Ces trois
« concerts » pour clarinette n’ont en commun avec les pièces
analogues pour piano que la couverture du recueil. Chaque recueil contient des
pièces originales. Celles-ci sont bien séduisantes et devraient convaincre les
jeunes instrumentistes.
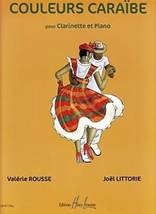
Hywel DAVIES : Folk rootspour clarinette avec
accompagnement de piano. 1 vol. 1 CD. Boosey &
Hawkes : ISBN 978-0-85162-919-3.
On se reportera pour le
commentaire au volume pour flûte recensé ci-dessus. Les airs sont les mêmes,
mais dans des tonalités et dans un ordre adaptés à la clarinette. Cette musique
est à découvrir absolument !

SAXOPHONE
Valérie
ROUSSE, Joël LITTORIE : Couleurs
caraïbe pour saxophone alto et piano. Lemoine : 29029 H.L.
Toujours dans cette
collection de « couleurs caraïbe » pour divers instruments, voici que
les saxophonistes sont, eux, « sous le vent » avec valse, calypso et
mazurka. La difficulté va de Préparatoire 1 à Elémentaire 1. Il y a beaucoup de
caractère dans ces pièces pleines de dynamisme avec parfois un brin de
nostalgie.

BASSON
Michel
NIERENBERGER : Pastorale et
Réjouissance. Pièce en deux mouvements pour basson et piano. Elémentaire. Lafitan : P.L.2423.
Ces deux pièces au
caractère contrasté sont un véritable dialogue entre les deux
interprètes : le piano est un véritable partenaire et la mise en place
supposera un vrai travail de musique d’ensemble. Changements de tempo,
changements de caractère, cadences, tout cela contribue au charme de ces deux
mouvements aux facettes multiples. Certes, il y aura beaucoup de travail, mais
à l’arrivée, beaucoup de plaisir.

COR
Bruno
GINER : Ambos. Duo pour cor en fa. Commande du
CNSMDP. Dhalmann : FD0408.
De niveau difficile, ce
duo fait appel à toutes les possibilités de l’instrument. Il s’agit d’un
véritable dialogue entre les deux instruments, plein de variété et de
dynamisme.

PERCUSSIONS
Bruno
GINER : Samba Caisse. Caisse-claire
solo. Dhalmann : FD0398.
De niveau moyen à
difficile, cette pièce réjouissante correspond bien à son titre. Il s’y trouve
beaucoup de contrastes, de dynamique, qui devrait plaire aux jeunes
interprètes.
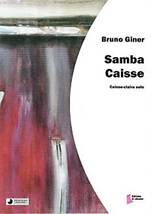
CHIN CHENG Lin : Flyscape. Marimba duo.Niveau difficile. Dhalmann :
FD0382.
Cette pièce nous met dans
une ambiance feutrée, très tonale, très répétitive dans son début, qui culmine
sur un large choral et s’achève sur une nappe sonore qui rappelle celle du
début. C’est tout simplement beau.

MUSIQUE D’ENSEMBLE
Billie Nastelin,
Bill Galliford, Robert Graham : Sunday Morning Organist. Volume 11 : duos de Noëls pour
orgue et piano. Alfred : 40546.
Il s’agit bien de duos
orgue (avec pédalier) et piano. Ces arrangements de Noëls traditionnels sont
fort bien faits et ne sont pas forcément cantonnés aux églises ou aux
temples : l’orgue électronique de qualité peut fort bien convenir ou
l’orgue Hammond. Quoi qu’il en soit, tout cela sonne fort bien et est
assez facile.

Edward Huws Jones : The Klezmer Fidler. Musique juive de célébration
sélectionnée et arrangée par Edward Huws Jones pour
violon et piano, avec violon d’accompagnement facultatif, violon facile et
guitare. 1 vol. 1 CD. Boosey & Hawkes :
BH12411.
Ce volume fait partie
d’une collection consacrée aux musiques traditionnelles de tous les pays.
Celui-ci fait revivre cette musique juive d’Europe centrale qui a bien failli
disparaître. Le CD, qui donne à la fois l’original et le play-back de chacun
des 16 morceaux en traduit à la fois tout le dynamisme et toute la nostalgie.
On appréciera également la préface et les explications détaillées données en
anglais, allemand et français. C’est une musique à découvrir et à faire
découvrir.
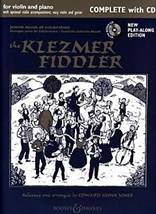
CHANT
CHORAL
Eric
LEBRUN : Motet pour l’Ascension. Trois
voix égales et orgue. Commande de Musique Sacrée à Notre Dame de Paris pour le
Livre de Notre Dame. Chanteloup-Musique :
CMP002. http://www.chanteloup-musique.org/
Saluons les premières
productions de cette jeune maison d’édition située en pleine forêt d’Othe dont
l’un des objectifs est de présenter des productions de qualité à un prix
abordable. Le compositeur et organiste Eric Lebrun nous offre ici une œuvre
attachante sur un texte de Sœur Françoise d’après le Cinquième sermon de saint Bernard sur l’Ascension. Cette Ascension
s’exprime notamment par des montées de quartes successives. Le langage est
poétique, proche de la déclamation. Il y faudra un ensemble vocal exercé.

Jean-René
ANDRÉ : Les chants de l’Iroise. I. Une
et deux voix égales et piano. Chanteloup-Musique :
CMP005.
Sur des poèmes de
Jean-Pierre Boulic, Jean-René André a écrit ces très
jolis et poétiques Chants de l’Iroise spécialement
pour les classes à horaire aménagé du complexe scolaire Saint
Vincent-Providence de Rennes. Le parcours musical est prévu sans interruption
du primaire à la terminale. Les chants présentés ici ont été écrits pour des
élèves allant du CM 1 à la 5ème. L’ambiance est souvent modale, les
mélodies d’un grand intérêt. Bref, il s’agit d’un travail de qualité qui
devrait rencontrer un grand succès.

CHANT :
Yves KÉLER : LES 43 CHANTS DE MARTIN LUTHER. Textes
originaux et Paraphrases françaises strophiques rimées et chantables. Sources
et commentaires suivis de Chants harmonisés à quatre voix pour orgue et chœur,
par Yves Kéler et Danielle Guerrier Kœgler, Collection Guides musicologiques (Vol. 7), Paris, Beauchesne (www.editions-beauchesne.com ), 2013, 482 p. 76 €.
Jusqu’au
XXIe siècle, pour les fidèles et chanteurs francophones, il n’existait que
quelques Chorals luthériens en français, mal adaptés et fort éloignés de la
pensée de Martin Luther. C’est le mérite d’Yves Kéler d’avoir, pour la première fois, regroupé 43 textes (41 Chorals et 2
Litanies) et réalisé des Paraphrases (et
non « traductions ») françaises, strophiques, versifiées et rimées
(ou assonancées), plus proches des intentions du réformateur et, de surcroît,
chantables sur les mélodies traditionnelles bien connues (même nombre de notes,
même nombre de syllabes) : une véritable gageure n’échappant toutefois pas à
quelques inévitables problèmes d’inadéquation prosodique entre accent verbal et
accent musical, ou encore à quelques maladresses textuelles délibérées
évidemment dictées par le souci de fidélité à l’original. La Première Partie
comporte une remarquable exégèse pluridisciplinaire : sources, commentaires
théologique, hymnologique ; historique et événementiel, sans oublier l’aspect
littéraire, sémantique et prosodique et la destination des chants dans le cadre
de l’Année liturgique avec également quelques Paraphrases pour le déroulement
liturgique des offices. La Seconde Partie contient les Paraphrases
minutieusement saisies par Danielle Guerrier Koegler,
avec les harmonisations à 4 voix provenant en grande partie du Livre d’orgue (Strasbourg, 1963). Elle
permet aux organistes d’accompagner le chant des fidèles mais s’adresse aussi
aux chorales paroissiales à l’attention desquelles des versions de remplacement
(de compositeurs allant de Johann Walter
(1496-1570), à travers Michael Praetorius (v. 1571-1621) et Heinrich Schütz
(1585-1672)… jusqu’à Jean Sébastien Bach) sont suggérées. Le maniement de cet
imposant volume à visée œcuménique très bienvenue est facilité par de
nombreuses Tables classées par
incipit et par langue. Une abondante Bibliographie raisonnée permettra d’approfondir le sujet et la problématique. Une Table des
traducteurs (c’est-à-dire : « paraphraseurs ») et un Index des noms
(noms propres et de lieux) rendront service.

VIOLONCELLE
ET PIANO
Dimitri KABALEVSKY : Rondo à la mémoire
de Serge Prokofiev pour violoncelle et piano. LE CHANT DU MONDE (www.chantdumonde.com ), 2013, VC4871, 15 p.
En
1973, Dimitri Kabalevsky (1904-1987) a composé un Rondo pour violoncelle et piano (op. 79) à la mémoire de Serge Prokofiev (1891-1953). D’entrée de jeu, le violoncelle introduit une ligne mélodique Largo avec sourdine, débouchant sur un Andante con moto et planant au-dessus d’accords
répétés et scandés par le pianiste à la main gauche. La partie de violoncelle
est parfois à découvert. L’interprétation de cette pièce de difficulté et de
virtuosité progressives nécessite des instrumentistes rompus à la musique
d’ensemble, une parfaite entente réciproque, un équilibre à toute épreuve, des
répliques précises. L’œuvre est très expressive, tranquille, incisive — avec de
longs traits de doubles-croches au violoncelle, des doubles cordes fortissimo et marcatissimo — puis énergique et bien
rythmée, avec des nuances brusques et diversifiées ; vers la fin, avec des
traits de 9 triples-croches descendantes au violoncelle, ascendantes au piano
pour aboutir à un trille dolcissimo et terminer en un vaste decrescendo (de ff à pp). La gravure est excellente et
d’une remarquable précision concernant les phrasés, les nuances, les ornements,
la technique pianistique et les liaisons au violoncelle. Pour interprètes
confirmés.

CLARINETTE ET PIANO
Youri
KASPAROV : Variations pour clarinette et
piano. Paris, Le Chant du Monde (www.chantdumonde.com ), 2013, CP4076, 25 p.
Rééditées
en 2013, ces Variations en Sib pour
clarinette et piano de Youri Kasparov (né en 1955) présentent, même dans le
tempo tranquille de l’introduction, des traits chromatiques en doubles-croches
et un accompagnement pianistique avec alternance entre les mains, des
intervalles distendus donnant lieu à une variation énergique comportant des
triolets et des changements de mesure. La deuxième Variation, de lecture difficile, est plus expressive ; la
troisième, dramatique, avec des groupes de 12 triples-croches et des
oppositions de nuances ; la quatrième, très légère, avec de subtiles indications
de nuances ; la cinquième, chantante ; la sixième, scherzando, plus développée, se termine fortissimo. Débutants : s’abstenir.

PIANO
Dimitri KABALEVSKY : Variations faciles, op. 51
pour piano. Paris, Le Chant du Monde (www.chantdumonde.com ), 2013, AJ46, 21 p.
Dimitri Kabalevsky, né à St-Petersbourg en 1904 et mort à Moscou en 1987, a été, en 1925, élève au Conservatoire de
Moscou (piano, composition). Il s’est notamment spécialisé dans des pièces pour
débutants : c’est le cas de ces Variations
faciles pour piano, op. 51. Dans les Cinq Variations sur un chant
populaire russe, le thème est énoncé d’abord par fragments à la main
gauche. Dans la première Variation,
la mélodie est confiée à la partie supérieure avec répliques staccato à la main gauche ; la
deuxième est de caractère marcato ; dans la troisième, des fragments du thème
apparaissent aux deux mains en dixièmes ; la quatrième force sur les
accords ; le thème revient dans la cinquième. Cette œuvre est suivie d’un
thème et de 6 Variations sur une danse
populaire russe, dont les deux dernières, avec leurs traits de
doubles-croches, exigent une certaine agilité pianistique. D. Kabalevsky affectionne aussi le chant populaire
slovaque ; de caractère chantant, joyeux puis marqué, la coda se termine dans la douceur. Les Sept Variations sur un thème populaire
ukrainien privilégient le jeu staccato et quelques successions d’accords à la fin fortissimo ;
les suivantes sont une initiation au jeu deux en deux et aux tierces
parallèles : excellent outil pédagogique pour pianistes débutants.

Édith Weber.
***
LE COIN BIBLIOGRAPHIQUE
Timothée PICARD : VERDI-WAGNER. Imaginaire de l’opéra et identités nationales. Actes Sud, 2013, 325 p. 22,80 €.
Il
serait vain et parfaitement illusoire de vouloir trouver dans cet ouvrage de
Timothée Picard, en cette année de bicentenaire, une quelconque biographie
comparée des deux illustres maîtes du drame musical.
Le propos est tout autre, puisque au-delà de leur réalité historique, Verdi et
Wagner prennent, ici, une dimension symbolique, incarnant respectivement les
images de l’italianité et de la germanité, dans le cadre de cette étude « imagologique ». On appelle « imagologie »
la somme des lieux communs relatifs aux représentations des identités
nationales, utilisées à des fins polémiques ou idéologiques. Dans les deux premiers chapitres, l’auteur
dresse à partir de références nombreuses et pertinentes, les portraits des deux
compositeurs, vus à travers le masque souvent déformant des valeurs
patriotiques ou culturelles, les mettant souvent, et bien artificiellement, en
opposition. Il serait possible puisque l’opéra est un psychodrame collectif,
d’effectuer l’analyse de la psyché collective d’une nation à travers son
rapport à l’opéra, surtout si celle-ci engage avec celui-là un lien privilégié,
comme c’est le cas pour l’Allemagne et l’Italie. A Verdi appartenant l’image de
la latinité, d’une certaine animalité, de la mélodie. A Wagner, celle d’une
germanité romantique toute boursoufflée d’intellectualisme décadent.
Opposition, certes, en partie réelle, peut-être utile au plan didactique, mais
à l’évidence caricaturale, à l’image des revirements de Nietzsche - Verdi
apollinien, Wagner dionysiaque - qui n’hésitera pas à ternir l’image de son
ancienne idole au profit d’un retour tardif vers le sud ! Impossible réconciliation, illusoire
synthèse ? Certains tenteront toutefois d’y parvenir, s’essayant dans la
définition d’une troisième voie. Latinité et germanité, deux écueils que les
compositeurs français tenteront d’éviter. Dans le sillage de Mallarmé, ce sont
Berlioz et Debussy qui vont incarner au mieux la modernité française
indépendante… Allemande, italienne ou française, c’est bientôt la légitimité de
l’identité nationale en musique qui est posée par Romain Rolland : L’œuvre
musicale se devant de réconcilier la pensée savante allemande, la mélodie
passionnée italienne, et les rythmes et harmonies nuancées françaises ! Le
roman de l’opéra est finalement celui de l’Europe moderne, avec sa cacophonie
de modèles culturels rivaux. Chaque pays recherchant une spécificité esthético-politique pouvant le conforter dans les
fondements d’une identité nationale qu’un contexte international incertain ne
cesse de fragiliser et de compromettre. Pour conclure de manière rassurante, il
semble bien, en définitive, que l’on puisse être à la fois
« verdien » et « wagnérien », deux aspects d’un même
« romantisme ». Une heureuse conclusion, symbolisée par la figure de
Liszt dont on connaît les affinités artistiques et familiales qui l’unirent à
Wagner, sans toutefois éclipser l’admiration qu’il portait à Verdi, ce dont
témoignent les 9 transcriptions qu’il consacra à l’œuvre du maitre de Busseto. Nous voilà rassérénés ! Un bel ouvrage, une
approche originale, une documentation juste et abondante. Une belle façon de
conclure cette année 2013 sur une lecture qui ne manquera pas de soulever
quelques questions…

Patrice Imbaud.
La Bible de
1611/The King James Version,
textes réunis par Matthieu Arnold et
Christophe Tournu, Collection Écriture et Société, Strasbourg, Presses
Universitaires de Strasbourg (www.pu-strasbourg.com ), 212 p. 18 €.
Les
réformateurs ayant vivement recommandé la lecture de la Bible, celle-ci a été
traduite, entre autres, en allemand par le réformateur Martin Luther (entre
1523 et 1534), en français par le théologien et humaniste Lefèvre d’Étaples (à
partir de 1523) et, en 1538, William Tyndale a
traduit en anglais le Nouveau Testament.
Au XVIIe siècle, le Roi James (VI d’Écosse et Ier d’Angleterre) a commandé une
traduction valable pour les Église d’Angleterre et d’Écosse qui, avec la
collaboration de plusieurs traducteurs, paraîtra en 1611 ; elle est
généralement appelée : The King
James Version. Pour marquer son 400e anniversaire, un Colloque a réuni en
2011 — à Strasbourg et Sélestat — de nombreux historiens, théologiens,
littéraires, hymnologues et musicologues, et c’est le
mérite de Matthieu Arnold et Christophe Tournu d’en
avoir publié les actes. À côté de l’évocation si instructive des divers
contextes historiques et politiques, des problèmes rencontrés par les
traducteurs-réviseurs et des influences subies (Martin Bucer, entre autres),
nos lecteurs s’intéresseront au rôle du chant pratiqué par les Anglicans, à
leur liturgie et, surtout, aux paraphrases de Psaumes transformés en strophes métriques et rimées. Pour
l’Archevêque Th. Cranmer (1489-1556), « le chant des Psaumes se
rapprochait de la psalmodie directe pratiquée dans l’ancienne Église ». Le
recueil réalisé par Sternhold & Hopkins : The Whole Booke of Psalmes(1562) a
suscité de nombreuses controverses, comme il ressort de la communication du
Professeur Beat Föllmi proposant plusieurs versions à
titre comparatif, et il n’a finalement pas tant influencé la King James Version ; il souligne
son influence sur les Psautiers ultérieurs (Ravenscroft, 1621 ; le Scottish Psalter,
1650). Pour terminer, l’auteur fait une brève allusion à la New Version (Brady & Tate, 1696) et
conclut que cette pratique permet donc « de lire les Psaumes et de les
chanter sous la même forme normative : en lisant la prose de la King James Version et en chantant les
versifications du Bay Psalm Book »
(1640). Le Professeur John Richard Watson (University of Durham) qui vient de terminer la réédition actualisée de l’incontournable Julian Dictionary of Hymnology, paru en 1907, s’interroge sur la
typologie, la forme, l’utilisation des Hymns pour attirer l’attention sur des passages bibliques spécifiques et sur
leur finalité confessionnelle dans la Bible de 1611 et les Olney Hymns de 1779. Il est important que les
organistes, chefs de chœur, choristes et prédicateurs soient mieux renseignés
sur les divers contextes des Psaumes,
leur rôle dans l’Église anglicane, leur interprétation et leur destination
liturgique et, d’une manière générale, sur les principaux recueils en usage et
la problématique herméneutique du chant des Psaumes.

Édith Weber.
Dom François
Bedos de Celles (1709-1779), un moine et un facteur d’orgues dans son temps. In memoriam Joseph Scherpereel.
Textes réunis et présentés par Marie-Bernadette Dufourcet,
avec la collaboration de Michelle Garnier-Panafieu. Les Cahiers d’ARTES, n°8, Pessac, 2011,
250 p. - 25 €.
Ce Cahier de l’Atelier de Recherches Transdisciplinaires Esthétique et Sociétés, publié par l’UFR Humanités, rend d’abord un vibrant
hommage à Joseph Scherpereel (1934-2009), Professeur
à l’Université Michel de Montaigne-Bordeaux III. Marie-Bernadette Dufourcet retrace avec émotion leur recrutement dans cette
Université, les riches moments passés ensemble et lui témoigne son indéfectible
reconnaissance. Michelle Garnier-Panafieu rappelle
que le regretté J. Scherpereel était un éminent
musicologue, un infatigable chercheur, décédé précisément sur son lieu de
travail à Lisbonne. Elle évoque sa forte personnalité, sa formation musicale et
musicologique complète, et accompagne son bel hommage de l’imposante
Bibliographie de ses travaux en français et en portugais portant sur la
musicologie régionale (le Comtat-Venaissin), la musique portugaise et également
Chopin, Bartok et Debussy (Ph. D. obtenu à
l’Université de Los Angeles en 1970). L’apport et l’œuvre de Dom François Bedos
de Celles (1709-1779) avaient déjà fait l’objet d’un Colloque qui s’est tenu à
Bordeaux en mai 2004 et de Conférences scientifiques en 2009. Ce numéro d’Artes en est un
important complément, Marie-Bernadette Dufourcet y
présente ce « moine des Lumières » et signale que cet ouvrage
collectif propose de nouvelles pistes de recherche. Parmi les communications,
figurent une présentation de l’auteur et de son important Traité : L’art du facteur d’orgues situé dans le
contexte de l’Académie des Sciences et des Encyclopédistes. D’autres aspects
sont abordés : la facture et l’histoire de l’orgue à Hunawihr (Alsace) ; la pratique organistique en France aux XVIIe et XVIIIe
siècles ; les problèmes de registration, de transcription du clavecin à
l’orgue. Ce Cahier comporte, en
conclusion, la contribution de J. Scherpereel :
« La veine populaire chez les organistes du Comtat-Venaissin et d’Avignon aux XVIIe et XVIIIe
siècles ». Excellente publication qui intéressa à plus d’un titre les
musicologues, historiens et organistes.

Édith
Weber.
François
DELALANDE : Analyser
la musique, pourquoi, comment, Paris, INA Éditions, 2013, 250 p. - 20 €.
Au
cours des siècles, théoriciens et musicologues se sont penchés sur l’analyse
musicale, son histoire et ses méthodes en fonction de l’élargissement des
œuvres musicales jusqu’à la musique électro-acoustique. Des auteurs récents,
tels que C. Deliège, J.-J. Nattiez, I. Bent, R. Campos, J.-M. Chouvel,
S. Arom (pour l’Afrique Centrale), P. Couprie (pour la musique électro-acoustique) ; R. Francès et M. Imberty (pour la
perception) ou encore R. Jakobson (pour la linguistique)… ont forgé leurs
propres critères et surtout leur terminologie spécifique. C’est aussi le cas de
la Revue Analyse musicale (puis Musurgia) et de
la Société Française d’Analyse Musicale. Dans son ouvrage, François Delalande
met, d’entrée de jeu, l’accent sur l’importance de l’écoute, les problèmes de
perception, sans oublier le facteur émotif. Il prend en considération les
musiques non codifiées par écrit, les musiques sans partitions comme certains
répertoires africains. Au sens de « science de la musique » (Musikwissenschaft),
sa démarche intradisciplinaire se veut globale par
rapport à l’objet musical, incluant
la sémiologie musicale, la sémiotique et l’épistémologie, entre autres. Elle
élargit ainsi la définition de l’analyse musicale à propos de laquelle l’auteur
pose deux questions pertinentes : Pourquoi ? Comment ? Le livre est fondé sur quatre dénominateurs communs :
pertinence ; transcription ; sens ; épistémologie de
l’analyse : autant de sujets de délimitation et de discussion — exemples
et œuvres à l’appui — résultant d’une vaste expérience et aboutissant à une Ultime remarque : sur le concept
d’Analyse musicale reposant sur l’écoute et la perception à travers la
« pratique et l’expérimentation musicale ». Voici la
conclusion de l’auteur : On analyse
aussi bien les objets musicaux que les pratiques et les conduites qui les définissent, les technologies dont
ils sont dépendants ; et la synthèse, réciproque de l’analyse, ne se fait
plus au niveau des œuvres, pas même de l’histoire qui les a portées, ni des
styles, ni des influences. Elle s’opère au niveau d’un « fait
musical » dont on ne cesse d’élargir les contours. (p. 242). La
valeur d’une publication peut se mesurer au nombre de questions et de
perspectives nouvelles qu’elle soulève. Quant à la musicologie, elle est
« débordée de tous côtés par des disciplines connexes. »

Édith
Weber.
Maud
POURADIER : Esthétique
du répertoire musical. Une archéologie du concept d’œuvre, Rennes, Presses Universitaires de Rennes
(<www.pur-editions.fr >), Collection Aesthetica,
2013, 190 p. - 16 €.
Vers
la fin des années 1950, l’esthétique musicale a été lancée en Sorbonne, dans le
sillage du Professeur Étienne Souriau, puis par Robert Francès,
Ivo Supicic, Alphons Silbermann,
entre autres. Depuis plusieurs décennies, la notion a considérablement évolué,
et les œuvres musicales créées ont bénéficié d’une approche pluridisciplinaire
incluant la psychologie de la musique, mais aussi la phénoménologie (Ernest
Ansermet) pour aboutir à l’anthropologie ou encore à l’archéologie
musicales. Après l’objectif historique et littéraire du fait musical
incluant la mémoire collective, Maud Pouradier ouvre
de nouvelles perspectives à propos de la
typologie des répertoires. Son point de départ a pour dénominateur
commun : le répertoire ; son point d’aboutissement : la « dérépertorialisation » de l’œuvre musicale, dépassant
largement la problématique de la musique dite « classique ». Elle
distingue le « répertoire-programmation » ; le
« répertoire-fonds » ; le
« répertoire-patrimoine » ; le
« répertoire-genre » ; le « répertoire des partitions ou
répertoire déthéâtralisé ». Comme le précise la
quatrième de couverture : « en faisant tomber les paradoxes temporels
de l’œuvre, le répertoire permet de penser une temporalité proprement musicale
où le classique n’est plus l’imitation extérieure d’un canon ». En ce
sens, l’auteur affirme l’indépendance de l’œuvre musicale à part entière par
rapport à l’œuvre plastique. Les lecteurs consulteront avec profit l’Index de quelques matières (p. 183) qui,
à lui seul, pourrait résumer la démarche et les notions correspondant à la
multiplicité de ses lignes d’approche. Remise en cause et paradoxes.

Édith
Weber.
***
CDs et DVDs
Alonso
LOBO : Misas Prudentes virgines - Beata Dei genitrix. 1CD LAUDA (www.laudamusica.com) : LAU 013. TT : 60’ 48.
Alonso Lobo
(1555-1617), un des grands polyphonistes espagnols de la Renaissance, a été
assistant de Francisco Guerrero (1528-1599) à Séville, puis maître de chapelle
des Cathédrales de cette ville et de Tolède. Ses deux Messes (parodiques) sont
extraites du Liber primus missarumen usage à la Cathédrale tolédane, et
publié en 1602 à Madrid, à l’époque de la Contre-Réforme.
Chacune est précédée du motet dont elle s’inspire, dans le style typique du XVIe
siècle. La Messe Prudentes virgines composée à 5 voix, enregistrée ici en première
mondiale, repose sur le thème biblique des vierges sages et des vierges folles.
Elle met l’accent sur la traduction musicale figuraliste des images et des idées de la parabole avec, par exemple, d’importants mélismes
pour évoquer le mot nocte (nuit) ou encore le traitement homophonique, homosyllabique et homorythmique sur clamor factus est pour traduire la surprise des jeunes filles. La Messe Beata Dei genitrix est entonnée après le
motet éponyme très intériorisé et particulièrement expressif. Les intonations
grégoriennes traditionnelles donnent lieu à des développements polyphoniques
très prenants. Grâce à son chef Albert Recasens,
l’interprétation de La Grande Chapelle fait preuve d’une remarquable
transparence des lignes mélodiques individuelles, d’une justesse et d’une
plénitude vocales exceptionnelles. Alonso Lobo : un musicien espagnol à
découvrir.

Édith Weber.
Marc-Antoine CHARPENTIER : Pour un reposoir. Noëls sur les instruments. Sonate à huit. 1CD
RICERCAR (www.outhere-music.com ) : RIC338.
TT : 74’ 43.
Marc-Antoine
Charpentier (1643-1704), installé à Paris et très apprécié des milieux
italiens, a notamment assuré les fonctions de « maître de musique des
Jésuites » en l’Église St-Paul-St-Louis, puis à la Sainte Chapelle, poste
très envié. Florence Malgoire, les Ensembles Les
Dominos — y compris Freddy Eichelberger (orgue) — et
Les Agrémens, ainsi que le Chœur de Chambre de Namur
et des solistes ont enregistré des pages significatives du grand musicien
français qui pourrait être comparé à son contemporain Jean-Baptiste Lully. Ses Symphonies pour un reposoir (H. 508)
accompagnent une procession en plein air. Elles font alterner des formes
traditionnelles : Ouverture (assez
entraînante), Fugue (centrale), Allemande (grave) et des passages
grégoriens : Tantum ergo (instrumental, puis grégorien), Genitori (monodique)… La Sonate à huit n’a aucune destination religieuse, mais représente
une des premières pièces du genre composée en France vers 1685. Enfin, les Noëls sur les instruments reprennent des
thèmes français bien connus : Les
Bourgeois de Châtres, laissez paistre vos bêtes, Joseph
est bien marié (deux versions), Une
jeune pucelle (deux versions)… Noëls de toujours que l’on a toujours
plaisir à réentendre et qui s’imposent par leur fraîcheur et leurs associations
d’idées.

Édith Weber.
« Lebensgebete. Romantische Vokalmusik aus dem 19. Und 20. Jahrhundert. Music and Devotion ». 1CD RONDEAU
PRODUCTION (www.rondeau.de ) : ROP6076. TT : 66’ 25.
Ces pages de
musique vocale romantique et moderne sont interprétées par l’Ensemble Thios Omilos, prix du Concours
international Anton-Bruckner 2013. En fait, il s’agit d’une Anthologie de Prières émanant de la vie religieuse et
quotidienne, chantées par 4 ou 5 voix d’hommes et composées, entre autres, par
des musiciens italien : G. Rossini (†1868) ; français :
Francis Poulenc (†1963)… ; allemands : Peter Cornelius (†1874), J. G. Rheinberger (†1901), Max Reger (†1916), Hugo Distler
(†1942), Erhard Mauersberger (†1982) jusqu’au Cantor
de St-Thomas (Leipzig), Georg Christoph Biller (né en 1955). Le livret
d’accompagnement a le mérite de donner
les paroles et deux traductions. Les titres s’inspirent du chant grégorien (Ave Maria, Avec maris stellaet Salve Regina), de chorals allemands, de textes bibliques (vétéro et néotestamentaires), de poèmes (Dietrich
Bonhoeffer, un an avant sa fin tragique) ; de la tradition catholique
comme de la tradition luthérienne. Ils sont destinés au service liturgique à
l’Église comme à la pratique domestique. Cinq voix d’hommes s’imposent par leur
riche paysage vocal, le fondu des voix, leur intelligence de ces Prières intensément vécues. Unique. À ne
pas manquer.

Édith Weber.
Jean Sébastien BACH : Himmelfahrt. Kantaten BWV 37, 43, 128.Das Kirchenjahr mit J. S. Bach 6/10. Chœur de Saint-Thomas. Gewandhausorchester Leipzig, dir. Georg Christoph Biller. 1CD RONDEAU
PRODUCTION (www.rondeau.de): ROP
4041. TT : 59’ 56.
Les Disques RONDEAU
ont programmé — avec le célèbre Chœur de St-Thomas et le non moins célèbre
Orchestre du Gewandhaus de Leipzig dirigés avec tant
d’autorité par le Cantor Georg Christoph
Biller — une série de Cantates classées d’après les différents temps de l’Année
liturgique. Le Volume 6 concerne plus particulièrement l’Ascension (Himmelfahrt),
célébrée 40 jours après Pâques, dont le récit est relaté dans les Évangiles de Marc, de Luc et dans les Actes des
Apôtres. Il comporte 3 Cantates. La première : Wer da gläubet und getauft wird(Celui qui croit
et sera baptisé), BWV 37 (créée à Leipzig, le 18 mai 1724) n’est conservée
qu’en parties séparées. Le livret d’un auteur inconnu s’inspire de l’Évangile
de Marc pour le Chœur introductif, du poète Philipp Nicolai pour le Choral n°3 et de Johann Kolrose pour le Choral (n°6) conclusif. Bach fait appel à un grand chœur, privilégie le
hautbois d’amour qui prépare l’entrée du Chœur Wer da gläubet und getauft wird, alors que les
violons font allusion à la mélodie des Dix
Commandements, mettant l’accent sur la foi et ce commandement donné par le
Christ aux apôtres. Elle comprend 6 parties avec chœur, récitatif et arias. Les
voix claires des jeunes garçons énoncent le texte avec précision et soulignent
le cantus firmus. Le choral conclusif, harmonisé à 4 voix, sollicitant la
« foi en Jésus Christ », n’est autre qu’un emprunt à un Choral de la
Réforme (1535) soutenu par les instruments. La deuxième Cantate : Gott fähret auf mit Jauchzen(Dieu monte au ciel avec des cris de joie),
BWV 43, remonte au 30 mai 1726. Les textes reposent sur un Psaume, l’Évangile de Marc et un Choral de Johann Rist. Bipartite, elle fait alterner récits, airs et
chorals ponctués par les timbales et associés aux sonorités des trompettes,
hautbois et violons qui renforcent l’atmosphère de jubilation. La troisième
Cantate : Auf Christi Himmelfahrt allein, BWV 128, se veut affirmative :
« C’est seulement sur l’ascension du Christ que je fonde mon
ascension ». Remontant au 10 mai 1725, cette méditation fait appel, entre
autres, à deux trompettes, deux cors, deux hautbois d’amour et à un hautbois da caccia, aux cordes et au continuo pour recréer le
caractère festif et solennel bien rendu par les instrumentistes et les
choristes. Le Choral introductif, très développé, est un modèle du genre, et
son pendant conclusif, harmonisé note contre note, pose un point d’orgue rempli
d’émotion sur cette belle réalisation.

Édith Weber.
Joseph HAYDN : Schöpfungsmesse. Johann Christian BACH : Sinfonia B-Dur, op. 21 n°1. Chœur de Chambre de la Frauenkirche de Dresde. Reussisches Kammerorchester, dir. Matthias Grünert. 1CD RONDEAU
PRODUCTION (www.rondeau.de) : ROP
6083. TT : 54’ 42.
Cette réalisation
regroupe deux compositeurs : Joseph Haydn (1732-1809) et son contemporain Johann
Christian Bach (1735-1782) — « le Bach de Milan » et « de
Londres » —, fils d’Anna Magdalena. Elle restitue une messe et une
symphonie. La Schöpfungsmesse (Messe de la Création), Hob. XXII :13 — dont
l’intitulé provient d’une citation de l’Oratorio éponyme, composée en six
semaines, a été créée en 1801 à Eisenstadt. Après une brève introduction
instrumentale, soprano solo et chœur entonnent le Kyrie. Après cet Adagio,
un Allegro moderato est suivi du Gloria plus énergique, aboutissant à un Amen fugué rapide et bien enlevé, tout
comme l’Amen conclusif du Credo très développé, marquant le point
culminant de l’œuvre. Après un fervent Sanctus,
l’Agnus Dei d’abord pour quatuor de
solistes, puis pour chœur, débouche sur une conclusion imposante. Ces diverses
atmosphères sont exprimées avec conviction par le Chœur de Chambre de la Frauenkirche de Dresde et le Reussisches Kammerorchester placés sous la direction énergique du
Cantor Matthias Grünert. La Symphonie en Sib Majeur op. 21 n°1 de Johann Christian Bach comprend 3 mouvements : Allegro con spirito, Andante et Presto de même
durée. Les interprètes restituent une légèreté quasi mozartienne ; les
cordes font preuve de virtuosité, d’expressivité dans l’Andante et d’élan dans le Presto.
Programme original magnifiquement desservi.

Édith
Weber.
« Pastoral ». Jean-Louis BEAUMADIER & Friends. 1 CD SKARBO (www.skarbo.fr) : DSK4117. TT : 61’ 34.
Le titre Pastoral se réfère, en fait, au
répertoire pour piccolo rarement enregistré. Il est interprété en spécialiste
par Jean-Louis Beaumadier (et des
« amis » instrumentistes : piano, tambour provençal ; flûte
alto, flûte basse ; cor anglais, violon, violoncelle). Ce Professeur au
CNR de Marseille, souvent appelé « le Paganini du piccolo », est
un soliste internationalement reconnu. Il a compilé un programme original pour
son instrument de prédilection : 15 compositeurs et 18 œuvres les plus
diverses et les plus exigeantes sur le plan technique, totalisant plus d’une
heure d’audition. Ils vont d’Albert Roussel (1869-1937) et Philippe
Gaubert (1879-1941) — célèbre flûtiste français — jusqu’aux membres du Groupe
des Six, en particulier : Arthur Honegger, représenté par son Canon sur basse obstinée à 4 voix (petite flûte, cor anglais, violon et violoncelle), extrait de ses Trois Contrepoints, respirant la
rigueur. À noter également deux pièces de Georges Migot intitulées : Le mariage des oiseaux (1970), monodies
pour flûte seule. Grâce aux Éditions SKARBO : programme instructif et
éclectique, très révélateur de la facture, de la richesse expressive du piccolo
et résumant un siècle d’histoire de cet instrument si attachant.

Édith
Weber.
Julien-François ZBINDEN : Œuvres (avec le compositeur au piano). 1 CD VDE
GALLO (www.vdegallo.ch ) : 1403. TT : 70’ 14
Né en 1917 à Rolle
(Suisse, Canton de Vaud), Julien-François Zbinden,
après ses études de piano, chant et violon, a commencé, en 1938, une carrière
de pianiste de jazz et d’orchestre. Il a assumé d’importantes fonctions au
département musical de la Radio Suisse Romande et présidé diverses
associations. En autodidacte, il traite non seulement des formes
classiques : symphonies, concertos, mais encore des œuvres radiophoniques,
musiques de scène et de films qui, sur le plan international, ont rencontré un
grand succès. Ce CD illustre sa « première période » avec des
pages déjà anciennes comme, par exemple, ses Trois préludes pour piano, op. 4 (1944-46) qu’il interprète avec
précision et nuances ; les Quatre Solitudes pour piano op. 17 (1951) pour lesquelles il donne d’utiles
précisions : « Avec une ironie douloureuse », « Avec une
énergie désespérée », « Avec une sérénité inhabituelle » et,
pour conclure : « Avec une indifférence douteuse », ou encore la Jazz-Sonatine pour piano, op. 11
(1949-50). Ces compositions ne pouvaient être mieux servies que par leur
créateur. La seconde période comprend Plaun la Greina (Trois images helvétiques) pour piano, op. 65, allusion
« funèbre et montagnarde » à une région entre Grisons et Tessin, qui,
menacée par un lac artificiel, a donné lieu à une exposition contestataire
(1975) lors de laquelle J.-Fr. Zbinden a interprété
son œuvre. En 1998, il compose sa Méditation
sur le nom de G.E.R.B.E.R. pour piano op. 90 (cadeau pour le 90e
anniversaire de son maître, René Gerber dont le nom lui a fourni les notes du
thème. Il a aussi écrit pour jazz-group et orchestre à cordes : Jazzific 59-16 et un Concerto de Gibraltar pour piano et fanfare, teinté d’ibérisme et
cédant une large place aux cuivres. Grâce au Label GALLO et aux Archives de la Radio-Télévision Suisse, l’œuvre de ce musicien
délibérément du XXe siècle sera largement diffusée.

Édith
Weber.
« Il Canto del Sentieri del Tempo ».1 CD VDE GALLO (www.vdegallo.ch) : 1411. TT : 78’ 27.
Le Chœur Valpellice, « Gruppo Vocale
d’Ispirazione Popolare »,
fondé en 1958 par Roberto Malan, est dirigé depuis 1983 par Ugo Cismondi. Ces 24 voix d’hommes ont donné près de 600
concerts dans le Val Pellice et les vallées
vaudoises, le Piémont jusqu’en Europe, Argentine et Uruguay. Leur répertoire
révèle d’abord la tradition vaudoise puis, d’une manière générale, la tradition
populaire à la frontière franco-italienne. Les Vaudois — dans le sillage de Pierre
Valdo — ayant sympathisé pour la Réforme du XVIe siècle se sont réfugiés dans
ces Vallées vaudoises qui constituent une enclave protestante. Leur répertoire
linguistique est donc particulièrement diversifié, avec même un dialecte
d’origine provençale à côté du français et de l’italien. Un remarquable livret,
très documenté et abondamment illustré (paysages, cartes de géographie,
monuments) invite au voyage dans l’espace et en musique. Le disque, avec ses 23
pièces, souligne des réminiscences française (Il pleut, bergère), argentine (Adios)… Plusieurs thèmes :
« Souvenirs de la vallée », « les émotions de l’âme et du
corps », « Insouciance » (vie, travail, guerre)… sont abordés.
Trois pièces comportent une résonance religieuse : Salmo (Psaume) 136 (M. Bepi De Marzi), Kumbaya (le
Gospel bien connu) et un Alleluia conclusif (T. et M. Douglas Brenchley), répétitif et entraînant, annoncent la naissance
du Christ et font alterner deux chœurs qui se répondent. Disque très instructif
à propos des spécificités vaudoises.

Édith
Weber.
Jean-Baptiste LULLY : Phaéton. Tragédie mise en musique en un Prologue et
cinq actes. Livret de Philippe Quinault. Emiliano Gonzalez Toro,
Ingrid Perruche, Isabelle Druet, Gaëlle Arquez,
Andrew Foster-Williams, Frédéric Caton, Benoît Arnould, Cyril Auvity, Virginie Thomas. Chœur de chambre de Namur. Les Talens Lyriques, dir. Christophe
Rousset. 2CD Aparté : AP061. TT.: 79'+74'.
«Tragédie mise en musique par Monsieur de
Lully, présentée devant sa Majesté à Versailles, le sixième jour de janvier
1683 », donc peu de temps après l'installation céans de la Cour, Phaéton connut d'emblée un grand succès. Allégorique, le sujet décrit
l'audace insensée de celui qui voulut s'élever aussi haut que le soleil et
prendre sa place sur le char de lumière. D'orgueil, Phaéton n'est pas avare,
lui qui proclame « pour régir l'univers les destins m'ont fait
naître » et finit par se persuader qu'il peut devenir « le maître du
monde ». C'est sans compter sur le prix à payer pour pareille témérité :
le char solaire, qu'il a osé occuper, sera foudroyé par Jupiter, emportant au
trépas son occupant. Emprunté aux Métamorphoses d'Ovide, le sujet est
agrémenté par Philippe Quinault, fin homme de théâtre, d'une intrigue
amoureuse, avec ce qu'il faut de jalousie féminine pour lui assurer
rebondissement autant que piment. Quelques divertissements, dont les
transformations de Protée, l'exotisme de cérémonies représentant les diverses
figures de l'Orient, et un cataclysme qui défigure le temple d'Isis en gouffre
effroyable, achèvent de donner à l'opéra une facture attrayante. Même privée de
mise en scène, la présente exécution, captée lors d'un concert à la salle
Pleyel, est un bel achèvement. Quand il ne touche pas son cher clavecin,
Christophe Rousset aime à diriger ces tragédies lyriques synonymes d'harmonie
et d'équilibre. Comme hier pour Vénus et Adonis de Desmaret, Hercule mourant de Dauvergne, ou Bellérophon, de Lully, Rousset pare Phaéton des vraies couleurs du Grand siècle, privilégiant l'intimisme à
la pompe, et un sens de la mesure tout racinien. Le continuo est strict, mais
pas rigide, apportant aux récitatifs une rectitude sonore enviable. Que ce soit
dans les ritournelles, enlevées, le « concert d'instruments », dans
lequel les vents apportent une agréable touche, les danses variées, telle la
bourrée bondissante des égyptiens, ou encore la belle chaconne qui clôt le 2 ème acte, ou les diverses réjouissances du 4 ème, tout est ici mené à l'aune de la discrétion et de la
sensibilité. On est frappé par une musique qui, même dans le drame le plus
affreux, ne se départit jamais d'un optimisme revigorant, ne distillant que
bien peu d'effroi. Mais il en va ainsi de la musique de Lully qui objective la
narration tragique. Côté vocal, on admire d'abord la beauté de la langue et la
justesse de la déclamation. Au premier chef avec Le Chœur de chambre de Namur,
un ensemble rompu à ce type de répertoire, brillant par la clarté et
l'articulation. Un cast habile a été rassemblé,
mêlant spécialistes confirmés et nouveaux venus : des voix émergentes déjà
expertes, comme Benoît Arnould, Protée, beau timbre de baryton clair, et Gaëlle
Arquez, agréable soprano. Emiliano Gonzalez Toro confère au rôle titre une belle aura, même si quelque peu taxé dans le haut du
registre de ténor, comme il en est de Cyril Auvity,
successivement Triton, le Soleil ou la déesse de la Terre. Mais ces réserves,
bien mineures, sont à attribuer aux aléas du direct. Ingrid Perruche et
Isabelle Druet par la ferme élocution et la juste
emphase tragique, font merveille. A écouter !

Jean-Pierre Robert.
Georg Philipp TELEMANN : 12 Fantaisies pour flûte seule sans basse.
Héloïse Gaillard, flûtes à bec. 1CD AgOgique :
AGO014. TT.: 58'39.
Telemann a écrit ses Fantaisies dans les
années 1727 et 1728. Tout comme les Partitas de Jean Sébastien Bach, elles
témoignent du goût de l'époque pour les pièces dédiées à des instruments
monodiques, violon, violoncelle, flûte. Publiées sous le titre de « Fantasie per il violino, sanza basso », on pense que le maître, qui privilégie une
écriture différente de celle de sa Fantaisie pour violon, de 1735, laissait aux
interprètes la liberté de choisir leur instrument. Comme elles correspondent à
la tessiture de la flûte traversière, alors en vogue, il est plausible de les
jouer sur cet instrument. Héloïse Gaillard a fait choix de quatre flûtes
différentes, la flûte sopranino, la flûte soprano, la
flûte alto, et la flûte ténor ou « flûte de voix ». Afin de
« traduire par les qualités sonores et techniques de ces instruments toute
la gamme des émotions suggérées par Telemann ». Le résultat est délectable
et on se prend à savourer les
différences subtiles, parfois ténues, mais bien réelles, entre ces divers
timbres, dans des compositions souvent proches de l'improvisation. Car là aussi
règne une grande liberté. C'est celle de la « fantaisie », cette sœur
de l'imagination, cultivant aussi l'effet de surprise. Il est certain que la
flûte apporte plus de « fun » que le violon, par exemple, notamment
dans les séquences marquées « spirituoso »
ou « vivace ». La flûte ténor, qualifiée de « véritable flûte de
concert » par le célèbre facteur Stanesby, en
1732, possède la sonorité la plus sombre, comme il apparaît dans les notes
graves de la 8 ème Fantaisie. La flûte alto sonne
suave, douce et chaude, comme à l'affettuoso de la 9 ème.
Quand à la flûte soprano, utilisée ici pour la 5 ème et la 12 ème, elle sonne piquante, tandis que la
flûte sopranino renchérit en brillance, celle du flautino. Héloïse Gaillard nous fait traverser ces pages
avec son talent de découvreuse.

Jean-Pierre Robert.
Georg Friedrich HAENDEL : Belshazzar. Oratorio en
trois actes. Livret de Charles Jennens. Allan Clayton, Rosemary Joshua, Caitlin Hulcup, Iestyn Davies, Jonathan Lemalu. Chœur et Orchestre des Arts Florissants, dir. William Chrsitie. 3CDs Les
Arts Florissants Éditions (distribution Harmonia Mundi)
: AF.001. TT. : 55'19+68'13+42'52.
Comme nombre de leurs confrères, orchestres
et maisons d'opéra, les Arts Florissants franchissent le pas et créent leur
propre label éditorial discographique. Le premier opus, dédié au Belshazzar de Haendel,
a été capté en studio suite à une série de concerts donnés fin 2012, dont celui
de la salle Pleyel (cf. NL de 02/2013). Ainsi l'enregistrement, bénéficiant
d'un temps de préparation appréciable et de la maturation qui s'opère au fil
des diverses exécutions publiques, est-il très proche de l'émotion et de
l'ambiance de celles-ci, sans devoir en souffrir les possibles imperfections.
Un large support de mécènes permet d'amortir les coûts de pareille entreprise. Belshazzar est l'un des meilleurs oratorios
anglais du Caro Sassone. Son succès provient de la
qualité littéraire du livret de Charles Jennens, qui
offre une vraie consistance dramatique, se prêtant à une mise en musique, dont
l'ampleur dépasse le cadre même de l'oratorio. Il est de vastes proportions, le
chœur y occupant une place singulière puisque figurant tour à tour juifs,
babyloniens et perses. Surtout, Haendel parvient à créer des tableaux vivants
d'un relief certain, pour animer les scènes ancrées dans l'histoire biblique,
tels que le détournement du fleuve Euphrate, le fameux banquet où Balthazar
défie le Dieu de Judée, ou encore le moment où le prophète Daniel décrypte les
hiéroglyphes tracés par la main divine. Créé en 1745, l'oratorio sera remanié à
plusieurs reprises. William Christie utilise la version d'origine comme
matériau de base et y ajoute plusieurs morceaux provenant de celle de 1751. Sa
vision est, comme on le soulignait à propos du concert parisien, sereine et
aristocrate. Elle se distingue par un fin équilibre entre intimisme et pompe.
On admire la suavité sonore (première intervention arioso de Daniel, musique
associée au personnage de la reine Nitocris) mais
aussi l'ampleur des interventions chorales (grandiose chœur des juifs qui
conclut le premier acte) comme leurs différentes caractérisations (chœur
vaillant et moralisateur des perses, par lequel débute l'acte II), ou encore la
respiration qui pare les récitatifs accompagnés, si développés ici. Le discours
ne se départit jamais de sa distinction, celle d'un ensemble instrumental pour
lequel ce répertoire n'a plus de secret. William Christie a assemblé un cast solide.
Rosemary Joshua, Nitocris, allie plénitude vocale et
ferveur dramatique, et est vraiment royale dans son chant habité, tout en
émotion retenue, idéalement projeté. Iestyn Davies,
jeune contre-ténor au timbre très avenant, et dans la veine d'un Andras Scholl, la puissance en
plus, distille avec grand soin dans l'intonation, le poids du texte du prophète
Daniel. Allan Clayton pare le personnage titre, velléitaire monarque, d'une
fougue retenue, et ne manque pas de bravoure au fil d'arias démonstratifs. Caitlin Hulcup, beau timbre de
mezzo grave, en Cyrus, et Jonathan Lemalu, basse
sympathique, en Gobrias, complètent un quintette
vocal sans faille. Techniquement, l'enregistrement se signale par une balance
naturelle entre orchestre et voix.

Jean-Pierre Robert.
Wolfgang Amadé MOZART : Concertos pour piano et orchestre N° 15, en si
bémol, K. 450, & N° 20, en ré
mineur, K 466. Orchestre de Chambre de Prague. Paul Badura-Skoda,
piano et direction. 1CD Transart Live: TR 175. TT.: 53'15.
Un vieux monsieur de 85 nous dit jouer pour
la première fois, au disque sans doute, car autrement on ne le croirait pas, le
concerto K 450, le 15 ème, qui, d'après ses mots,
passe pour être « une des œuvres les plus exigeantes » de Mozart. Et
confie avoir souffert. Quelle humilité ! Il est vrai que l'exécutant n'est pas
ménagé au fil des deux mouvements extrêmes. C'est que dans cette pièce, qu'il a
écrite pour lui-même, Mozart, fier de son succès d'alors, lance un défi à qui
veut le jouer. Il n'est que de constater la course du piano dans le
développement de l'allegro initial, ou le rondo final, bâti sur un thème de
chasse, enlevé. Paul Badura-Skoda les aborde avec un
entrain salvateur. L'andante offre, en contraste, un thème d'une simple beauté,
varié en des variations comme à l'infini. La souveraine simplicité du pianiste
fait merveille. Elle se retrouve dans sa direction, sans effet, certes un peu
« old fashoned »,
mais combien musicale. Elle dévoile une orchestration, originale chez Mozart,
qui en vient à mettre sur un pied d'égalité vents et cordes. Ce qui est mis en
valeur par un effectif restreint, capté dans un enregistrement très proche, qui
ne cherche pas la brillance de l'instrument, en l'occurrence un Steinway de la
propre collection du pianiste. Le concerto K 466, un des plus célèbres, occupe
une place unique parmi ses pairs : c'est une « œuvre de crise »,
« aux accents orageux », selon C. M. Girdlestone,
mais qui mène aussi aux tréfonds de l'intime. Badura-Skoda
l'affectionne depuis des lustres et dit l'avoir remis sur le métier, nanti de
cadences nouvelles, de son cru. La tonalité de ré mineur est, chez Mozart,
celle de la souffrance. La sourde trame dramatique du 1er mouvement, que Paul Badura-Skoda mène haletant dans ses façons de sombre
roulement, complète l'intimisme chambriste. La « Romanza »,
que le pianiste considère tel « un chant d'amour », semble bien
calée. Las, bien vite « les démons sont bien là », avec les syncopes
rageuses du clavier sur la plainte désespérée des bois qui semblent crier
merci. Le finale illustre la tension entre angoisse et libération. L'interprète
ménage çà et là une légère accélération, ce qui donne un supplément de vie. La
coda est on ne peut plus joyeuse, s'achevant dans un presto jubilatoire.

Jean-Pierre Robert.
Hanns EISLER : Ernste Gesänge(Chants
sérieux) pour ensemble instrumental et baryton. Lieder avec piano. Sonate pour piano, op. 1. Matthias Goerne, baryton. Thomas Larcher, piano.Ensemble Resonanz. 1CD Harmonia Mundi :
HMC 902134. TT.: .
La carrière de Hanns Eisler (1898-1962) connut plusieurs phases : né en Allemagne, à Leipzig, fils du philosophe
Rudolf Eisler, il se rend très tôt à Vienne avec sa famille, et ensuite à
Berlin, puis émigrera au États Unis, dans les années 1930, avant de revenir en
Europe et de s'installer à Berlin Est en 1950. Marxiste convaincu, mais pas
toujours dans la ligne officielle. Il fut d'abord l'élève de Schoenberg, avant
de rompre toute relation avec l'auteur de Pierrot lunaire, son anti
conformisme le conduisant à refuser « l'élitisme » de celui-ci. Il se
lie alors d'amitié avec Bertold Brecht et écrira pour
lui trente années durant, notamment des musiques de scène pour certaines de ses
pièces et films. Sa passion pour le verbe acéré et ironique devait l'amener à
composer pour le Lied. Le présent disque offre l'intérêt de montrer plusieurs
facettes de sa production. La Sonate pour piano, son opus 1, de 1922/23, est
dédiée au maître Schoenberg, qui l'accueillit favorablement et la fit créer par
le célèbre pianiste Eduard Steuermann. Deux allegros
librement atonaux, fébriles et nerveux, encadrent un intermezzo en forme de
passacaille, sur le modèle du développement par variation cher à Brahms. Les Ernste Gesänge (Chants graves) ont été composés en 1962, peu avant la mort du compositeur. Ces
sept pièces pour baryton et ensemble de cordes, précédées d'un court prélude et
d'une maxime lancée rageusement, réunissent divers poètes dont Friedrich
Hölderlin. Le climat est très pessimiste, au-delà d'une mélodie en apparence
aisée, comme traversé d'un cri de désespoir. Matthias Goerne,
familier de ce musicien dont il grava naguère la Deutsche-Sinfonie(Decca), offre une déclamation toute en
souffrance, souvent pathétique. Un bouquet de Lieder avec piano, sur des textes
de Brecht, s'avère fort intéressant, car ces très courtes pièces, en apparence
proche d'un romantisme tardif, se révèlent grinçantes dans leurs aphorismes.
Elles illustrent parfaitement le partenariat fructueux qui s'était établi entre
les deux artistes, alors exilés outre Atlantique. Enfin, Goerne interprète trois chansons à couplets et refrain, pièces engagées, dans la
manière de Kurt Weill. Deux sont tirées de « Têtes rondes et têtes
pointues » de Brecht. Enfin, le Solidaritätslied (Chant de la solidarité), de 1932, véritable manifeste, est extrait de la
musique de film « Kuhle Wampe »
(Ventres glacés), de Dudow et Brecht (1931). Le grand
baryton allemand est admirable et ses accompagnateurs, l'Ensemble Resonanz comme le pianiste Thomas Larcher, à la hauteur du
challenge.

Jean-Pierre Robert.
Frédéric
CHOPIN : Polonaises. Rafal Blechacz, piano. 1CD Universal DG : 479 0928. TT.: 54'45.
Après un détour par Debussy et Szymanowski, Rafal Blechacz revient à
son cher Chopin, pour l'intégrale des Polonaises. Du moins des sept pièces de
la maturité, car il omet les œuvres de jeunesse. Plus que tous autres morceaux
livrés au piano, les polonaises forment
un vibrant hommage à la Pologne : une musique héroïque, emplie de bravoure et
de résolution, mais aussi une apologie de la danse. En un mot ce que Bernard Gavoty qualifie de « kaléidoscope de la Pologne vue par Chopin ».
« L'amour du pays en musique », dit le polonais Rafal Blechacz, qui le ressent au plus profond. Et
l'exprime à travers un nuancier très large : une force certaine, mais pas
pesante, loin du brio racoleur, une poétique vraie, jamais affectée. Surtout,
il émane de son jeu cette alternance de tension et de détente qui distingue ces
pièces. On le vérifie d'emblée dans la paire de l'opus 26, opposant la
première, combative, quasi martiale, à la seconde, mystérieuse et dramatique,
presque épique dans sa partie centrale, où semble se vivre quelque
conspiration. De même, dans le doublé de l'opus 40, à l'héroïsme de l'une,
demandant le forte de bout en bout, font pendant les sombres accents de
l'autre, tragique déploration à travers les vagues de la main gauche, «
une gloire endeuillée » dira Alfred Cortot. L'op 44 est sous les doigts de Blechacz véhémente, ménageant un contraste saisissant
dans le fameux passage médian en forme de mazurka. Vis à vis de l'op. 53, le
pianiste adopte un tempo fort alerte et la progression se veut de plus en plus
soutenue, conférant un sentiment d'urgence. Il ne relâche la pression que dans
la section centrale, infiniment lyrique. Enfin, la liberté de l'ultime Polonaise
op. 61, si dissemblable de ses sœurs, Blechacz la conçoit comme une immense rêverie : dans
cette pièce ressortissant plus au genre de la fantaisie, l'idée d'improvisation
domine, comme si des souvenirs affleuraient. Blechacz y voit « un combat intérieur », et insiste sur ce qui la sépare
stylistiquement des autres. Son Steinway sonne glorieusement, avantageusement
capté.

Jean-Pierre Robert.
Anniversaire Verdi
« Domingo
Verdi ». Giuseppe VERDI : Arias pour baryton, extraits de Macbeth, Rigoletto, Un ballo in maschera, La traviata, Simone Boccanagra, Ernani, Il trovatore, Don Carlo, La Forza del destino. Placido Domingo. Cor de la Generalitat Valenciana. Orquesta de la Communita Valenciana, dir. Pablo Heras-Casado. 1 CD
Sony : 8883733122. TT.: 60'.
Placido Domingo aime les
challenges vocaux et dramatiques. Fin musicien, comédien hors pair, hier
inoubliable Othello, et avant hier magistral Alfredo, le célébrissime ténor se
meut avec le même naturel, la même stamina, en
territoires de barytons verdiens ! Nouvelle phase de carrière, déjà fort
abondante pourtant ! Ce virage, il l'a amorcé en 2009, avec son interprétation
flamboyante de Simon Boccanegra à Berlin, suivi d'un film (2010) où il
incarnait Rigoletto. Giorgio Germont,
récemment au MET, et sous peu Le Comte de Luna, à Berlin, enrichiront cette
nouvelle galerie de portraits. « S'attaquer aux rôles de baryton chez
Verdi c'est voyager au plus profond de la psychologie humaine »,
relève-t-il. Le présent récital, qui comprend quelques unes des plus belles
inspirations que Verdi ait laissé au baryton, pivot de sa dramaturgie, est
médusant. La voix conserve tout son impact et son pouvoir de séduction, et
n'est affectée d'aucun vibrato. Son engagement coutumier trouve là un nouveau
terrain de prédilection : ces pères autoritaires ou justiciers (Rigoletto, Giorgio Germont), ces
amants vengeurs (Luna, Carlo di Vargas), ces amis fidèles (Rodrigo) ont
tellement à dire ! On connaît son habileté innée à « entrer » dans un
personnage, à trouver le ton juste. Sa suprême diction, un art du legato, déjà
légendaire, font le reste. Ces pages mémorables, où la véhémence des réactions
exacerbées rencontre la plus poignante tendresse, et que Verdi couronne d'une
quinte aiguë puissante, le timbre « ténorisant » du chanteur leur
apporte précisément cet éclat et ce supplément d'aura. On ne sait qu'admirer :
l'émotion étranglée qui adorne « Di Provenza »
de La traviata, l'interjection vengeresse de
« Il balen del suo sorriso » du Trouvère,
ou le « Eri tu » menaçant du Bal masqué.
Ou encore l'intensité qui parcourt une scène entière, où l'expression se mesure
à la fracture intérieure du héros. C'est un Doge grandiose et impérieux qui
apparaît lors de la scène du Conseil de Simone Boccanegra. Dans celle de
la prison de Don Carlo, son Rodrigo, à l'heure d'une mort expiatoire,
est tout simplement bouleversant. Le jeune chef Pablo Heras-Casado
prodigue des accompagnements sensibles, voire imaginatifs dans les climax de
ces pages tragiques, véritables concentrés de dramaturgie verdienne. Et
quelques chanteurs espagnols prêtent leur concours à cette anthologie qui,
assurément, fera date. Seul bémol, l'absence de notice en français et de traduction
des textes chantés.

Jean-Pierre Robert.
Maurice RAVEL : Tzigane. Pavane pour une infante défunte. Le Tombeau de
Couperin. Claude DEBUSSY : Petite Suite. Danse sacrée, Danse profane. Sarabande. Danse. Emmanuel Ceysson, harpe. Orchestre de chambre de
Paris, violon et dir. Thomas Zehetmair.
1CD Naïve : V 5345. TT. : 65'10.
Ce disque atteste des qualités de
l'Orchestre de chambre de Paris, sous la direction de son chef principal
actuel, le violoniste Thomas Zehetmair, plus encore
que de la pertinence des choix interprétatifs de ce dernier. Le programme en
est pourtant ingénieux, partagé entre les deux grands maîtres français. La Petite Suite de Claude Debussy, pour piano à quatre mains (1889), devait
être orchestrée par Henri Busser, à la satisfaction de l'auteur qui en loua
« l'ingénieuse orchestration ». Celle-ci est en effet un petit bijou
de goût, clin d'œil au retour aux anciens, tant prôné à l'époque. La
délicatesse du trait, l'allant général, dont un entraînant finale, tout ici
respire la meilleure veine gallique. De même, les Danses pour harpe sonnent-elles finement différenciées, enchaînant la gravité et la grâce, sous
les doigts experts d'Emmanuel Ceysson. Celui-ci joue,
bien sûr, un instrument à pédale, et non la harpe chromatique pour laquelle
furent conçues ces pièces. Deux autres danses, Sarabande et Tarantelle,
orchestrées par Ravel, complètent ce paysage debussyste choisi. Le volet
consacré à Ravel, quoique séduisant, convainc moins. Tzigane, joué sur
le crin par Zehetmair, ne cherche pas à « faire
beau », et frôle la caricature du style hongrois, outre que le
soliste-chef n'hésite pas à bouler le tempo à mesure qu'approche la fin du
morceau. Ce parti pris de rapidité affecte aussi Le Tombeau de Couperin.
Si le raffinement de l'orchestration ravélienne n'en souffre pas, du fait du
galbe chambriste justement adopté, l'exécution manque cette ultime élégance qui
doit orner ces quatre vignettes, là encore traitées dans l'esprit ancien. Zehetmair privilégie une articulation brusque qui élude la
magie. Reste que le travail orchestral est immaculé, cordes transparentes, bois
caquetant délicieusement, enjoués ou graves.

Jean-Pierre Robert.
Dmitri CHOSTAKOVITCH : Symphonie N° 8, op. 65. Mariinsky Orchestra, dir.
Valery Gergiev. 1CD Mariinsky : MAR0525. TT.: 65'38.
Poursuivant son exploration des symphonies
de Dimitri Chostakovitch, Valery Gergiev s'attaque à
la Huitième. Écrite en 1942 et créée en 1943, à Moscou, par Evgeni Mavrinski, elle fait figure de grande confession
intime, un vrai cri de révolte contre les atrocités de la guerre. Rarement le
tragique a-t-il atteint un tel degré d'expression dans l'univers symphonique.
Il semble que la présente exécution live soit le fruit de plusieurs prises en
concert, attestant de la volonté du chef de trouver la meilleure inspiration et
la parfaite concentration de son orchestre. Elles sont bien présentes au fil
des cinq mouvement de ce monument, certes moins
directement abordable que la Septième, mais combien fascinant. Gergiev ménage le début du premier mouvement adagio dans un
calme quasi hiératique : les longues phrases des cordes sont l'objet de
pianissimos envoûtants. Comme sont bien soulignés les dissonances et les éclats
en vagues successives de la séquence allegro qui suit, ou encore ciselée la
mélopée du cor anglais sur les cordes assagies, qui conclut l'épisode. Au
scherzo suivant, marqué allegretto, le chef ne cherche pas à accentuer la
dureté contenue dans les bois stridents, et contient la dynamique. La pulsation motorique du second scherzo, il le cadre, ces
ostinatos scandés aux cordes, sur lesquels se détachent les sifflements des
bois. Et ce n'est qu'aux ultimes mesures qu'il lâche ses forces dans un
fortissimo assourdissant. Les accents funèbres du Largo, en forme de
Passacaille, sont nursés aux cordes comme un long sanglot que le ton
de la flûte ppp rend encore plus poignant. Le finale, qui s'enchaîne,
avec son brusque changement de tonalité, semble apporter un climat apaisé, mais
le répit reste de courte durée et les démons du premier mouvement resurgissent.
La coda, en apparence sereine, est en réalité étouffante, au bord de
l'immobilisme, en une résolution équivoque des conflits précédemment exposés.
On ne sort pas indemne d'une telle interprétation pénétrante de l'évocation de
la douleur.

Jean-Pierre Robert.
Anniversaire Poulenc
Francis POULENC : Stabat Mater pour soprano
solo, chœur mixte et orchestre. Gloria pour soprano solo, chœur mixte et
orchestre. Litanies à la Vierge noire pour chœur de femmes avec
accompagnement d'orchestre. Patricia Petibon,
soprano. Chœur de l'Orchestre de Paris. Orchestre de Paris, dir. Paavo Järvi. 1CD Universal DG : 479 1497. TT.: 64'05.
Ce disque réunit trois chefs-d'œuvre
laissés par Francis Poulenc à la musique sacrée du XX ème siècle. Les Litanies à la Vierge noire, pour voix de femmes et orgue
(1936), et remaniées pour accompagnement d'orchestre à cordes et timbales en
1947, ont été écrites en hommage à un cher disparu, le compositeur
Pierre-Octave Ferroud. Dans ce morceau « humble et fervent », est
glorifiée la Vierge noire de Rocamadour. Le grand dépouillement des seules cordes
met en valeur les voix de femmes. Poulenc compose, de même, son Stabat Mater en 1949/1950, en souvenir du décorateur Christian Bérard, dont la disparition
l'affecta beaucoup. Là encore, est célébrée la Vierge de Rocamadour. Les 12
séquences alternent calme recueillement et dramatisme presque violent, outre
quelques passages de grande douceur. La manière puise au plain-chant comme aux
polyphonies de la Renaissance et au grand motet à la française. Quoique de
proportions généreuses, l'œuvre jamais ne vise au monumental. Le chœur mixte
égrène comme une prière émue, et la voix de soprano s'élève avec une limpidité
bouleversante, notamment au verset « Fais que ses blessures me
blessent », ou dans un jaillissement radieux, lorsqu'évoquant, dans les
ultimes paroles, « le beau paradis de gloire ». Le Gloria, de
1959/160, créé par Charles Munch en 1961, à Boston, puis peu après à Paris, par
Georges Prêtre, frappe par sa liberté de ton, presque désinvolte. Le « Laudamus Te » ou le « Domine Deus unigenite » sont menés bon train, dans une allégresse
sonore d'une frénésie irrésistible. Les
deux passages solistes sont empreints d'un poignant recueillement, qui n'est
pas sans évoquer l'intériorité des Dialogues de Carmélites. La
modulation de l'Agnus Dei, dont Poulenc se souviendra dans sa Sonate pour
clarinette et piano, émeut, en particulier par la gravité du solo de la
soprano. Il émane de cette pièce un climat fervent que son mélange de style,
loin de desservir, renforce au contraire. Patricia Petibon confère aux interventions solos ce « style très humain, très
expressif » voulu par Poulenc, tourné vers l'intérieur, de son timbre
éthéré, usant volontairement de peu de vibrato. Paavo Järvi montre sa profonde empathie pour le répertoire
français et magnifie la saveur des vents de l'Orchestre de Paris. Et le
Chœur de l'Orchestre est d'une ductilité
rare.

Jean-Pierre Robert.
Anniversaire Britten.
Benjamin BRITTEN : War
Requiem, op. 66. Words from the Missa pro defunctis ; poems by Wilfred Owen. Ian Bostridge, ténor, Anna Netrekbo, soprano,
Thomas Hampson, baryton. Orchestra, Coro e Voci Blanche dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dir. Sir Antonio Pappano. 1 CD Warner classics : 6 15448 2. TT.: 80'05.
Comme Verdi pour sa Messa da Requiem, le War Requiem valut à
Benjamin Britten un succès à l'égal de ses plus grands chefs-d'œuvre
opératiques. Une dimension discrètement dramatique dans les deux cas n'y est
peut-être pas étrangère. Commandée pour marquer la consécration de la nouvelle
cathédrale de Coventry, détruite durant la Seconde guerre mondiale, sa
création, en 1962, fut unanimement saluée. Le dessein n'est pas tant la
dénonciation des horreurs de la guerre que l'affirmation d'un message
pacifiste. Œuvre de contrastes, entre héroïsme et apaisement, recueillement et
éclat, ironie presque caustique et ton de consolation, enthousiasme et
désespérance, son architecture est singulière. Elle mêle intimement trois
plans, distribuant les forces gigantesques qu'elle réclame : la Messe des
morts, en latin, confiée au grand chœur, à l'orchestre et à la soprano ; un
plan humain, compassionnel, dévolu aux deux solistes masculins, chantant les
poèmes de Wilfred Owen, sur l'horreur de la guerre, accompagné d'un orchestre
de chambre de douze musiciens ; enfin une strate ressortissant au surnaturel,
celui du chœur de garçons aux voix flûtées, comme dans l'opéra contemporain A Mdsummer Night's Dream, et de l'orgue. L'emploi distinct ou simultané de
ces divers éléments confère à l'œuvre une étonnante puissance évocatrice. Ainsi
du duo, à l'Agnus Dei, entre le ténor et le chœur, chantant respectivement en
anglais et en latin. Sans effacer le souvenir de la version d'origine, gravée
en 1963 par le compositeur et les solistes vocaux, pour la voix desquels
Britten avait écrit, la présente interprétation offre des atouts considérables.
A commencer par la direction inspirée d' Antonio Pappano qui sculpte une fresque sonore extrêmement dramatique, contrastant au maximum
la dynamique, n'hésitant pas à convoquer des pianissimos impalpables et
ménageant une adroite mise en perspective des divers masses sonores, aptes à
créer l'effet spatial, ici essentiel. On admire encore l'habileté à bâtir un
climat, notamment à travers les transitions : les deux derniers solos du ténor
et du baryton, au « Libera me », sur une pédale grave d'un vaste
orchestre assagi, évoquant le dernier interlude de Peter Grimes, avec
son allure fantomatique, sont saisissants. Son orchestre romain répond avec
efficacité : suprême raffinement, des bois en particulier, ou couleurs
volontairement crues, telle la stridence demandée aux cordes. Il en va de même
des chœurs, très disciplinés, et tant sollicités dans le registre du murmure là
aussi. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui trio de solistes plus
prestigieux que celui réuni pour cette captation de concert en juin dernier, à
Rome. Ian Bostridge est sans doute le seul parmi ses
pairs à approcher le timbre, particulier entre tous, de Peter Pears. Les
nuances dont il pare le récit du jeune soldat, la plénitude du registre piano,
la vigueur du mezzo forte, sont proprement inouïs, la beauté intrinsèque de la
voix étant en soi un objet d'émotion. Anna Netrebko,
comme son illustre devancière Galina VichnevskaÏa,
possède ce « ton » russe, lui aussi bien particulier, et cette
habileté à varier les divers registres sollicités du soprano, avec des écarts
véhéments, du grave assuré à l'extrême aigu filé. Enfin, Thomas Hampson, dans la partie conçue pour la voix et l'art de
Dietrich Fischer-Dieskau, fait assaut d'intensité, de violence contenue ou de
douleur asservie, là encore jusqu'au pur chuchotement.

Jean-Pierre Robert.
« Miroirs ».
Samuel BARBER : Adagio pour codes, op. 11. Johann Christoph BACH : Lamento « Ach dass ich Wassers genug hätte ». Dimitri
CHOSTAKOVITCH : symphonie de chambre, op. 110a. Nicolas BACRI : Lamento op. 81. Jean Sébastien BACH : Extrait de la cantate BWV 170. Malena Ernman, mezzo-soprano. Ensemble Matheus, dir. Jean-Christophe Spinozi.
1CD Universal DG : 481 0648. TT. : 53'56.
Ce CD se veut un jeu de miroirs entre des
musiques d'époques différentes, réunies autour de la même idée de déploration.
Le projet est né de la découverte par Jean-Christophe Spinozi,
il y a quelques années, d'une pièce en forme de lamento, de Jean-Christophe
Bach (1642-1703), cousin du père de Cantor. Saisi par sa puissance évocatrice,
mais aussi par sa modernité, il demanda au compositeur Nicolas Bacri (*1961) d'écrire une pièce de proportions identiques
et utilisant les mêmes instruments, en fait un sextuor de cordes. L'idée étant
de juxtaposer les deux morceaux. Et pour étoffer le propos, se fit jour celle
de leur adjoindre deux pièces instrumentales, conçues dans la même veine. Ainsi
furent choisis l'Adagio de Samuel Barber et la Symphonie de chambre de
Chostakovitch. Curieux assemblage, l'étrangeté venant encore du fait que les
pièces sont jouées dans une quasi continuité, ce qui
renforce l'impression de tristesse envahissante. A la pièce vocale recueillie
de Jean-Christophe Bach fait écho celle ingénieuse de Nicolas Bacri, toute autant versée dans une affliction sincère,
magnifiquement mise en valeur par le chant souverain de Malena Ernman et un beau substrat de cordes graves. Les deux
morceaux purement instrumentaux séduisent également, pour ne pas dire plus
encore, par leur profondeur de ton. L'adagio de Samuel Barber est le fruit
d'une transcription, par l'auteur, en 1936, du mouvement lent de son premier
Quatuor. La Symphonie de chambre de Chostakovitch, transcription pour orchestre
de cordes, par Rudolf Barchai, du Huitième Quatuor,
de 1960, déploie une atmosphère poignante, celle de Dresde dévastée, au fil de
cinq mouvements enchaînés dont le deux derniers marqués adagio. Dans ce
répertoire à la tonalité mélancolique, inattendue chez celui qu'on associe plus
à la vivacité de Vivaldi et de Rossini, Spinozi se
montre fort convaincant. Son Ensemble Matheus, mises
à part quelques stridences dans les cordes aiguës, apporte une profondeur de
ton certaine, qu'il agisse en large effectif ou en formation réduite, le chef
occupant alors la partie de violon solo. Un programme singulier, à écouter hors
période cafardeuse.

Jean-Pierre Robert.
Jean-Fery REBEL (1661-1747) & François REBEL
(1701-1775) : « Rebel de père en fils ».
Ensemble Les Surprises. 1 CD Ambronay Editions :
AMY303. TT : 72’32.
Comme à son habitude, le label Ambronay nous propose, ici, un très bel album, dans sa
réalisation, à la fois technique et musicale. Favorisant l’émergence de jeunes
musiciens, en résidence au Centre culturel de rencontre éponyme, par le
truchement de la collection « Jeunes Ensembles », voici le premier
disque de l’Ensemble Les Surprises, en référence à l’opéra ballet de Jean-Philippe
Rameau, Les Surprises de l’Amour. Un disque comme un hommage rendu au siècle
d’or de l’opéra français du XVIIIe siècle, encore bruissant de nombre de
partitions inédites et méconnues, de raretés musicales, fruits de recherches
musicologiques assidues. Héritier de Lully, Rebel père transmet savoir et
positions à son fils qui deviendra, à son tour, une personnalité de la vie
musicale française, auteur de nombreux opéras, en collaboration avec son
inséparable ami, François Francoeur. La production opératique, toutes formes
confondues, était très importante pour l’Académie Royale de Musique, près de
cent créations entre 1700 et 1750 ! D’où la nécessité pour favoriser la
diffusion de ces œuvres, d’en effectuer des transcriptions pour ensembles
instrumentaux plus réduits, permettant de les jouer en concerts privés à
Versailles ou dans les salons bourgeois. Ces opéras de salon constituent
précisément le programme de l'album, bâti à partir de trois opéras des Rebel
père & fils : Le Ballet de la
Paix (1738) Scanderberg (1735) et Le Prince de Noisy (1749) dont sont extraites différentes pièces,
aux climats variés, reflétant la diversité de l’opéra français, en même temps
que la curiosité et le talent de ce jeune ensemble qui nous livre là une
interprétation élégante et sans emphase, digne d’éloges, tant par sa qualité
instrumentale que par sa valeur vocale.
Une découverte, d’un répertoire et d’un ensemble musical, à ne pas
manquer ! Des talents à suivre…

Patrice Imbaud.
« Baroque
à Bossa ». Ensemble Les Sales Caractères. 1CD Indésens :
INDE052. TT : 53’41.
Un disque qui juxtapose de façon un peu
surprenante des œuvres appartenant à la musique italienne du XVIIIe siècle et
des œuvres populaires brésiliennes des années 50, issues de la Bossa Nova,
mêlant, avec bonheur, les accents jazzy nord américains aux rythmes syncopés du
Samba. Le pourquoi d’une telle juxtaposition ne parait pas évident de prime
abord, malgré quelques explications données dans le livret, dont on retiendra,
simplement, que la quête de l’amour constitue le fil conducteur commun aux deux
courants musicaux ! Peu importe ces considérations musicologiques, ce qui
parait particulièrement original est que toutes les pièces de cet
enregistrement sont jouées, avec une réelle réussite, par un instrumentarium de type baroque, associant flûte à bec,
cornet à bouquin (Rodrigo Calveyra), clavecin (Marie
Labrousse), archiluth et théorbe (Ronaldo Lopes) sur lequel vient planer la
superbe voix du contre ténor Christophe Laporte. Un disque à déguster comme une
friandise, un disque qui invite à la danse et surtout une magnifique occasion
de découvrir l’alto d’une admirable expressivité et d’une belle rondeur de
Christophe Laporte. Une découverte à suivre…

Patrice Imbaud.
Franz
SCHUBERT : Klavierstücke D 956. Sonate D 959. Impromptu D 899 N°3. Irina Lankova, piano. 1CD IndéSENS :
INDE056. TT : 79’.
Après Rachmaninov, Liszt, Scriabine,
Chopin, voici le nouvel opus de la jeune pianiste russe Irina Lankova, consacré, cette fois, à Schubert. Un magnifique
enregistrement comportant les trois Klavierstücke D.956,
la Sonate D.959 et l’Impromptu D.899 N°3, toutes œuvres de la
maturité, composées en 1827 et 1828, peu avant la mort du compositeur. Des
œuvres tardives chargées d’affect, toutes empreintes d’une nébuleuse mélancolie.
Irina Lankova nous invite, ici, à un voyage aux
confins de l’âme où le piano guidé par les souffrances intérieures sait se
faire à la fois témoin et confident. Une superbe interprétation, intériorisée,
contrastée et poétique, d’une grande sincérité, sans aucune affectation. Un
Schubert habité…Du grand art, assurément !
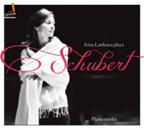
Patrice Imbaud.
CHOPIN : 24 préludes &
Sonate n° 2. Jean-Philippe Collard, piano.
1CD La dolce volta : LDV09. TT : 58’16.
Comme à son habitude le label La Dolce
Volta nous propose, ici, un superbe coffret où ramage et plumage sont en
parfaite adéquation. Une très belle présentation pour une remarquable prestation
musicale du pianiste Jean-Philippe Collard qui joue
les 24 Préludes op. 28 et la Sonate n° 2 Op. 35 « Marche
funèbre » de Frédéric Chopin. Une proximité entre Chopin et le
pianiste français existant depuis toujours, naguère houleuse du fait d’une timidité
à s’épancher, aujourd’hui apaisée par la maturité et la confiance dans la
manière d’aborder cette œuvre, peut-être de façon plus virile. Élève et
ami du grand Horowitz, Jean-Philippe Collard n’en a pas oublié les leçons dans la manière de
rechercher la sonorité idéale, la note bleue de Samson François, et le chant
profond et soutenu qui font de lui un virtuose du lyrisme en demi-teinte, de la
confidence vibrante et chaleureuse. Les Préludes, tous reliés par des tons voisins qui en font toute la cohésion et les rendent
indissociables, furent composés entre 1835 et 1839 lors de séjours à Majorque,
où Chopin tentait de soigner sa maladie, en compagnie de George Sand. Suite de
miniatures intimistes, ils sont abordés, ici, avec sincérité, sans effusion excessive,
sans rubato délétère, avec intégrité et respect du tempo. Un jeu d’une
admirable maturité, sans vaine virtuosité, contrasté, fait de l’alternance de
séquence joyeuse, légères ou ardentes (préludes impairs) et de séquences
empreintes de nostalgie, de désespoir et de souffrance (préludes pairs). S’y
associe la Sonate n° 2, bien
différente, composée entre 1837 et 1839, à Nohant. Une pièce passionnée,
profonde, virtuose, fluide voire impétueuse, chargée d’une noirceur lumineuse,
étonnamment moderne, en quatre mouvements dont la célèbre Marche funèbre, pour laquelle Jean-Philippe Collard nous livre une interprétation digne des plus grands ! Admirable !

Patrice Imbaud.
« Piano
des Lumières de Bach à Mozart ». Edna Stern, piano. 1CD Label Air Note.TT : 60’33.
Un album qui porte bien son nom tant cet
enregistrement parait lumineux… A la fois par la prise de son, intimiste, d’une
exceptionnelle présence, mais aussi par la qualité de l’interprétation toute en
ressenti, et le choix des œuvres, se situant à la lisière des mondes baroque et
classique : des pièces de Baldassare Galuppi,
J.S. Bach, Haydn, Mozart, C.P.E Bach. Un jeu pianistique d’une rare éloquence,
claire, limpide, léger et « cantabile » où le piano sonne
merveilleusement pour notre plus grand plaisir !

Patrice Imbaud.
Franz
LISZT. Frédéric CHOPIN. Richard WAGNER. Giuseppe VERDI. Pièces pour piano. Florence Delaage,
piano. 1CD Calliope Records : CAL1316. TT : 63’10.
Un
bien bel hommage rendu par Florence Delaage à Alfred
Cortot à l’occasion du cinquantième anniversaire de sa mort. Élève du Maître,
qui lui légua ses deux pianos, Florence Delaage a
appris l’art de mettre en valeur le discours musical. Ce disque magnifique en
est une preuve éclatante : un jeu contrasté, d’une exceptionnelle
expressivité où le piano tantôt orchestral, tantôt confident, rugit, gronde,
murmure ou chante. La Mort d’Isolde de Wagner, Deux Légendes d’une
étonnante modernité du Liszt de la maturité (1863) (Saint François d’Assise prêchant aux oiseaux, Saint François de Paule
marchant sur les flots), le Miserere paraphrasé par Liszt à partir du Trouvère de Verdi, et la Sonate n° 3 de
Chopin, autant d’œuvres aux climats bien différents parfaitement rendus par le
jeu fascinant de Florence Delaage. Superbe
interprétation, un son énorme ! Indispensable !

Patrice Imbaud.
GRANADOS.
PIAZOLLA. SCARLATTI. GINASTERA. MOMPOU. Duo Résonances. Frédérique Luzy & Pierre Bibault, guitares. 1CD
Calliope : CAL1317. TT : 64’57.
Un disque original qui ravira tous les
amateurs de guitare et bien d’autres… Qualité des œuvres choisies, qualité de
l’interprétation alliant virtuosité, musicalité et complicité, voilà qui
participe du fait que ce disque soit incontournable. Un disque charmant,
coloré, chargé d’émotion et d’états d’âme… Un réel plaisir d’écoute.
Remarquable !

Patrice Imbaud.
Jean Sébastiaen BACH & Astor PIAZZOLA : « Tête à tête ».
Duo Intermezzo : Sébastien Authemayou, bandonéon,
Marielle Gars, piano. 1CD IndéSENS : INDE054.
TT : 59’29.
Un enregistrement œcuménique réunissant
dans un syncrétisme passionnant deux musiciens, deux instruments, deux
compositeurs, deux cultures, classique et populaire. Au-delà de toute
considération savante faisant état des convergences existantes entre les deux
compositeurs, c’est d’un véritable plaisir d’écoute qu’il s’agit ! Un
disque qui réunit le corps et l’esprit, le dionysiaque et l’apollinien, le café
Zimmerman et les bas fond de Buenos aires, la Suite de danse et le Tango, dans
un discours enflammé et véhément d’une étonnante richesse. Un disque qui fait
pleurer et danser tout à la fois ! A écouter absolument !

Patrice Imbaud.
Philippe
HERSANT (*1948). Clair
Obscur. Christine Plubeau, viole de gambe. Ensemble vocal Sequenza 9.3, dir. Catherine Simonpietri. 1CD Universal Decca
: 481 0486. TT : 61’16.
Un disque de musique sacrée contemporaine
regroupant plusieurs œuvres du compositeur français Philippe Hersant. Une belle
opportunité pour découvrir une formation musicale rare, associant un chœur a capella et une viole de gambe. Quatre compositions sont
regroupées ici, écrites entre 1994 et 2008 : Stabat Mater (2002), pour 10 voix et viole de gambe, sur un texte
du XIIIe siècle de Jacopone da Todi,
œuvre originale où la viole de gambe joue véritablement un rôle de soliste
dialoguant avec les voix, pouvant, de ce fait, être considérée comme un
« concerto pour viole de gambe avec orchestre de voix ». Psaume 130, pour chœur de chambre, orgue
positif et viole de gambe, construit sur la traduction de Luther du Psaume De profundis clamavi. Falling Star (2005) composé sur des poèmes de
Henry King et John Donne, et Clair Obscur (2008), commande du festival d’Ambronay, composé à
partir de 7 poèmes allemands de l’époque baroque. Un enregistrement
particulièrement original exploitant toutes les possibilités expressives de la
viole de gambe et de la voix, associant l’ombre un peu nostalgique de la
première et la lumière de la seconde qui s’élève avec ferveur dans une immense
prière. On pourra retrouver Philippe Hersant, le 10 décembre prochain, en la
cathédrale Notre Dame-de-Paris, pour la création mondiale de sa dernière œuvre, Les Vêpres de la Vierge, donnée en
clôture de la saison célébrant le 850 ème anniversaire de la cathédrale.

Patrice Imbaud.
***
MUSIQUE ET CINEMA
Entretien avec Gilles Tinayre

© DR
Gilles Tinayre, est un compositeur, arrangeur et orchestrateur
prolixe. Après avoir beaucoup travaillé pour les autres, il a composé sous son
nom des musiques pour des génériques, des séries, des unitaires pour la
télévision, des publicités, des documentaires, des musiques de scène, des
comédies musicales et même des habillages musicaux pour des parcs à thèmes, des
parcs d’attractions.
Il est venu à
l'écriture pour le cinéma par les arrangements ou les orchestrations qu'il
réalisa pour « The Lair of the White
Worm » de Ken Russell, « Le
Bâtard de Dieu » de Christian Fechner, avec le London Philharmonic Orchestra. Après avoir écrit la musique de quelques films de moindre
importance, il co-composé la musique de « Chouchou », de Merzak Allouache, et participe à l'écriture musicale de
plusieurs longs-métrages en tant qu'arrangeur, « Les Parrains », « Iznogoud », ou en
tant que music-supervisor, « Mercenaire ». Il a écrit la musique du
film de Philippe Dajoux « La Belle Étoile », celles d'« Avant-Poste » d'Emmanuel Parraud, et de « La
Malette Rouge » de Bernard Mazauric.
Il a été
Président de l'Union des Compositeurs de Musique de Film (UCMF) et offre
beaucoup de son temps pour pédagogiquement mieux faire connaître la musique de
films surtout auprès des élèves des écoles de cinéma et des futurs compositeurs
de musique.
Quelle est votre actualité ?
Je viens de
finir de préparer un concert que nous allons donner pour le festival de cinéma
de Rueil organisé par Yves Alion,
le rédacteur en chef de l’Avant Scène Cinéma. Il y a là un but pédagogique. Au
cours de ce concert, l’Orchestre du Conservatoire, gonflé d'une soixantaine de
musiciens, jouera, en hommage à Francis Lai, ses grands thèmes sur des images
des films de Claude Lelouch.
Un travail pas évident, je suppose ?
L’art de la
musique de film est un art de synchronisation. Il faut que les ressorts
musicaux correspondent aux ressorts dramatiques, aux gestes, aux mouvements.
Donc la difficulté dans ce genre d’exercice est de trouver les bons rythmes,
car ces musiques et ces images n’étaient pas à priori faites pour fonctionner
ensemble. Ce qui est amusant c’est qu’on se rend compte de ce qu’est un vrai
couple de cinéma.
Francis Lai a le
même rythme que Claude, ce qui nous permet de trouver des correspondances, même
en décalant soit la musique soit l’image. Lai / Lelouch est un des plus vieux
couples de cinéma, près de cinquante ans je crois. C’est Pierre Barouh qui les avait présenté pour
« Un Homme et une Femme ».
Aviez-vous toutes les partitions pour faire cet
hommage ?
Il a fallu les
retrouver, réécrire à l’oreille certaines qui
n’existaient plus et puis les réaménager pour le concert. Francis Lai, ne les
trouvant plus, pensait que sa femme de ménage peut-être les avait mises à la
poubelle ! Ce travail a été un grand plaisir surtout parce que je travaillais
pour ce grand amoureux de cinéma et de musique qu’est Yves Alion.
Trouvez-vous cohérent qu'une revue de musique s’intéresse
à la musique de films, plutôt qu’une revue de cinéma ?
J'ai été
président de l’UCMF (Union des Compositeurs de Musique de Films) pendant trois
ans et depuis dix ans je me préoccupe de la pédagogie de la musique de films.
Pour moi, c’est tout à fait formidable qu’existe cette rubrique de musique de
films dans la revue l'Éducation musicale. Je suis ravi de savoir
qu’une revue de musique s’intéresse à la musique de films. Il y a une chose qui
m’a toujours étonnée avec les gens de cinéma : lorsqu'ils parlent d’un
compositeur, ils disent très rarement le compositeur mais le musicien. C’est
assez symptomatique de cette zone très floue qu’il peut y avoir dans le monde
du cinéma avec la musique. La musique ils en ont besoin, très souvent ils s’en
méfient. C’est quand même de tous les langages cinématographiques celui qui a
la puissance émotionnelle la plus forte. C’est vrai qu’on a tendance dans le
monde du cinéma à ne pas trop parler de la musique de films. C’était une de mes
préoccupations lorsque l’étais à l’UCMF. Je me suis aussi beaucoup occupé de
pédagogie, pour que dans les écoles de cinéma il y ait des possibilités de
toucher à la musique de films. On s’est tout de suite rendu compte qu’il y
avait beaucoup d’écoles de cinéma qui n’abordaient pas la musique de films.
Comment voulez-vous qu’un jeune réalisateur qui sort d’une école puisse savoir
utiliser la musique si on ne lui a pas appris à quoi elle sert ! Savoir
qu’elle peut sous-tendre une scène sans qu’elle soit trop présente, que ce
n’est pas forcément que la chanson de Lara avec 120 musiciens, que c’est aussi
un tendeur, un détendeur d’images, un noircisseur d’émotion, qu’elle peut
donner un éclairage positif d’une scène… On a commencé à mettre des choses dans
les écoles de cinéma et puis aussi dans les écoles de musique. Il y a une sorte
d’élitisme dans les conservatoires vis à vis de la musique classique. Souvent,
la musique de films est pour eux de la musique vulgaire, de la sous musique.
Jusqu’à ce qu’enfin, le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris
crée, l’année dernière, une classe de composition de musique de films, et là
tout a changé.
Donc il va y avoir une génération de compositeurs
formés par le Conservatoire.
Avant, il n’y
avait pas de formation. On sait qu’Antoine Duhamel, grand compositeur
dodécaphoniste a décidé de faire de la musique de film lorsqu'il a entendu qu'Herrmann avait écrit de la musique dissonante. Je ne pense pas qu’on puisse apprendre à
faire de la musique de films. Les grands compositeurs ont avant tout le plaisir
de voir une image, de voir un récit cinématographique. Avoir le sens de l’image
cela ne s’apprend pas. Par contre, en apprenant, on peut faire gagner du temps, empêcher de faire des bêtises. C’est là qu’intervient
la pédagogie de la musique de films. Pour les réalisateurs on peut leur ouvrir
l’oreille, leur faire prendre conscience de ce qu'est la musique de films, leur
faire mieux comprendre, et mieux savoir s'en servir.
Vous avez eu une expérience intéressante avec le
film muet de Dziga Vertov « L’homme à la Caméra » ?
J’ai écrit une
musique pour fanfare des Balkans, chœur mixte et chœur d’enfants. On a fait des
concerts projection dans plusieurs villes de France et on continue.
Ce film, cet « l’œil caméra », est un des
piliers de l’histoire du cinéma. Y
avait-il un challenge énorme à composer de la musique sur ces images ?
Le challenge est
en effet énorme car Pierre Henry avait déjà fait une musique, ainsi que Michael Nyman. C’est un film incroyablement tentateur pour un
compositeur. Il est tellement rythmique qu’on meurt d’envie d’y poser une
musique. J’y ai travaillé pendant un an, il fallait être très précis, être
« cut au plan ». Sur You tube on peut
écouter les différentes versions et c’est très intéressant. Je le fais voir
pour les master classes et montre comment sur un film
muet on peut avoir des points de vue musicaux différents. La musique imprime
dans l’œil du spectateur des visions extrêmement fortes. Elle peut être
dangereuse car elle peut complètement détruire un film. Il y a eu des expériences
désastreuses dans l’histoire du cinéma. Il y a eu des compositeurs très
célèbres dont la musique a été refusée au dernier moment avec des résultats
catastrophiques. Gabriel Yared, oscarisé,
a vu son score refusé pour « Troy », par exemple, et remplacé par
James Horner au dernier moment, qui n'a pu faire
qu’une musique très médiocre. Celle de Yared est
pourtant superbe (on peut l’entendre sur You tube).
Il y a de nombreux compositeurs qui ne font pas les
arrangements, les orchestrations : n’est-ce pas curieux de leur attribuer la
paternité des musiques ?
Les compositeurs
ont toujours eu des assistants. En musique classique c'est un tabou. Il y a
quelques compositeurs de musique de films qui écrivent tout. Ennio Morricone ne
supporte pas de ne pas tout écrire ; pour lui le contraire est une hérésie. Il
ne supporte pas ces compositeurs qui fredonnent un thème et qui sont arrangés
par d’autres. Ces compositeurs qui font cinq à huit musiques par an, n'ont
matériellement pas le temps de tout formaliser. J'ai fait plusieurs
arrangements pour des compositeurs très connus. J'ai eu la chance de faire mes
classes d'écriture et de savoir écrire pour un orchestre, mais il m'est arrivé
plusieurs fois d'avoir à faire des réductions d'orchestre et, là, j'ai confié
le travail à un orchestrateur. Un arrangeur c'est celui qui amène une idée
créative dans le projet musical. L'orchestrateur, lui, c'est quelqu'un qui
adapte la base d'orchestration qui est fournie par le compositeur. Les
arrangeurs déclarés ont une part de droit d'auteur à la SACEM, 1/12ème. Mais ce
qui compte c'est le résultat. Aux États-Unis il y a énormément de gens qui
travaillent pour un compositeur et cela donne une musique formatée qui plait
aux producteurs.
Lorsqu'on regarde les génériques des films français
on s'aperçoit qu'il y a de nombreux compositeurs dont on ne connaît ni le nom
ni ce qu'ils ont fait. Peut-on vivre en tant que compositeur de musique de
films?
Je pense
que oui, car quand on parle de musique de films, on pense plus fiction pour le
cinéma. Ce n'est qu'un tiers de la musique car il y a le documentaire, le
reportage, la fiction télé, les séries...Il y a des gens qui gagnent bien leur
vie en composant pour l'image ou même pour la variété. Mais ils n'ont pas la
notoriété du compositeur de cinéma, et encore faut-il que le film soit un
succès. Le public connaît peu les compositeurs. Le seul, à Cannes, à qui on a
fait un triomphe en montant les marches, c'est Morricone. John Powell, pour la
projection de « Xmen » était derrière
l'équipe du film et personne ne faisait attention à lui, alors que c'est un
grand compositeur (Antz, Volte Face, Shrek, Bourne Identity,
Hancock, Ice Age....). Il y a quand même un point
positif, c'est que le public adore la musique de films, et les concerts sont toujours
très appréciés. On ne peut pas en dire autant pour les concerts de musique
classique.
En
complément Gilles Tinayre nous autorise à publier un
texte qu' il a écrit pour l’Avant Scène n°580 sur la
musique classique et originale autour des choix emblématiques qu'a fait Stanley
Kubrick pour « 2001 Odyssée de l'Espace »
2001, Odyssée lyrique…
« Noir
sidéral… Ré ré fa# la la…,
la la…, fa# fa#..., Le beau Danube bleu, aimable
pièce à faire tournoyer les couples et vaciller les femmes, est ici presque
méconnaissable, revisitée par Karajan qui ‘’malhérise’’
l’œuvre à outrance... Pour nous livrer une interprétation ralentie,
intériorisée, à contre-courant de la définition première voulue par Johann
Strauss, qui n’en demandait certainement » pas tant… Pourtant, il s’agit
bien d’une valse, qui garde ô combien son poids de sens premier – succès oblige
- celui d’une danse, à ranger au rayon des musiques ludiques et futiles. Et qui
vient puissamment frapper nos sens de spectateurs, lorsqu’elle est, dans
« 2001 », associée aux images hyper technologiques des engins
cosmiques cheminant dans l’astral. Un cocktail plutôt pernicieux qui fait
vaciller l’image de l’omnipuissance du contrôle de l’homme sur ses joujoux
technologiques. Formidable opposition entre l’ouïe et l’œil, la première se
berçant de ce que le deuxième ne saurait admettre…Une combinazione chère à Kubrick, dont on sait qu’il n’accordait que peu d’importance aux mots,
mais une attention extrême au choix des sons et des musiques de ses films.
Pourtant, tout au long de sa période glorieuse, de 2001 (1968) à Shining (1980), il n’utilisera aucune musique
originale dans ses films. Tout sera affaire de musiques préexistantes dont les
choix, longuement maturés, jamais gratuits et souvent iconoclastes, sont à
l’évidence l’une des plus grandes réussites de l’œuvre de Kubrick.
Retour en
arrière : lorsque Kubrick et Arthur C.Clarke travaillent à l’écriture du scénario, ils se bercent des célèbres
« Carmina Burana » du compositeur Carl
Orff. Au point de songer tous deux à proposer au compositeur d’écrire la
musique de « 2001 ». Mais celui-ci a 72 ans, et l’idée est
abandonnée. En 1968, ils contacteront également les Pink Floyd, mais ceux-ci refuseront d’écrire la musique (Ils composeront pourtant en
1969 la bande originale du film « More », de Barbet Schroeder. Roger
Waters dira quelques années plus tard qu’il regrettait amèrement de ne pas
avoir accepté l’offre de Kubrick. Le temps passe, le tournage commence, et les
premiers rushes sont montrés à la MGM accompagnés de « temp tracks » (musiques temporairement posées sur
l’image) de Mendelssohn (le scherzo du Songe d’une nuit d’été) et du
compositeur Vaughan Williams. On engagera même peu après un compositeur, Franck Cordell, pour enregistrer quelques extraits de la 3ème symphonie de Mahler dont on pensait avoir besoin. Pour finalement en abandonner
le choix.
Au fur et à
mesure du tournage et des previews à la production,
Kubrick habille ses rushs d’autres temp tracks : Ainsi parlait Zarathoustra, de Richard
Strauss, Atmosphères, Lux Aeterna et le Kyrie du Requiem de György Ligeti,
ainsi qu’ un extrait du ballet Gayaneh d’Aram Khatchaturian. Et finit par avouer à la MGM
qu’il souhaitait utiliser définitivement ces musiques pour 2001. Ce n’était pas
du tout du goût des producteurs, qui demandèrent alors à Alex North de composer la musique. Ce dernier, qui avait signé
le score de « Cléopâtre »
et avait déjà travaillé pour Kubrick en écrivant la musique de « Spartacus », fut enchanté à l’idée
de collaborer de nouveau avec lui. Néanmoins, « imposé » par la
production, qui n’agissait ainsi que pour des raisons de marketing, il eut du
mal à faire admettre à Kubrick qu’il était temps d’abandonner les choix
temporaires auxquels celui-ci tenait tant. Alex North mit donc un soin tout particulier à garder dans son écriture les fondamentaux
présents dans les musiques préexistantes choisies par le réalisateur. Installé
à Londres, muré dans un appartement de Chelsea, travaillant d’arrache-pied
malgré de graves problèmes de santé pendant plusieurs semaines de l’hiver 1967,
il écrivit quarante minutes de musique qu’on enregistra début février dans des
conditions très difficiles, Alex North devant se
rendre au studio chaque jour en ambulance. Kubrick semblait satisfait du
résultat…A son retour aux États-Unis, Alex North pensait néanmoins que « tout ce qu’il avait écrit pour remplacer Ainsi
parlait Zarathoustra ne pourrait pas satisfaire Kubrick ». Le résultat
fût pire que tout ce qu’il avait imaginé : lors de la projection en
avant-première à New-Yorkais le 1er avril ( !) 1968, pas une de
ses musiques ne figurait dans la bande originale du film…Au-delà de l’anecdote,
et du terrible camouflet infligé par Kubrick au célèbre compositeur, il faut se
pencher sur les raisons qui ont présidé au maintien des choix premiers du
réalisateur et aux vertus qui, incontestablement, en découlent. Dès la
conception de « 2001 »,
Kubrick voulait « que le film soit une expérience intensément suggestive
qui ramène le spectateur à un niveau plus intérieur de connaissance, justement
comme le fait la musique. ». Et la musique, il connaît… Dans son excellente
étude sur la musique dans l’œuvre de Kubrick, Damien Deshayes rapporte que ‘’dans l’âme, Kubrick était autant un musicien qu’un cinéaste’’.
Il est un fait que dans « 2001 »,
à aucun moment le rôle de la musique n’est innocent, qu’elle y est
systématiquement génératrice de sens. En osmose avec l’opinion de Michel
Ciment, « Un cinéma qui ne s’adresse à l’intellect que par le détour de la
sensation, au conscient qu’après avoir mobilisé le subconscient ».
Les raisons qui
ont conduit Kubrick à utiliser telle ou telle musique reste un mystère… Il semble que les choix du réalisateur découlent non tant d’une
analyse techniquement élaborée que d’une recherche très personnelle d’affect,
transmis, confié ensuite à celui du spectateur. Le film est construit comme un
opéra. Séquences très longues, montées comme les tableaux d’une œuvre lyrique.
Avec une (incroyable) ouverture, 2:50 de noir intégral avec Atmosphères de
Ligeti, et un entracte de 2:20, identique dans sa forme. Et de très nombreuses
plages de silence.
Trois ‘’blocs’’
d’essence et de style différents constituent la bande musicale du film : Ainsi
parlait Zarathoustra, de Richard Strauss, dirigé par Karl Böhm, est le
premier. Un deuxième bloc, qui réunit les musiques de György Ligeti, Atmosphères, Lux Aeterna et Requiem.
Et un troisième, formé d’un extrait de la suite de ballet Gayaneh d’Aram Katchaturian,
dirigé par Guennadi Rozhdestvensky, et du Beau
Danube bleu dont j’ai déjà parlé. Dès les premières images (l’alignement
des planètes et du soleil), apparaît Ainsi parlait Zarathoustra. On a
beaucoup écrit sur les raisons de ce choix. Je retiendrai que Zarathoustra
avait tout pour aiguiser l’intérêt de Kubrick : son sous-titre, l’ « énigme
du monde », et la note de Richard Strauss qui y est associée, « nous
avons été trop longtemps somnambules. Désormais, nous voulons rester bien
éveillés… », la doctrine nietzschéenne (l’homme
doit se dépasser pour devenir surhomme et tuer Dieu), la grandiloquence proche
de Carl Orff, dont il avait choisi la musique au départ, la puissance
symbolique de son écriture (en Do majeur, tonalité la plus basique qui soit,
trois notes ascendantes sur les degrés fondamentaux de la gamme – tonique do,
dominante sol, tonique do, sa puissance dramaturgique, et on ne le dit pas
assez, la notoriété de l’œuvre auprès du public). Tout était réuni pour faire
vibrer la corde sensible du réalisateur. On retrouvera notamment Zarathoustra
sur la scène de la découverte de l’outil chez les primates, avec de belles et
intéressantes relations cut au plan entre image et
temps forts musicaux.
Plus
conventionnelles sont les utilisations faites des musiques de Ligeti, qui par
leur texture atonale et arythmique, sont en rapport direct avec les séquences
qu’elles habillent, avec pour objectif
d’intensifier la perte des repères du spectateur.
Le troisième
bloc est plus surprenant : Gayaneh, comme Le Beau Danube bleu, remplissent à priori le même premier
objectif, celui de « lisser » l’image d’un point de vue esthétique, mais
le rapprochement s’arrête là. Car Le Beau Danube bleu va rajouter de
toutes autres dimensions suivant les espaces que l’œuvre habille. Dans la
première des séquences dans laquelle elle est utilisée, qui relie les plans des
engins spatiaux dans l’astral, c’est un rôle « perturbateur »
qu’elle endosse, pour les raisons évoquées en début de cet article. Pour la
deuxième séquence où elle apparaît, Kubrick va faire jouer à notre mental un
drôle de tour de passe-passe en transformant cette première mission musicale en
un tout autre exercice : après quelques plans sidéraux, intérieur vaisseau
- travail de l’hôtesse ; sans aucune pause, la musique endosse alors le rôle
des pires « musiques d’ascenseur », habillage sonore habituel des musiques
pour lieux publics. Et ajoute une note d’humour d’un type tout différent, alors
même que la musique n’a pas changé…
Ce diable
d’homme qu’est Kubrick est sans doute l’un des seuls à savoir jouer avec autant
de brio ce genre de carte dans ses films. Et cette intelligence musicale
devrait servir de modèle à bien des compositeurs en mal d’inspiration…
Au fait, pour
quelle invraisemblable raison Le Beau Danube bleu est-il arrivé sur le
film ? C’est Andrew Birkin, qui était à l’époque coursier pour la
production, qui le raconte : pendant le visionnage de rushes d’effets
spéciaux, Kubrick, qui s’ennuyait ferme, entend, venant de la cabine du
projectionniste, la valse de Strauss, que le technicien était vraisemblablement
en train de recopier, pour habiller les bandes son d’attente des cérémonies
d’avant-première. Un autre jour, alors
que l’on visionne un plan de vaisseau spatial, la même musique se fait
entendre. Kubrick s’adresse alors à ses proches et dit : « ce serait
une folie ou une idée de génie de mettre cette musique dans le
film ? »
C’était une idée de génie… ! »
A noter que
Ligeti n’était pas du tout heureux de la façon dont sa musique a été utilisée
dans le film, jusqu’à intenter un procès à la MGM.
Pour en savoir plus :
Polydor n° 831 068-2

Varese Sarabande n°VSD 5400
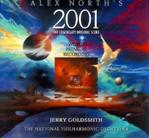
John Baxter
« Stanley Kubrick » au Seuil

Michel Chion « La
Musique au Cinéma » Fayard

Damien Deshayes « La musique dans l’œuvre de Stanley Kubrick »; En ligne sur www.damiendeshayes.fr
Stéphane Loison.
BO EN CDS
THE FOUR HORSEMEN OF THE APOCALYPSE : Réalisateur Vincente Minnelli. Compositeur André Prévin.
1 CD Hallmark n°713872
En 1961,
Minnelli fait le remake du livre d’Ibanez après le
chef d’œuvre réalisé par Rex Ingram avec Rudolph Valentino en 1927. Il déplace
l’action au cours de la seconde guerre mondiale. Le drame s’installe entre les
deux branches d’une famille, l’une française, l’autre allemande dont est issue
une famille argentine,
André Prévin est né à Berlin le 6 avril 1929. Il est le fils d’un
chef d’orchestre. Avec sa famille, il émigre aux États-Unis en 1938 pour
échapper aux nazis. Il devient citoyen américain en 1943 et travaille pendant
des années à partir de 1948 pour la MGM sous la direction de Miklos Rosza. Il adapte et dirige
la musique pour des films comme « Gigi »,
« Porgy and Bess »,
« My Fair Lady »,
« Irma la Douce », et
reçoit des Oscars pour son travail. Parallèlement à la composition, il
enregistre comme pianiste de jazz avec Shelly Manne, conduit des orchestres
symphoniques aussi célèbres que celui de Londres, de Los Angeles. Après ses
années hollywoodiennes, il se concentre plus sur la musique classique et la
direction d’orchestre. On lui doit des concertos et un opéra « Un Tramway
Nommé Désir » créé en 1998.
C’est dès 1946
que Minnelli et Prévin travailleront ensemble et sur
plusieurs films jusqu’en 1964. C’est dans des partitions dramatiques aux
antipodes des conventions de la comédie musicale, comme celle des « Quatre Cavaliers de l’Apocalypse »,
que Prévin a trouvé ses meilleures idées et exprime
le mieux son tempérament musical. Dans cette partition on sent ses
préoccupations qu’il pourra développer dans ses concertos pour violon, piano,
violoncelle et surtout dans son opéra. Il met en soliste soit le violon, soit
le violoncelle, augmentant ainsi la solitude des personnages et leurs attitudes
face à la tragédie qui se passe autour d’eux. Cette réédition nous fait
réentendre la richesse harmonique de cette musique pour l’image.
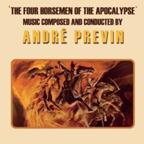
LES DIX COMMANDEMENTS. Réalisateur Cecil B.DeMille. Compositeur Elmer Bernstein. 1CD Milan Music
399 524 - 2
À l’occasion de
la reprise du film de Cecil B. DeMille « Les Dix Commandements » par Swashbuckler,
les éditions Milan Music éditent la bande originale du film composée par Elmer
Bernstein. C'est peut-être une des plus célèbre BO de ce compositeur prolixe
avec bien sûr celle des « Sept Mercenaires » et de « La Grande
Evasion »
Après avoir été
travaillé avec Aaron Copland, Elmer Bernstein débuta sa carrière à la
télévision, à la radio et au théâtre au début des années 50. C'est un des
premiers qui avec « L'Homme aux Bras D'Or » d'Otto Preminger, a
introduit le jazz comme élément moteur dans un film et non plus comme une
musique fonctionnelle. Deux ans plus tard, Louis Malle demandera à Miles Davis
d'écrire la musique d'« Ascenseur Pour L'Echafaud ».
En 1956, dans un
style orchestral radicalement différent, Cecil B De Mille lui confie la tâche
titanesque de mettre en musique « Les Dix Commandements ». Il lui demande :
« Pensez-vous que vous pourriez
faire pour la musique de film la même chose que Puccini a fait pour
l’opéra ? ». Elmer Bernstein lui répond « Je ne peux pas en être sûr mais je voudrais bien essayer ». Le
jugement final du réalisateur fut le suivant : « Votre musique va sûrement me survivre et
peut-être même à vous même ». Cecil B De Mille avait vu juste. Elmer
Bernstein écrira près de 250 musiques, passant du western, au drame, au polar,
à la comédie, avec autant d'aisance et de talent. Le seul Oscar de sa carrière
fut en 1968 pour « Millie » de
George Roy Hill. On lui doit les musiques de « SOS Fantômes » et cinq autres films de John Landis aussi bien que « Les Nerfs à Vif » le remake de Scorcese,
un avec un bel hommage à son ami Herrmann qui avait
écrit la partition de celui réalisé par J. Lee Thompson en 1962. Sa dernière
partition est une des plus belles qu'il a écrites pour le magnifique mélo de
Todd Haynes, « Loin Du Paradis » en 2002.
Elmer Bernstein disparaît des écrans le 18 aout 2004.
« Les Dix Commandements » est un des
plus spectaculaires et grandioses péplum. Il raconte la libération des Hébreux
esclaves en Égypte. Le scénario est fidèle aux Écritures mais rajoute beaucoup
d’éléments : « le devoir de tout dramaturge est de remplir les lacunes entre
les faits » déclarait DeMille. Il avait déjà tourné une version des « Dix Commandements » en 1923. Il
récidive trente ans plus tard pour une version démesurée : sept mois de
tournage, cent mille accessoires, des chameaux venus d'Australie, des lotus
cueillis en Guinée britannique...Pour la BO, Elmer Bernstein composa, pour un
orchestre symphonique, des thèmes très mélodiques et rythmés. Pour les motifs
principaux, il utilisa la technique du leitmotiv. Il eut également recours à de
nombreux instruments égyptiens, tiple (petite
guitare), cymbales et sistre (tambourin sacré), et à des instruments
hébreux : shofar (corne de bélier rituelle), xylophone (pendant la
bacchanale de la fonte du veau d’or). À de nombreuses reprises, le film met en
scène des musiciens en arrière-plan : pour cette musique Bernstein utilise
la formation : harpe, flûte, sistre, tiple.
Peu de jeunes
compositeurs aujourd'hui savent écrire, ou en ont les moyens, pour le cinéma de
cette façon. On peut le regretter. Alors écoutez cette BO, je vous la
recommande par dix !

EXODUS : Réalisateur Otto
Preminger. Compositeur Ernest Gold. 1 CD Milan Music 399 525-2
Récompensée en
1961 par un Oscar, et un Grammy Award de la meilleure chanson et de la meilleure bande originale, cette musique de Ernest Gold est toujours agréable à écouter et cette
réédition en CD est une bonne idée. Dalton Trumbo, le
célèbre scénariste blacklisté par la commission
McCarthy, et que Kirk Douglas a osé mettre au générique de « Spartacus », a fait l’adaptation d’un roman de Leon Uris. En 1947, plusieurs centaines de rescapés de
l’Holocauste désirent à tout prix rejoindre la Palestine. Après un voyage
mouvementé sur un vieux rafiot, l’Exodus, ils débarquent enfin sur cette terre
promise où d’autres dangers les attendent, c’est le prix de la liberté. La
sortie de ces deux CD chez Milan est peut-être une coïncidence, mais raconte un
périple semblable. Est-ce un hasard si à quelques années d’intervalle avec
celle de Bernstein, cette musique a un air de péplum ? Ernest Gold était
sûrement concerné par cette histoire du fait de ses origines. C’est à l’âge de
17 ans qu’il arrive aux États-Unis, fuyant Vienne et la monté du nazisme. Comme
Preminger, il est un émigré juif. Entre 1947 et 1999, date de son décès, il a écrit
une centaine de musiques pour la télévision et le cinéma. Exodus est sa
composition la plus célèbre. Le succès du film doit beaucoup au lyrisme de
cette musique, nourrie d’inspirations ethniques, juives et arabes, passées aux
fourches caudines hollywoodiennes comme savait le faire les compositeurs de
studios des années cinquante.

CARTEL : Réalisateur
Ridley Scott. Compositeur Daniel Pemberton. 1CD Milan
Records / 20th Century Fox n° 399522-2
Cartel est la descente aux enfers d’un avocat pénal, attiré
par l’excitation, le danger et l’argent facile du trafic de drogues à la
frontière américano-mexicaine. Il découvre qu’une décision trop vite prise peut
le faire plonger dans une spirale infernale, aux conséquences fatales. C’est en
voyant « Awakening », film d’horreur de 2011,
réalisé par Nick Murphy, que Ridley Scott a voulu travailler avec Daniel Pemberton. Ce compositeur est surtout connu pour avoir
écrit pour la télévision et pour des jeux vidéo. Il a été plusieurs fois
récompensé. Il a composé pour quelques longs-métrages, inconnus en France, et
ses musiques n’ont pas été éditées. Les compositeurs employés par Ridley Scott
ont eu de grands succès musicaux avec ce réalisateur. Goldsmith et « Alien », un pur chef d’œuvre, Vangelis avec « Blade Runner », et « 1942 », toujours appréciées et
éditées, « Gladiator » de Zimmer, un succès mondial. Hans Zimmer a commencé très tôt avec Scott, puis son assistant
Marc Streitenfeld a pris la relève et a travaillé sur
des films très moyens de ce réalisateur. Sa musique est très influencée par Zimmer. Pour « Prometheus » elle est loin d’avoir la patte de
Goldsmith sur le même sujet. La musique de Daniel Pemberton pour « Cartel » est une belle surprise, au cours du film et à
l’écoute du CD. Si le film est raté, la musique, elle, arrive à sauver quelques
scènes. La guitare est très présente dans les différents morceaux aux accents
mexicains. Les personnages nous laissent totalement indifférent à ce qu’ils
vivent. C’est souvent la musique qui apporte la dramatisation nécessaire à
l’action. Donc le CD oui, le film non.

IN MY LIFETIME. Réalisateur Robert E.Frye.
Compositeur Alain Kremski. 1 CD Cézame CEO 2013.
Né à Paris
en 1939, et après de brillantes études, encouragé par de nombreuses
personnalités (Igor Stravinski, Nadia Boulanger, Darius Milhaud, Olivier
Messiaen), Alain Kremski remporte le Premier Grand
Prix de Rome de composition à 22 ans, puis séjourne trois ans à la Villa
Médicis, où il se lie d'amitié avec le peintre Balthus, qui lui communique sa
passion pour la peinture, la sculpture, la littérature et les voyages…Il
délaisse les chemins d’une carrière toute tracée pour explorer l'univers
mystique des sons des cloches de temples, gongs, bols bouddhiques (Japon,
Chine) et bols chantants (Tibet, Népal). Son album
« Résonance/Mouvements », pour piano, percussions, bols et gongs,
regroupe des œuvres écrites pour le ballet. Il compose et interprète la musique
originale du documentaire « In My Lifetime », réalisé
par Robert E. Frye. Ce documentaire
raconte 65 ans de menaces nucléaires et comment trouver une solution pour réduire le nombre d’armes nucléaires dans le monde. La
musique de Kremski est très influencée par la musique
orientale, même si on reconnaît la patte d’un compositeur de musique
contemporaine. La Sacem vient de lui décerner
le Grand Prix de la Musique symphonique et le distingue pour l'ensemble de sa
carrière.
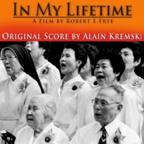
Stéphane Loison.
JOE HISAISHI, Compositeur

© DR
Arte a eu la bonne idée
de passer quelques films d'animation de Hayao Miyazaki dont les musiques sont de Joe Hisaishi. On
peut écouter avec bonheur sur plusieurs CD les musiques de ce compositeur qui a
aussi travaillé avec Takeshi Kitano.
Il en sera le collaborateur pendant plus de dix ans. Né en 1950, à Nagano, de
son vrai nom Mamoru Fujisawa, diplômé du Kunitachi College of Music, il
s'est fait connaître en composant des musiques pour des dessins animés. Artiste
complet, il a écrit des livres et réalisé des films dont il a composé la
musique. Dès 1984 il compose pour Miyazaki. On lui doit la superbe musique de
« Princesse Mononoké »,
celles de « Le Voyage de Chihiro », de « Porco Roso », « Le Chateau Ambulant »… En France, il
a composé pour Olivier Dahan, « Le Petit Poucet ». Sa musique est
assez simple, limpide, classique dans la forme, très reconnaissable dans sa
structure harmonique, avec des thèmes faciles à retenir. Elle colle
parfaitement au style d'animation de Miyazaki et apporte autant de couleurs que
les images de ce maître du dessin animé. C’est un amateur passionné de la
musique française de la fin du XIXème et du début du XXème siècle et cela se
sent dans le développement de ses mélodies. Pour « Porco Roso », il s'est inspiré de la
musique italienne et s’amuse à faire des clins d'œil du côté de Nino Rota. En
2013, il travaille aussi pour un autre réalisateur de dessins animés, Isaho Takahaka. En 2011, il est
venu à Paris pour un concert caritatif après le Tsunami qui a frappé son pays.
Il a été le premier directeur musical du World Dream Orchestra. Il y dirige des concerts de musiques de films et sa propre
composition classique. On trouve de nombreux CD de ses BO. La musique de
« Princesse Mononoke »
est une pure merveille, envoûtante, poétique, magique à souhait. Milan music
propose plusieurs compilations intéressantes dont une avec les musiques des
films de Kitano dont l’univers musical est bien loin
de celui de Miyazaki.
Milan 399
055-2

Milan 198
496-2

Milan 198 417-2
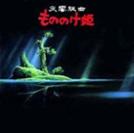
CONCERTS
Au Grand Rex à Paris, le 10
janvier 2014, L’Union des Compositeurs de Musiques de Films
présente, pour fêter ses 10 ans, un
concert exceptionnel : le BO CONCERT, Au cœur de la
musique de film française.

Dans le cadre des évènements liés à ses 10 ans, outre un concours de
composition à l’image, une série de master-classes et de rencontres
professionnelles, l’UCMF a porté tous ses efforts pour produire un prestigieux
concert : Le « B.O. » Concert, réunissant ce que la musique de film
française représente de noble et prometteur. Un orchestre symphonique
interprète pendant près de 2h30, 25 partitions de ces bandes originales,
empreintes d’imaginaire, qui ont fait le tour du monde et marqué la mémoire du
cinéma. Fidèle soutien et ami de l’association, Patrick Doyle est l’invité
international de ce concert exceptionnel.
Programme :
Jean-Michel Bernard et La Science des Rêves, de Michel Gondry
Claude Bolling et Borsalino de Jacques Deray
Ludovic Bource et The Artist, de Michel Hazanavicius
Bruno Coulais et Microcosmos, de Marie Pérennou et Claude Nuridsany
Alexandre Desplat et La
Jeune Fille à la perle, de Peter Webber
Antoine Duhamel et Ridicule, de Patrice Leconte
Francis Lai et Love Story, d’Arthur Hiller
Jean-Claude Petit et Le Hussard sur le toit, de Jean-Paul Rappeneau
Philippe Rombi et Joyeux
Noël, de Christian Carion
Eric Serra et Arthur et les Minimoys, de Luc Besson
Gabriel Yared et Camille Claudel, de Bruno Nuytten
Patrick Doyle et Indochine de Régis Wargnier
La comédienne Anouk Aimée (« Un Homme et une femme ») est la
marraine du concert.
Le concert est en trois
parties :
-
La première partie consacre des morceaux choisis
des grands maîtres et talents reconnus de la musique de film française,
-
La seconde partie présente un bouquet choisi de
compositeurs français membres de l’UCMF, et rend hommage à la présidence de
l’association depuis ses débuts.
-
Enfin, la partition du gagnant du concours de
composition lancé par l’UCMF (de septembre 2012 à septembre 2013) pour ses 10
ans dera présentée et son auteur félicité sur scène.
Stéphane Loison.
***
JEUNESSE ET MUSIQUE
Emilie
Collet (auteur), Sophie Rohrbach (ill.). Mon tout premier xylophone. Gründ.
Livre avec xylophone. Dès 3 ans. 12,95 €.
Un grand livre cartonné qui présente aux
tout-petits les plus célèbres chansons illustrées avec humour : Pomme de reinette et pomme d'api, Dans la forêt lointaine, Pirouette cacahuète, Les petits poissons dans l'eau, Dodo l'enfant do, Bateau sur l'eau. Pour chacune d'elles, des notes en couleurs
indiquent à l'enfant comment jouer la mélodie sur le xylophone qui accompagne
le livre. Une découverte musicale bien active.

Antoine Sahler, Lucrèce Sassella,
Juliette et François Morel. La tête de l'emploi. Actes
sud Junior. Livre-CD. Dès 5 ans. 22 €.
Un livre à offrir absolument ! Un
ouvrage plein de bonne humeur, d'humour et de réalisme sur la vie de quartier.
Notre héros a reçu un appareil photo pour son anniversaire et décide de faire
un reportage sur les habitants de sa rue et leurs métiers. Et c'est ainsi que
l'on découvre un gros fromager, un couple de maraîchers braillard, une jolie
infirmière, un garagiste timide, un sans emploi... Récit et chansons se mêlent
à la perfection et les illustrations d'Aki, vives et
délirantes, illuminent le tout !

Ana
Gerhard (auteure), Cécilia Varela (ill.). Le chant des oiseaux. La montagne
secrète. Livre-CD. Dès 7 ans. 16,95 €.
Un bijou d'une grande originalité pour
initier à la musique classique en utilisant le thème du chant des oiseaux. En
effet, la beauté de leurs chants nous intrigue et nous inspire depuis toujours.
L'auteur aborde ici une vaste sélection de compositeurs issus de toutes les
époques (Mozart, Tchaïkovski, Vivaldi...) et traite différents genres de
musique (musique de chambre, ballet, opéra...). Chaque extrait s'accompagne
d'une rapide description de l'oiseau évoqué par le compositeur, d'une petite
biographie de celui-ci, d'une explication simple et pédagogue et d'un glossaire
expliquant les termes musicaux.

Florence Noiville (auteure), Louis Dunoyer de Segonzac
(compositeur), Philippe Dumas (ill.). Le vieil homme et
la perle. Gallimard Jeunesse. Livre-CD. Dès 6 ans. 24 €.
Un récit tendre et nostalgique qui
interroge les jeunes auditeurs sur le temps qui passe et les rêves perdus. Le
vieux Lucien est aujourd'hui sans le sous alors qu'il était un incroyable
chanteur lyrique. Que s'est-il passé ? Comment accepter cette
situation ? Louis Dunoyer de Segonzac met en musique ce texte d'une grande
richesse avec poésie et légèreté. Un véritable conte de Noël illustré avec
talent par Philippe Dumas.

Eric Senabre (texte), Dominique Pinon (Récitant), Merlin (ill.). Rockin'Johnny. Didier Jeunesse. Livre-CD.
Dès 7 ans. 23,80 €.
Didier Jeunesse nous offre une plongée
endiablée dans l'Amérique des années 50 et les débuts du rock'n'roll. Dominique
Pinon raconte la fugue de deux enfants qui accompagnent un groupe de rock parti
enregistrer son premier disque à Memphis. Un voyage plein de rebondissements et
une découverte musicale incroyable puisqu'ils rencontrent un certain Elvis...
40 minutes de tubes, de morceaux à valeur historique et de perles méconnues
sont illustrées avec fougue par Merlin. Un CD à écouter en famille.

Aurélie Clément.
***
LA VIE DE L’EDUCATION MUSICALE
Passer une publicité. Si vous souhaitez promouvoir
votre activité, votre programme éditorial ou votre saison musicale dans L’éducation musicale, dans notre Lettre
d’information ou sur notre site Internet, n’hésitez pas à me contacter au 01 53
10 08 18 pour connaître les tarifs publicitaires.
maite.poma@leducation-musicale.com
|
Les projets d’articles sont à envoyer à redaction@leducation-musicale.com
Les livres et les CDs sont à envoyer à la rédaction de l’Education
musicale : 7 cité du Cardinal Lemoine 75005 Paris
Tous les dossiers de l’éducation musicale
·
La librairie de L’éducation
musicale
| Publié l'année même de son ouverture, cet ouvrage raconte avec beaucoup de précisions la conception et la construction du célèbre bâtiment. Le texte est remis en pages et les gravures mises en valeur grâce aux nouvelles technologies d'impression. |
|
 |
Pour la première fois, le Tchèque Leoš Janácek (1854-1928), le Finlandais Jean Sibelius (1865-1957) et l'Anglais Ralph Vaughan Williams (1872-1958) sont mis en perspective dans le même ouvrage. En effet, ces trois compositeurs - chacun avec sa personnalité bien affirmée - ont tissé des liens avec les sources orales du chant entonné par le peuple. L'étude commune et conjointe de leurs itinéraires s'est avérée stimulante tant les répertoires mélodiques de leurs mondes sonores est d'une richesse émouvante. Les trois hommes ont vécu pratiquement à la même époque. Ils ont été confrontés aux tragédies de leur temps et y ont répondu en s'engageant personnellement dans la recherche de trésors dont ils pressentaient la proche disparition. (suite). |
 |
Ce guide s’adresse aux musicologues, hymnologues, organistes, chefs de chœur, discophiles, mélomanes ainsi qu’aux théologiens et aux prédicateurs, soucieux de retourner aux sources des textes poétiques et des mélodies de chorals, si largement exploités par Jean-Sébastien Bach, afin de les situer dans leurs divers contextes historique, psychologique, religieux, sociologique et surtout théologique. Il prend la suite de La Recherche hymnologique (Guides Musicologiques N°5), approche méthodologique de l’hymnologie se rattachant à la musicologie historique et à la théologie pratique dans une perspective pluridisciplinaire. Nul n’était mieux qualifié que James Lyon : sa vaste expérience lui a permis de réaliser cet ambitieux projet. Selon l’auteur : « Ce livre est un USUEL. Il n’a pas été conçu pour être lu d’un bout à l’autre, de façon systématique, mais pour être utilisé au gré des écoutes, des exécutions, des travaux exégétiques ou des cours d’histoire de la musique et d’hymnologie. » (suite) |
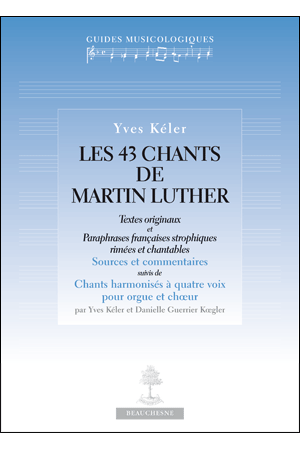 |
Cet ouvrage regroupe pour la première fois les 43 chorals de Martin Luther accompagnés de leurs paraphrases françaises strophiques, vérifiées. Ces textes, enfin en accord avec les intentions de Luther, sont chantables sur les mélodies traditionnelles bien connues. Aux hymnologues, musicologues, musiciens d'Eglise, chefs, chanteurs et organistes, ainsi qu'aux historiens de la musique, des mentalités, des sensibilités et des idées religieuses, il offrira, pour chaque choral ou cantique de Martin Luther, de solides commentaires et des renseignements précis sur les sources des textes et des mélodies : origine, poète, mélodiste, datation, ainsi que les emprunts, réemplois et créations au XVIè siècle... (suite) |
 |
Mozart aurait-il été heureux de disposer d'un Steinway de 2010 ? L'aurait-il préféré à ses pianofortes ? Et Chopin, entre un piano ro- mantique et un piano moderne, qu'aurait-il choisi ? Entre la puissance du piano d'aujourd'hui et les nuances perdues des pianos d'hier, où irait le cœur des uns et des autres ? Personne ne le saura jamais. Mais une chose est sûre : ni Mozart, ni les autres compositeurs du passé n'auraient composé leurs œuvres de la même façon si leur instrument avait été différent, s'il avait été celui d'aujourd'hui. Mais en quoi était-il si différent ? En quoi influence-t-il l'écriture du compositeur ? Le piano moderne standardisé, comporte-t-il les qualités de tous les pianos anciens ? Est-ce un bien ? Est-ce un mal ? Qui a raison, des tenants des uns et des tenants des autres ? Et est-ce que ces questions ont un sens ? Un voyage à travers les âges du piano, à travers ses qualités gagnées et perdues, à travers ses métamorphoses, voilà à quoi convie ce livre polémique conçu par un des fervents amoureux de cet instrument magique.
|
En préparation
 |
Analyses
musicales
XVIIIe siècle – Tome 1
L’imbroglio
baroque de Gérard Denizeau
BACH
Cantate BWV 104 Actus tragicus Gérard Denizeau Toccata ré mineur Jean Maillard Cantate BWV 4 Isabelle Rouard Passacaille et fugue Jean-Jacques Prévost Passion saint Matthieu Janine Delahaye Phœbus et Pan Marianne Massin Concerto 4 clavecins Jean-Marie Thil La Grand Messe Philippe A. Autexier Les Magnificat Jean Sichler Variations Goldberg Laetitia Trouvé Plan Offrande Musicale Jacques Chailley
COUPERIN
Les barricades mystérieuses Gérard Denizeau Apothéose Corelli Francine Maillard Apothéose de Lully Francine Maillard
HAENDEL
Dixit Dominus Sabine Bérard Israël
en Egypte Alice Gabeaud
Ode à Sainte Cécile Jacques Michon L’alleluia du Messie René Kopff
Musique feu d’artifice Jean-Marie Thill |
***
Paru en juillet
·
Où trouver le numéro du Bac ?
Les analyses musicales de L'Education Musicale