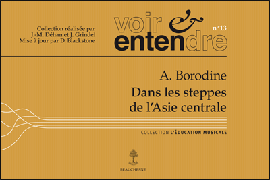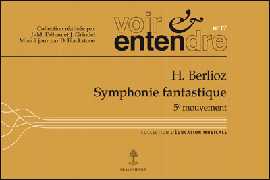REPÈRES PÉDAGOGIQUES : FRANÇOIS LAZAREVITCH ET LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN
PROPOS PARTAGÉS :
1. ELZBIETA SIKORA, UNE COMPOSITRICE POLONAISE ENGAGÉE
2. JÉRÔME PERNOO, L'HOMME PROTÉE DU VIOLONCELLE
L'AGENDA
8 / 4
Thierry Escaich
à Saint-Etienne-du-Mont

Thierry Escaich
se produira avec l'Ensemble Vocal de
Paris et l'Ensemble Zoroastre sous la direction de Savitri
de Rochefort dans un programme présentant son œuvre Terra desolata, qui sera précédée d'une
improvisation à l'orgue. Seront donnés également le Miserere en ré mineur de Johann Adolf Hasse et le Dixit Dominus HWV
232 en sol mineur de Georg Friedrich Haendel. Si on ne présente plus cette
dernière pièce de Haendel, le Miserere de Hasse, composé en 1730 pour l'un des Ospedale de Venise, est aux côtés de la Messe en D mineur,
l'une de ses pièces religieuses les plus emblématiques. Thierry Escaich a composé Terra desolata,
en 2001. La pièce est pour quatre voix, ensemble instrumental et orgue de
chambre. Elle a été créée l'année suivante par Hervé Niquet et le Concert
Spirituel. Une belle occasion de l'entendre par son auteur à l'orgue de
l'église parisienne
Saint-Etienne-du-Mont dont il est titulaire de l'instrument de tribune,
lointain successeur du grand Maurice Duruflé.
Église
Saint-Etienne-du-Mont, le 8 avril 2016 à 20H30.
Réservations
: http://ensemble-vocal-de-paris.com ou sur place le
soir du concert.
11 / 4
Alexandre
Kantorow à la Fondation Louis Vuitton

DR
Dans le cadre du cycle Piano nouvelle génération, Alexandre Kantorow, 18 ans, pianiste virtuose de sa
génération se produira sur la scène de l'Auditorium de la Fondation Louis
Vuitton. Dès l'âge de 5 ans il entre au conservatoire, à 16 ans il commence une
carrière de concertiste en France mais aussi à l'international. Il se produit
avec le Sinfonia Varsovia
aux Folles Journées de Nantes et
de Varsovie où il se fait
remarquer. Boris Berezovsky l'invite pour deux
récitals dans son festival Pianoscope à Beauvais. Il joue également avec
L'Orchestre de Liège, de Douai, d'Orléans, le Tapiola
Sinfonietta de Finlande, l'orchestre de Kaunas
en Lituanie pour ne citer que certains d'entre eux, et sans
oublier un concert avec l'orchestre Pasdeloup à la Philharmonie
de Paris. En 2015, après avoir
enregistré deux CD, il part en tournée avec Augustin Dumay
au Japon et en Chine. Une
des particularités d'Alexandre Kantorow est de jouer
sans partition. Il prend plaisir également à étendre son répertoire
au delà de la musique classique en jouant par exemple le Concerto d'Addinsell (musique de film) et la Rapsodie in Blue
de Gershwin qu'il donne dans sa version originale avec un jazz band. Au
programme de ce récital : le Scherzo
à la russe op.1 n°1, et des extraits de 18 pièces op.72 de
Tchaïkovski, la Sonate pour piano n°1 op. 28 de Serge Rachmaninov, puis
de Stravinsky / Guido Agosti, des extraits de L'Oiseau de feu, et de Mily Balakirev , Islamey.
Auditorium de la Fondation
Louis Vuitton, 8 avenue du Mahatma Gandhi, Bois de Boulogne, 75016 Paris, le 11
avril 2016 à 20H30.
Réservations : par tel.: 01 40 69 96 00 ;
en ligne : contact@fondationlouisvuitton.fr
13 / 4
Concert Royal à Saint Jean Baptiste de Neuilly

À l'occasion de leur 60ème
anniversaire, les Petits Chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly proposent un
grand Concert Royal avec le Te Deum de Lully et le Requiem de
Campra. Les 80 chanteurs qui constituent cette Maîtrise de garçons seront
accompagnés pour l'occasion d'un orchestre baroque composé des meilleurs
instrumentistes français (membres des Orchestres de Radio France, de l'Opéra de
Paris et de Lyon...). Ils recevront également le concours des ténors Hervé Lamy
et Jérôme Billy (tous les deux anciens petits chanteurs) et de la basse Florian
Westphal. Tous seront placés sous la direction de François Polgár.
Cette soirée s'inscrit dans un vaste programme de festivités pour
l'anniversaire du chœur, qui a débuté en décembre par un concert à la Salle
Gaveau, se prolongera par une représentation à la Chapelle Royale de Versailles
avec Jean-Claude Malgoire au mois de juin, une
tournée d'un mois en Chine en juillet, et s'achèvera par un grand spectacle le
8 octobre 2016 à l'Olympia à Paris.
Église Saint-Jean Baptiste de Neuilly, le 13 avril 2016 à 20H30.
Réservations : par tél.
: 01.47.45.18.66 ; en ligne : www.petitschanteurs.com ; sur place, 158 avenue Charles de
Gaulle 92200 Neuilly
22, 23, 24 / 4
Les Siècles donnent festival à Soissons

DR
C'est dans le cadre de leur
résidence commencée en 2007 dans le département de l'Aisne que Les Siècles ont
été appelés à célébrer l'ouverture de la Cité de la Musique et de la Danse
de Soissons le 7 février 2015, désormais lieu de leur résidence. A la
tête de l'Atelier départemental d'orchestre symphonique de l'Aisne depuis 2009,
François-Xavier Roth initie une dynamique et des actions transversales,
conjuguant pédagogie et diffusion, actions culturelles et pratiques
amateurs. C'est dans cette perspective que s'inscrivent les trois jours de
manifestation des 22, 23 & 24 avril prochain. Le vendredi 22 avril, sont
organisées à 14h00 des actions culturelles autour de la sérénade Gran Partita de
Mozart, le chef d'œuvre de ses pièces pour instruments à vents. Puis à
20h30, un concert où Les Siècles retrouvent la violoniste Amandine Beyer qui a conçu un programme brillant autour des
chefs-d'œuvre préclassiques du XVIIIème siècle, dont les deux concertos de
Carl-Philip Emanuel Bach, illustrant bien l'influence du style italien sur la
musique germanique. Le samedi 23 avril, ce seront, d'abord à 11h30, des
actions culturelles ou un lever de rideau par les élèves. Rassembler les élèves
du pôle d'enseignement artistique en avant-concert pour une prestation autour
d'un des grands titres de la saison, tel est le concept original de ce « Lever
de rideau », des rendez-vous, véritables mises en bouche pour le concert du
soir ; puis à 14h00 : d'autres actions autour de l'Oiseau de feu ; enfin
à 16h30, actions culturelles encore ou «Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur la composition d'un orchestre !». Le dimanche 24 avril, à 15h00 :
actions culturelles ou lever de rideau par les élèves. Puis à 16h00, concert
par Les Siècles avec, entre autres, de la Sérénade K. 361.
Cité de la musique et de la danse de
Soissons, 9 allée Claude Debussy, Parc Gouraud, 02200 Soissons, les 22, 23 et
24 avril 2016.
Réservations
: par tel au 03 23 59 10 12; en ligne : info@citedelamusique-grandsoissons.com
Lien
vers Les Siècles : http://www.lessiecles.com/la-cite-de-la-musique-et-de-la-danse-de-soissons/
23, 25, 29 / 4 & 2 / 5
Insula orchestra joue Lucio Silla

Franco
Fagioli / DR
Laurence Equilbey,
son Insula Orchestra et le Jeune Chœur de Paris se lancent dans une bien jolie aventure : monter Lucio Silla en
version de concert semi staged. Composé en 1772 pour
Milan, Mozart y rafraichit la forme de l'opera seria, expérimente
une nouvelle façon de traiter les arias, munies ici de longues introduction
symphoniques, et dont le schéma da capo est libéré, et enfin abandonne le
traditionnel recitativo secco au profit du récitatif
accompagné. La grande virtuosité vocale est mise désormais au service de
l'expression dramatique La version concertante sera accompagnée d'une mise en
espace due à l'argentine Rita Cosentino qui indique
vouloir recréer une « représentation libérée de ses mécanismes... tout en
gardant intacte la nature du concert » : les chanteurs interviennent en
dehors de passages où ils sont actifs « en prêtant leurs corps à l'espace,
devenant des témoins muets ou participant à la construction du décor ».
Intéressant de voir ce qu'il en sera. Quant à Laurence Equilbey
et ses forces, on ne doute pas un seul instant de leur engagement au service de
cet opéra de jeunesse combien attachant. Le cast est
quant à lui fort attractif : Franco Fagioli, Olga Pudova, Paolo Fanale, Chiara Skerath et Ilse Eerens.
Cité de la musique, PP2, le 23 avril 2016 à 20H30
Le Volcan, Le Havre, le 25/4 à 19H30
Grand Théâtre de Provence , le 29/4 à
20H30,
Réservations : PP2 Paris
Billetterie, 221, av. Jean Jaurès Paris 19 ; par tel 01 44 84 44 44 ; en ligne : www. philharmoniedeparis.fr
Le Volcan/Le Havre : Place
Oscar Niemeyer, 76000 Le Havre ; par tel : 02 35 19 10 10
; en ligne : www.levolcan.com
Grand Théâtre de Provence :
380, avenue Max Juvénal, 13100 Aix-en-Povence ; par tel.: 04 42 91 69 70 ; en ligne : www.aixenprovence.fr/grand-theatre-de-provence
8 / 5 - 5 / 6
La Défense d'aimer revit à l'Opéra du Rhin

Avant de livrer les dix chefs
d'œuvres que l'on sait, Richard Wagner a composé quelques opéras certes moins
connus et partant, peu joués, mais où perce déjà la patte du dramaturge. Ainsi
en est-il de Das Liebesverbot,
qui sera créé en 1836 à Magdebourg où le musicien était chef d'orchestre à
l'Opéra. Le plus piquant est que le choix se soit porté sur un sujet comique
inspiré de la pièce Measure for measure de Shakespeare. Pour ce « Grand
opéra-comique », en deux actes, Wagner est déjà son propre librettiste.
Mais il va modifier l'intrigue, en transportant le lieu de Venise à Palerme. La
sensualité qui émane de la trame n'est pas pour lui déplaire. L'opéra sera un
succès plus critique que public. L'un des chroniqueurs allant jusqu'à pointer
qu'« on y trouve de la mélodie, ce qu'on cherche vainement chez nos
compositeurs allemands ». Grand admirateur de Bellini, Wagner se souvient
de ce modèle. Pour sa création française ( ! ),
l'œuvre sera montée par l'Opéra du Rhin avec une distribution intéressante et sous la direction de
Constantin Trinks. La mise en scène est confiée à Mariame Clément.
Opéra du Rhin, à Strasbourg
Opéra, les 8, 22 mai 2016 à 15H, et les 13, 17, 19 mai à 20H ; puis à Mulhouse
La Filature, les 3 (20H) et 5 juin (15H).
Réservations :
Opéra
de Strasbourg : 19, Place Broglie, BP 80320, 67008 Strasbourg cedex ; par tel.
: 03 68 98 51 80.
La Filature/Mulhouse, 20, Allée Nathan- Katz , 68090 Mulhouse cedex ; par tel.: 03 89 36 28 29 .
En ligne : caisse@onr.fr
14 / 5 – 25 / 6
Rencontres Musicales Pro Quartet en Seine-et-Marne

Pro Quartet organise son
festival annuel en Seine-et-Marne de la mi mai à la
fin juin. Plusieurs formations attachées à cette institution se produiront dans
des lieux prestigieux du patrimoine du sud du département. Les festivités
s'ouvriront le 14 mai par deux concerts
donnés à l'église St Amand de Thomery, d'une part, par le Trio Atanassov (18H : Mozart, Tulve, Dvořák) et d'autre part, par le Quatuor van Kuikj (20H30 : Mozart Kurtag
Smetana). L'ensemble Hélios jouera le 15 mai (16H) dans l'église St Martin de
Fontaine-le-Port des pièces de Vivaldi, Bacri,
Boccherini, Solbiati et Rossini. Puis le quatuor Lyskamm donnera, le 28 mai au Musée de la Préhistoire de
Nemours, des œuvres de Stravinsky, Beethoven et Casale
(19H). Le Belenus Quartet donnera des quatuors de
Haydn, Schnyder et Schubert (le 5 juin à 16 H, en l'église St Étienne de Moncourt-Fromonville). Le quatuor
Zerkalo jouera Hosokawa et
Schubert, le 11 juin à 19 H à l'église St Sévère de Bourron-Marlotte. Les Arod joueront, le
12 juin à l'église St Pierre de Bois-le-roi, Mozart, Webern et Beethoven (16H).
Les Aristos, le 18, Haydn, Bacri et Mendelssohn (19H,
église de Villiers-sous-Gretz). Le 19 juin, le Dudok Kwartet donnera des pièces de Haydn et Ravel à la Chapelle
de Lourps à Longueville (16H). Enfin le 25 juin, se
produira le quatuor Tchalik dans Haydn, Mozart et
Brahms (église St Corneille de Chartrettes,
19H).
Réservations : par tel.: 01 44 61 83 68 ; en ligne :
http://www.proquartet.fr/fr/concerts/rencontres-en-seine-et-marne-1
20 / 5 - 1 / 6
Un chef d'œuvre du XX eme siècle : Lear
de Aribert Reinmann

Aribert Reinmann et
Dietrich Fischer-Dieskau (à dr.) en 1978 / DR
Malgré son éminent potentiel
dramatique, Le Roi Lear de Shakespeare n'a pas eu l'heure d'inspirer les
compositeurs d'opéras. A moins qu'ils ne se soient sentis tétanisés par
l'ampleur de la tâche ou trop impressionnés par le sujet. Ainsi Verdi, qui en
caressa longtemps le projet, renonça-t-il. C'est à Dietrich Fischer-Dieskau
qu'on doit l'idée de ce qui allait être un des chefs d'œuvre de l'opéra du
dernier quart du XX ème siècle. Souhaitant incarner
ce personnage hors norme, le grand baryton sollicita d'abord son ami Benjamin
Britten qui déclina. Il se tourna alors vers le compositeur allemand Aribert Reinmann (*1936), qui
après avoir longtemps hésité, s'attela à la tâche, enhardi par une commande
passée en 1975 par l'Opéra de Munich. L'opéra y sera créé en juillet 1978 par
le grand DFD dans le rôle titre et son épouse Julia Varady
dans celui de Cordelia. Pour y avoir assisté, on en
garde un souvenir bouleversé. Peu donné depuis lors, et une seule fois à Paris
en 1982, l'opéra va revivre à l'Opéra Garnier dans une nouvelle production
confiée à l'iconoclaste Calixto Bieito
et dirigée par Fabio Luisi. Bo Skovhus
défendra le rôle de Lear, Annette Dasch celui de Cordelia. On voit aussi dans la distribution les noms
prestigieux de Riccarda Merbeth,
Goneril et de Gidon Saks, Le Roi de France. Il ne faut pas manquer l'occasion
de voir cette pièce, qui comme peu, décrit la solitude d'un homme ravagé par le
désespoir de voir ses projets (de partition de son royaume) rejetés, puis gagné
par la folie. Et d'écouter une musique, certes complexe, mais riche d'effets
sonores à l'image du drame qu'elle véhicule, et dont l'écriture s'inscrit dans
le sillage de Penderecki.
Opéra Garnier, les 20
(avant-première), 23 mai, 1er (20H30), 6, 9, 12 juin 2016 à 19H30, et le 29/5 à
14H30.
Réservations : Billetterie,
130, rue de Lyon, 75012 Paris ou angle rues Scribe et Auber, 75001 Paris ; par
tel. : 08 92 89 90 90 ; en
ligne : operadeparis.fr
25 / 7 – 13 / 8
Le Festival de Prades : « DÉSACCORDS PARFAITS »
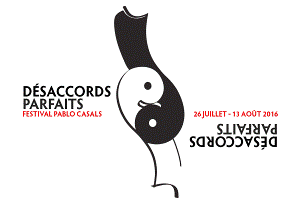
Le prochain Festival de Prades, 64 ème du nom, propose de merveilleuses rencontres de musique
de chambre. Comme le souligne son directeur Michel Lethiec,
« L'histoire de la musique doit beaucoup aux rencontres... amicales,
amoureuses... au hasard... à la nécessité... et surtout au génie des
compositeurs qui l'ont écrite œuvre après œuvre ». Pau Casals, âme et
fondateur de ce festival choisi entre musique,
architecture et montagnes du sud, avait voulu réunir les plus grands
noms, des amis. L'aventure a perduré et cette nouvelle édition ne fait pas
exception. S'il y a pu y avoir dans la longue histoire de la musique des
moments chaotiques, voire des querelles de chapelle, des discussions confinant
au demeurant plus à des dialogues de sourds qu'à des échanges constructifs, la
plupart du temps ceux-ci se sont révélés vains. Car les chefs d'œuvre ont
triomphé et traversé l'Histoire sans encombre. Comme l'an passé, on croisera
les musiques : de Bach à Debussy, de Mozart à Stravinsky, de Brahms à Bernstein
en passant par bien d'autres, au fil de rapprochements souvent inédits pour ne
pas dire osés. On achalandera les interprètes en fonction de celles-ci et des
affinités : on entendra les fidèles, comme le quatuor Talich
ou l'Artis Quartet, l'altiste Bruno Pasquier, le
celliste Arto Noras ou le
corniste André Cazalet, mais aussi des nouveaux
venus, tels le chevronné Jérôme Pernoo et le jeune
prodige Edgar Moreau, violoncellistes, Itmar Golan au
piano, ou le Polish Leopoldinum
Orkestra ou Opus Ensemble de Séoul. Et bien sûr tous
réunis sous la ferme et joviale direction du maitre des lieux Michel Lethiec qui jouera de sa clarinette enchantée.

DR
Durant ces trois semaines de festivités
continues, on entendra bien des œuvres des plus grands chambristes. Et cette
année, l'orchestre sera bien présent. En voici
quelques temps forts :
-
le
25/7, une séance de trios de Mozart, Schubert et Kokai
par le Trio Leopoldinum (16H au centre culturel Saint
Laurent/Saint Guilhem le Désert, puis une soirée « De Bach à Bernstein »,
à l'abbaye de Gellone (21H)
-
le
28/7 « Opus ensemble » dans le cadre de l'année France-Corée (Prokofiev,
Brahms et Ryu)
-
le
31/7 à l'occasion de l'exposition
Maillol au Musée de Céret, un concert in loco « Couleurs et timbres »
(18H30) et une soirée « Hommages aux modèles et aux muses (salle de
l'union, 21H)
-
le
2/8, les Sept dernières Paroles de Christ en croix de joseph Haydn
(Prieuré de Marcevol à 17H), puis une soirée
« Madrid-Barcelone » associant
Albeniz, Granados, de Falla et Turina (Abbaye
de Cuxa, 21H)
-
le3/8,
conférence de Michel Lethiec sur « Grandes et
petites histoires de la Musique... » (11H, Prades), puis « Les
révélations classiques de l'ADAMI » (église de Catllar,
17H) et enfin « Grands quintettes », de Schubert et de Dvořák (21H abbaye de Cuxa)
-
le
4/8 « Musiques au sommet », de Schubert et de Penderecki (18H, Abbaye
Saint Martin du Cazigou), et « Écoles de
Vienne » ( 21H, abbaye de Cuxa)
-
le
7/8, « Ensemble de violoncelles », jeunes solistes de l'Académie
réunis autour de François Salque (17H, église de Villefranche de Conflent) et « Mozart et
Salieri » ( 21H, église Saint Pierre de Prades)
-
9/8,
JOURNEE PABLO CASALS : « A savourer sans modération » (11H,
Grand Hôtel de Moligt les Bains), « Pablo Casals
et les compositeurs » (15H même lieu),
puis « Hommage à la reine Élisabeth de Belgique » (17H, église
de Molitg village) et enfin un concert « Hommage
à Pau Casals », croisant Tchaikovski, Dvořák et Brahms (21H, abbaye de Cuxa)

L'abbaye
Saint Michel de Cuxa
L'Académie internationale de musique, du
1er au 14 août, offrira des cours par les interprètes du festival, dont les
deux quatuors en résidence. Les étudiants donneront leurs concerts (gratuit)
les 10, 11, 12 et 13 août à 11H et 16 H, dans les diverses églises de la
région.
Réservations : par correspondance :
Festival Pablo Casals, BP 50024, 66502 Prades Cedex ; par Fax : 04 68 96 50 95
; par tel. : 04 68 96 33 07 ; en ligne :
www.prades-festival-casals.com
Jean-Pierre Robert.
Festival Pablo Casals, entre Prades et le Théâtre des Champs-Elysées
Entretien avec Michel Lethiec,
clarinettiste et directeur artistique du festival

Michel
Lethiec © Josep Molina
A l'occasion du premier concert de la série
« Prades aux Champs-Elysées 2016 »* Michel Lethiec,
clarinettiste international et directeur artistique du festival nous livre
quelques unes de ses réflexions concernant l'histoire, les partenariats, les
perspectives artistiques de ce festival de musique de chambre fondé à Prades
par Pablo Casals en 1950.
Michel
Lethiec, pouvez vous nous rappeler succinctement
l'origine de ce festival ?
Ce festival fut fondé en 1950 par le
violoncelliste catalan Pablo Casals, comme le fruit conjugué d'un renoncement
et d'une résurrection. Renoncement d'abord par le refus de Pablo Casals de
retourner en Espagne après la victoire du général Franco et la défaite de la République
espagnole. Il s'installa alors dans le petit village de Prades (Pyrénées
orientales) où il se condamna au silence en signe de protestation devant
l'indifférence internationale, silence qui perdura jusqu'après la seconde
guerre mondiale malgré les appels répétés de tous les mélomanes et musiciens du
monde entier. Ce n'est qu'en 1950 que se produit la résurrection musicale du
maître, à l'occasion du bicentenaire de la mort de J. S. Bach. Alexandre
Schneider et nombre des plus grands interprètes de son temps (Clara Haskil,
Joseph Szigeti, Rudolf Serkin,
Isaac Stern…) lui proposèrent alors de venir jouer à Prades. Ainsi naquit le
festival, en territoire français, permettant à Casals de ne pas trahir sa
promesse de ne pas retourner en Espagne. Pablo Casals (1876-1973)
violoncelliste, chef d'orchestre et compositeur, fondateur du mythique trio
Casals, Thibaud, Cortot en 1905, fondateur d'un orchestre à Barcelone en 1919,
fut sans nul doute une personnalité majeure du paysage musical en ce début de
XXe siècle, un des plus grands solistes de son temps, personnalité complexe et
universelle au plan des idées, profondément humaniste, à la fois proche de la
famille royale espagnole et fermement engagé pour la République, antifasciste
dans l'âme, porteur inlassable d'un message de paix qu'il ne cessera de
véhiculer jusqu'à sa mort à Porto Rico en 1976.
Comment
votre collaboration avec le Théâtre des Champs-Elysées a-t-elle débutée, et
comment s'est-elle maintenue avec le même succès depuis plus de vingt
ans ?
C'est paradoxalement lors d'un concert que
je donnais à Tokyo, où il y a d'ailleurs une salle portant le nom de Pablo
Casals, que la possibilité d'une exportation du festival m'est apparue, faisant
suite à une demande des organisateurs de concerts japonais, connaissant mon
rôle dans la programmation du festival. Ce fut notre première exportation du
festival de Prades à l'étranger, suivie dès lors par de nombreuses tournées
dans le monde entier. De retour à Paris, Alain Durel,
alors directeur du TCE me proposa de renouveler l'expérience de façon régulière
et programmée dans la salle mythique de l'avenue Montaigne. Le festival
abandonna pour trois concerts l'Abbaye Saint Michel de Cuxa
et son exceptionnelle acoustique pour celle différente mais tout aussi légendaire
du TCE. Ainsi débuta le cycle de musique de chambre « Prades aux
Champs-Elysées » renouvelé d'années en années depuis 1993. Une forme
différente ne comprenant que quelques concerts, un autre public, mais toujours
une même fidélité à ce qui fait le cœur de notre festival : un même niveau
d'excellence dans la pratique de la musique de chambre sous les doigts des plus
grands solistes ou ensembles du moment. Paris ou Prades, finalement deux
facettes d'une même médaille, saison d'hiver ou saison d'été, un tout
transformant pour quelques jours un petit village du midi ou Paris en capitale
de la musique de chambre.
Quelles
sont actuellement les perspectives artistiques du festival ?
En complément de la pratique de la musique
de chambre à son plus haut niveau, le festival de Prades sous ma direction
s'est imposé deux missions essentielles : une mission pédagogique et une
mission de soutien à la création de la musique dite contemporaine que je
préfère appeler musique d'aujourd'hui. En effet, le festival est à la fois
ancien de par son histoire, mais également moderne de par sa programmation qui
prend en compte la création d'œuvres nouvelles par des compositeurs
d'aujourd'hui, un souci constant qui implique une mixité entre œuvres anciennes
et œuvres contemporaines. Une mixité des programmes, souvent bien accueillie
par le public, qui s'appuie sur la fréquentation assidue des compositeurs,
comme récemment Penderecki ou Widmann, une
collaboration qui s'enrichit mutuellement des éclairages différents apportés
par interprètes et auteurs. Les rapports entre compositeurs et musiciens sont
primordiaux : sans eux, les musiciens ne seraient rien, mais sans nous leur
musique ne serait jamais jouée…Pourquoi d'ailleurs ne pas participer aussi à la
composition comme je l'ai fait quelques fois, avec Claude Ballif
ou mon gendre Krystof Maratka…Toutefois,
il ne faut pas oublier que cet effort vers et pour la musique d'aujourd'hui a
un coût financier qu'il faut assumer auquel s'ajoutent les difficultés
techniques de réalisation, souvent importantes, et l'instrumentation parfois
complexe impliquant un instrumentarium adapté.
Quant à la mission pédagogique, elle nous
parait également primordiale et depuis quelques années nous recrutons sur
dossier un certain nombre de jeunes
musiciens au sein de notre Académie du festival. Ces jeunes musiciens sont pris
en charge lors de master classes, de concerts d'étudiants, de concerts mixtes
associant élèves et professeurs. Sorte de compagnonnage musical où chaque
soliste est également professeur dans le cadre d'un enseignement continu
pendant la quinzaine de jours que dure le festival (fin juillet-mi août). Un
effectif de solistes-professeurs qui se renouvelle chaque année, qui touche
tous les instruments et prépare les plus jeunes à leur vie professionnelle de
solistes ou de musiciens d'orchestre. Une belle façon de faire de la musique
ensemble et de se perfectionner au sein d'un creuset qui a déjà donné naissance
à nombre de grands solistes, comme tout dernièrement le violoncelliste Edgar Moreau,
pour ne citer que lui
.
Comme
vous le signaliez précédemment, il ne semble pas possible de clore ce rapide
entretien sans évoquer les contraintes économiques actuelles et le danger de
voir disparaitre à plus ou moins longue échéance nombre de festivals. Qu'en
est-il concernant le festival de Prades ?
Le contexte économique incertain nous a
contraints à restreindre quelque peu la voilure concernant notamment les
concerts que nous donnions dans les écoles et les hôpitaux, souhaitant en cela
rester fidèles à la tradition et à l'esprit de Prades, initiés par Pablo
Casals. Une situation difficile qui nous affecte, bien que le festival ne soit
pas directement menacé, mais qui nous apparait à long terme comme un mauvais
calcul. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille faire fi des difficultés actuelles
et qu'il ne faille pas participer à l'effort de solidarité. Mais considérer le
budget de la culture comme une variable d'ajustement n'est-ce pas pour l'avenir
une menace sérieuse quand on connait la valeur refuge que constituent l'art, la
culture et la musique en particulier dans les situations difficiles…D'autant
qu'il suffit sans doute de maintenir l'existant (conservatoires, festivals,
orchestres) pour sauvegarder une pratique
et un enseignement musical de qualité. Une réflexion à méditer…
Propos recueillis par Patrice Imbaud.
* Le second concert, « Hommage à Pablo
Casals », aura lieu le 2 avril prochain, à 20H. Peter Frankl, piano, Kyoko Takezawa,
violon, Yuval Gotlibovich, alto, François Salque, violoncelle + Orchestre de violoncelles joueront de
Haydn le Trio avec piano n°39 en sol
majeur, de Schumann le Quatuor avec piano op .47 en mi bémol majeur, de
Mozart le Quatuor avec piano K. 493, enfin des pièces de J.S. Bach - G. Fauré - P. Casals (dernier
concert de Pablo Casals à Paris en 1956).
***
PAROLES D'AUTEUR
Proposition d'analyse du
processus de traduction en art
L'exemple de la Scène première du Rheingold de
Fantin-Latour d'après l'opéra de Wagner
Seconde partie :
Traduction et Création
Fidélité et liberté sont deux aspects indissociables de
tout processus de traduction. Dans le précédent numéro de L'Education musicale
nous avons vérifié la fidélité de la
gravure Scène première du Rheingold de Fantin-Latour à son modèle wagnérien sur
trois plans : celui de la narration, de l'expression et de l'idée (1).
Il s'agit maintenant d'évaluer la part de liberté prise
par le peintre par rapport à Wagner. Dans quelle mesure Fantin-Latour a-t-il
« laissé éclater son sentiment particulier », sachant que
« c'est en cela », selon Eugène Delacroix, « que se montre le
génie » du traducteur (2) ?
En réalité, comme l'écrit encore le grand romantique : « Nous mêlons
toujours de nous-mêmes dans ces sentiments qui semblent venir des objets qui
nous frappent. Il est probable que ces ouvrages ne me plaisent tant que parce
qu'ils répondent à des sentiments qui sont les miens » (3). En quoi le début
de L'Or du Rhin a-t-il d'abord
répondu à des sentiments qui étaient ceux de Fantin
lui-même ?
Pour mettre en évidence les convergences entre la
gravure et l'œuvre de Wagner, nous avons procédé, dans la première partie de
notre article, à une analyse allant de l'extérieur vers l'intérieur, en
comparant successivement : le livret de Wagner et le sujet
"extérieur" de la gravure, l'expression des formes plastiques et
celle de certains motifs musicaux, la structure interne de la gravure et le
motif des Filles du Rhin, enfin l'interprétation de cette structure par rapport
à l'opéra. Grâce à cette méthode, il a été possible de dévoiler la
signification profonde de l'œuvre de Wagner, son essence même, confirmée par la
correspondance du compositeur à sa seconde épouse Cosima (4).
Mais quant aux intentions cachées de Fantin-Latour au
moment même où il a choisi de mettre en gravure le début de L'Or du Rhin, elles ont été, jusqu'à
maintenant, totalement occultées. Pourquoi le peintre a-t-il choisi de traduire
cette scène en particulier ? Qu'a-t-il reconnu de lui-même qui ait pu l'inciter
à vouloir la traduire à plusieurs reprises ?
Au cours de cette seconde partie nous allons donc
tenter de percer le dessein secret de Fantin-Latour et, pour cela, suivre son
cheminement créateur depuis ses premières réactions au spectacle consignées
dans sa lettre écrite de Bayreuth, en passant par ses divers croquis et
esquisses, et jusqu'à ses œuvres achevées : la gravure de 1876, le pastel
de 1877 et la peinture de 1888, cette dernière représentant, selon nous,
l'aboutissement du processus. Il s'agit donc d'une analyse de type poïétique,
grâce à laquelle un autre contenu se fera jour, un contenu que Maurice Denis
appelle le « sujet intérieur » ou « subjectif », qu'il a défini dans Charmes et Leçons d'Italie en se référant à Delacroix :
Il faut donc s'entendre sur le sens du mot sujet. Il y a le
sujet extérieur, le sujet dogmatique qui exige du spectateur des
connaissances historiques, allégoriques, religieuses. Mais dans une véritable
œuvre d'art, ce sujet est toujours doublé
d'un autre sujet qui parle aux yeux de tout homme doué de sensibilité et d'intelligence
: appelons-le le sujet intérieur ; le sujet subjectif si vous voulez.
"O jeune artiste, disait Delacroix, tu cherches un sujet. Tout est sujet. Ton sujet c'est toi-même, tes
impressions, tes émotions devant la nature (5).
Quel est donc le « sujet intérieur » de la Scène première du Rheingold
de Fantin-Latour qui « double » le sujet wagnérien et qui est
capable de « parler aux yeux de tout homme doué de sensibilité et
d'intelligence », sans passer nécessairement par la connaissance de
l'œuvre wagnérienne ? Les deux sujets (celui du compositeur et du peintre)
se rejoignent-ils ou non dans leur signification profonde ? Pour répondre à
cette question, nous nous appuierons, entre autres, sur un ouvrage de Didier
Anzieu (1923-1999), Le Corps de l'œuvre.
Essais psychanalytiques sur le travail créateur (6), qui analyse le processus créatif à
travers cinq phases – des phases dont l'ordre de succession et le nombre ne
sont toutefois pas immuables (7).
Quelles étapes Fantin-Latour a-t-il dû franchir pour parvenir à « laisser
éclater son sentiment particulier » dans sa dernière traduction du début de L'Or
du Rhin, la peinture Scène première
du Rheingold ? Comment ces différentes étapes
nous éclairent-elles sur ses intentions profondes ?
Les
étapes du processus créateur de Fantin-Latour
1. Première étape du processus créateur : le
saisissement créateur
La première étape du processus
créateur est d'une importance capitale. Didier Anzieu la nomme le
« saisissement créateur » :
Le sujet est saisi […] par une impression forte,
sensation […], émotion, sentiment, qui envahit l'esprit, et même l'âme,
c'est-à-dire le noyau de son être psychique (8).
Grâce aux lettres de Fantin-Latour écrites de Bayreuth,
il est possible d'analyser cette étape essentielle sur laquelle repose tout le
travail du peintre à venir. Nous avons évoqué, dans la première partie de notre
article, le choc émotionnel d'une rare intensité éprouvé par Fantin-Latour au
début de l'opéra, un choc retranscrit dans sa lettre à Edmond Maître. Citons de
nouveau le fragment concerné :
Oh, c'est très beau, unique. Rien n'est comme cela.
C'est une sensation pas éprouvée encore. […] Je n'ai rien dans mes souvenirs
féeriques, de plus beau, de plus réalisé. […] Là comme dans tout le reste,
c'est de la sensation, pas la musique, pas le décor, pas le sujet, mais un empoignement du
spectateur, c'est pas le mot qu'il faut, que spectateur, ni auditeur non plus,
c'est tout cela mêlé (9).
Par le terme d'« empoignement »,
Fantin-Latour ne peut mieux exprimer cet état de « saisissement » que
la musique, le décor et le sujet, dans leur totale fusion, ont provoqué en lui.
Désirant faire partager son émotion à son ami, il poursuit sa lettre en
décrivant le spectacle dans son évolution même, tel qu'il l'a perçu :
Le rideau s'écarte doucement et une
chose sans nom, obscure, vague, petit à petit verdâtre, s'éclairant tout
doucement, puis on aperçoit des roches, puis tout doucement des formes passent,
repassent, les Filles du Rhin dans le haut, dans le bas Alberich,
dans le fond des roches. Ces mouvements des Filles qui nagent en chantant, est
(sic) parfait, l'Alberich qui grimpe, qui ravit l'or,
l'éclairage, la lueur que jette l'or dans l'eau, est ravissante (10).
D'une musicalité évidente, la traduction en mots par
Fantin-Latour du début de L'Or du Rhin
parvient à nous faire presque ressentir ce que lui-même a éprouvé : à la fois
une progression simultanée de tous les éléments et un balancement. La
progression (suggérée par les adverbes « doucement », « petit à
petit », « puis », « puis tout doucement ») concerne
diverses perceptions : la perception des formes – qui vont de l'inconnu
(« une chose sans nom ») et de l'informe (« vague ») aux
formes minérales (les roches) et aux formes humaines (les Filles du Rhin, Alberich) ; la perception des couleurs – qui vont
de l' « obscur » au « verdâtre » et à « la lueur
[de] l'or » ; la perception du rythme – d'abord très doux, puis de
plus en plus rapide (les « Filles qui nagent », « l'Alberich qui grimpe, qui ravit l'or »).
Quant aux oppositions, elles se jouent entre des
mouvements (« passent et repassent »), ou entre des espaces (le
« haut » pour les Filles du Rhin et « le bas » ou « le
fond » réservé à Alberich), ou entre des
sentiments (d'un côté la joie s'exprimant par le chant des Filles du Rhin et
« la lueur [ravissante] que jette l'or dans l'eau », de l'autre le
drame (provoqué par Alberich qui « ravit
l'or »). Mais sans doute est-il révélateur que le peintre utilise le même
terme, « ravir » et « ravissante », dans deux sens opposés,
l'un négatif (le rapt de l'or) et l'autre positif (au sens de magnifique), et
surtout, qu'il déplace l'ordre des
événements en terminant son évocation par « la lueur ravissante que jette
l'or dans l'eau », juste après avoir évoqué le ravissement (ou rapt) de l'or par Alberich
qui, en réalité vient après et clôt la première scène de L'Or du Rhin dans l'obscurité totale ; comme si, pour
Fantin-Latour, la lumière devait l'emporter sur les ténèbres.
Comment ne pas faire le lien avec la lithographie que
nous avons analysée dans la première partie de notre article ! Déjà sont en
germe, dans cet extrait de lettre, l'idée de balancement entre des directions,
des actions ou des sentiments opposées et l'idée de progression de l'obscurité
à la lumière, cet aspect étant l'un des plus significatifs de l'ensemble des
variantes du peintre sur ce thème (nous allons le voir), mais surtout le plus
surprenant, la première scène de l'opéra se concluant par une obscurité
tragique.
L'inconscient de Fantin
affleure donc de manière évidente dans ce texte. Pour le peintre, la lumière
est le terme inéluctable d'une progression musicale qui a débuté avec le
Prélude. Comme l'écrit Catherine Clément à propos du Prélude de L'Or du Rhin :
Cela commence dans l'eau, eau profonde et noire. Des
notes très graves, tenues très longuement, puis un accord en arpège, puis
encore un autre, cela monte des profondeurs ; c'est d'en haut que vient la
clarté, une clarté indéfinissable (11).
Du Prélude de L'Or
du Rhin, Fantin-Latour a transcrit lui-même les sensations qu'il en avait
éprouvées, juste après la représentation de L'Or
du Rhin :
Le début du Rheingold à
l'orchestre, murmure sourd des eaux [...] comme des mugissements, (c'est
sonore et voilé) l'orchestre fait l'effet d'une seule voix, Orgue immense ! Oh,
c'est très beau, unique. Rien n'est comme cela. C'est une sensation pas
éprouvée encore (12).
La progression
relevée par le peintre – du « murmure sourd » et des « mugissements » jusqu'à
l'« orgue immense » – traduit sans doute l'expansion progressive des
registres, des timbres et des intensités à laquelle est associée l'idée de «
genèse, d'un monde en train de se constituer à partir du néant » (13). Et « l'effet
d'une seule voix » provient probablement de la trame statique du mi bémol de contrebasse tenu pendant
cent trente-huit mesures sur lequel l'accord se constitue progressivement, «
les entrées successives des instruments créant un tissu mouvant malgré une
apparence de surplace (14)
». C'est donc cette montée irrésistible vers la lumière, commencée au tout
début du Prélude de L'Or du Rhin (15), qui serait entrée
en résonance avec le « noyau psychique » de Fantin-Latour et qui
constituerait la véritable source de l'ensemble de ses œuvres sur ce thème.
Une vérification de la justesse de perception du
peintre pourrait venir de Jean Dauwen dans son
ouvrage La Gamme mystique de Richard
Wagner( 16). L'auteur y attire
l'attention sur « l'importance symbolique des degrés de la gamme »
dans l'œuvre de Wagner, la « note absolue » pouvant, selon lui,
l'emporter dans certains cas sur la tonalité. Comme exemple de prééminence de
note absolue, il cite, entre autres, le mi
bémol du Prélude de L'Or du Rhin
et, pour en préciser la signification symbolique, il se réfère à
« l'association degrés de la gamme / couleurs / symboles proposée par
Guido d'Arezzo » (17).
Sachant que, pour le célèbre moine bénédictin (18), le ré
représente « la lumière et la couleur jaune », le mi « le mouvement et
l'orangé », le mi bémol étant
« une combinaison entre le jaune de ré
et l'orangé de mi (lumière et
mouvement) », le symbolisme du début du Ring serait donc « le mouvement vers la lumière. Une prise de
conscience dynamique et évolutive » (19).
Comment le cheminement créateur de Fantin-Latour, à
travers les diverses variantes qu'il a réalisées d'après le début de L'Or du Rhin, corrobore-t-il cette
interprétation ?
2. L'étape de la conception : Esquisse pour les
Trois Filles du Rhin
Après
le « saisissement créateur », l'étape que l'on peut observer dans le
parcours créateur de Fantin-Latour, grâce à un petit dessin, est celle que l'on
nomme communément la conception. C'est, en quelque sorte, « le premier
moment de l'inspiration » (20).
Pour Paul Klee, la force créatrice est à son apogée. Il en parle encore comme
d'un « fulgurant éclair » et du « jaillissement idéel
primordial » (21).
Quant à Eugène Delacroix, il va plus loin en déclarant que « les premiers
linéaments par lesquels un maître habile indique sa pensée contiennent le germe
de tout ce que l'ouvrage présentera de saillant. […] Pour des yeux
intelligents, la vie est déjà partout, et rien dans le développement de ce
thème, en apparence si vague, ne s'écartera de cette conception, à peine éclose
au jour et complète déjà » (22).
Ce que Didier Anzieu précise encore en observant que ce que saisit le créateur
à cette phase, « grâce à l'acuité, la vivacité de l'attention », est
« une réalité psychique » (23).
En quoi le premier dessin de Fantin-Latour répond-il aux caractéristiques de la
conception telle que définie ici [Fig. 1] ?
 |
 |
| Fig. 1. Rheingold, dessin mis au carreau (24) | Fig. 2. Une construction en
arabesque
|
Conservé au Louvre (25), ce petit dessin portant l'inscription
« Rheingold »
est daté du 20 novembre 1876, quatre jours exactement après le mariage de
Fantin-Latour avec Victoria Dubourg (peintre et
pianiste) – mariage dont la date avait été retardée en raison du départ
précipité du peintre à Bayreuth ; nous y reviendrons. Au premier regard,
le dessin frappe par une agitation fébrile exprimant le jaillissement de
l'inspiration et témoignant de la rapidité avec laquelle le peintre a jeté son
idée sur le papier. Le paysage et les figures sont mis en scène essentiellement
par le jeu de hachures vigoureuses et multidirectionnelles, les corps étant
délimités grossièrement par un trait plus épais. L'ensemble correspond
toutefois aux sensations éprouvées par Fantin-Latour à Bayreuth telles qu'il
les a transmises dans sa lettre à Edmond Maître. On y observe en effet à la
fois le balancement des formes et la progression de l'ombre à la lumière, à
travers l'évocation du début de L'Or du Rhin.
Des profondeurs surgit le nain, la tête tournée vers
les ondines, une masse informe sombre prolongeant son buste. Plus haut, les
trois Filles du Rhin, dont les corps s'entrecroisent, évoluent en tous sens
dans un mouvement quasi tourbillonnaire. L'ondine inférieure plonge
précipitamment vers le nain un bras en avant, l'autre bras à l'oblique, alors
que sa sœur, dans la direction opposée, s'élance vers le sommet dans un
mouvement d'une grande fluidité, un bras en avant l'autre en arrière ;
enfin la troisième tout en haut, à demi allongée dans le sens inverse de sa
sœur, contemple, immobile, « la claire lumière » qui l'illumine.
Dans un format en hauteur qui ne tient pas compte de
l'espace scénique – preuve d'une certaine liberté du peintre vis à vis du
spectacle –, l'idée de la composition – la superposition de figures opposées et
le mouvement vers la lumière – est donc déjà « complète », « et
rien dans le développement de ce thème, en apparence si vague, ne s'écartera de
cette conception » tout au long des esquisses et œuvres achevées qui
suivront.
Que Fantin-Latour ait été satisfait de sa
représentation, la mise au carreau qu'il effectua de ce dessin en est la preuve
[Fig. 1] – la hauteur ainsi que la largeur sont divisées en quatre parties
selon le rapport 1,5/1. L'ordonnance des quatre figures ainsi se précise.
Peut-être même, une construction serpentine est-elle déjà sous-jacente [Fig. 2]
: prenant appui sur une ligne courbe stylisant le mouvement des flots dans la
partie inférieure du dessin et reliant le nain à l'ondine qui plonge, elle
semble envelopper au sommet l'ondine à demi allongée. De part et d'autre de
cette arabesque virtuelle et de la diagonale lui servant d'axe, s'inversent les
directions des corps et des têtes en une sorte de balancement rythmique accordé
au mouvement ondoyant des vagues que fait entendre la musique au début de la
scène première.
Ce dessin confirmerait ainsi « la réalité
psychique » entrevue dans l'extrait de lettre de Fantin,
une réalité qui se cache derrière le sujet de l'opéra, à savoir le mouvement de
la vie avec ses élans et retombées et son irrésistible ascension vers la
lumière. Cependant, pour comprendre le processus de traduction dans toute sa
complexité, l'ensemble des essais et réalisations de Fantin-Latour d'après le
début de L'Or du Rhin doit être
examiné. C'est à partir des divers ajustements effectués par le peintre dans
les versions suivantes que nous pourrons faire la part, en effet, de ce qui
relève de la fidélité au drame wagnérien ou de l'expression du propre
« moi » de l'artiste traducteur.
3. Première étape de la réalisation : du
croquis à l'huile et du calque à la lithographie (1876)
Au premier dessin ont succédé un
croquis à l'huile (26)
[Fig. 3] et un dessin sur papier calque (27) [Fig. 4] – tous deux disposés dans le même
sens que le dessin initial (Alberich est situé dans
le coin droit inférieur) –, et la première lithographie (28) [Fig. 5] – en
contrepartie (Alberich sous son rocher est dans le
coin gauche) –, première œuvre achevée sur ce thème. Le calque est daté du
« 11 décembre 1876 », quatre semaines exactement après le premier
dessin, et il est conservé au musée de Grenoble (29).
 |
 |
 |
| Fantin-Latour, Scène première du Rheingold | ||
| Fig. 3. Croquis à l'huile, 1876 | Fig. 4. Calque, 11/12/1876 | Fig. 5. Lithographie, 1876
|
Nous avons regroupé cet ensemble dans la première étape
de la réalisation pour deux raisons : les deux dessins sont très proches
de la lithographie – en dépit de l'inversion de l'image –, et surtout, la
pensée rationnelle, organisatrice, s'y manifeste de manière évidente dans les
trois œuvres, à travers un même schéma structurel. Pour Didier Anzieu, au cours
de cette troisième phase du travail créateur, se met en route « un
dynamisme organisateur » qui s'exprime au moyen d'un « schème »
constituant le « noyau générateur » de l'œuvre (30).
Une double structure
Dans le cas des trois œuvres ici
rassemblées, un schéma géométrique et symbolique reliant l'œuvre plastique à
son modèle wagnérien s'impose au regard. Il s'agit d'un anneau suggéré par la
forme de trois bras : les deux bras de l'ondine qui plonge et le bras arrière
de celle qui remonte le Rhin [Fig. 6-7-8] (31). La référence à L'Anneau du Nibelung ne fait ici aucun doute.
 |
 |
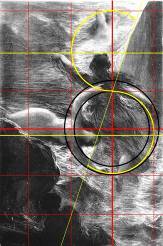 |
| Une double structure en anneau et en S | ||
| Fig. 6 | Fig. 7 | Fig. 8
|
Bien que la disposition générale des figures observée
dans le premier dessin ait été conservée en grande partie – la superposition de
figures opposées et la progression de l'ombre à la lumière –, des changements
importants sont donc intervenus dans la composition, notamment en ce qui
concerne les deux bras largement ouverts de l'ondine qui plonge – bras
dessinant désormais un arc de cercle sur le prolongement duquel se trouve le
bras arrière de sa sœur remontant le Rhin – et la nouvelle orientation de
l'ondine du sommet qui ne surplombe plus majestueusement la scène en position
demi allongée, mais poursuit l'ascension de sa sœur, toute livrée à la lumière
dont elle semble s'enivrer, la tête renversée en arrière.
C'est alors que l'anneau de la gravure – à l'image de
l'Anneau de l'opéra, moteur de toute l'action dramatique – devient le foyer
dynamique autour duquel se constitue une structure ondoyante en forme de S
supportant les mouvements « en cercles gracieux (32) » des trois
ondines [Fig. 6-7-8], une structure dynamique directement issue de la musique (33) – le motif
ondoyant des Filles du Rhin qui, à Bayreuth, dictait les mouvements parfaits
des ondines –, et pressentie dans le dessin initial. Cette structure
serpentine, inscrite dans un quadrillage parfaitement géométrique – mais sans
lien avec la mise au carreau du dessin initial –, emprunte la courbe de la
portion d'anneau qui prolonge le bras de l'ondine plongeant et contient le bras
arrière de celle remontant le Rhin, puis s'inverse dans la partie supérieure en
enveloppant le corps de l'ondine du sommet.
Ce qui unit les trois œuvres
envisagées ici est donc la forte présence de la structure annulaire (absente du
premier dessin) et la structure en S qui en jaillit. Grâce à cette double
structure servant de soubassement aux mouvements des trois ondines, le peintre,
tout en respectant son intuition première – la progression vers la lumière –, a
pu joindre les sensations musicales et visuelles qu'il avait éprouvées lors du
spectacle à la signification même de l'œuvre wagnérienne.
Le premier niveau
de signification : la mise en abyme de L'Anneau du Nibelung
Comment la double structure intervient-elle dans la
signification de l'image ? Nous l'avons montré dans la première partie de
notre article : d'une part, en attribuant à l'ondine qui plonge avec
l'anneau entre ses bras la responsabilité d'avoir livré l'or au nain ;
d'autre part, en conférant à l'ondine qui remonte le Rhin, l'un de ses bras lié
à l'anneau, le rôle de Flosshilde qui, à la fin
du Crépuscule des dieux, récupère
l'anneau pour le restituer au Rhin afin que l'or y brille de nouveau. Grâce à
la découverte de la structure interne, on comprend alors que la représentation
gravée prend en compte la totalité de L'Anneau
du Nibelung, et pas seulement la première scène de L'Or du Rhin comme pourrait le laisser entendre le titre attribué à
l'œuvre (34).
Une confirmation de cette interprétation pourrait venir
du choix des motifs musicaux associés à chacune des ondines (35) – le motif de l'Or
pour l'ondine en extase, le motif du Rhin pour l'ondine qui remonte le Rhin, le
motif de l'Anneau pour celle qui plonge vers le nain –, motifs dont les
dénominations sont constitutives du titre même de l'opéra (L'Or du Rhin et le Ring).
D'une manière particulièrement subtile, témoignant d'une rare pénétration de
l'œuvre wagnérienne, Fantin-Latour désignerait ainsi le contenu synthétique de
sa gravure (36).
Mais qu'en est-il du Nibelung dans les deux croquis et
la gravure ? A-t-il été affecté, lui aussi, par la mise en place de la
structure annulaire ? Dans le premier dessin, l'environnement du nain demeurait
imprécis. Dans les deux croquis et la lithographie qui sont examinés
maintenant, le nain, toujours ramassé sur lui-même, la tête tournée vers les
Filles du Rhin, surgit d'une caverne dont l'ouverture épouse une forme
semi-circulaire évoquant un rouleau de vague se retournant. Aussi le nain, tapi
à l'entrée voûtée de la « crevasse ténébreuse », son corps enroulé
sur lui-même, participe-t-il du tourbillon généralisé de la composition, et
même, pourrait-il apparaitre comme celui qui donne l'impulsion première au
tournoiement des ondines.
En liant structurellement le nain au groupe des ondines
– comme cela était déjà suggéré dans le dessin initial par la ligne courbe
imitant les flots –, le peintre n'assure pas seulement l'unité formelle de sa
composition ; il induit en outre l'idée d'un mouvement ininterrompu qui
« peut toujours repartir au commencement, se transformer en son contraire »
(37). Cette idée, qui
reflète l'essence même du drame wagnérien – comme nous l'avons montré dans la
première partie de notre article –, est renforcée par le prolongement virtuel
de la structure serpentine en deçà du S jaillissant de l'anneau (jusqu'à l'abri
voûté du nain), voire au-delà (la tête renversée en arrière de l'ondine du
sommet amorce en effet un mouvement ascendant en sens contraire).
Soulignons cependant que la courbe
de la caverne n'entre pas dans la perfection géométrique du quadrillage où
s'inscrit la structure ondoyante qui, rappelons-le, est liée uniquement au
motif des Filles du Rhin. Le monde du nain et celui des ondines sont en effet
deux mondes totalement différents, y compris musicalement (38). Un schéma de
construction le met en évidence. Il s'agit d'un losange asymétrique [Fig. 9]
qui prend appui sur l'horizontale d'or (39) et l'axe vertical principal, l'un des
côtés du losange séparant le domaine du nain de celui des ondines, un autre en
haut délimitant des mamelons rocheux s'étageant dans le lointain. À l'intérieur
du lumineux losange sont réunies les Filles du Rhin dont les principales
directions des corps ou des membres s'accordent aux axes et aux côtés du
losange ; à l'extérieur du losange, au sein d'un triangle obscur, se
trouve le Nibelung difforme dans son antre chaotique.

Fig.
9. Une composition en losange
Conférant une grande harmonie à la lithographie, la
forme en losange n'est pas sans signification. Le losange,
en effet,
représente symboliquement la vulve (40)
(le
symbolisme en est connue dès la période magdalénienne) et, en conséquence, la matrice de
la vie, une vie qui ne finit jamais – la guirlande d'algues tenue
entre les mains de l'ondine remontant le Rhin en est le symbole (41).
L'idée
de Genèse en tant qu'essence de l'Anneau
du Nibelung est donc ici confirmée. La signification de la composition losangée
complète ainsi celle de la structure interne – le S jaillissant de l'anneau –,
mais « déplace » toutefois la signification sur un autre aspect
de l'œuvre wagnérienne dont l'importance est indéniable, la dimension sexuelle (42).
La première œuvre achevée : quatrième
phase du travail créateur
Si
Fantin-Latour, dans cet ensemble peint, dessiné et gravé, a cherché à
être le plus fidèle possible au contenu expressif et sémantique du drame
musical wagnérien, il faut cependant différencier l'exécution de lithographie
de celle des deux essais qui l'ont précédée : l'un plus abstrait
(l'esquisse à l'huile) – les formes traitées par plans schématiques de
différentes valeurs préfigurent le cubisme –, l'autre épuré et précis (le
dessin sur papier calque), animé d'un grand souffle rythmique le traversant de
part en part.
Avec la lithographie, première œuvre achevée d'après le
début de L'Or du Rhin, Fantin-Latour
conserve les qualités de l'un et l'autre essais, mais s'attache en outre à
donner aux formes toute leur plénitude. Nous avons vu aussi qu'un élément
nouveau apparaissait, quoique discret : une guirlande d'algues tenue entre les
mains de l'ondine intermédiaire.
En exploitant au maximum les ressources de son art, le
peintre franchit alors une phase supplémentaire dans son processus créatif, la
quatrième, celle de « la composition proprement dite » selon Didier
Anzieu, mais que nous considérons dans le cadre de notre analyse comme faisant
partie de la première étape de la réalisation (ou encore du premier niveau de
signification et d'exécution) – la seconde étape (ou le second niveau
d'exécution et de signification), qui est celle de l'aboutissement du projet
initial du peintre, étant constituée, selon nous, par la peinture de 1888.
D'après le psychologue psychanalyste, cette phase
relève plus généralement « des tâches de confection » et concerne notamment
« l'agencement interne des parties dans une organisation d'ensemble de
l'œuvre achevée » (43).
Paul Klee en parle lui-même comme de « la production de la forme »,
ou encore, de manière imagée, « la charnelle croissance de l'œuf » (44). Pour cet artiste,
afin d'éviter un trajet trop uniforme dans le parcours créateur, le chemin doit
alors « gagner en complexité, se ramifier de manière excitante » (45).
Dans la lithographie, d'une exécution particulièrement
aboutie, on relèvera surtout l'intensification du dialogue entre les figures et
la nature. On a déjà souligné le lien entre le nain et le rocher qui le
surplombe : un même aspect ténébreux et chaotique qui tend à les
confondre. À la limite supérieure de la caverne, se glisse l'ondine nue qui
plonge vers le nain, son corps au modelé parfait étant partagé entre ombre et
lumière et ses bras ouverts en arc faisant écho à la voûte semi-circulaire de
la crevasse. Entre l'ondine et le nain, les flots animés des reflets
prismatiques du soleil jouant avec les vagues et les remous provoqués par le
relief accidenté du fond pourraient faire écho au caractère mouvementé de leurs
échanges. Au-dessus de cette même ondine, un autre monde se déploie. Les stries
régulières des eaux immobiles invitent à la paix et à la contemplation. Vers ce
monde allégé, comme suspendu, s'élance l'ondine remontant le Rhin, qui relie le
bas et le haut, tout en déployant une guirlande d'algues. À sa droite, un récif
imposant se dresse tout droit vers le sommet avec le même élan que celui qui
l'anime. S'orientant dans le sens opposé au récif, elle tend son bras en avant
vers un lointain où s'étagent, en plans successifs, d'autres rochers aux formes
moins distinctes, auréolés de lumière. Sur le même plan et à l'opposé, l'ondine
en extase émerge peu à peu des flots en s'éloignant vers l'infini par une
brèche où l'eau et la lumière se confondent.
Ainsi, le paysage, en rapport étroit avec les figures –
aux niveaux formel, psychologique et spirituel –, contribue-t-il à mettre en
valeur la progression qui, du monde des ténèbres, en bas, aboutit au monde de
la lumière, en haut, les différents niveaux étant reliés les uns aux autres et
s'engendrant mutuellement par les rebonds successifs de la structure spiralée
sous-jacente. L'idée première du peintre que nous avons pressentie dans son
dessin initial est donc toujours bien présente dans la gravure. Cependant, la
volonté du peintre de rendre avant tout « l'esprit » de Wagner domine
ici nettement.
En effet, d'une grande force et d'une intense vie
intérieure grâce à son exécution, la gravure Scène première du Rheingold de
Fantin-Latour, en dehors même de sa structure annulaire directement issue de
l'opéra, est traversée par une sorte de "sève" wagnérienne. Bien des
amateurs de Wagner ayant admiré les lithographies wagnériennes du peintre l'ont
perçue. Si Mallarmé, auquel Fantin-Latour avait offert sa gravure, considérait
« avec émerveillement […] la façon dont tout était vu à travers la
musique » (46),
plus tard, Teodor de Wyzewa
(1862-1917) loua sans réserve les lithographies de Fantin-Latour, « d'un
métier admirable, si profondément wagnériennes
par l'harmonieuse sensualité de lignes à la fois indécises et pures » (47), qui parviennent à
« rendre le sens profond de la scène et du drame en entier »,
ajoutant que « s'il les eût connues, Richard Wagner […] les eut trouvées
un hommage digne de sa grande âme » (48). En réalité, largement diffusées, les
gravures de Fantin reçurent un « véritable brevet de
wagnérisme » (49)
de la part du fils même de Wagner, Siegfried Wagner. Probablement au marchand
de Fantin, Tempelaere, il écrivit en effet le 23 janvier
1903 :
Je suppose que vous ne me demandez pas mon
avis sur les illustrations des œuvres de mon père par M. Fantin-Latour, car
depuis bon nombre d'années, elles occupent un rang parmi les compositions de ce
genre les mieux appréciées et les plus renommées (50).
4. Seconde étape de la réalisation : du
croquis à l'huile et du pastel (1876) à la peinture à l'huile (1888)
Après la mise en place du schème
structurel symbolisant l'essence de l'œuvre wagnérienne – le S jaillissant de
l'anneau – et la réalisation de la première œuvre achevée dans une technique
très élaborée – la lithographie de 1876 –, Fantin-Latour aborde la couleur dans
trois autres œuvres : un croquis à l'huile daté de 1876 (51) [Fig. 10], un
pastel de la fin de la même année (52)
[Fig. 11] – tous deux proches par leurs dimensions de la lithographie –, et une peinture à l'huile datée de
1888, aux dimensions beaucoup plus importantes (53) [Fig. 12], sans doute l'image la plus
célèbre du Ring de Fantin, conservée au Hamburger Kunsthalle
de Hambourg. Comment cette dernière œuvre constitue-t-elle l'aboutissement du
projet initial du peintre né lors de la représentation de la Tétralogie à
Bayreuth en 1876 (54) ?
 |
 |
 |
| Fantin-Latour, Scène première du Rheingold | ||
| Fig. 10. Croquis à l'huile, 1876 | Fig. 11. Pastel, 1876-1877 | Fig. 12. Peinture à l'huile, 1888 |
Baignant dans des harmonies colorées très différentes,
les œuvres que nous abordons maintenant – toutes dans le même sens que la
lithographie –, et l'ensemble que nous avons examiné précédemment, si l'on s'en
tient uniquement à l'ordonnance générale des formes, frappent davantage par
leurs ressemblances que par leurs différences. C'est à scruter plus
attentivement la structure interne des œuvres de ce nouvel ensemble qu'une différence majeure apparaît : la suppression de
la structure annulaire. Les deux bras de l'ondine qui plonge et le bras arrière
de celle qui remonte le Rhin ne constituent plus un anneau et la main
supérieure de l'ondine qui plonge n'est plus dirigée vers l'Or qui brille au
sommet mais vers le nain avec lequel elle converse (55).
L'ondine qui plonge est donc libérée du poids
dramatique qu'elle recélait dans la lithographie avec son bras levé, lourd de
gravité, et elle contribue ainsi largement au changement de caractère, surtout
dans le pastel et la peinture. Dans ces deux œuvres, l'ondine vêtue déploie en
outre une guirlande d'algues très nettement incurvée qui semble se substituer à
l'anneau, comme si l'alliance avec la vie qui ne finit pas – symbolisée par
l'algue (56) – avait supplanté
à jamais la malédiction de l'anneau. Pleine d'allégresse, cette ondine se
retourne vers le nain avec une expression souriante, voire moqueuse, alors que
dans le croquis à l'huile, l'ondine qui remonte le Rhin regarde toujours droit
devant elle et ne porte pas de guirlande d'algues ; cette esquisse
représente donc bien une étape intermédiaire.
Une composition musicale
En abordant la couleur, très peu de
temps après la réalisation de la gravure, Fantin-Latour abandonne donc la
structure annulaire, probablement parce que la couleur, langage par excellence
de l'affectivité, a poussé le peintre à vouloir exprimer sa propre sensibilité.
Il conserve en revanche la structure serpentine mise en place dans la gravure,
structure issue du motif ondoyant et gracieux des Filles du Rhin [Ex. 1] (57), et servant de
soubassement aux mouvements des ondines [Fig. 13, 14, 15].
 |
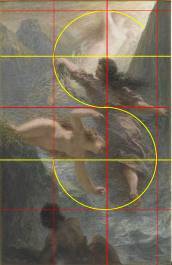 |
 |
| Une structure serpentine | ||
| Fig. 13 | Fig. 14 | Fig. 15 |
![]()

Ex. 1. Du motif des
Filles du Rhin au schéma en S de la structure plastique
S'inscrivant dans un quadrillage rigoureux, le schéma
en S entretient cependant avec les figures un rapport différent de celui de la
gravure [Fig. 8], d'une aisance et d'une élégance nouvelles, surtout dans la
peinture. On observe en effet un nouveau rapport entre les formes, une aération
nouvelle entre elles – le rôle de la guirlande est ici primordial (58) –, et un
enchaînement beaucoup plus satisfaisant entre les trois ondines – le geste de Flosshilde se retournant et le lien créé par la guirlande
sont à cet égard importants –, tout cela contribuant largement à l'harmonie
voire à la musicalité de la composition (59).
Rappelons que pour le peintre
Hogarth, la ligne en S, qualifiée par lui de « ligne serpentine » ou
« ligne ondoyante » selon qu'elle se déploie dans un espace à trois
dimensions ou qu'elle se dessine sur un plan, est le tracé le plus accompli.
Dans The Analysis
of Beauty, il qualifie ce tracé de « ligne de grâce » ou de
« ligne de beauté » (60).
Dans la peinture, plus encore que dans le pastel, l'harmonieux déploiement de
la ligne S autour des figures mérite tout à fait l'appellation de « ligne
de grâce », et elle est à l'évidence la clé de l'harmonie.
Outre la structure ondoyante, les gestes des ondines
concourent, eux aussi, à la musicalité de l'œuvre, Fantin-Latour imitant
toujours les effets de motifs musicaux entendus au début de L'Or du Rhin pour donner vie à chacune
des ondines. L'une d'entre elles se modèle sur le même extrait musical que dans
la lithographie : la Fille du Rhin planant au sommet de l'image et
s'enivrant des rayons de l'or qui renvoie au fragment musical débutant le
troisième épisode, l'un des fragments les plus "impressionnistes" de
l'opéra. Nous avons vu, dans notre précédent article (61), comment Wagner y
dépeint le moment où une lumière féerique
et dorée irradie progressivement les flots. La progression sonore qui le
suggère, Fantin-Latour a cherché à la reproduire
dans la partie supérieure de la peinture. Une progression colorée
extrêmement subtile conduit en effet le regard, de la pointe du pied de
l'ondine posée sur l'eau immobile à sa gorge où le doré s'éclaircit jusqu'au
blanc, en passant par les fines irisations colorées de ses draperies dont les
plis s'accentuent sur les hanches, à la manière des oscillations des violons
qui s'amplifient. Tout en haut, la lumière éclatante de l'astre invisible darde
la pluie fine de ses rayons d'or qui éblouissent l'ondine et pénètrent l'espace
aquatique, imitant l'effet de ruissellement sonore produit par les oscillations
des violons dans l'aigu qui accompagnent la fanfare éclatante de l'Or à la
trompette.
Pour les deux autres figures
féminines, les gestes et attitudes – qui comportent davantage de modifications
– se modèlent sur d'autres fragments musicaux que ceux des mêmes figures dans
la gravure. Ainsi le sourire autant que l'allure dansante de Flosshilde entrent-ils en résonance avec la fin du deuxième
épisode au cours duquel les trois filles réunies se moquent d'Alberich en chantant en chœur sur des onomatopées : Wallala ! Lalaleia !
Leialaleil ! [Ex. 2]. Leur chant plein d'élan
rappelle le motif ascendant et arpégé du Rhin – le rythme deux doubles croches-noire pointée donnant un
vigoureux élan aux Wallala –, et il est accompagné du motif des
Filles du Rhin et de celui des Flots ondoyants, comme au début de la
scène première (62).
À divers moments du quatrième épisode, ce motif varié du Rhin, plein
d'allégresse, réapparaît, tel un refrain, toujours avec le même rythme et sur
les mêmes onomatopées, ce qui peut justifier que le peintre s'en soit inspiré
pour insuffler à l'ondine son dynamisme joyeux.

Ex. 2. Les
moqueries des Filles du Rhin
Quant à l'ondine qui plonge, d'une
délicatesse extrême dans ses gestes – surtout dans la peinture où elle est
particulièrement sensuelle avec sa chevelure frisée abondante et rousse, son
court drapé de même couleur ainsi que sa poitrine frémissante –, elle pourrait rappeler Wellgunde
dans le deuxième épisode de la scène première lorsqu'elle feint d'être
amoureuse du nain [Ex. 3]. S'étant laissée
glisser sur un récif profond, elle l'appelle : « Holà ! Doux
ami ! / Ne m'entends-tu pas ? ». La nuance pp et les grands sauts intervalliques
prêtent à Wellgunde un caractère maniéré qui concorde
parfaitement avec la représentation de l'ondine dans la peinture.

Ex. 3. La séduction
de Wellgunde
L'imitation des effets de certains motifs ou fragments
musicaux n'est cependant pas le seul moyen utilisé par le peintre pour
insuffler la vie aux trois ondines et musicaliser l'image. Le « profil
vocal et psychologique » de chacune des Filles du Rhin dans l'opéra (63) l'inspire
également, non plus pour les gestes, mais pour le choix des couleurs dont les
ondines sont parées dans la peinture. Ainsi Flosshilde,
à la voix d'alto « profonde et grave », la plus « consciente de
sa mission », est-elle revêtue dans le tableau d'une longue robe
« violette couleur de crépuscule (64) » où s'entrelacent le bleu et le
rouge (65), alors que Wellgunde, « la plus séductrice », dont la voix
de mezzo se singularise par une « couleur ambrée et sensuelle »,
revêt dans la peinture une draperie rousse et une abondante chevelure de même
couleur, particulièrement sensuelle. Quant à Woglinde,
« la plus insouciante », dont la voix de soprano se caractérise par
un « timbre lumineux et cristallin », elle entre en résonance avec
l'ondine couleur or qui fusionne avec la lumière au sommet de la peinture et
dont les draperies légères et transparentes ont un effet quasi cristallin.
Par la couleur, Fantin-Latour harmonise en outre la composition.
D'une palette beaucoup plus riche que dans le pastel, la peinture est baignée
dans une harmonie générale vert et or, non sans rapport avec le spectacle de
Bayreuth décrit par Fantin dans sa lettre à son ami
Edmond Maître – « une chose […] petit à petit verdâtre, s'éclairant tout
doucement », « la lueur ravissante que jette l'or dans l'eau ». Une
technique par petites touches de couleurs essentiellement complémentaires (de
primaires et de binaires) qui s'entrelacent les unes avec les autres, permet en
outre des modulations très subtiles tout en créant un effet vibratoire
généralisé. Dans le paysage autour des ondines, une progression colorée et
lumineuse très graduée va du brun sombre en bas, au jaune et blanc lumineux en
haut, en passant par des tons intermédiaires mêlant le brun, le vert et le
jaune pour le récif, et les mêmes couleurs baissées de tons pour les reliefs du
fond. Quant aux quatre figures évoquées précédemment, bien mises en valeur par
leur coloris dominants contrastés (brun cuivré, roux, violet, or), elles
composent un accord coloré d'une richesse de vibrations exceptionnelle qui
concourt, avec le balancement harmonieux des formes, à la musicalité de
l'œuvre.
La signification dans le contexte wagnérien
Mais qu'en est-il de la signification ? En raison
de la suppression de la structure annulaire, la signification du pastel et de
la peinture n'est plus la même que dans la gravure, le lien avec l'opéra est
plus faible et le contenu apparent beaucoup plus mince : il se limite strictement
au tout début de la scène première – le jeu de séduction/répulsion entre les
ondines et le nain, les moqueries des Filles du Rhin vis à vis du nain,
l'adoration de l'or du Rhin –, excluant totalement le quatrième épisode où il
est question de l'anneau. Aussi, le sujet du drame wagnérien semble-t-il ici
plutôt insignifiant.
En intitulant son pastel « Souvenir de
Bayreuth » (66),
Fantin-Latour laisse entendre lui-même qu'il ne prétend pas à une restitution
fidèle de ce qu'il a vu et entendu. Lorsqu'il reprend douze années plus tard le
même sujet dans une peinture à l'huile de grandes dimensions, le souvenir de
Bayreuth est encore plus lointain. S'y mêle, à l'évidence, sa propre
interprétation.
Pourtant, la musique de la première scène de L'Or du Rhin, Fantin-Latour n'avait
probablement pas cessé de l'entendre, que ce soit en concerts (67) ou dans
l'intimité, comme l'attestent, dans la peinture, l'effet synesthésique
des couleurs revêtues par les ondines en relation avec les timbres de voix de
chacune des Filles du Rhin dans l'opéra, ou encore, l'expression des gestes des
ondines calquée sur les effets de certains motifs musicaux. Rappelons, en
outre, que dans les années 1885-1888, Fantin-Latour fréquentait le Petit
Bayreuth et participait à la Revue
wagnérienne (68). Sa passion pour
Wagner était donc toujours aussi vive et ses connaissances de la musique
wagnérienne n'avaient pu que s'accroître.
Il est facile d'imaginer cependant qu'assister au
festival de Bayreuth et entendre un extrait d'opéra en concert ou dans
l'intimité ne produisent pas le même effet sur l'auditeur. Par ailleurs, le
contexte en 1888 n'était plus le même qu'en 1876. Au "wagnérisme
militant" des années 1860 et 1870, faisait place, désormais, le
"wagnérisme triomphant", qui allait contribuer au développement du
mouvement symboliste en France. Dans cette voie, Fantin-Latour s'engage lui
aussi. Au Salon de 1888 où il exposait sa peinture, de nombreux critiques
estimèrent même qu'il était le seul « symboliste pur » du Salon (69).
Quand l'on compare le traitement du paysage dans le
pastel et la peinture, on constate en effet que dans le premier, la
représentation de la nature est fidèle à la réalité – Fantin-Latour y traduit
notamment les transparences de l'eau et ses reflets dans une manière proche de
l'impressionnisme alors en plein essor (70) –, alors que dans la seconde, le rêve et
l'imaginaire ont pris nettement le pas sur le réel (71). L'harmonie vert et or observée
précédemment acquiert ici une valeur symbolique. Gustave Geffroy, qui admira
« la science profonde de coloriste » de Fantin-Latour, évoque
notamment « cet or vert triomphal et mélancolique » (72).
Aussi la peinture nous met-elle face à un paradoxe.
D'une évidente musicalité, qui tient en grande partie à l'imitation des effets
de la musique de Wagner, le tableau, contrairement à la gravure, ne fait pas
résonner en nous la musique de Wagner. Une autre musique s'y fait entendre, une
musique où l'on reconnaît la voix du peintre, ou mieux, son âme. D'une certaine
manière, Fantin-Latour détournerait donc la musique de Wagner au profit de
l'expression de son propre sentiment (73).
Avec la peinture Scène première du Rheingold, il réaliserait alors un rêve qu'il avait confié à son ami Edwards vingt-quatre
ans auparavant, en 1864, après l'audition de l'Ouverture du Vaisseau Fantôme : « Oh ! quelle
belle chose que de [...] donner sa pensée, son suprême idéal, dire ce que l'on
ne peut dire avec la voix ! » (74)
Sa satisfaction à l'égard de son tableau pourrait le confirmer. À Madame
Edwards, il écrit en effet, le 26 novembre 1891 : « J'ai bien envie de
tenter l'exposition des Filles du Rhin,
à l'exposition de Glasgow [...]. C'est un milieu bien artistique, et mon
tableau est celui que je préfère de tout ce que j'ai fait dans ce genre » (75). Quel est donc le
« sujet intérieur » de la peinture qui « double » le sujet
wagnérien ? C'est ce que nous allons tenter de décrypter.
Le « sujet intérieur » de la peinture
Si la peinture est plus libre par rapport à Wagner et
d'une harmonie formelle supérieure à la gravure et au pastel, elle a en outre
la capacité de parler « aux
yeux de tout homme doué de sensibilité et d'intelligence ». Aucune connaissance
wagnérienne n'est requise pour la comprendre. Ici, Fantin-Latour semble revenir
à son intuition première née de la musique seule, une intuition que nous avions
devinée à travers l'extrait de lettre écrite de Bayreuth par le peintre,
confirmée par son premier dessin, et qui a trouvé comme une justification dans
le symbolisme du mi bémol au début du
Ring qui serait « le mouvement
vers la lumière. Une prise de conscience dynamique et évolutive ».
En effet, avec la peinture des Filles du Rhin, le « mouvement vers la lumière »,
particulièrement saisissant, entre immédiatement en résonance, pour quiconque contemple
l'œuvre, avec une aspiration inscrite au plus intime de l'être, et les
différentes figures s'étageant du bas vers le haut selon des directions
opposées apparaissent comme autant d'étapes ou de « prises de
conscience » sur le chemin de l'évolution.
Bien des auteurs ont tenté de décrire les étapes du
cheminement de l'être humain au cours de son existence. C'est le cas de Paul Diel (1893-1972), dont « la grande originalité est
d'avoir traduit les récits mythologiques et leurs images symboliques en termes
de fonctionnement psychique » (76).
L'un de ses ouvrages, Le Symbolisme dans la mythologie grecque (77), peut alors
éclairer la peinture Scène première du Rheingold, celle-ci paraissant même illustrer, et de
manière troublante, le fonctionnement évolutif de la psyché tel que le
psychologue-philosophe l'a analysé trois quarts de siècle plus tard. Essayons
de le montrer.
Aux quatre figures réunies dans la peinture
correspondent en effet les quatre instances psychiques reconnues par Paul Die (78) : l'inconscient
étant personnifié par le nain, le subconscient par l'ondine plongeant vers le
nain, le conscient par l'ondine qui remonte le Rhin tout en veillant à sa sœur,
et le surconscient par l'ondine en extase.
Divers symboles confirment leur identification :
l'inconscient et ses dangers sont associés à la figure monstrueuse du nain
« noir », qui « surgit de l'abîme […] tout environné
d'obscurité » (79),
alors que la fonction surconsciente est signifiée par
l'éclatante lumière d'or – reflet de la lumière céleste – se déversant
sur l'ondine qui s'enivre de ses rayons.
Au centre, se trouvent les deux ondines personnifiant
le conscient et le subconscient. C'est le lieu du « conflit essentiel de
l'âme humaine, le combat entre spiritualisation et pervertissement » (80). Flosshilde, la femme-héroïne (81), figure « l'élan évolutif vers la
spiritualisation ». Telle une flamme montant vers le ciel, elle est au
service de « l'esprit illuminant » incarnée par l'ondine du sommet
qui fusionne avec la lumière (résultat de la « sublimation ») et
cherche à entrainer dans son élan sa sœur aux seins nus attirée vers le bas par
le monstre séduisant, victime qu'elle est de son « imagination erronée et
exaltée ». Le conflit intrapsychique est signifié par le double mouvement
de chute et d'élévation de ces deux ondines et par l'ondine se retournant.
Chaque changement d'orientation des figures correspond
à une transformation de l'énergie psychique : l'exaltation pour l'ondine
qui plonge vers le nain, la spiritualisation et la sublimation pour les deux
ondines qui s'élèvent. L'harmonisation des pulsions – traduite par
l'harmonie de la composition –, « tâche essentielle de tout être
humain », apparaît comme le « sens ultime de la vie », et elle
« conduit vers la joie la plus intense », ce que manifeste dans la
peinture l'ondine du sommet s'enivrant des rayons d'or.
Pour accomplir son mouvement ascensionnel, l'être
humain doit donc passer de l'obscurité des instincts et de l'exaltation
des désirs, à la lucidité de l'intelligence, et jusqu'à son sommet spirituel
qui provoque l'éblouissement. Tel pourrait être « le sujet
intérieur » qui « double » le sujet wagnérien dans la peinture
des Filles du Rhin.
Mais ce « chemin d'ascension
évolutive » que l'être conscient poursuit à travers « les cycles
d'élévations et de chutes qui se répètent » (82), Fantin-Latour l'a d'abord expérimenté
dans sa propre vie. Ayant dû affronter dans sa jeunesse un dur « débat
entre la vie humaine et la vie artistique » (83), il s'est livré, à travers sa correspondance
des années 1859-1864 et une série importante d'autoportraits [Fig. 16-17], à
une introspection extrêmement lucide et sans concession.
 |
 |
| Fig. 16. Autoportrait, vers 1860 (84) | Fig. 17. Autoportrait, 1861 (85)
|
Un ensemble de dessins sur le thème
des Vanités [Fig. 18] et sur celui de
la Vérité [Fig. 19] témoignent
également du conflit intrapsychique de Fantin-Latour durant ces mêmes années.
 |
 |
| Fig. 18. Vanités, 1865 (86) | Fig. 19. Le Toast, la Vérité, 1864 (87)
|
Fréquentant au même moment avec
passion les lieux où l'on jouait de la musique, celle-ci a été pour lui la
« force harmonisante » de sa vie, le
guidant dans son « combat évolutif » jusqu'à ce qu'il parvienne à une
vie de plus en plus harmonieuse, après une période d'apprentissage de la solitude
(88) et son mariage en
novembre 1876 (à l'âge de 40 ans) avec Victoria Dubourg,
peintre et musicienne, peu après son retour de Bayreuth.
Que Fantin-Latour ait choisi de
traduire le début de L'Or du Rhin peu
de temps après son mariage, cela n'est pas sans signification. Sous ce nouvel
éclairage, les trois ondines pourraient alors renvoyer aux trois formes d'amour
que les anciens Grecs désignaient par les mots éros, c'est-à-dire le plaisir
charnel – symbolisé ici par l'ondine très sensuelle qui cherche à séduire le
nain –, philia ou l'amour bienveillant – signifié par
l'ondine du centre, attentive à sa sœur –, agapè ou l'amour divin,
incarné par l'ondine en extase au sommet de la peinture (89). Le thème est
récurrent dans l'œuvre féerique de Fantin-Latour. D'une certaine manière, on
pourrait même voir dans Alberich, l'image du peintre
contemplant le ballet des ondines (90),
celui-ci représentant la réconciliation de toutes les formes de l'amour, une
réconciliation qui devait se réaliser, selon le peintre, grâce au mariage.
Outre la vie psychique et affective
de Fantin-Latour, les Filles du Rhin
– expression utilisée par le peintre pour désigner son tableau – pourraient
refléter son travail créateur. On peut en effet voir en elles les
représentations allégoriques des trois niveaux de l'être – corps, esprit, âme –
à partir desquels l'artiste crée son œuvre et le récepteur la comprend.
L'hypothèse vient d'un entretien avec Camille Mauclair
au cours duquel le peintre fait référence aux trois dimensions physique,
rationnelle, spirituelle de la création artistique en analysant son processus
pour la réalisation des natures mortes et des portraits [Fig. 21]. Selon lui,
pour que les fleurs et les figures soient ressemblantes à leur modèle, il faut
les « exprimer dans un triple sens » : un sens physique (la
« réalité physique » ou « l'extérieur »), un sens rationnel
(« l'harmonie » des formes et des couleurs pour la nature morte, et
pour le portrait, l'expression de « ce que le modèle pense de soi »),
un sens spirituel (« l'intérieur »). À ce dernier stade, les fleurs
deviendront, selon Fantin-Latour, de « l'âme assimilée », et le
portrait devra faire « entendre » ce que le peintre « devine ou
suppose » de l'âme de son modèle, une âme qu'il définit lui-même comme « une
musique qui se joue derrière le rideau de chair ».

Fig. 21. Portrait de Charlotte Dubourg, 1882 (91)
Le travail créateur de l'artiste
suivrait donc un parcours identique à celui de la Vie : « de sa
donnée brute et élémentaire jusqu'à cette élaboration transcendante où il peut
trouver son suprême accomplissement » (92). Il mobilise aussi toutes les forces du
psychisme et s'accomplit par la synthèse des polarités énergétiques
antagonistes. René Huyghe évoque ce chemin de l'art dans Les Puissances de l'image :
On sait
maintenant que si le génie monte plus haut que les autres esprits, cette
extension repose sur les mêmes bases où survit l'animalité primitive. Sa force
n'est pas seulement de les dépasser, elle est parfois tout autant de savoir y
descendre pour y puiser la substance initiale afin de la remonter jusqu'au
sommet où elle sera élaborée et livrée au regard (93).
Georges
Braque le confirme :
Partir de la cendre, de ce qu'il y a de plus bas, de
plus inutile, et mener cela vers la lumière et la vie […]. Si l'on veut avoir
des chances de s'élever, il faut savoir partir du bas (94).
En définitive, qu'il s'agisse de l'Art ou de la Vie, la
tâche est toujours la même : « Conduire un être – l'œuvre d'art ou
nous-mêmes – de son minimum à son maximum d'existence, d'une base à son
sommet » (95).
Pour Fantin-Latour, le sommet est la Musique, que ce soit la musique de
quelques grands compositeurs qui l'ont enthousiasmé et qu'il a cherché à
traduire en gravure ou en peinture, la « musique » des fleurs et de
l'âme humaine, ou la « musique du tableau » (96) capable
d'enchanter le spectateur avant même qu'il en ait saisi le sujet. Pour
Fantin-Latour la musique est toujours la source et le terme de son art :
« J'y songe sans cesse en peignant » (97), déclarait-il.
Conclusion
Pour analyser le processus de traduction en art, et
plus précisément la traduction de la musique par la gravure et la peinture,
nous nous sommes référée au xixe siècle qui est la grande époque des
"correspondances" entre les arts et de "l'art total". L'un
des meilleurs témoins de ce temps est un peintre français, Henri Fantin-Latour
(1836-1904), ami des poètes et des musiciens, grand admirateur, entre autres,
de Baudelaire (98)
et de Wagner, et qui entreprit, selon ses termes, de traduire la poésie et la musique dans son art, notamment celle de
Wagner (99).
Bien d'autres peintres français du xixe siècle ont été
des mélomanes, voire des instrumentistes, et se sont inspirés de la musique
dans leurs peintures (Ingres, Delacroix, Corot, Cézanne, Degas, Renoir,
Gauguin, Denis, Lautrec…). Mais Fantin-Latour est sans aucun doute l'un de ceux
qui a eu le jugement le plus éclairé sur la musique de son temps et qui a
réalisé le plus grand nombre de traductions
de la musique (100).
Parmi les cinq compositeurs dont il a traduit les œuvres – Wagner, Berlioz,
Schumann, Brahms, Rossini, et Weber(101)
–, si notre choix s'est finalement porté sur la Scène première du Rheingold, c'est
essentiellement en raison de deux versions de cette œuvre qui nous donnaient la
possibilité de vérifier de la manière la plus convaincante les deux aspects
fondamentaux de toute traduction soulignés par Delacroix, à savoir, d'une part,
la fidélité à « l'esprit » de l'œuvre source, que nous pouvions
observer dans la première œuvre achevée sur ce thème, la gravure de 1876 ;
d'autre part, la liberté d'une expression personnelle, exprimée plus
particulièrement dans la dernière œuvre achevée sur ce même thème, la peinture
de 1888.
Deux méthodes d'analyse opposées ont permis cette
vérification : la première, « à rebours de la genèse de
l'œuvre » et aboutissant au dévoilement de la signification de l'Anneau du Nibelung ; la seconde,
dans le sens de la genèse de l'œuvre (102)
et révélant ce que Fantin-Latour a voulu exprimer de son propre univers
intérieur.
Cette seconde analyse, qui seule était capable de
démontrer la liberté de l'artiste vis à vis de son modèle, a été rendue
possible par les commentaires de Fantin-Latour après le spectacle à Bayreuth en
1876 et par un ensemble d'esquisses (au crayon et à l'huile) et d'œuvres
achevées (gravure, pastel et huile) nous offrant la possibilité de suivre les
différentes étapes du cheminement créateur, mais aussi par une première analyse
nous ayant permis d'entrer progressivement dans la pensée de l'artiste et de
découvrir notamment un schème en lequel se reconnaît tout vrai traducteur. Pour
Benjamin, en effet, la tâche principale du traducteur est la libération du
« germe » ou du « noyau essentiel » de l'œuvre source. Dans
la première scène de L'Or du Rhin,
nous avons montré que le motif ondoyant des Filles du Rhin ouvrant l'opéra a
constitué probablement pour Fantin-Latour ce germe qu'il a géométrisé dans un
schéma hautement symbolique en S vertical servant de soubassement à la
représentation figurée (103).
Traduire est en effet rationaliser. « Toute traduction apparaîtra toujours comme un peu plus claire que
l'original », écrit Albert Bensoussan. Brahms lui-même l'avait reconnu en
contemplant les dessins de Klinger accompagnant ses propres mélodies (104) : « En les contemplant, écrit-il, il me
semble que la musique continue à résonner dans l'infini et exprime ainsi tout
ce que j'aurais voulu dire, plus clairement que le pouvait la musique […].
Quelquefois je vous envie de pouvoir être aussi clair avec votre crayon. »
Traduire, c'est
aussi créer. Étienne Souriau le laisse entendre lorsqu'il évoque le travail du
graveur illustrant un poème : « […] il lui faudra inventer certaines choses, en oublier
d'autres, donc repenser artistiquement, selon ses normes propres, cet
univers » (105).
Car, comme le dit Fantin-Latour lui-même : « les arts ont une logique
qui leur est propre » (106).
Le changement de medium (ou de langue) implique nécessairement une sorte de
« trahison » de l'original (107).
Au-delà de la fidélité à son modèle, le traducteur a l'obligation d'être fidèle
aux lois propres à son art. Selon Benjamin, dans la traduction, il ne demeure
alors de l'original qu'un « point infiniment petit de sens » :
De même que la tangente ne touche le cercle que de
façon fugitive et en un seul point et que c'est ce contact, non le point, qui
lui assigne la loi selon laquelle elle poursuit à l'infini sa trajectoire,
ainsi la traduction touche l'original de façon fugitive et seulement dans le
point infiniment petit du sens, pour suivre ensuite sa trajectoire la plus
propre, selon la loi de la fidélité dans la liberté du mouvement langagier (108).
Ce
« point infiniment petit de sens » que la traduction ne fait que toucher pour « suivre ensuite sa
trajectoire la plus propre » est donc, selon nous, le « germe »
de l'Anneau du Nibelung traduit dans
la Scène première du Rheingold
de Fantin-Latour par un schème en S, à partir duquel l'œuvre plastique s'est
déployée « selon ses normes propres ».
Toutefois, pour sa traduction,
c'est en deux étapes que le peintre s'est hissé au niveau le plus élevé de sa
création personnelle (109).
En comparant la gravure et la peinture, on a pu constater en effet que la
première – qui associe un anneau à la structure en S –, témoigne avant tout de
l'admiration du peintre pour l'œuvre de Wagner, alors que la seconde – libérée
de l'anneau – se soutient seule, indépendamment de Wagner, et fait entendre sa
propre musique. Ces deux étapes distinctes peuvent trouver leur explication
dans ce qu'écrit Fantin à propos de ses
« esquisses » d'après les maîtres du passé : « On essaie
ainsi ses forces en se mettant dans les idées d'un autre avant d'avoir les
siennes (110). Dans la gravure Scène première du Rheingold,
Fantin-Latour aurait donc essayé ses forces
en se mettant dans les idées de
Wagner, avant de pouvoir, dans la peinture, « laisser éclater son
sentiment particulier », tout en se soumettant pleinement aux « lois
harmonieuses » de son art.
La gravure et la peinture ne sont pourtant pas sans lien
l'une avec l'autre. Au schème commun en S, une idée essentielle est associée :
celle d'un processus évolutif en tant qu'essence de l'art et de la vie. Mais
cette idée, qui s'origine dans la musique du début de l'opéra, c'est dans la
peinture qu'elle se manifeste avec le plus d'éclat, de légèreté et d'évidence,
débarrassée qu'elle est de tout le poids dramatique de l'opéra, et
« assimilée » entièrement par « l'âme » du peintre. Toute
traduction véritable, en effet, a la capacité d'être « relevante »
selon Jacques Derrida (111).
« En elle l'original croît et s'élève dans une atmosphère, pour ainsi dire plus
haute et plus pure du langage », confirme Benjamin (112). De son côté, la
peinture, en s'associant à la musique, acquiert « comme un surcroît
d'être » (113), s'enrichit d'une
musicalité nouvelle. C'est ce que l'on peut vérifier chaque fois que l'une des
muses – que ce soit la danse, la musique, la poésie, la gravure ou la peinture
– « saisit la main » d'une autre muse : « […] séparément [elles]
sont bornées à elle-même […] La seule action de saisir la main de l'autre les
élève, au-dessus de cette limite » (114).
(1)
La première partie de notre article est intitulée « Traduire le sujet,
l'expression et l'idée d'un art dans un autre art ».Voir L'Éducation musicale, Lettre
d'information, n° 101, mars 2016.
http://www.leducation-musicale.com/
(2) Eugène Delacroix, « Gravure », Dictionnaire des Beaux-Arts, 25 janvier
1857. Reconstitution et édition par Anne Larue, Paris, Hermann, 1996, p. 107.
(3) Eugène Delacroix, Journal II, 1853-1856, 17
octobre 1853, Paris, Librairie Plon [1932], 1960, p. 97.
(4) Voir « La double structure de la
lithographie et l'essence de l'œuvre wagnérienne » dans la première partie
de notre article (L'Éducation musicale,
Lettre d'information, n° 101, mars 2016).
(5) Voir Maurice Denis, Charmes et Leçons d'Italie [1933], Paris, Armand Colin, 1947, p.
165.
(6) Didier Anzieu, Le Corps de l'œuvre. Essais psychanalytiques sur le travail créateur,
Gallimard, coll. « Connaissance de l'inconscient », 1981.
(7) Selon Didier Anzieu, les cinq phases du
travail créateur sont : « Le saisissement créateur », « la prise
de conscience de représentants psychiques inconscients », « instituer
un code et lui faire prendre corps », « la composition proprement
dite de l'œuvre », « la rencontre avec le public ».
(8) Didier Anzieu, Le Corps de l'œuvre. Essais psychanalytiques sur le travail créateur,
op. cit.,
p. 102.
(9) Lettre de Fantin-Latour à Edmond Maître, 28
août 1876, Bibliothèque municipale de Grenoble.
(10) Ibid.
(11) Catherine Clément, « L'Anneau raconté
à… », L'Avant-Scène Opéra :
Numéro spécial Wagner. L'Anneau du Nibelung. L'Or du Rhin, nos
6-7, Paris éditions Premières Loges, nov.-décembre 1976,
p. 23.
(12) Lettre de Fantin-Latour à Edmond Maître,
28 août 1876, Bibliothèque municipale de Grenoble.
(13) André Bocourechliev, "Commentaire littéraire et musical", L'Avant-Scène Opéra : L'Anneau du Nibelung. Prolongue L'Or du Rhin nos 6/7, Paris, éditions Premières Loges, nouvelle édition, novembre 1992, p. 62.
(14) Christian Merlin, Wagner mode d'emploi. L'Avant-Scène
Opéra, éditions Premières Loges, Paris, 2002, p. 113.
(15) Rappelons que le lever du rideau
s'effectue une dizaine de mesures avant la fin du Prélude, sur un crescendo de
l'orchestre, et que l'on voit alors l'une des Filles du Rhin qui « nage en
tournoyant d'une manière toute gracieuse » avant que ne débute la scène 1.
(16) Jean Dauwen, La Gamme mystique de Richard Wagner : suivi de Couleur et Musique, Rennes,
Nouvelles éditions latines, 1963.
(17) « Ut
représente la terre et la couleur verte ; ré, la lumière et la couleur jaune ; mi, le mouvement et l'orangé ;
fa, la richesse-activité et le
rouge ; sol, le violet et le
sommeil ; la, le bleu outremer
et la mort ; si, le bleuâtre et
l'au-delà. » Cité par Bruno Lussato, Voyage au cœur du Ring. Wagner – L'Anneau du
Nibelung. Encyclopédie, Fayard, 2005,
p. 367.
(18) « Il est censé avoir inventé la
dénomination latine des sept notes ». Ibid.
(19) Ibid.,
p. 367-368.
(20) Eugène Delacroix, Journal, op. cit., 23 avril 1854.
(21) Paul
Klee, « Philosophie de la création », Théorie
de l'art moderne,
Bâle, 1920,
réed. Genève, Bibliothèque Médiations, Denoël/Gonthier, trad. P.-H. Gonthier, 1982, p. 58 et p.
61.
(22) Eugène Delacroix, « Pensée (première
pensée) », Dictionnaire des
Beaux-Arts, op. cit.,
25 janvier 1857.
(23) Pour Didier Anzieu cette phase correspond
à « la prise de conscience de représentants psychiques
inconscients […] de façon à les fixer dans le préconscient comme noyaux
d'une activité de symbolisation ». Voir Le Corps de l'œuvre. Essais psychanalytiques sur le travail créateur,
op. cit.,
p. 113-114.
(24)
http://arts-graphiques.louvre.fr/detail/oeuvres/1/26428-Esquisse-pour-les-Trois-filles-du-Rhin-max
(25) Esquisse
pour les Trois Filles du Rhin, 1876 ; crayon noir, estompe, mine de
plomb ; 21,4 x 29,8 cm ;
annoté Rheingold ;
RF 12526 recto ; musée du Louvre, département des arts graphiques.
(26) Scène
première du Rheingold (L'Or du Rhin), 1876, huile sur toile, 52,5 x 34 cm, Brême/Berlin, Kunsthandel Wolfgang Werner. Reproduit dans Fantin-Latour, De la réalité au rêve,
catalogue d'exposition, Fondation de l'Hermitage, 2007, Lausanne, La
Bibliothèque des arts, p. 126.
(27) Scène
première du Rheingold, crayon noir sur papier
calque, non signé, daté, en haut à gauche, « 11 Décembre 1876 », 51 x
33 cm, musée des Beaux-Arts de Grenoble, inv. 63.13.
(28) Scène première du Rheingold, 1876, lithographie (crayon, grattoir et estompe, sur papier vélin brun clair), 51 x33, 7 cm : (comp.), s.d.b.d. : "Fantin 76", inscr. en h. dans la marge : "Rheingold, Richard Wagner" inscr. au bas dans la marge : "A Monsieur A. Lascoux, Souvenir de Bayreuth", Paris, BnF, Cabinet des Estampes.
(29) Ce croquis aurait été probablement utilisé
pour la lithographie qui a les mêmes dimensions.
(30) Didier Anzieu intitule cette phase :
« instituer un code et lui faire prendre corps ». Voir Le Corps de l'œuvre, op. cit.,
p. 116.
(31) Voir « Les figures de la lithographie
et les thèmes musicaux de L'Or du
Rhin » dans la première partie de notre article (L'Éducation musicale, Lettre d'information, n° 101, mars
2016).
(32) Voir la didascalie précédant l'entrée de Woglinde au tout début de la première scène.
(33) Voir « Traduire la structure et
l'idée » dans la première partie de notre article (L'Éducation musicale, Lettre d'information, n° 101, mars
2016).
(34) En réalité, comme on peut le lire dans la
marge de la lithographie originale (Voir Fig. 1 au début de la première partie
de notre article dans L'Éducation musicale,
Lettre d'information, n° 101, mars 2016), Fantin
n'a inscrit que les mots : « Rheingold, Richard Wagner ». Tout en indiquant la
source de l'image, « Rheingold » laisse une certaine liberté
d'interprétation au spectateur. Par ailleurs, Fantin
ayant traduit en 1877 le Finale du Rheingold dans une gravure éponyme, il était nécessaire
de préciser « Scène première » pour la gravure de 1876 et ses
diverses variantes.
(35) Voir « Les figures de la lithographie
et les thèmes musicaux de L'Or du
Rhin : l'imitation des effets de l'autre art » dans la première
partie de notre article (L'Éducation
musicale, Lettre d'information, n° 101, mars 2016).
(36) Voir « De la double structure à la
signification des figures féminines de la lithographie » dans la première
partie de notre article (L'Éducation
musicale, Lettre d'information, n° 101, mars 2016).
(37) Cosima Wagner, Journal I (1869-1872), 23 juillet 1872, Paris, Gallimard, 1977, p.
265. Cité dans Christian Goubault, « Guide d'écoute
», L'Avant-Scène Opéra : L'Anneau du Nibelung. Troisième Journée. Le Crépuscule des dieux, n° 230, art. cit., p. 96.
(38) Ces deux mondes sont très caractérisés
musicalement : diatonisme et mesure ternaire pour le premier ;
chromatisme et rythmes heurtés pour le second.
(39) C'est sur cette horizontale que les deux
moitiés de cercle constitutifs du S sont tangents.
(40) Voir
Jean Chevalier et Alain Gheerbrant (dir.), « Losange », dans Dictionnaire des symboles, Paris, Robert Laffont, 1969, réed. 1982, p. 580.
(41) Ibid.,
« algue », p. 24 : « Plongée dans l'élément marin, réservoir
de vie, l'algue symbolise une vie sans limite et que rien ne peut anéantir, la
vie élémentaire, la nourriture primordiale ».
(42) Selon Bruno Lussato,
« Wagner a proclamé à maintes reprises que tout émanait de l'instinct
sexuel. […] Dans le Ring, la
sexualité brute est le point de passage obligé vers des sentiments d'un ordre
plus élevé. Aucune œuvre dramatique ne montre mieux les métamorphoses de la
libido ». Bruno Lussato, Voyage au cœur du Ring. Encyclopédie, op. cit., p. 158.
(43) Didier Anzieu, Le Corps de l'œuvre, op. cit., p. 125.
(44) Paul Klee, « Philosophie de la
création », Théorie de l'art moderne,
op. cit.,
p. 57-58.
(45) Ibid.,
p. 60-61.
(46) Lettre de Mallarmé à Fantin-Latour, 5 février 1877. Cité dans Douglas Druick et Michel Hoog (dir.), Fantin-Latour, catalogue de l'exposition, Galeries nationales
du Grand Palais, Paris, 9 novembre 1982-7 février 1983, RMN, 1982, p. 279.
(47) Teodor de Wyzewa, Beethoven et
Wagner. Essais d'histoire et de critique musicales, Paris, Perrin, 1914, p.
196.
(48) Teodor de Wyzewa, « Peinture wagnérienne. Le Salon de
1884 », Revue wagnérienne, tome
I 1885-1886, réédition de l'édition de Paris 1885-1888 3 vol., Genève, Slatkine, 1993, p. 155-156.
(49) Douglas Druick
et Michel Hoog,
Fantin-Latour, op. cit., p. 19.
(50) Lettre de Siegfried Wagner, 23 janvier
1903, BN Est. Y b3 3204.
(51) Scène
première du Rheingold (L'Or du Rhin), 1876, huile sur toile, 52,5 x 34,3 cm, Monsieur et
Madame Françoise Hudry. Reproduit dans Fantin-Latour, De la réalité au rêve, op. cit., p.
128.
(52) Souvenir de Bayreuth, 1876-1877, pastel, 52 x 33,7 cm, Paris, musée d'Orsay.
Intitulé aussi Les Filles du Rhin. Scène
première du Rheingold. http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=018064&cHash=ff619d3ed7
(53) Scène première du Rheingold (L'Or du Rhin), 1888, huile sur toile, 116,
5 x 79 cm,
s.b.g. : « Fantin », Hambourg, Kunsthalle
(5274).
(54) Nous n'évoquerons pas la seconde
lithographie de 1886 destinée au livre d'Adolphe Jullien (Richard Wagner, sa vie et ses poeuvres, Paris, Librairie de l'Art, 1886) et intitulée L'Or du Rhin : Scène 1ère. Les filles du Rhin, (22,9 x 15,1 cm, Paris, BnF, Cabinet des estampes) dont la composition
est totalement différente. http://tierradentro.tumblr.com/post/108662191132/artemisdreaming-das-rheingold-scène-première
(55) Dans le pastel, Fantin
n'aurait donc pas « repris la lithographie en l'agrandissant et en la
rehaussant de pastel » comme cela est écrit dans la notice du musée
d'Orsay où le pastel est conservé.
(56) Voir
Jean Chevalier et Alain Gheerbrant (dir.), « Algue », dans Dictionnaire des symboles, Paris, Robert Laffont, 1969, réed. 1982, p. 24 : « Plongée dans l'élément marin, réservoir
de vie, l'algue symbolise une vie sans limite et que rien ne peut anéantir, la
vie élémentaire, la nourriture primordiale ».
(57) Voir « Traduire la structure et
l'idée » dans la première partie de notre article (L'Éducation musicale, Lettre d'information, n° 101, mars
2016).
(58) En effet, la guirlande que l'ondine tient
entre ses mains s'est nettement incurvée au point qu'elle se confond avec une
portion du demi-cercle supérieur du S (sa main s'y enroule en tenant compte du
quadrillage sous-jacent), laissant un vide important sous son bras gauche.
Ajoutons que la main supérieure de l'ondine qui plonge, dirigée vers le bas,
n'empiète plus sur le S et que le talon de Flosshilde,
bien que toujours posé sur le demi-cercle inférieur, s'est écarté de l'axe
vertical (et donc aussi de la main de l'ondine qui plonge). Enfin, le
changement de sens des deux courbes du S s'effectue de manière plus équilibrée
au niveau de la taille de Flosshilde.
(59) Nous n'évoquerons pas ici la construction
en losange, reprise de la gravure, et qui contribue elle aussi à l'harmonie de
la composition.
(60) William Hogarth, L'Analyse de la beauté, Nizet, 1963.
(61) Voir « Les figures de la lithographie
et les thèmes musicaux de L'Or du
Rhin » et [Ex. 2] dans la première partie de notre article (L'Éducation musicale, Lettre
d'information, n° 101, mars 2016).
(62) Sont ainsi superposés dans la
partition : le bref motif arpégé ascendant (Wallala !) issu du Rhin – qui soutient l'élan de Flosshilde
dans la peinture –, et le motif ondoyant des Filles du Rhin – qui a dicté la
structure en S supportant les trois figures. L'image et la partition concordent
donc parfaitement ici.
(63) Voir Christina Merlin, « Les 35
personnages du Ring. Profils vocaux et psychologiques », L'Avant-Scène Opéra : L'Anneau du Nibelung. Prologue. L'Or du Rhin, n°227, Paris éditions Premières Loges, 2005, p. 109.
(64) Gustave Geffroy, « Salon de
1888 : IX. Avant-dernière promenade », La Justice, 22 juin 1888, p. 2.
(65) D'après le Dictionnaire de symboles, le violet, « fait d'une égale
proportion de rouge et de bleu » manifeste une sorte d'équilibre entre la
terre et le ciel, les sens et l'esprit ». Voir op. cit., « Violet », p. 1020.
(66) Rappelons toutefois que Fantin-Latour
avait déjà inscrit dans la marge de la lithographie Scène première du Rheingold dédiée à
« Monsieur A. Lascoux » :
« Souvenir de Bayreuth ».
(67) En 1888, la scène I de L'Or du Rhin n'est pas au programme des
concerts Colonne et Lamoureux. Elle est donnée en revanche le 16 juin 1888 par
l'orchestre du Petit Bayreuth avec Mme Dalmont (Woglinde), Braig (Wellgunde), Balliste (Flosshilde). Toutefois, à cette date, Fantin-Latour avait
probablement achevé sa peinture, le Salon ayant lieu au début du printemps.
(68) Pas moins de dix-neuf lithographies de
Fantin-Latour furent utilisées pour promouvoir la revue et la cause
wagnérienne.
(69) C'est le cas d'Alfred Paulet,
« Le Salon de 1888 », Le
National, 4 mai 1888, p. 2.
(70) En 1876 a lieu la deuxième exposition du
groupe impressionniste chez Durand-Ruel.
(71) Rappelons qu'à partir de 1889, les sujets
d'imagination l'emporteront dans l'œuvre de Fantin-Latour sur les sujets
réalistes, et que les sujets d'inspiration musicale seront les plus nombreux
entre 1876 et 1888.
(72) Gustave Geffroy, « Salon de
1888 : IX. Avant-dernière promenade », La Justice, 22 juin 1888, p. 2.
(73) Soulignons que le pastel ne représente
qu'une étape vers l'expression du « sentiment particulier » du
peintre, grâce à la suppression de la structure annulaire, mais que Fantin ne l'a pas encore investi de son « suprême
idéal ».
(74) Lettre de Fantin-Latour à Edwards, 26
décembre 1864, Bibliothèque municipale de Grenoble.
(75) Lettre de Fantin-Latour à Mme Edwards, 26
novembre 1891, Bibliothèque municipale de Grenoble.
(76) http://www.payot-rivages.net/livre_Ce-que-nous-disent-les-mythes-Paul-Diel_ean13_9782228907286.html
(77) Paul Diel, Le Symbolisme dans la mythologie grecque
[1952], Paris, Payot, 1966, p. 23-44.
(78) Conscient, Préconscient et Inconscient sont des
concepts freudiens ; Subconscient (littéralement "sous la
conscience") est un terme introduit par Joseph Jastrow
en 1906. C'est Paul Diel, dont le travail se rattache
plus à Jung qu'à Freud, qui a ajouté le Surconscient au début des années 1950.
(79) Voir le livret de l'opéra.
(80) Paul Diel, Le Symbolisme dans la mythologie grecque, op. cit., p.
23-44. Toutes les citations de cette partie en sont issues.
(81) Flosshilde
s'impose par le coloris intense de sa robe et par la vigueur de son élan auquel
est associé le mouvement spiralé des plis de son vêtement.
(82) Paul Diel, Le Symbolisme dans la mythologie grecque, op. cit., p.
250.
(83) Voir par exemple la lettre de
Fantin-Latour à Whistler, 10 novembre 1862 (Bibliothèque municipale de
Grenoble) : « Je suis dans un tel état de trouble, de chercher
moi-même. Penses-tu quelquefois combien il faut du temps pour de certaines
natures à sortir des troubles et des folies de ce temps. Moi je me trouve
quelquefois perdu dans mes songeries. Je ne sais plus où je suis. J'ai de plus
que les autres le débat entre la vie humaine et la vie artistique. »
(84) Henri Fantin-Latour, Autoportrait, crayon noir, estompe, fusain, lavis noir, blanc
(rehaut), 14,3 x 12,1 cm, Paris, musée du Louvre, département des arts
graphiques. https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Fantin-Latour
(85)
Henri Fantin-Latour, Autoportrait,
huile sur toile, 25,1 x 21,4 cm, Washington, National Gallery
of Art.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Fantin-Latour
(86)
Henri Fantin-Latour, Vanités, dessin
au crayon noir, estompe, fusain, 29,9 x 37,8 cm, 4 juillet 1865, Paris, musée
du Louvre, département des arts graphiques.
http://arts-graphiques.louvre.fr/detail/oeuvres/1/26348-Vanites-max
(87)
Henri Fantin-Latour, Le Toast, la Vérité, dessin au crayon noir, estompe,
21,4 x 29,8 cm, 11 octobre 1864, Paris, musée du Louvre, département des arts
graphiques.
http://art.rmngp.fr/fr/library/artworks/ignace-henri-jean-theodore-fantin-latour_le-toast-la-verite_crayon-noir_estompe_1864
(88) L'évolution du cheminement humain de
Fantin-Latour, depuis son « débat entre la vie humaine et
artistique » (première moitié des années 1860) jusqu'à « l'harmonie
retrouvée » (janvier 1876-août 1904), en passant par une période d'
« apprentissage de la solitude » (août 1865-décembre 1875) a été mise
en évidence dans notre thèse de doctorat d'État, Fantin-Latour et la musique, tomes I, II, III, Université
Paris-Sorbonne (Paris IV), 1992.
(89) Cette interprétation peut être rapprochée
de celle de Bruno Lussato pour le Ring : « Le Ring retrace un lent processus
civilisateur au cours duquel, en dépit des apparences, l'amour ne cesse de
gagner du terrain contre la barbarie du pouvoir et de l'argent. La notion
d'amour ne cesse en effet de s'affiner tout au long des quinze heures du Ring », de la « simple pulsion
sexuelle dans L'Or du Rhin » au
« sacrifice consenti pour l'amour de l'humanité tout entière, accomplie
par Brünnhilde » (Voyage au cœur du Ring. Wagner – L'Anneau du Nibelung. Encyclopédie,
p. 101).
(90) On pense à l'une des versions peintes de
Fantin-Latour d'après Tannhäuser de Wagner
(Tannhaüser,
1886, Cleveland) où le héros, auprès duquel est allongée Vénus, contemple deux
femmes dansant l'une avec l'autre, l'une symbolisant l'amour charnel, l'autre
l'amour spirituel, une instrumentiste les accompagnant au son de sa flûte double.
(91)
Henri Fantin-Latour, Portrait de
Charlotte Dubourg, huile sur toile, 118 x 92,5
cm, Musée d'Orsay, Paris.
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/recherche/commentaire.html?no_cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1%5BshowUid%5D=109558
(92) René Huyghe, « La lutte et la montée
de l'esprit », Les Puissances de
l'image. Bilan d'une psychologie de l'art, Flammarion, 1965, p. 134.
(93) Ibid.,
« L'inconscient et les instincts obscurs », p. 119.
(94) Propos rapportés par Stanislas Fumet
dans : Georges Braque, Maeght, 1965, p. 19.
(95) Étienne Souriau, La Correspondance des arts, Paris, Flammarion, 1969, p. 311.
(96) L'expression est de Delacroix :
« Il y a un genre d'émotion qui est tout particulier à la peinture […]. Il
y a une impression qui résulte de tel arrangement de couleurs, de lumières,
d'ombres, etc. C'est ce qu'on appellerait la musique du tableau ». Voir
Eugène Delacroix, Écrits, Paris,
Plon, 1942, p. 88.
(97) Camille Mauclair,
« Un entretien avec Fantin-Latour », Servitude
et grandeur littéraire, Paris, Ollendorff, 1922,
p. 156.
(98) Voir, par exemple, le grand portrait
collectif de Fantin-Latour, Hommage à
Delacroix (1864, huile sur toile, 160 x 250 cm, Paris, Musée d'Orsay),
dans lequel Baudelaire est représenté assis au premier plan.
(99) Voir « Nos artistes : le peintre Fantin-Latour à son atelier », L'Éclair, 14 mai 1892 : « Les
wagnériens qui sont nés en foule depuis la mort de Wagner, me déconcertent tant
soit peu, moi qui ai aimé Wagner et ai cherché à le traduire picturalement depuis 1864 ».
(100) Si l'on s'en tient uniquement aux
lithographies, Fantin-Latour en a réalisé 43 d'après Wagner, 36 d'après
Berlioz, 21 d'après Schumann, 10 d'après Brahms, 4 d'après Rossini, 4 d'après
Weber.
(101) Notons que dix lithographies comportent
un fragment musical sur portée. Elles illustrent des partitions de Rossini (3),
Berlioz (3), Schumann (2), Wagner (1), Brahms (1), et ont été exécutées entre
1892 et 1895, à l'exception du Finale du Rheingold daté de 1877.
(102) Pour Paul Klee, « le principal
handicap de celui qui la contemple [l'œuvre d'art] ou la reproduit est qu'il
est mis d'emblée devant un aboutissement et qu'il ne peut parcourir qu'à
rebours la genèse de l'œuvre » (« Credo du créateur », Théorie
de l'art moderne, op. cit., p. 38).
(103) L'hypothèse se vérifie par les
lithographies de Fantin-Latour intégrant un motif musical (voir note 100),
celui-ci dictant la structure interne de la gravure et lui donnant sens. Voir
par exemple notre article « Les relations entre
la gravure, la musique et la poésie dans la lithographie Sara la baigneuse de Fantin-Latour », dans Michèle Barbe
(éd.), Musique et arts plastiques :
interactions, Paris, Observatoire musical français, série « Musique et
arts plastiques », n° 8, 2011, p.
89-114.
(104)
Il s'agit de la Brahmsphantasie publiée en 1894, ensemble de
quarante et une gravures de Max Klinger (1857-1920) inspirées par des
partitions de Brahms. Citation sur le site du musée d'Orsay à propos de
l'exposition « Klinger / Brahms gravure, musique et fantaisie » (2
octobre 2001-13 janvier 2002) :
http://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/au-musee-dorsay/presentation-detaillee/article/klinger-brahms-gravure-musique-et-fantaisie-4180.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=649&cHash=883ed7bd83
(105) Étienne Souriau, La Correspondance des arts, op.
cit., p. 308-309.
(106) Lettre de Fantin-Latour à Scholderer, 18 septembre 1893, dans Correspondance entre Henri Fantin-Latour et Otto Scholderer
1858-1902, Paris, édition de la Maison des Sciences de l'homme, 2011.
(107)
Cette idée provient d'une expression italienne célèbre (une paronomase) : Traduttore,
traditore signifiant littéralement :
« Traducteur, traître »,
soit : « Traduire, c'est
trahir ».
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traduttore,_traditore
(108) Walter Benjamin, « La tâche du
traducteur », dans Œuvres,
t. I [1972], Paris, Gallimard, coll. « Folio/Essais »,
trad. M. de Gandillac, R. Rochlitz,
P. Rusch, 2000, p. 257.
(109) Il en est de même pour la plupart des
traductions de Fantin-Latour.
(110) Lettre de Fantin-Latour à Edwards, 30
décembre 1871, Bibliothèque municipale de Grenoble.
(111) Pour Jacques Derrida la traduction est
« relevante » dans un triple sens : ce qui
donne du goût (relève) ; ce qui tire vers le haut, spiritualise ; ce qui
élève en remplaçant ce que l'on a détruit. Selon le philosophe, dans toute
traduction il y a mise à mort, et en même temps, un dépassement. Voir Jacques
Derrida, « Qu'est-ce qu'une traduction "relevante
" ? » (inédit), Cahier de l'Herne
Derrida, Paris, L'Herne, 2004.
(112) Walter Benjamin, « La tâche du traducteur
», op. cit.,
p. 252.
(113) Mikel Dufrenne, L'œil et l'Oreille, Jean-Michel
Place, 1991, p. 195.
(114) Richard Wagner, L'Œuvre d'art de l'avenir [Delagrave, 1910], traduction de J.G. Prod'homme et Dr F. Holl, éditions
d'Aujourd'hui, Les Introuvables, 1982, p. 97-98.
Michèle Barbe.
***
REPÈRES PÉDAGOGIQUES : FRANÇOIS LAZAREVITCH ET LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN
François Lazarevitch et Les Musiciens de Saint-Julien
Où il est question de musique
baroque, de cabrette, de musette
et aussi de flûte irlandaise…
Dans mon enfance, pendant une dizaine
d’années j’ai travaillé la flûte à bec puis la trompette avec un professeur qui
lui-même était tromboniste ! Même si j’habitais à Paris, c’était un peu
comme apprendre la musique à la campagne. Au moment d’entrer au lycée j’ai
choisi de faire F 11 et j’ai suivi la filière des horaires aménagés au C N R de
Paris dans la classe de Daniel Brebbia pour la flûte
à bec. C’est une époque très importante dans ma vie : Daniel Brebbia m’a initié aux « secrets de la musique
ancienne » et fait connaître Antoine Geoffroy-Dechaume qui recevait et enseignait chez lui rue Ordener, et de temps en temps Daniel
allait le voir. Je me souviens de la première fois, chez Antoine. Nous étions
trois flûtistes et nous lui avons joué une Chaconne de Purcell pour trois
flûtes à bec et basse continue : cela m’avait vraiment fasciné. Avec lui
j’ai eu l’impression d’avoir accès à des choses que personne ne connaissait.
C’est à ce moment, vers 15/16 ans, que j’ai commencé à dévorer tous les traités
anciens d’interprétation que je pouvais trouver en librairie ou en
bibliothèque.

François Lazarevitch / DR
Chez Geoffroy-Dechaume c’était un endroit particulier, une sorte d’atelier d’artiste : pas de confort,
des rayonnages au mur, un clavecin en kit et plein de partitions anciennes. Je
n’ai jamais osé lui demander - c’est bête - il me les aurait sans doute
montrées. Mais j’étais un peu timide et jeune. Né en 1905, il avait déjà plus
de 86 ans et une distinction « d’autrefois » qui me plaisait
beaucoup. Je prenais auprès de lui des cours d’interprétation sur la flûte et
sur le clavecin.
Il parlait beaucoup de l’articulation d’une
note à l’autre liée au mouvement du doigt qui caresse la touche. Il estimait
qu’on devait jouer comme si on enlevait des miettes sur la touche. Le centre du
travail c’était cette grande attention prêtée à l’articulation, à une grande
variété d’articulations. C’était une vision très différente de ce qui se
pratiquait ailleurs. Il jouait Bach en notes inégales. Révolutionnaire pour
l’époque ! – et aujourd’hui encore… Pour moi, c’était découvrir la musique
ancienne avec les pionniers. Dans les années 50, pour défendre les notes
inégales il fallait quand même se heurter à tout ce que les gens pensaient être
la réalité, et ce n’était pas facile.
Je pense que ces personnes ont une
perception au-delà de la norme et du coup elles se sentent vite jugées. Elles
sont un peu retirées chez elles, entourées d’un petit groupe d’élèves et d’amis
fidèles ce qui fait que certains y ont vu un côté sectaire.
A l’âge que j’avais je n’étais pas
conscient de tout cela mais le personnage était passionnant et quand il donnait
des exemples au clavier je trouvais ça merveilleusement beau. La musique
prenait sous ses doigts un tel relief que j’avais l’impression qu’il y avait là
une vérité toute simple et presque inatteignable. C’était d’ailleurs très
complémentaire avec ce que j’apprenais chez Daniel Brebbia.
Mais du coup il fallait faire attention à
la flûte à bec pour que le jeu ne soit pas trop sec. Couperin explique que ne
pouvant ni enfler ni diminuer le son au clavecin, on joue sur la cessation du
son et sa retenue. Tout l’art du clavecin est là. Le silence de l’articulation est ENERGIE.
Je jouais un peu de clavecin en bricolant
comme je pouvais entre un clavinova à la maison et le
clavecin au conservatoire mais j’avais tellement ce problème d’articulation en
tête que je pense que je jouais un peu trop sec. Il y a le squelette et la
chair. Il faut avoir conscience qu’une flûte c’est avant tout un SON, le côté
sensuel du son.
J’ai rencontré plus tard Bart Kuijken qui était plus dans le son, le bel canto. La
vibration du son, qui vient des tripes, et résonne dans les cavités du corps,
est une sensation délicieuse à expérimenter et à approfondir. Un peu plus tard
j’ai travaillé au CNSM de Paris avec Pierre Séchet qui lui aussi avait travaillé avec Geoffroy-Dechaume.
J’étais curieux de voir ce qu’il avait fait de cet enseignement. C’était un
homme charmant, très cultivé qui ne polémiquait pas. C’est lui qui a créé la
classe au CNSM de Paris. Ça m’a fait beaucoup de bien de le côtoyer. Il est parti
à la retraite, Bart aussi… Ce sont des pages qui se tournent…
J’ai été beaucoup marqué par cet état
d’esprit de remise en question permanente. Notre rôle en musique ancienne n’est
pas de nous contenter d’idées reçues. Aujourd’hui que se passe-t-il ? Il y a
des cursus très sérieux. On étudie, et ensuite on fait sa carrière. Il y a
quelque chose de tellement institutionnalisé que c’est aux antipodes de ce que
c’était au départ.

Avec les
musiciens de Saint-Julien ©Jean-Baptiste Millot
Au lycée, j’avais vendu ma trompette et
m’étais mis à la flûte traversière baroque avec Philippe Allain-Dupré avec
lequel j’ai beaucoup appris et qui de plus jouait de la musique irlandaise.
J’ai joué de la musique irlandaise et cela m’a donné des idées…
Donc, j’avais 20 ans, j’allais voir Antoine
Geoffroy-Dechaume, je prenais des cours à Bruxelles
et j’ai commencé la flûte irlandaise avec Michel Sikiotakis,
musicien français spécialiste de la flûte irlandaise. Un an plus tard je me
suis intéressé à la Cabrette auvergnate. Ma famille maternelle est
aveyronnaise. La cabrette est une cornemuse à laquelle on a adapté au cours du
19e siècle tous les attributs extérieurs de la musette baroque
(soufflet, forme de la poche, boîtier à quatre boules). C’est la plus riche et
la plus intéressante des cornemuses françaises populaires. La transmission de
bouche à oreille est ininterrompue, fait plutôt rare en France. Aujourd’hui
dans la majorité des cas en France, le jeu de cornemuse est du revivalisme,
c’est-à-dire qu’on n’a pas vraiment de modèle. Avec la cabrette il y a des
modèles, des enregistrements du début du 20e siècle. Les techniques
d’ornementation et de variations sont très riches.
Ensuite je me suis intéressé à la musette
baroque. La musette a toujours été jouée par des instrumentistes à vent : Hotetterre, Philidor, Chédeville jouaient de la musette. Au conservatoire
de Toulouse j’ai suivi les cours de Jean-Christophe Maillard dans le cadre des
week-ends de musique ancienne. La classe de musette baroque de Jean-Christophe a
d’ailleurs été fermée récemment (juin 2015) et il est mort un mois après. À
l’époque c’était le seul endroit en France où on pouvait apprendre à jouer de
cet instrument. Les tessitures de la musette et de la flûte à bec alto sont
très similaires bien que la flûte monte un peu plus haut. Les bourdons de la
musette sont en sol ou en do (majeur ou mineur) avec possibilité de petites
modulations ; le plus naturel étant de passer de Majeur à mineur sur un
ton homonyme ce qui n’empêche pas d’aller aussi vers les tons relatifs, sans y
demeurer trop longtemps. De Lully à Rameau la musette est présente dans le
répertoire de musique de chambre (suites et sonates avec basse continue,
cantates) et orchestral (concerto, opéra).
L’équivalent du silence au clavecin c’est
la note fondamentale de la musette qui se mêle au bourdon. C’est la richesse de
l’articulation entre chaque note, créée par la proportion de note du bourdon
qu’on donne et la proportion de note réellement écrite… C’est là que le jeu de
musette me permet de mettre en œuvre ce que j’ai appris en clavecin. Il faut de toutes façons faire sentir la structure harmonique et
jouer avec. C’est toujours le même problème.

François Lazarevitch & David Greenberg
©Jean-Baptiste Millot
Tout ce qui est intéressant avec les
musiques traditionnelles c’est qu’on n’est pas en face de gens qui ont des
idées mais face à des gens qui incarnent une tradition et un savoir faire, qui sont passeurs d’une énergie par la
musique.
Cette énergie s’appelle la Cadence. La
cadence c’est quelque chose de primordial et dont on ne parle pas assez en
musique ancienne. Pourtant le terme existe : « Être en
cadence », et il est défini par des théoriciens du XVIII e siècle. tels que Rousseau ou Compan.
Aujourd’hui, on ne se soucie pas assez de bien comprendre cette notion.
La cadence c’est l’énergie qui se dégage
d’un musicien, qui donne envie de danser. Georg Muffat (1653-1704) dit bien
qu’une bonne musique de danse (dans le style de Lully) doit
« comme inspirer même malgré soy l’envie de danser » !
Sentir la cadence c’est bien sentir la
relation entre temps fort et temps faible, l’un générant l’autre. Les qualités
d’une bonne musique de danse sont universelles. En musique baroque on joue des
gigues mais en musique irlandaise aussi. La troisième croche est soulevée,
c’est presque « swingué », ce qui n’est pas sans évoquer la façon de
jouer les mesures à temps inégaux en musique ancienne. La structure rythmique
du reel irlandais demande un accent sur le
deuxième et quatrième temps, donc, comme en jazz, dans un groupe de quatre
croches c’est la troisième qui est accentuée.
C’est de plus en plus difficile de voir de
jolies danses traditionnelles en bal. Ce sont des répertoires liés à un mode de
vie, à une culture. Au fur et à mesure que cette culture est remplacée elle
perd de sa saveur, elle disparaît.
Qu’il s’agisse de la cabrette ou de la
flûte irlandaise, j’ai voulu aller voir les musiciens. C’est une façon d’aller
au bout d’une tradition où on travaille d’oreille. Je dois dire que jouer de la
flûte irlandaise conforte dans la lecture et la compréhension des traités
anciens…

©Jean-Baptiste Millot
L’ensemble Les Musiciens de Saint-Julien
est à géométrie variable à un par partie. Nous développons différents
axes : musique française (avec l’air de cour, les suites et sonates pour
flûte ou musette baroque, et même « Je voy le bon tens venir »
consacré à la musique du XIVe siècle), musique ancienne
« celtique » (« For ever Fortune », « The High Road to Kilkenny », et musique « virtuose »
(sonates de Bach, concertos de Vivaldi). Nous avons produit un spectacle jeune
public intitulé « Rigodon ! »
avec musiciens, danseurs et comédien, collaboré avec la compagnie de danse
L’Éventail de Marie-Geneviève Massé pour « Métamorphoses », etc… Cela peut
paraître un peu disparate que ces programmes si variés, mais la recherche de
fond est la même.
L’ensemble m’a amené à réfléchir à des
projets de série comme par exemple 1000
ans de cornemuse en France. Cette série a bénéficié du soutien de Mécénat
Musical Société Générale qui a permis l’enregistrement de 6 disques
actuellement parus sur les 7 prévus. Le concert de répertoire irlandais est
donné avec une danseuse de claquettes (step dancing).
J’ai tendance à penser que les claquettes des danseurs de Broadway descendent des anciens gigueux du Québec ! Notre nouveau disque consacré à la musique ancienne d’Irlande,
« The High Road to Kilkenny »,
vient de sortir le jour de la Saint Patrick, le 8 mars dernier [NDLR : cf. la
recension, ci-dessous in LE BAC DU DISQUAIRE]
Les prochains concerts de l'ensemble auront
lieu :
- le
21 mai 2016, à Pont-Audemer, l'Éclat (programme « For ever Fortune »)
- le 24 mai à Thouars, Hôtel Tyndo (musique ancienne d'Irlande et d'Écosse)
- tous le samedi de juin (à compter du 18),
de juillet, d'août et de septembre, (jusqu'au 17), au Château de Versailles
(Les sérénades royales, avec la Compagnie l'Éventail)
Retrouvez les Musiciens de Saint-Julien sur
leur site : http://www.lesmusiciensdesaintjulien.fr
Conversation entre
François Lazarevitch*
et Laurence Renault
Lescure.
*François Lazarevitch enseigne au CRR de Versailles la flûte traversière baroque, la musette baroque
et l’ornementation.
***
PROPOS PARTAGÉS
Elzbieta Sikora, une compositrice polonaise engagée
D'origine polonaise et installée en France
depuis 1981, Elzbieta Sikora
mène aujourd'hui sa carrière de compositrice dans l'un et l'autre pays. Son
premier séjour en France remonte aux années 60. Un diplôme d'ingénieur du son
en poche, elle décide de venir travailler dans les studios du GRM (Groupe de
Recherche Musicale). La rencontre décisive avec Pierre Schaeffer, personnalité
hors norme qui la fascine, scelle son attachement vital à la musique
électroacoustique. Pour autant, revenue en Pologne, elle reprend ses études,
dans le domaine de la composition instrumentale où elle estime avoir des
lacunes. En 1981, elle obtient une bourse d'étude, pour la France toujours. Le
séjour était de neuf mois... Les circonstances en décideront autrement. Le coup
d'état du 13 décembre réinstaurant le régime totalitaire communiste en Pologne
la dissuadera de revenir dans son pays. Elle n'y retournera que sept ans plus
tard! Le triple album (« Secret Poems »)
qui vient de sortir sous le label polonais Bôłt
témoigne du début de carrière de la compositrice, années où elle fonde avec
Krzysztof Knittel et Wojciech
Michniewski le groupe KEW. La photo de couverture où Elzbieta, cheveux courts à la garçonne, est épaulée par ses
deux confrères, en dit long sur la détermination de cette artiste hors norme
qui n'a cessé de composer, à sa table comme dans les studios.

Photo Wroclaw
La
période héroïque
Le groupe KEW, qui va lancer votre carrière
de compositrice en Pologne est-elle une étape qui compte dans votre cheminement
de compositrice ?
C'est pour moi une période héroïque! Je
revenais de France où j'avais étudié pendant deux ans la musique
électroacoustique avec Pierre Schaeffer au GRM. Et je décide en 1970 de
reprendre des cours de composition. Je retrouve des amis polonais qui font ou
ont terminé leurs études musicales. Nous décidons alors de constituer un groupe
en 1973. Nous voulions faire la révolution, redonner un élan et faire parler de
la nouvelle génération de compositeurs après les Penderecki, Lutoslawski ou
encore Gorecki, qui, à nos yeux, monopolisaient un
peu trop la scène musicale. Former un groupe nous permettait d'affermir nos
élans et nous donnait la force de réaliser nos intentions. Nous voulions
introduire les multi-médias dans la composition
musicale et les nouveaux supports comme la bande électroacoustique. L'usage de
la vidéo n'était pas encore très développé mais on se servait de diapositives
pour associer la musique à l'image et quelquefois à l'action scénique comme
dans les happenings. Un premier concert, où chacun de nous avait écrit une
œuvre nouvelle, incluait Pas de cinq de Kagel. Un papier très négatif de la presse locale,
loin de nous desservir, nous a aussitôt fait connaître. On était devenu l'image
de l'avant-garde. Le groupe KEW a voyagé dans toute la Pologne, du Festival
Automne de Varsovie, à Stockholm, Berlin, Vienne... On s'exprimait très
librement et on osait beaucoup de choses, à travers des œuvres collectives très
engagées. Le groupe s'est dissout au bout de quelques années mais le souvenir
de KEW ne s'est pas effacé dans la mémoire collective.
L'installation
en France
1981
est une date capitale, pour vous comme pour l'avenir de la Pologne !
A l'issue de mes études de composition
polonaises, j'ai demandé une bourse du gouvernement français, que j'ai obtenue.
Je reviens donc en France où j'avais gardé des contacts, au GRM notamment.
Comme vous le savez, ce séjour qui devait durer neuf mois s'est mué en
installation définitive, avec mon mari et mon fils. J'ai heureusement eu très
vite l'opportunité de me mettre au travail. J'ai commencé par composer une pièce à l'Ircam,
invité par Tod Machover que
j'avais rencontré au Festival Automne de Varsovie où était jouée ma pièce
électroacoustique La tête d'Orphée.
Je ressentais à cette époque l'absolue nécessité de renouveler mes outils et de
sortir du monde électroacoustique pur. J'ai donc décidé d'écrire une pièce pour
flûte et électronique en gardant le même titre. La tête d'Orphée II a été créée par Pierre-Yves Artaud et a été
jouée dans le monde entier. La période de travail dans les studios de l'IRCAM,
où j'ai côtoyé des personnalités comme Philippe Manoury,
Gérard Grisey, Horatiu Radulescu, fut très enrichissante même si j'y ai beaucoup
souffert. Cette obligation de tout contrôler en amont, en programmant chaque
séquence sonore, ne convenait guère à ma manière plus intuitive de composer.
Sans doute est-ce la raison pour laquelle je n'ai pas
toujours été sur la même longueur d'onde avec Pierre Boulez. Je devais
très certainement passer pour quelqu'un de suspect, moi qui fréquentais très
librement et le GRM et l'IRCAM!
J'avais d'ailleurs au même moment une
commande de François Bayle pour la saison de concerts du GRM. L'œuvre a été
écrite en réaction aux événements polonais du 13 décembre 1981. Je me suis
souvenue d'une victime du régime communiste, abattue par l'armée lors
d'événements antérieurs, en 1970. Cette pièce engagée s'appelle Janek Wiśnewski, décembre Pologne, du
nom de ce héros politique. Une chanson qui avait été écrite en son honneur
passe en filigrane dans ma composition.
Le
plaisir d'écrire pour la voix
On note, à côté de votre grand opéra Madame Curie, qui couronne votre
carrière (http://www.resmusica.com/2011/11/18/madame-curie-par-elzbieta-sikora/),
la présence de trois autres œuvres scéniques. Est-ce un genre que vous
affectionnez particulièrement ?
Figurez-vous qu'à mes débuts je détestais
l'opéra que je trouvais, comme Pierre Boulez, totalement démodé. Jusqu'à ce que je sois
obligée d'en écrire un pour mon diplôme de composition. Ce fut Ariadna sur un
très beau texte de Cesare Pavese, traduit en polonais. J'ai opté pour un
dispositif léger, un ensemble instrumental et deux voix seulement. J'ai alors découvert
le plaisir d'écrire pour la voix et j'ai bien évidemment renouvelé
l'expérience. En 1982 d'abord, grâce à Guy Erismann
que j'avais connu en Pologne, j'obtiens une commande de France Culture pour un
opéra radiophonique, Derrière son double,
sur un livret de Jean-Pierre Duprey. Depuis mon
expérience avec Pierre Schaeffer, j'étais très attirée par le médium
radiophonique. J'ai fait également une œuvre documentaire, Passion selon Kijno, sorte de montage
radiophonique sur le peintre, avec de la voix et des musiques d'appartenance
diverse.
Vos
rapports avec le GRM sont-ils toujours au beau fixe ?
Je dois avouer que, dans les années 60,
j'étais tombée « amoureuse » de Pierre Schaeffer, dont la personnalité m'a
toujours fascinée. J'étais aussi très attachée à toute son équipe, François
Bayle, Bernard Parmegiani, Ivo Malec, Luc Ferrari,
Guy Reibel, qui s'investissaient corps et biens dans
l'aventure du son et de l'audio-visuel que Schaeffer appelait de ses vœux. Il
n'était plus là en 81 ; les locaux n'avaient plus le même charme mais on y
travaillait toujours avec le même élan et François Bayle, qui avait pris la
direction du GRM, m'y a accueilli les bras ouverts.

©Marta
Koehler
Avez-vous
enseigné la composition ?
J'ai commencé à enseigner très tard. Au
début de ma carrière en France, j'ai vécu avec
des bourses qui m'ont permis de voyager, à Stanford,
aux USA, en Allemagne, à Heidelberg, Mannheim... Puis un jour, en 1985, le
compositeur Arnaud Petit, que j'avais connu à l'IRCAM lors de mon stage, m'a
demandé de le remplacer à Angoulême où il y avait une classe de composition
électroacoustique. J'ai immédiatement accepté et comme il n'a jamais repris son
poste, j'y ai travaillé pendant 20 ans. J'ai alors fondé une association de
musique à l'image, secteur qui m'a toujours passionnée, et un atelier de
création sonore à l'école des Beaux-Arts. Il fallait
imaginer une pédagogie pour guider l'écoute des plasticiens. Un de mes
étudiants est d'ailleurs devenu professeur aux Beaux-Arts
d'Angoulême. Lorsque j'ai atteint l'âge de la retraite, c'est mon assistant
Edgar Nicouleau, compositeur bordelais, qui m'a
succédé.
De
la partition au studio électroacoustique
Comment
vous situez-vous dans le paysage musical d'aujourd'hui ?
J'ai une position assez singulière, ayant
la double formation d'électroacousticienne et de compositrice instrumentale.
J'ai également fait 18 ans de piano lorsque j'étais en Pologne. Il est donc
naturel pour moi d'aller d'un univers à l'autre. Mais, il y a quelques années
encore, je passais pour une traitre dans le milieu électroacoustique lorsque je
faisais de l'instrumental. Et lorsque je compose aujourd'hui de la musique
acousmatique, on me classe dans « les symphonistes »...
Vous n'avez jamais cessé de composer,
conciliant vie de famille, voyages, direction de festival. Comment s'organisent
vos journées de travail ?
C'est très variable. Tout dépend du lieu où
je me trouve pour composer. En Pologne, j'ai pris l'habitude de travailler le
matin et de réserver mes après-midi à la promenade. En France, depuis 2009, je
consacre mes matinées à l'administration relative au festival que je dirige. Je
n'ouvre la partition que l'après-midi quand la lumière inonde ma salle de
séjour. Je mets sur la table un papier un peu épais où je peux noter mes idées
et autres astuces qui stimulent mon écriture ; un papier que je roule quand viennent des invités ; et je fais tout au crayon! Je n'ai
jamais aimé travailler la nuit sauf quand je me trouvais dans les studios du
GRM où il m'est même arrivé de dormir!
Combien
d'œuvres sont aujourd'hui inscrites à votre catalogue ?
Une soixantaine à ce jour. J'ai écrit en
moyenne une pièce et demi par an ; mon sentiment est
d'avoir beaucoup travaillé, sans vraiment m'être arrêtée. Et j'estime avoir eu
beaucoup de chance car j'ai toujours pu écrire sur commande : d'abord pour
l'IRCAM et le GRM, puis pour Radio France, l'Orchestre Poitou Charentes et la Société Chopin qui m'a demandé un concerto
pour piano. Il n'y a vraiment que ma pièce de violon, Solo, que j'avais besoin d'écrire pour moi-même, qui échappe à
toute commande. J'ai également eu plusieurs contacts en Allemagne où j'ai vécu
cinq années, avec mon mari Nicolas. J'ai obtenu des résidences dans les villes
d'Heidelberg, Mannheim et Ulm, lieu de naissance d'Einstein, où j'ai pu
composer dans de bonnes conditions. Je termine en ce moment pour l'ensemble Court-Circuit, Sonosphère II pour
clarinette et quintette à cordes, qui est une commande d'Etat. La Pologne m'a
également demandé pour 2018 un concerto pour
violon. Et je suis très heureuse de revenir travailler à l'IRCAM en 2016, pour
une pièce d'orchestre et électronique commandée par le MEN. Je serai assistée
par un RIM (Réalisateur en Informatique Musicale) et me prépare à cette
nouvelle aventure avec la technologie de pointe de cet Institut. L'œuvre sera
créée à la Philharmonie de Wroclaw durant le festival de 2017, année où je
passerai la main à Pierre Jodlowski, qui m'assiste à
la programmation depuis 2013 déjà.
Quelles
sont vos sources d'inspiration ?
Pour une pièce comme celle-ci, destinée à
la salle de la nouvelle Philharmonie de Wroclaw, qui vient d'être inaugurée,
j'aime imaginer l'espace pour lequel j'écris, la manière dont va se propager le
son, comment il va pouvoir l'investir pleinement. Il m'arrive aussi de tirer
mes idées ou mes titres d'œuvres de la littérature. J'ai travaillé sur L'Arrache-coeur
de Boris Vian, sur des textes de Pavese et Jean-Pierre Duprey,
comme je vous l'ai dit, pour mes œuvres vocales. Mais la source littéraire peut
n'être qu'un prétexte à l'œuvre, qui ne la citera pas mais s'en nourrira, comme
cette phrase de Blaise Pascal qui est associée à l'une de mes pièces
instrumentales …selon
Pascal. La peinture et
l'architecture qui me passionnent et font partie de mon environnement peuvent
également susciter l'envie de composer. J'ai écrit une pièce pour chœur sur Guernica, hommage à Pablo Picasso, en
1975, juste après avoir vu la toile à Cleveland.
Un simple vol d'oiseau, dans ses allures toujours mouvantes, peut être pour moi
un véritable modèle pour la composition.
Quels
ont été vos maîtres en matière de composition ?
J'ai eu deux professeurs, Tadeusz Baird, et Zbigniew
Rudzinski qui m'ont fait beaucoup travailler. Et j'ai toujours à cœur de les mettre à
l'affiche des concerts quand je le peux. Mais mon véritable maître à penser est
Witold Lutoslawski à qui j'ai pu montrer mes
partitions. Il représente pour moi la dimension apollinienne de la musique, une
certaine clarté et une puissance dans l'écriture. On jouera au prochain festival
de Wroclaw son Interlude pour orchestre, une pièce étonnante qui tend
vers l'univers électronique par la qualité de sa texture. Krzysztof Penderecki,
que je connais bien et que j'admire également beaucoup, incarne pour moi
l'autre versant de la musique, plutôt dionysiaque. Je reste très attachée à son
Requiem polonais, notamment le Lacrymosa qui est
une splendeur, toute comme sa Huitième Symphonie. Il faut également citer Kazimierz Serocki, grande figure
de la musique polonaise, qui reste très mal connu en France. Et je n'oublierai
jamais mon professeur de piano, une personnalité très éclairée avec qui
j'échangeais beaucoup dans tous les domaines et à qui j'ai soumis mes premiers
essais de composition. Pour l'anecdote, nous avions trouvé dans la maison de
Gdansk où nous étions installés, un piano rescapé de la guerre, à moitié brûlé
par les Russes, qui n'avait ni pieds ni
couvercle et sur lequel j'ai eu mes premières leçons de musique!
Wroclaw,
capitale européenne de la culture en 2016
Depuis 2009, vous assumez la direction du
MEN (Musica Electronica
Nova) -http://www.resmusica.com/2015/05/29/musica-electronica-nova-a-wroclaw/-,
manifestation biennale accueillie par la ville de Wroclaw qui est en 2016
capitale européenne de la culture. L'enjeu est de taille !
Cette manifestation biennale a été lancée
en 2007 par l'Union des compositeurs de la ville de Wroclaw qui renouvelait la
direction à chaque édition. Depuis ma nomination en 2009, j'assume en continu
la responsabilité du Festival. Je ne voulais pas limiter la programmation aux
seules œuvres purement électroniques. J'ai
donc introduit l'orchestre et prévu l'espace d'une grande salle pour attirer un plus large public. Nous avons aujourd'hui la
chance d'être soutenu par la ville de Wroclaw et par la Philharmonie qui
nous prend sous son aile. J'essaie également de travailler le plus possible
avec les différentes institutions culturelles de la ville et nous collaborons
étroitement avec le festival des arts audio-visuels WRO, une autre biennale
mondialement connue qui se déroule en parfaite synchronie avec le MEN. En 2017,
avec pour thématique l'Identité, nous
recevrons le saxophoniste et jazzman américain, d'origine juive, John Zorn.
2016, durant laquelle Wroclaw est capitale européenne de la culture, est une
année exceptionnelle. On m'a demandé de prévoir un mini festival de quatre
journées, du 19 au 22 mai, au lieu de huit habituellement. Pour cette année
européenne, j'ai lancé le thème du portrait de ville, un cinéma sonore autour
des capitales: Varsovie, Berlin, Paris, Barcelone, Oslo, Cracovie... une idée
qui semble ravir les compositeurs dont le cahier des charges stipule
l'obligation d'introduire au moins un son naturel enregistré dans la ville. Il
y aura également un concert d'orchestre et la présence de l'Ensemble Intercontemporain. Il a passé commande à une compositrice
polonaise et jouera également Germination
de Jean-Luc Hervé, une oeuvre-installation très
surprenante qui se terminera en plein-air où cinquante petits haut-parleurs
sonoriseront un espace vert qui doit pousser devant la Philharmonie...!
Propos recueillis
par Michèle Tosi*.
*Michèle
Tosi est musicologue et critique musicale.

Musica Electronica
Nova
19–22.05.2016, Wrocław
/ Special edition for Wroclaw Europeen Capital of
Culture
GROWING
Elżbieta Sikora
–Artistic Director / Andrzej Kosendiak
– General Director
19.05.2016 Thursday, 11:00 am and 12:00
noon
Wrocław, NFM, Black Hall
SOUND CINEMA Sessions for children
Mariusz Gradowski –host
Sound
cityscapes
19.05.2016 Thursday, 6:00 pm, 7:00 pm,
8:00 pm, 9:30 pm
Wrocław, NFM, Black Hall
SOUND CINEMA
Cityscapes
6:00–6:55
pm
Wroclaw
Mateusz
Ryczek –curator
7:00–7:45 pm
Basque Cities Sound Portrait
Ramon Lazkano –curator
8:00–9:00 pm
Warsaw
Barbara Okoń-Makowska –curator
9:30–10:20
pm,
Cracow
Magdalena
Długosz, curator
20.05.2016 Friday, 11:00 am and 12:00 noon
Wroclaw
/NFM, Black Hall
SOUND CINEMA Sessions for children
20.05.2016 Friday, 7:00 pm
Wrocław,
NFM, KGHM Main Hall
CONFRONTATIONS
Symphony concert
Michał Klauza –conductor
Simon Steen-Andersen –electronics
NFM
Wrocław Philharmonic
York Höller (1944) Résonance,
for orchestra and computer-generated sounds (1981)
Wolfgang Mitterer (1958) Innen
drinnen for orchestra and electronics
Simon Steen-Andersen (1976) Double
up (2010)
Piotr Roemer (1988), Szymon Stanisław Strzelec
(1990) Duet
for symphony orchestra and electronics (2016) **
20.05.2016 Friday, 9:30 pm, 10:30 pm
Wrocław, NFM, Black Hall
SOUND CINEMA
Cityscapes
9:30–10:15 pm,
Vilnius
Michał Mendyk, curator
10:30-11:30 pm,
Tallinn
Marianna Liik, curator
21.05.2016, Saturday 11:00 am and 12:00 noon
Wrocław, NFM, Black Hall
SOUND CINEMA Sessions for children
21.05.2016,
Saturday, 6:00 pm, 8:00 pm, 9:30 pm
Wrocław, Wolności
square
GERMINATION
Installation
Jean-Luc
Hervé –music and installation concept
IRCAM-Centre
Pompidou –electronics
landscape Magdalena Subocz
Programme:
Jean-Luc
Hervé (1960) Germination concert
landscape architecture and electronics (2013)
Co-organized
by:
WRO Art Centre and the Landscape Architecture Institute of
the Wrocław University of Natural Sciences
21.05.2016, Saturday, 7:00 pm
Wrocław, NFM, Red Hall
INSIDE –
OUTSIDE
Guillaume
Bourgogne –conductor
IRCAM-Centre
Pompidou –designers of computer music
Ensemble Intercontemporain
Agata Zubel (1978) Double
Battery for ensemble and electronics, commission by Ensemble Intercontemporain
Yan
Maresz (1966) Tutti
for ensemble and electronic devices
in the intermission we invite you to the
second show of the Germination installation in the square in front of
the NFM entrance
Edgard Varèse (1883–1965) Octandre (1924)
Jean-Luc
Hervé (1960) Germination for chamber ensemble
and electronics
after the concert we invite you to the third
show of the installation in the square in front of the NFM entrance (20')
22.05.2016, Sunday, 11:00 am,
12:00 noon
Wrocław, NFM, Black Hall
SOUND CINEMA Sessions for children
22.05.2016,
Sunday, 1:00 pm
Wrocław,
Wolności square
Germination, installation
22.05.2016, Sunday, 5:00 pm, 7:00 pm, 8:30 pm, 9:45 pm
Wrocław,
Sala Czarna NFM / NFM Black Hall
SOUND CINEMA
Cityscapes
5:00–5:45
pm,
Berlin
7:00–8:00
pm,
Paris
Des Coulam, curator
8:30–9:30
pm, curator
Barcelona
José Manuel Berenguer curator
9:45–10:30
pm,
Oslo
Natasha Barret, curator
22.05.2016, Sunday, 6:00 pm
Wrocław, NFM, Cameral Hall
Interactive sounds
Special
concert
Tarmo
Johannes –flute, concept, software of sound-game
Tammo Sumera –live electronics,
sound diffusion
Programme:
Interactive
sound-game developed by Tarmo Johannes
Tatjana Kozlova-Johannes (1977) Doors
1 for flute and electronics (2001)
Jüri Reinvere (1971)
a.e.g/t.i.m.e
for flute, electronics, text and video ad. lib. (2005)
Pierre
Jodlowski (1971) Limite
circulair for flute and 8-channel tape (2008)
Sunday, 8:00 pm
Wrocław, Wolności square
Germination,
installation
Jérôme Pernoo, l'homme protée du violoncelle
La belle quarantaine, Jérôme Pernoo est un violoncelliste comblé. Il a fait le tour du
monde avec son instrument pour jouer le répertoire, donner des cours, des master classes, un peu partout, inciter des compositeurs à
écrire pour lui. Il a initié des festivals, mais cela ne lui suffisait
pas ! Il avait un projet encore plus fou dans ses rêves de jeune
violoncelliste de 25 ans ! Il vient de le réaliser ! Et pour parler
de musique autrement et de ce projet, il nous a reçu entre deux répétitions
dans l'ancien conservatoire du XVIIème arrondissement de Paris, à deux pas de
la salle Cortot ! L'enthousiasme et les rires étaient au rendez-vous
!

Photo prise
au cours de l'entretien
© Kevin Drelon
Aux
Victoires de la Musique on a entendu pour la première fois une œuvre assez
énergique d'un compositeur contemporain. Pouvez-vous m'en parler ?
Guillaume Connesson
a écrit cette œuvre pour moi. C'est un costume taillé sur mesure. J'ai lu
feuillets après feuillets la composition. Je lui ai conseillé de commencer par
le final parce que je savais qu'il allait écrire quelque chose de terriblement
difficile. Je me préparais au pire, je voulais avoir la partition très tôt pour
la travailler car tout cela s'est fait très peu de temps avant la première. Je
me souviens d'avoir travaillé la nuit d'avant la première pour connaître par
cœur la cadence. Ce qui est formidable avec cet événement des Victoires de la
Musique c'est qu'en prime time, il y a eu un million six téléspectateurs qui
ont regardé et écouté cette musique bouillonnante, virtuose, joyeuse, avec ce
dialogue magnifique avec l'orchestre !
https://www.youtube.com/watch?v=KlrOIEDP05Q
Excusez-moi,
mais en terme de musique on a eu droit à toutes les scies musicales, les tubes
rabâchés de chez rabâché…
Oui mais cette séquence a été l'une de
celles qui a eu le plus de succès ! Parce que c'est une musique - il faut
arrêter de dire contemporaine - d'abord d'aujourd'hui,
vivante, qui est bien là, en chair et en os. Connesson
est un compositeur d'aujourd'hui. Il a la quarantaine,
il fait de la musique extraordinaire, c'est cela que les gens ont vu et
entendu !
Mais pour beaucoup
de gens la musique d'aujourd'hui c'est Boulez !
Boulez c'est la musique d'hier ! C'est
le dernier de cette génération, Berio, Ligeti, Stockhausen.
Ils étaient dans la succession de la Seconde École de Vienne,
Schoenberg, Webern, Berg, qui eux étaient dans la succession du post
romantisme. Il y avait besoin de cette cassure, de cette coupure, de quelque
chose de plus sec, de plus aride, de plus conceptuel, de plus classique en
quelque sorte. Et aujourd'hui on voit bien qu'il y a une nouvelle génération de
compositeurs qui a besoin de plus de romantisme dans leur musique,
d'expressions du sentiment, dont en l'occurrence la joie. Mais Connesson exprime aussi la tristesse dans son concerto.
Si on
continue dans cette voie on va se retrouver avec la polémique qu'il y a eu au
Collège de France avec Ducros et Beffa…
Oui, je pense que c'est une polémique pour
ceux qui sont très conservateurs, qui veulent conserver le style du XXème
siècle, qui veulent être les tenants de l'art moderne
en disant que c'est ce qui se faisait quand ils étaient jeunes. Mais les choses
changent : ces gens-là, qui étaient pour quelque chose de très nouveau dans
leur jeunesse, aujourd'hui n'admettent pas qu'il y ait une nouvelle génération
d'artistes, pas seulement des musiciens, qui ont envie de s'exprimer autrement.
Comment
un jeune compositeur vient-il vous chercher pour écrire pour vous ?
C'est tout le contraire, c'est moi qui suis
allé le chercher. Je l'ai découvert parce que je faisais partie d'un jury de
musique de compositeurs d'aujourd'hui, en tant qu'interprète. J'ai lu vingt
cinq monographies et je suis tombé sous le choc de sa musique. J'avais là son
numéro de téléphone, comme un comédien de cinéma qui rêve de travailler avec un
réalisateur et qui a tout d'un coup ses coordonnées. Jamais je n'avais eu de coup de foudre comme
cela. Je l'ai appelé, j'ai commencé à jouer le peu de choses qu'il avait
écrites pour violoncelle. Ensuite je lui ai commandé d'autres œuvres : une
sonate pour piano et violoncelle, un quatuor à cordes. Et puis on a eu ce
projet de concerto qu'on a pu réaliser avec l'aide de l'association Musique
Nouvelle en Liberté, l'Opéra de Rouen, d'autres coproductions. Ce qui est
extraordinaire c'est que ce concerto a sa propre vie ; je crois que je l'ai joué
plus de trente fois en concert. On l'a enregistré chez Deutsche Grammophon, et voilà qu'on passe en prime time avec lui,
c'est ahurissant ! Aujourd'hui il y a des élèves du Conservatoire qui
travaillent ce concerto. Il rentre dans
le répertoire, ce qui est extrêmement rare pour une œuvre d'aujourd'hui. En
général, on fait une première et on range la partition. Je ne me suis jamais
battu pour la musique contemporaine, pour la musique d'aujourd'hui ; ce n'est
pas ma mission, je n'en ai rien à faire ; la musique qui m'intéresse est celle
qui me permet de partager une émotion musicale avec mon public. A partir du
moment où je ressens une œuvre au point de l'aimer et de vouloir la transmettre
et que je sens que le public la reçoit et s'enthousiasme, alors l'œuvre fait
son chemin. Elle n'existe que s'il y a ce cocktail savant entre
auteur-interprète-auditeur ; une fois que cette mayonnaise a pris, alors
on a envie de jouer cette œuvre, donc elle se joue. Lorsqu'un orchestre
m'appelle, je ne lui propose pas le concerto de Dvořák,
je ne lui propose pas du rococo - je suis très heureux de jouer le répertoire,
j'en joue beaucoup - mais la première chose que je dis à un producteur ou à un
chef d'orchestre : Est-ce que vous
connaissez le concerto de Connesson ? C'est
ainsi que je l'ai joué énormément de fois ! Mais ce n'est pas une mission
politique. Il n'y a qu'une manière de partager la musique c'est d'être à côté
du musicien qui est en train de jouer. Le problème c'est souvent, quand on est
dans une très grande salle, qu'on a du mal à partager de l'émotion très
directement avec le musicien. On est loin, et puis il y a quelque chose d'un
peu mondain, on est bien habillé, il y a madame machin qui sent le parfum, et
finalement on perd la juste relation entre l'auditeur, l'interprète et l'œuvre.
Alors il faut que la salle soit adaptée, pas trop grande pour qu'il se passe
quelque chose. Dans une grande salle il faut un grand orchestre. Cette émotion
musicale, elle va passer dans des salles plus petites. Je crois en l'échelle
humaine dans la relation entre le musicien et son public, et aussi dans la
proportion de la salle. On ne pense pas assez à cette problématique.
Il ne faut pas
aller voir Jérôme Pernoo à la Philharmonie de Paris
alors !
Non, il faut aller le voir à la Salle
Cortot ! Parce qu'il a crée le Centre de Musique de Chambre de
Paris !
Bel
enchaînement !
(rires) Dans cette
salle mythique, exceptionnelle du point de vue acoustique et aussi de la
relation scène public. C'est pourquoi les gens s'y sentent bien et y
reviennent.
Comment
fait en une année Jérôme Pernoo pour apprendre des
œuvres de musique d'aujourd'hui, jouer un peu partout en Europe ou ailleurs,
être Directeur artistique du Centre de Musique de Chambre de Paris, du festival
Les Vacances de Monsieur Haydn,
à La Roche-Posay, du festival de Deauville,
enseigner ?
J'avoue que je ne dors pas beaucoup en ce
moment ; mais ça arrive à des gens très biens. Lorsque vous avez un enfant
c'est pareil, c'est fatigant. La question qu'il faut se poser est quel est le
rôle du musicien dans la cité ? Quelle est ma fonction ? Toute ma
vie, j'ai vécu avec les plus immenses œuvres d'art, j'ai eu cette chance depuis
que je suis tout petit de côtoyer des chefs-d'œuvres,
celles qui ont passé les siècles. On ressort certaines œuvres qui avaient été
oubliées, par but commercial et par manque d'œuvres d'aujourd'hui. S'il y avait
plus de Connesson ou de Ducros on pourrait imaginer
que la musique classique soit plus vivante et même plus rentable, comme le
cinéma. Il y a des musiciens qui composaient de la musique tonale, qui
n'avaient pas le droit de cité et qui se sont dirigés vers la musique de film.
On ne va pas refaire l'histoire. Ce que je veux dire c'est qu'à cause de ce
phénomène, on passe son temps à réenregistrer toujours la même chose, à
provoquer des cercles vicieux dans l'industrie du disque classique. Alors on
s'intéresse à quoi ? A l'interprète ? On dit que monsieur untel joue
mieux qu'un autre monsieur untel, on est loin de la musique, de l'œuvre elle même ;
c'est comme si je vous disais untel a regardé ce tableau de cette manière et un
autre d'une autre manière ? C'est cela l'interprétation. Ce qui importe c'est
la transmission de l'œuvre. On a créé un déséquilibre à force de jouer de la
musique ancienne tout le temps : on a du coup sauté sur l'occasion avec le
renouveau dans le baroque ou des œuvres perdues dans le passé qu'on remet à
l'ordre du jour. On a sauté sur ces occasions là pour faire du beau. Et si les
œuvres d'aujourd'hui étaient belles ?
Vous allez me dire que la question de la
beauté est une question très subjective… Je n'en suis pas si sûr… Je ne vais
pas entrer dans des questions philosophiques qui me dépassent, et je n'ai pas
les outils pour cela. Mais dans la beauté, il y a la question de l'harmonie. Si
on est tous face à une montagne ou à un coucher de soleil ou encore à une voûte
étoilée, on va tous avoir ce sentiment de beauté ; il y a quelque chose
d'objectif qui nous concerne. Donc je ne pense pas que la beauté soit si
subjective. Figurez-vous, lorsque j'étais étudiant, je disais : ça ce n'est pas
beau ; oui mais ce n'est pas fait pour être beau, me répondait-on ! Donc
j'ai compris que la préoccupation des artistes du XXème siècle n'était pas dans
la beauté, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, ce n'était pas la
préoccupation des artistes. On était dans une revendication, une
déconstruction, et aujourd'hui on aspire à autre chose. Les créateurs, les
interprètes, le public semblent avoir besoin d'autre chose. Ma foi, on est dans
un virage comme il y en a eu à tous les débuts de siècle. Alors pourquoi
j'enregistre de la musique d'aujourd'hui ? Pas pour me draper dans une
mission qui consiste à dire : le musicien doit défendre la musique
d'aujourd'hui qui n'est jamais écoutée. Non, non, j'enregistre des musiques qui
sont nouvelles et qui sont belles. Voilà !
Pour
revenir au concerto de Guillaume Connesson, c'est une
version qui a été entendue par le compositeur. Il y a eu une relation très
étroite entre vous deux, c'est donc la version historique…
Je suis très fier d'avoir été dans ce
moment historique. Connesson était présent à
l'enregistrement. Mais je sais qu'il souhaite que l'œuvre vive à travers
d'autres interprètes, comme une pièce de théâtre. Justement cet aspect figé de
l'interprétation au disque est assez contradictoire avec la liberté qu'on peut
trouver dans la manière de jouer une œuvre. Il y a quelque chose d'anti naturel
dans l'enregistrement, qui ne me va pas trop.
Aujourd'hui on peut
tout manipuler dans l'enregistrement d'une œuvre...
Cela ne me dérange pas. C'est comme au
cinéma, on fait tel plan puis tel plan, on recommence, on peut faire mieux, on
profite de la technologie pour faire ce que l'on désire le plus pour jouer une
partition. Après, ce qui me dérange, c'est ce qu'on appelle les versions de
référence. Il faut les considérer comme des instantanés ou comment la personne
l'a pensée à ce moment-là. Pour moi c'est comme de l'encyclopédie…
Ce
concerto vous l'avez joué une trentaine de fois. Y-a-t-il eu une évolution dans
votre jeu ?
Bien sûr, cela a évolué au fil du temps.
Lorsqu'on joue en public, on sent des questions d'équilibre, d'assise, de
tempos, d'expérience ; c'est aussi les cheveux blancs qui font qu'on est moins
tout fou…
Je
pense qu'on a pas mal parlé de ce concerto qui vous tient à cœur. Parlons
maintenant de ce mini festival que vous avez créé dans cette salle mythique.
Dans cette conversation c'est la musique
d'aujourd'hui et la musique du passé, qui sont liées, et le fait de jouer
plutôt que d'enregistrer. Pour moi, ce Centre de Musique de Chambre c'est avant
tout un lieu dans lequel on se retrouve.
Françoise
Noël-Marquis avait l'intention de
faire revivre cette salle Cortot depuis qu'elle est devenue directrice de
l'École Normale de Musique…
C'est
ce qu'on appelle de la synchronicité ! Cela fait
vingt ans que j'ai ce projet de lieu, de troupe et de partage avec le public.
C'est cela la place du musicien dans la cité.
Et vous aviez déjà en tête la salle Cortot ?
Mais,
à l'époque la salle Cortot était une vieillerie poussiéreuse qui n'existait pas
dans le paysage français et qu'on louait à telle ou telle association. J'avais
déjà joué pour une de ces associations, dans le temps, pour des jeunes…J'ai
toujours aimé cette salle du point de vue de l'acoustique, de l'architecture...

DR
… et de ce fameux rapport au public…
Oui,
et j'avais écrit un dossier il y a vingt ans avec le même président
qu'aujourd'hui, Philippe
Fanjas, président de l'association des
orchestres. J'avais même commencé à travailler avec des musiciens sur des
programmes et sur des lieux de résidence qui auraient pu m'accueillir. J'avais
toujours l'idée de cette salle. Mais je suis passé à autre chose. C'était
compliqué, ce n'était peut-être pas le moment, peut-être fallait-il que je fasse
mes preuves. C'était un projet très ambitieux ; on ne pouvait pas le confier à
quelqu'un comme moi. Je l'ai mis de côté, j'ai fait ma vie de violoncelliste,
je suis devenu enseignant à Londres, à Paris…J'ai écrit un bouquin,
« L'Amateur », sur l'enseignement, sur la transmission. J'ai fait des
émissions de radio, j'ai vécu ma vie de soliste dans des salles mythiques. J'ai
enregistré chez Deutsche Grammophon, chez Decca. Il
m'est arrivé des tas de choses extraordinaires. Et régulièrement me revenait en
tête ce projet, mais je n'y touchais pas, je le remettais à plus tard…Et un
jour, je me suis réveillé et j'ai dit voilà c'est le moment !
J'ai
ressorti le dossier, j'ai réécrit, cela ressemblait à ce que j'avais imaginé au
départ. J'ai appelé Philipe Fanjas pour lui en faire
part. Je l'ai intitulé « Le Centre de Musique de Chambre »
parce que c'est large ; pas mon petit truc à moi ; pour que les groupes de
musique de chambre y viennent, que les jeunes s'y retrouvent; c'est une
assiette. Ce nom est un peu impersonnel, exprès. Il y a des thèmes comme
« Bach and Breakfast », « Freshly Composed », « Quintette à Claque »… et comme
illustration, j'ai mis la salle Cortot !
Peu
de temps après, complétement par hasard, je reçois un
coup de fil d'une dame que je ne connaissais pas et qui me dit : je viens
d'être nommée à la tête de l'École Normale et j'aimerais bien avoir votre avis
sur deux ou trois choses ; est-ce que vous voulez bien venir me voir… Je
la vois, on discute, et elle me dit que son rôle dans cette école c'est de
monter le niveau des cordes, qu'elle pense qu'il faudra passer par la musique
de chambre pour y arriver ; et puis elle me parle de la salle Cortot. Mais elle
n'a pas de projet concret …Là je lui dis que je suis son homme, une sorte de
mentaliste, et je sors mon dossier avec la salle en couverture ! C'est de la synchronicité : c'est arrivé au même moment ! Après on
a travaillé…
Alors le projet : ce sont des jeunes qui jouent de
la musique de chambre ?
Il
y a deux catégories. Il y a des groupes qui sont déjà formés, des quatuors, des
trios que j'invite et qui font un concert à 20h. Le concept est qu'on joue une
seule œuvre, et ça marche d'enfer. Je suis très heureux d'avoir inventé cela.
On retrouve notre discussion d'avant : le public vient écouter une œuvre, comme
il irait au cinéma pour voir un film, ou une pièce de théâtre ; le spectacle
c'est une œuvre. Ensuite, à 21h30, il y a un deuxième concert qui lui est plus
sous forme de spectacle que de concert. Je le fais avec une troupe de jeunes musiciens
: ce n'est pas une formation déjà constituée, c'est moi qui en fonction du
programme, choisis tel ou tel jeune. Le programme musical tourne aussi autour
d'une œuvre. On a commencé par La Nuit Transfigurée, puis un programme dans lequel on se baignait dans
les Nocturnes
de Chopin, et on arrivait petit à
petit à Ainsi
le Nuit de Dutilleux. On avait
différents aspects de la nuit pour arriver au poème de Richard Dehmel qui a
inspiré Schoenberg. Tout cela avec des jeunes musiciens avec lesquels je
travaille comme une troupe de théâtre. On répète, répète, ici dans cette belle
salle de l'ancien conservatoire du XVIIème qui a été mise à notre
disposition ! Les musiciens jouent
par cœur ! On apprend son texte comme un comédien, on doit connaître la
partition de l'autre. J'ai le rôle du chef d'orchestre et du metteur en scène ;
c'est comme cela qu'on arrive à une interprétation qui a une direction
artistique avec des musiciens qui connaissent parfaitement le texte. Comme je
ne suis pas là sur scène au moment du concert, ils s'expriment en leur nom
propre et avec toute leur énergie et leur sensibilité artistique. Je résultat
est absolument inédit ; les gens dans la salle sont émerveillés, ils ne
s'y attendent pas, ils reviennent et ils amènent des amis ; ce qui fait que
pour un programme qui est donné pendant trois semaines - cela aussi c'est
inédit, comme au théâtre - on va faire plus d'un millier d'entrées sur La Nuit
Transfigurée, sur Souvenirs de
Florence de Tchaikovski
ou sur La Truite. Et cela va crescendo de jours en jours.
Comment fait-on financièrement ?
Nous
n'avons aucune subvention. On a commencé avec très peu de moyens. Il y a
quelques sponsors, cela fonctionne sur le mécénat privé. On a le Crédit
Agricole qui soutient la troupe, l'Adami qui soutient
les jeunes du concert de 20h. Puis il y a quelques partenaires média. La Mairie
de Paris nous met à disposition ce lieu du conservatoire d'arrondissement pour
travailler et une petite subvention de démarrage. L'équipe, c'est le
minimum : un administrateur, un chargé de production et un chargé de com.
Et Pernoo y met combien
de temps ?
C'est
du 24/24 plus les 24h pour ma classe au Conservatoire, plus les autres 24h pour
ma vie de soliste et pour le festival Les Vacances de
Monsieur Haydn
à La Roche-Posay. Mais j'ai là une équipe plus rodée
parce que ce festival existe depuis onze ans. Pour un festival il faut se
battre tous les ans, comme pour les premiers jours, pour aller chercher les
subventions.
Ces jeunes où
allez-vous chercher ces jeunes ?
Je suis aux premières loges en tant que
professeur au Conservatoire. Je fais aussi des auditions à l'École Normale
parce que je les connais moins. Je suis prof à la European
Music Chamber Academy, une
académie itinérante des grandes écoles et j'entends beaucoup de jeunes de très très haut niveau. J'enseigne aussi régulièrement à la Kronberg Academy, la pépinière en
Allemagne des jeunes solistes. On est en partenariat avec ces deux institutions
mais aussi avec Pro Quartet à Paris, ce qui garantit le niveau. Dans mon
festival à La Roche-Posay j'engage aussi des jeunes
du in et du off.
Et puis vous avez
aussi le fameux invité surprise ?
(rires) Parfois je
ne sais pas moi-même qui va venir, c'est ça la vie ! C'est simple, on
n'est pas là à faire une programmation un an à l'avance ! On a fait une Schubertiade fin janvier au dernier moment. J'ai appelé mes
potes et c'était plein à craquer. ''Faire le bœuf'', c'est réservé aux jazzmen.
J'adore le jazz. Là c'est un peu différent : ce qu'on adore faire, nous
musiciens, c'est lire un quatuor de Mozart ou un quintette de Schumann, on les
a tous joués dans nos vies. Dans le fait de jouer sans répéter, il y a quelque
chose de spontané. Lorsque le Quatuor Hanson, jeune quatuor, va venir
prochainement, j'ai demandé à un ami altiste de renom de venir et ce sera un
quintette à deux altos !
Vous êtes là tous
les soirs ?
J'y suis quasiment là. Notre saison finit
fin mars. En avril, je suis sur les routes et dans les avions.
La saison prochaine
est-elle déjà prête ?
Oui bien sûr. La programmation sera sur le
même principe que celle de cette année : le 20h avec des jeunes, les concerts
de 21h30 avec la troupe et le programme autour d'une œuvre. Entre les deux
concerts, il y a le « Freshly Composed » et là ce sont de très jeunes compositeurs
qui jouent, avec des amis, dix minutes d'une œuvre qu'ils viennent d'écrire ou
qu'ils sont en train d'écrire. Le public, s'il apprécie, peut participer
financièrement sur internet à la composition et commander une œuvre pour
l'année prochaine. Du coup le public s'approprie la création. On aura une
soirée spéciale avec les œuvres commandées par le public. Il va y avoir des
concerts hors série avec nos partenaires Deutsche Grammophon,
Deviallet. Et surtout on a un système de carte à cinq
ou huit places comme au cinéma : si on a une carte cinq concerts par exemple,
on peut venir avec quatre amis ou la donner à un ami car elle n'est pas
nominative. Ces cartes nous permettent d'avoir des gens qui amènent d'autres
personnes ; c'est ce bouche à oreille qui fait marcher le Centre. Avec la
carte c'est six euros l'entrée ! Il y a la carte intégrale qui coûte 100
euros pour tous les concerts de la saison !
Qui est le
public ?
C'est un public familier qui se sent bien,
qui vient réécouter une œuvre. On a joué le 15ème Quatuor de
Beethoven pendant trois semaines ; on m'a dit : mais tu es complétement
fou ! Tu ne vas pas trouver du public ! Et bien si, il y a des gens
qui reviennent écouter le 15ème ! On reçoit quelque chose de
tellement différent du disque. Proust en parle sur la Sonate de Vinteuil. Il dit que la deuxième fois on a retenu des
choses sans le savoir ; sinon c'est comme la première fois, ce ne seraient que
des premières fois ! A chaque fois on découvre quelque chose de nouveau.
Quand j'écoute cette œuvre monumentale de Beethoven, je me rends compte que
c'est un chef-d'œuvre énorme mais je n'arrive pas totalement à la saisir. Si je
l'écoute le lendemain ou le surlendemain ou la semaine d'après, alors petit à
petit il y a des choses qui deviennent plus évidentes. C'est une très belle
expérience pour le public et ça marche.
Et qu'est ce que ce
''Bach and Breakfast'' ?
Les gens viennent à 10h du matin, le
dimanche : il y
a un petit déjeuner, puis on leur apprend un Choral de Bach. J'arrive avec
l'orchestre, on joue la cantate, et tout le monde chante ! Les gens
sortent avec la banane, et dans le public on entend une voix de basse : c'est
Philippe Naouri qui participe !
https://www.youtube.com/watch?v=8fZyDxNrw98
Et Jérôme Pernoo le musicien dans tout cela ?
Il y a un concert à Copenhague avec Jérôme
Ducros, autour de Brahms et Piazzolla. J'aime cette jonction musique populaire
musique savante. A Bruxelles, le 26 juin, ce sera la Symphonie Concertante de
Prokofiev avec l'Orchestre de la Monnaie et Alain Altinoglu.
Cet été, beaucoup de concerts. En septembre, du 16 au 18, le festival à La
Roche-Posay avec la création d'une magnifique sonate
pour violoncelle et piano de Fabien Waksman. Puis à Paris, le 22 septembre, le
Concerto de Guillaume Connesson avec l'Orchestre
National de France et Stéphane Denève. Ma vie de
musicien est aujourd'hui celle que je rêvais qu'elle soit ! Quelque chose
de très ouvert sur plein de champs. Que peut-on rêver de mieux pour un musicien
: d'avoir son festival, sa salle, d'inviter des musiciens avec qui on a envie
de jouer, de jouer quand on a envie et de ne pas le faire quand on n'a pas
envie. Le reste du temps être invité ici ou là et avoir des élèves qui sont extraordinaires
comme s'ils étaient mes mômes, et avoir des partenaires de musique de chambre
formidables !
Cher Jérôme que ce
rêve s'éternise !


Propos recueillis
par Stéphane Loison.
***
La Johannes-Passion par le Chœur de chambre
Les Temperamens Variations

Concert
du 19 mars 2016
Église Évangélique
Allemande (Paris) :
au premier
plan : les solistes avec, au centre, Thibault Lam
Quang.
L'église Évangélique Allemande de Paris a
renoué avec la tradition luthérienne en relançant d'abord l'audition annuelle
de l'Oratorio de Noël, puis celle de la Passion, grâce à Thibault Lam Quang. Loin
des modes actuelles, son interprétation historique reste fidèle aux critères de
Jean Sébastien Bach : effectifs limités à 25 choristes afin de respecter
le caractère liturgique de l'œuvre destinée à faire revivre intensément le
déroulement de la Passion du Christ, avec lecture chantée de l'Évangile du haut de la chaire pour
instruire les auditeurs ; réponses des protagonistes, récitatifs et airs
de caractère méditatif, ainsi que chorals typiques de la musique luthérienne.
Thibault Lam
Quang s'est assuré le concours de remarquables chanteurs allemands : Jan Hübner (Évangéliste, Ténor), Hans Hermann Jansen (Jésus,
Baryton), Daniel Eggert (Pilate, Basse), Philippe
Gié/ Rudolf van Heijst (Pierre), Hervé Saint Raymond
(un serviteur), et surtout des solistes Tobias Hechler
(Alto) et Johanna Knauth, très jeune Soprano promise
à une belle carrière. Tous se sont complètement investis dans cette émouvante
partition à laquelle ils ont conféré toute la densité spirituelle requise. Il
en est de même des instrumentistes : Guillaume Humbrecht
(Konzertmeister, violon solo de la Chapelle Rhénane),
Stéphane Réty (flûtiste, soliste de l'Orchestre
Symphonique de Bâle) et — à l'orgue — Helga Schauerte,
l'organiste titulaire toujours si efficace et attentive pour assurer le
continuo. Tous ces noms se devaient d'être mentionnés car, sous la baguette si
sensible et suggestive du chef qui peut compter sur ses musiciens, lors de ce
mémorable Concert, ils ont restitué le caractère voulu par Jean Sébastien Bach,
c'est-à-dire liturgique, comme ce fut aussi le cas de la tradition
strasbourgeoise du Vendredi Saint lancée en l'Église Saint-Guillaume en 1895
par Ernest Münch et reprise en 1928 par Fritz Münch. Chaque Vendredi Saint, en alternance, une Passion y
est programmée (soit la Johannes-Passion soit
la Matthäus-Passion (en deux concerts), à une
exception près où — l'Église ayant été bombardée à la fin de la Deuxième Guerre
mondiale — le Requiem allemand de J.
Brahms a été dirigé à la Salle des Fêtes par Fritz Münch.
Parmi les temps forts, citons entre autres,
pour le CHŒUR : l'introduction Herr, unser Herrscher créant
l'atmosphère et gagnant peu à peu en assurance ; l'intériorité émanant des
Chorals, apanage et identité de l'hymnologie luthérienne, avec effet
d'association d'idées ; la volubilité dans la question posée à
Pierre : Bist du nicht (seiner Jünger einer) ?, l'énergie dans les réactions de
la foule (turba)
s'écriant : [Nicht diesen, sondern] Barrabam ! ou encore
l'impératif : Kreuzige ! et la
question : Wohin ?... Pour les SOLISTES : la
précision d'attaque dans les dialogues ; la réplique de Jésus : Ich bin's. Pour
l'alto : l'air si expressif : Von
den Stricken meiner Sünden zu verbinden
et l'air si poignant : Es ist vollbracht. Pour la
Basse : le ton tranché et catégorique de Pilate. Pour la Soprano :
l'air si affirmatif : Ich folge dir gleichfalls
mit freudigen Schritten
ou encore la souplesse des vocalises dans le très bel air (avec flûte) : Zerfliesse, mein Herz. Pour la Basse : l'impressionnant passage Eilt ihr angefochten Seelen. L'ORCHESTRE
a largement, par ses timbres diversifiés (violon, flûte entre autres) assuré
l'arrière-plan émotionnel voire dramatique et, à l'orgue, Helga Schauerte a vigoureusement soutenu l'œuvre. Une mention
spéciale revient à l'ÉVANGÉLISTE (Ténor) qui s'est imposé par sa diction et son
élocution si précises, ses diverses intonations en fonction du sens du texte
biblique chanté, et descendant de la chaire pour interpréter ses deux airs, car
Thibault Lam Quang a aussi largement exploité les
possibilités spatiales de l'Église. De plus, à l'attention des non
germanophones, les surtitrages français et quelques
illustrations ont été projetés, et le programme, comprenant sa remarquable
introduction à l'œuvre, reproduisait également les textes allemand et français (grâce aux traductions revues par
Sylvie Le Moël et Élisabeth Rothmund).
Thibault Lam
Quang suit le texte de très près, en insuffle le sens à ses choristes jusque
dans les moindres nuances. Il ne bouscule jamais le déroulement de l'action,
exploite le caractère très éloquent et la valeur des silences si bien calculés,
afin que l'œuvre respire entre les diverses articulations. Il dirige en
souplesse, avec minutie et précision d'attaque (entrées successives). Il met
aussi particulièrement en valeur les passages descriptifs (par exemple :
le rideau du temple qui se déchire, puis le spectaculaire tremblement de
terre). Il spécule avant tout sur l'intériorité et la simplicité, sans
recherche d'effet ou de grandiloquence, et respecte l'esprit voulu par le
« cinquième évangéliste ». Les auditeurs se souviendront longtemps
encore du grand chœur : Ruhet wohl, ihr heiligen
Gebeine et de la plénitude du Choral final :
Ach Herr, lass dein lieb'
Engelein avec sa conclusion affirmative : Herr Jesu Christ, erhöre mich, ich will
dich preisen ewiglich (…Je te
louerai éternellement). Quant au Chœur de chambre Les Temperamens
Variations, créé en 2005, il a donc aussi le grand mérite d'avoir lancé, à
Paris — en l'Église protestante Allemande si accueillante et dont le cadre s'y
prête parfaitement —, ces traditions pour le temps liturgique de Noël (reprise :
les 3 et 4 décembre 2016 avec le Weihnachtsoratorium/Oratorio
de Noël) et, anticipant sur le Vendredi Saint, avec cette première audition, pour le temps
de la Passion.
Édith Weber.
Mendelssohn révélé

Yannick
Nézet-Séguin et le COE / DR
Le second des concerts de
l'intégrale des symphonies de Mendelssohn, donnée par Yannick Nézet-Séguin à la tête du Chamber
Ochestra of Europe, présentait les symphonies Nos 1,
3 et 5. Devant une grande salle de la Phiharmonie de
Paris comble. Un public fort attentif indéniablement sous le charme, et qui
n'aura pas perdu son après-midi. La Première Symphonie, op. 11, de 1824,
n'est sans doute pas la plus jouée parmi les œuvres que le musicien a laissé au
grand orchestre romantique. Celle qui suit immédiatement les douze Symphonies
de jeunesse pour cordes - au point qu'on l'avait initialement numérotée comme
« treizième » - est loin d'être négligeable. D'abord par sa durée
conséquente, pour ses quatre mouvements mais aussi par sa diversité. L'allegro
molto, que Nézet-Séguin prend de manière musclée pour
faire saillir son thème entraînant, va traverser des épisodes contrastés avec
en particulier un traitement des cordes que le chef rend tout intimiste avant
que la coda ne reprenne la course soutenue du début. A l'andante, on va
musarder dans une atmosphère délicieusement nocturne qui anticipe celle du Songe
d'une nuit d'été et de sa fameuse Ouverture et de son « Notturno ». On admire le ramage des bois de
l'orchestre, le hautbois et les flûtes. Le menuet, en habit de scherzo, sonne
vif entre les mains de Nézet-Séguin, alors que le
trio médian va offrir un moment d'apaisement presque léthargique : ce choral
des bois sur un accompagnement soft des cordes entraine l'auditeur dans le
rêve. Le finale con fuoco a fière allure, en
particulier dans son sujet fugué et les diverses interventions de la
clarinette. Il se dégage de cette lecture une luminosité étonnante, une
transparence de texture qui n'est pas hélas toujours associée au symphonisme romantique. Cette belle manière, on va la
retrouver, encore plus rayonnante dans la Symphonie N°3 « Italienne ». Nézet-Séguin empoigne l'allegro vivace dans une irradiante
allégresse et le mouvement découvrira un extrême raffinement, celui-là même de
l'orchestration de Mendelssohn, dont se détache la clarinette (Romain Guyot).
Comme cela respire ! L'andante con moto exhale un ton bienfaisant, au fil de
cette procession qui fait penser à la « Marche des Pèlerins » de Harold en Italie de Berlioz. Avec le con
modo moderato suivant, sur un schéma de menuet, on savoure les beautés du
paysage. Le finale attaca introduit un cheminement
qui va s'avérer éblouissant, pas seulement de lumière, mais aussi de technique
orchestrale : cordes translucides, bois en fête dans les deux danses croisées
de saltarello et de tarentelle, une des plus
originales inspirations de Mendelssohn. Scintillante exécution.

Yannick
Nézet-Séguin et de dos la Ière violon du COE,
Lorenza Borrani / DR
La Cinquième symphonie
dite « Réformation » - « Réforme » serait plus juste -,
diffère des précédentes. Un ton plus sérieux pare les deux mouvements extrêmes,
eu égard au dessein poursuivi : commémorer le tricentenaire de la Confession
d'Augsbourg. En fait, l'anniversaire sera décalé de deux ans car l'œuvre ne
sera créée, à Berlin, qu'en 1832, donc à titre posthume. Là encore on admire le
travail du chef canadien et de ses merveilleux musiciens. Après une
introduction très majestueuse débouchant sur une superbe fanfare, le con fuoco marque un magique temps d'arrêt sur le fameux
« Amen de Dresde » que Nézet-Séguin prend
dans un extrême pianissimo habité, nous rappelant au passage l'usage que Wagner
en fera dans le Prélude de son Parsifal. Il
boule légèrement le tempo dans le développement pour tracer toute la
dramaturgie de ce vaste mouvement aux diverses inspirations thématiques
(grégorien, choral luthérien). Le scherzo vivace semble encore plus
démonstratif de cette maestria, se frayant un chemin parmi ses belles
inventions mélodiques, comme au trio paré du chant des altos et des
violoncelles. Le très court épisode andante conduit au choral « Eine feste Burg ist unser Gott »
(Notre Dieu est une solide forteresse) : pris dans un crescendo pianissimo
alors qu'introduit par la mélopée de la flûte solo (extraordinaire Clara Andrada) ; dans un silence impressionnant de l'auditoire.
Le finale s'enchaine, et là encore, Nézet-Séguin va
en réimaginer et ordonner tous les éléments divers.
Un souffle habite sa lecture et l'orchestre répond avec un engagement inouï.
Même l'austère fugue étale ses vertus, et tout s'achève dans une fanfare comme
au début de l'œuvre. Après les dernières notes, un silence retient la salle
subjuguée par cette exécution si hautement pensée et magistralement exécutée.
On attend avec impatience ce que les micros du label Deutsche Grammophon en auront tiré comme des deux autres symphonies
données la veille (cf. NL de 3/2016). Du grand art.
Jean-Pierre
Robert.
L'expérience du Concertgebouw

DR
Le Concertgebouw,
comme son nom l'indique, est d'abord une salle de concert, en lisière du
Quartier des Musées d'Amsterdam, célèbre pour son acoustique, sur le modèle de
''la boîte à chaussure'' (comme Le Muzikverein de
Wien ou le Symphony Hall de Boston, quoique ici la
largeur de l'auditorium soit plus importante que dans ces deux cas). C'est
aussi, lorsqu'on y accole le mot Orkest, l'une des
phalanges symphoniques les plus en vue actuellement. Leur concert d'abonnement
dans leur salle en cette fin février, devait être dirigé par Franz Welser-Möst, pour se débuts in loco. Une mauvaise chute l'ayant
contraint à renoncer, il était remplacé par le jeune Lorenzo Viotti, natif de
Lausanne et ayant fait ses études à Lyon dans le domaine de la percussion.
Passé à la direction, il a été assistant
de Bernard Haitink à Chicago et de Mariss Jansons au Concertgebouw, dont il prenait pour la première fois les
rennes. Voilà un chef qui sait ce qu'il veut. Son interprétation de la
Deuxième symphonie D 125 de Schubert est loin d'être neutre : un largo
introductif qui fait justement saillir la ligne des bois et un allegro vivace prestissime : mais les cordes de cet orchestre d'élite
savent comment articuler à pareil train. L'andante est empreint de sensibilité
et les géniales combinaisons imaginées par le jeune Schubert font flores,
hautbois, flûte clarinette sont à la fête. Le Menuetto
parait plus motorique qu'alerte ; péché de jeunesse.
Et au presto final, Viotti boule les accents, quoique sa vision soit d'une
débordante vivacité. L'orchestre répond magnifiquement. Viennent ensuite les Lieder
eines fahrenden Gesellen, un des grands cycles (1883-1885) de Gustav
Mahler. Ces quatre morceaux sonnent idéalement dans l'écrin acoustique si
présent du Concertgebouw. Car l'orchestration
mahlérienne est un modèle de transparence, claire et détaillée. Au point que le
chanteur, Markus Werba, a tendance à ne pas toujours
apparaitre distinctement, dans les forte en particulier : problème de taille de
la voix plus que d'articulation, car celle-ci est irréprochable. Et
paradoxalement, les notes graves viennent mieux de ce timbre de baryton
lyrique, lui qui fut un fameux Papageno dans la
dernière Flûte enchantée de Nikolaus
Harnoncourt à Salzbourg en 2012. Le chef prodigue le lyrisme de ces pièces,
notamment de la première « Wenn mein Schatz Hochzeit
macht », comme dans la suivante « Ging heut' morgens übers
Fefd ». Avec le Lied « Ich
hab' ein glühend Messer », le drame s'installe dans l'ouragan
qui s'empare de l'orchestre, contraignant le soliste à s'ajuster. La section
médiane offre son lyrisme désespéré et la péroraison souffle les grands climax.
Le dernier Lied « Die zwei blauen
Augen », un sommet de poésie, est prétexte à des
sonorités orchestrales somptueuses, ce que le chef magnifie par une battue
large. Werba célèbre ces « deux yeux
bleus » avec infiniment de tact et de retenue. La seconde partie était
consacrée à un bouquet de valses et polkas viennoises. Ou un peu de
l'atmosphère du Concert du Nouvel An sur les bords de l'Amstel
! Ce seront tour à tour Leichtes Blut, une polka schnell de
Johann Strauss fils, bien enlevée, La Valse du baiser du même
compositeur, introduite par un beau duo du hautbois et de la clarinette. Puis La
libellule, polka Mazur de Josef Strauss, l'une
des pièces les plus exquises de cet immense répertoire, où l'on savoure le
frémissement impalpable des cordes, merveilleuses de transparence ici, et cet
accord final court et si doux. On mesure la maitrise du chef dans ces pages
réclamant tact et élégance. Friedenspalmen du
même Josef Strauss raconte une histoire, comme bien des morceaux de musique
viennoise, et ses divers épisodes alternent lyrisme expansif et furia
détonante. Le concert s'achevait par la Czárdás
pour orchestre op. 441 de Johann Strauss fils, tirée de l'opéra-comique Ritter
Pásmán (1882) ; un choix judicieux, dû à Welser-Möst, car le morceau est peu connu mais d'une indéniable
inspiration, qui fait penser à cette autre Czárdás,
de La Chauve-souris. Lorenzo Viotti enflamme l'auditoire, prenant le
mouvement à bras le corps, montant sa pâte avec doigté, ménageant avec flair
accélérations et ralentissements. Le Concertgebouw Orkest brille de tous ses feux. Et on mesure combien cette
musique viennoise est incomparable.
Jean-Pierre
Robert.
Bruckner selon le maestro Haitink

DR
Dans cette même salle du Concertgebouw, se produisait le lendemain un autre
orchestre, le Radio Philharmonisch Orkest, l'Orchestre Philharmonique de la radio
néerlandaise, pour un de ses concerts de matinée. Dirigé cette fois par Bernard
Haitink, une idole ici. Une salle archi comble
l'acclame à son entrée, pour l'écouter interpréter un de ses musiciens favoris,
Anton Bruckner. Il donnait d'abord le Te Deum. Composée dans les années
1881-1884, et ''pour Dieu'', c'est une des œuvres les plus inspirées du
musicien autrichien et de la musique sacrée. Haitink
en livre une interprétation puissante, révélant au-delà de son inspiration
grégorienne, sa dimension monumentale. Et ce dès le chœur d'entrée « Te
Deum laudamus », sur un unisson des cordes et un
rythme persistant, qu'on retrouve a travers les diverses autres séquences.
L'éloquence du discours de foi s'exprime fortement, comme à travers
l'intervention des solistes, un quatuor vocal d'exception avec le ténor Mark Padmore, les sopranos Sally Matthew et Karen Gargill, et la basse Gerd Grochovski.
Haitink transfigure l'austérité de ces pages, en
soulignant les pleins et déliés comme les silences entre les divers morceaux,
et s'attachant à des fins de phrases claires, non emphatiques. Et l'on perçoit
fugitivement quelque thème de la Septième Symphonie, contemporaine. La
péroraison, une immense fugue, est grandiose. Au fil de cette magistrale
exécution on aura apprécié la prestation du chœur à huit voix, ici les Groot OmroepkoorKoor, et Vlams Radio Koor, en particulier
lors de la séquence « In te Domine speravi »,
comme délivrée a cappella. Et la qualité de l'orchestre galvanisé par pareille
baguette : homogénéité des cordes, éloquence des bois et des cuivres. Venait
ensuite la Neuvième symphonie, également dédiée « au Bon
Dieu ». Ce sommet de la production symphonique de Bruckner, qui la laissa
inachevée (1896), Haitink
le joue comme tel, et dans la version de Nowak. Dans
une optique quasi liturgique, loin de toute séduction sonore facile, forgée à
une ferveur qui porte loin le pur exercice orchestral et dépasse sa monumentale
architecture. Il dirige avec la partition, comme pour la pièce précédente, beau
signe d'humilité de la part d'un chef qui connait ce langage. Le « Feierlich, misterioso » et
son trémolo continu des cordes est pris lent, d'une lenteur combien habitée
avec ses pizzicatos évocateurs, et le deuxième thème amené comme
affectueusement. Le développement sera puissamment dessiné avec ses effets de
masse, pourtant non pesante, ses brèves séquences s'emboitant les unes dans les
autres. Et la coda et ses crescendos par paliers successifs croissant en
intensité dévoilent une force proprement fervente plus que tellurique. Le
« Scherzo, ''animé'' », livre ce martèlement brucknérien typique, mordant
mais sans dureté, la scansion respirant naturelle ; et le trio est bien senti
avec son deuxième thème large, quoique sans excès, la sobriété se voulant alors
l'autre face de la grandeur. De l'adagio et son envoûtante digression mystique,
Haitink magnifie la nature de prière, d'hymne à la
gloire du Maître des cieux. On admire, entre autres, la reprise des cordes dans
le grave. Le nœud gordien de cette page unique est bien là dans ces passages
puissants et leurs silences. Lors des grands climax, les cuivres ne seront pas
sollicités, comme chez Klemperer par exemple, mais insérés dans la pâte sonore,
évoquant presque une idée de douceur. Au développement, et ses longues
digressions, qu'on a pu caractériser de méandres de la pensée brucknérienne, Haitink libère ce qui semble un cri de désespoir de l'homme
craignant de ne pas être à la hauteur, comme un sentiment d'aspiration à la
spiritualité. Mais devant pareille lecture, peut-on encore parler de méandres
de l'inspiration ? Des tentatives plutôt pour tenter de s'approcher du but, de
s'approcher de ce Dieu que vénère le compositeur : la réitération des thèmes
n'est pas répétition mais progression. La coda nous fait quasiment accéder à
une sorte de Nirvana, les dernières mesures ppp laissant entrevoir l'éternité.
Certes, le chef aura ajouté une bonne dizaine de minutes au timing ''habituel''
- qu'on n'aura pas vu passer - mais nous aura mené par la main dans des
contrées rares. Standing ovation, bien sûr.
Jean-Pierre
Robert.
Khovantskigate à
Amsterdam
Modest MOUSSORGSKY : Khovantschina. Drame musical en cinq actes.
Livret du compositeur. Version de Dimitri Chostakovitch. Dmitry
Ivashchenko, Maxim Aksenov, Kurt Streit, Orlin Anastassov, Anita Rachvelishvili, Gabor Bretz, Olga
Savova, Endrey Popov,
Svetlana Aksenova, Roger Smeets,
Vasily Efimov, Morschi Franz, Vitali Rozynko, Sulkhan Jaiani, Richard Prada. Chœur du National Opera. Nieuw Amsterdama Kinderkoor. Nederlands Philarmonisch Orchest, dir. Ingo Metzmacher.
Mise en scène : Christof Loy.
Nederlandse Opera,
Amsterdam.

©Nederlandse Opera
La trame de Khovantschina
est fort complexe. Dans son opéra, Moussorgsky qui a
lui-même conçu le livret, traite un grand morceau d'histoire russe des années
1660 et écrit une musique d'une beauté
souvent à couper le souffle, dépassant même en intensité son Boris Godounov.
Cette trame mêle en effet trois plans. Une intrigue politique d'abord, sorte de
crise de régime : la montée et la défaite du clan Khovantski,
du nom du principal opposant au régime de la régente Sofia qui à la mort du
tsar Fyodor en 1662, assura la transition, ses deux
demi frères Pierre et Ivan, nommés tsar ne pouvant effectivement régner du fait
de leur minorité. C'est Pierre, bientôt « le Grand », qui pendra le
pouvoir. Des divers partis d'opposition, celui du Prince Ivan Khovantski, aidé de ses affidés, les Streltzy
ou gardes du Kremlin, mène la rébellion. Il sera conduit à former des alliances
avec d'autres au gré des intérêts du moment. Une crise religieuse ensuite,
celle des Vieux Croyants, menés par le moine Dosithée,
contestant la légitimité des réformes, ce qui se traduit par un schisme. Et
enfin un arrière plan sentimental. Deux femmes jouent dans l'opéra un rôle
important, pour ne pas dire déterminant : Emma, une jeune femme d'origine
allemande qui est courtisée par Andrei, le fils de Khovantski;
et surtout Marfa, ex amante d'Andrei, plus ou moins
fortune teller, et possédée par une vision de mort,
qui la verrait périr dans les flammes avec celui-ci et les Vieux Croyants, en
un suicide collectif. C'est dire que si fragmentée, la trame entrecroise les
diverses strates en permanence, au point qu'on a pu dire que chacun des cinq
actes raconte une histoire différente. Ce qui parait dominer pourtant c'est la
rébellion d'Ivan Khovantski ; d'où le titre de Khovantschina ou « affaire Khovantski » ; ce qui fait dire aussi en poussant à
peine le trait : une sorte de Khovantskigate...

©Nederlandse Opera
Voilà en tout cas un challenge
pour un metteur en scène, qui doit tâcher d'unir ce qui n'a pas forcément de
lien logique. Christof Loy
signe une régie qui bien sûr actualise tout cela dans la Russie moderne. Tout
en l'inscrivant dans un cadre d'époque, au sens propre : la seconde partie de
la courte Ouverture laisse apparaître un arrêt sur image ou un tableau d'époque
saisissant. Mais en une fraction de seconde tout le monde se défait de ses
lourds vêtements d'époque pour se retrouver en quidam du moment ; tandis que
l'avant dernière image restituera le même tableau moyenâgeux. Entre ces deux
extrêmes, place à la théâtralité d'aujourd'hui. Aux échanges durs entre rivaux
d'un jour ou alliés du moment, car l'opéra compte beaucoup de ces dialogues à
deux ou trois personnages. Aux vastes déploiements, car c'est nul doute le
peuple, d'une Russie éternelle, qui tient les cordons de cette histoire
tortueuse. Loy inscrit sa mise en scène dans un
environnement dépouillé afin de se concentrer sur ces échanges et tableaux de
foule : un vaste espace blanc pour tout décor, pourvu de quelques rares
accessoires, une table, trois ou quatre chaises, qui feront office de lieu pour
l'écrivain public, de bureau, etc. Cet espace immaculé virera un temps au noir,
au III ème acte, pour mieux illustrer la douleur des
Vieux Croyants. Les scènes s'enchainent sans solution de continuité, à
l'intérieur d'un même acte. La direction d'acteurs en un clin d'œil fait et
défait une foule, remplit le plateau et le vide en un éclair, contraste les
diverses scènes : les Strelzy joyeux drilles, les
interventions des femmes éplorées ou tentant de maitriser leurs mâles éméchés,
les Vieux Croyants partagés entre béatitude et révolte. Loy
instaure des climats de frénésie ou de désolation, de fièvre ou de détresse
poignante. La scène du harem de Khovantski, au IV éme acte, est saisissante où l'on danse comme à regret, un
majordome femme à queue de pie flanquant les filles dans les bras du seigneur
des lieux qui se prend mécaniquement au jeu comme malgré lui ; tandis qu'une
enfant, téléguidée par le boyard Shakloviti, va lui
planter un couteau mortel dans le dos. Loy détaille
l'âme de chaque personnage : Ivan Khovantski, cynique
et balourd à la fois, son fils Andrei, vrai faux héros dans ses assiduités
envers Emma et son rejet d'un passé amoureux avec Marfa,
le Prince Golitsyne, veule mais habile manœuvrier, le boyard Shakloviti, inflexible dans son idée de vengeance, lui
qu'on a dépossédé de ses privilèges, Dosithée, moins
mystique qu'habité par la stratégie pure et dure, mais dont l'isolement est
souligné ; Marfa enfin, dont l'ambiguïté du
personnage est mise en exergue, femme fatale, un peu sorcière, illuminée,
réconfortant pourtant ses semblables, Emma en particulier, mais aussi blessée
dans ses sentiments de femme. Ses derniers échanges avec Andrei ne laissent pas
de doute sur la force desdits sentiments. Le personnage en acquiert un relief
particulier, une autre dimension, plus humaine que possédée par le fanatisme
religieux qu'on a l'habitude de représenter. Ajouté à cela que la faconde
vocale et dramatique de l'interprète (Anita Rachvelishvili)
frôle souvent l'incandescence - qui lui
vaudra la plus large ovation aux rideaux finaux - et on a une idée du léger
déplacement dramaturgique que Loy fait subir à la
pièce. L'enchainement des dernières scènes de l'acte V est moins clair et le
parti adopté montre sans doute ses limites. Il faut dire que les coups de théâtre
se succèdent : la défaite et l'assassinat de Khovantski,
donc la fin de la rébellion des Steltzy coïncident
avec l'accession au trône du tsar Pierre qui décrète une amnistie, mais peut-être pas religieuse, en tout cas
insuffisante à endiguer la soif de martyre des Vieux Croyants. Dans sa volonté
d'unifier tout, Loy manque ici de lisibilité : dans
la primauté accordée à la trame politique, le dessein du suicide des Vieux
Croyants n'est pas mis en évidence et partant, le sort du moine Dosithée.

Anita
Rachvelishvili ©Nederlandse
Opera
Musicalement, le spectacle de
l'Opéra d'Amsterdam est une réussite. Les interprètes en majorité russes ou
d'Europe centrale défendent leur partie avec la plus grande conviction. Ainsi
de Dmitry Ivashchenko, Ivan
Khovantski, qui malgré un souci de santé, défend le rôle avec panache,
singulièrement lors de la scène orientalisante des adieux. Question basses, Orlin Anastassov, Dosithée, lui dame le pion de sa voix de stentor et de son
émission très sonore, où l'on manque seulement le moelleux d'une basse chantante ; mais le parti scénique rend
cette approche parfaitement crédible. Le baryton basse Gabor Bretz, Shakloviti, est solide
comme un roc comme dans sa résolution tranquille à faire vaciller le rebelle.
Côté ténors, Maxim Aksenov
prête à Andrei de fiers accents tandis que Kurt Streit
assure au Prince Golitsyne un bagout tour à tour enflammé et veule. La joute
sans merci qui le met aux prises avec Ivan Khovantski
et Dosithée, au début du II ème
acte, restera d'anthologie. Si l'Emma de Svetlana Aksenova
frôle les limites de son soprano, l'engagement fait le reste. Et la Suzanne
d'Olga Savova fait de sa scène du III un moment fort,
échange véhément avec Marfa dont elle tente
d'endiguer, sans y parvenir, le débordement des sentiments amoureux. C'est qu'à
cet instant la Marfa d'Anita Rachvelishvili
montre la fêlure et avoue sa vraie féminité, qu'on ne soupçonnait pas de la
part de cette femme archétype de la possédée. L'ultime phrase de cette
confrontation, où elle prédit mourir avec Andrei, caressée dans un triple
pianissimo extraordinaire, montre combien cet amour est inassouvi. La
prestation vocale est tout simplement fabuleuse grâce à un timbre de mezzo grave où fleurissent des échappées
vers le soprano ou le grave de quasi contralto. Une foultitude d'autres rôles
sont parfaitement distribués. Une palme
est à dresser aux chœurs de l'Opéra d'Amsterdam, d'une précision et d'un
investissement impressionnants. Les scènes d'ensemble dont cette œuvre regorge
ont toujours un impact fort comme les contrastes entre les divers éléments
qu'ils représentent, rebelles, Vieux Croyants, femmes, enfants aussi. Et
confirment le statut de Khovantschina au rang
de meilleur opéra de chœurs du répertoire russe, bien plus que Boris
Godounov. À la tête du Nederlands Philharmonisch Orkest, Ingo Metzmacher, naguère directeur musical céans, fait sonner la
partition de Moussorgsky d'un éclat particulier. On
apprécie cette saveur chambriste qui appert au prélude et parcourt certains
passages clés, l'épure musicale à mains endroits, la veine orientalisante même
au besoin, le déferlement épique à bien d'autres, en particulier lorsque
l'orchestre renforce le chœur, les jaillissements de cuivres. La version
utilisée, celle réalisée par Dimitri Chostakovitch en 1959/1960, restitue toute
l'aspérité du langage de Moussorgsky, loin de la cure
d'adoucissement que lui fit subir l'orchestration de Rimsky-Korsakov.
Et Ingo Metzmacher sait distiller âpreté et douceur,
mélismes modulants et éclats vaillants. Du très grand travail ! Et un spectacle
qu'on aurait avantage à voir par ici.
Jean-Pierre
Robert.
Prades aux Champs Elysées

Le
Quatuor Talich, ici au Festival de Prades / DR
Deux fois l'an, le Festival de
Prades prend ses quartiers parisiens au Théâtre des Champs Elysées pour des
concerts de prestige. Ce premier de la saison était consacré à deux chefs
d'œuvre de la musique de chambre : le Quintette pour clarinette de Brahms et la
Quintette à deux violoncelles de Schubert. Comme entrée en matière le Quatuor Talich donne le Quartettsatz
de ce dernier, mouvement d'un quatuor inachevé D. 703 que le musicien écrivit
en 1820, au plus profond d'une crise dépressive. Cet allegro montre pourtant
une belle énergie avec son entame en forme de chevauchée et son développement
lyrique. A son écoute, on a une pensée pour un grand schubertien, Nikolaus
Harnoncourt, dont avait appris la disparition le matin même du concert.
Curieuse impression à l'écoute des Talich dont
l'exécution semble bien détachée et un peu incolore. Le Quintette pour
clarinette, fruit de la passion tardive éprouvée par Johannes Brahms pour
cet instrument, est un modèle, à placer à côté de celui de Mozart. L'une des
plus fortes inspirations du vieux musicien. Les Talich
le jouent là aussi de manière distanciée (développement de l'allegretto
initial, adagio pas si doux et rêveur qu'on le voudrait, où on semble presque
perdre le fil par endroit). La sonorité de la clarinette de Michel Lethiec est belle, mais un peu elliptique de l'intimité
associée à ces pages de tendre mélancolie. L'andantino, scherzo en fait, est
bien sage. Le finale con moto ne recherche pas l'éclat mais à force de sobriété
verse dans une objectivité sans saveur. Une lecture qui veut à tout prix fuir
tout excès de romantisme, certes, mais à l'inverse, n'offre pas suffisamment de
couleurs. Le Quintette pour deux cellos op.
163 D 956 de Schubert vient mieux. Un des plus beaux
fleurons de la production tardive du musicien, en Ut majeur comme la
« Grande » symphonie D 944 contemporaine, et dont l'écriture est
quasi symphonique du fait du doublement de la basse. L'allegro ma non troppo impressionne malgré
quelques traits trop martelés. L'adagio, un des sommets de la poétique scubertienne, est pris à une allure soutenue, ce qui n'est
pas forcément un mauvais parti, et le développement révèle une pensée
structurée de la part des Talich et du second
celliste Gary Hoffman qui pare ces phrases de beaux pizzicatos et de ces traits
justement soulignés enrichissant le discours de ses partenaires. Le
développement sera quasi orchestral et la coda habitée. Le scherzo presto est
combattif et le trio andante sostenuto bien contrasté : enfin y trouve-t-on le
vrai ton d'intimité qui sied à ce moment d'exception. Le finale, marqué
allegretto più allegro, est rapide comme souvent, le premier sujet vigoureux et
le deuxième très calme. Après le vaste développement qui voit progresser
l'association si caractéristique des deux violoncelles, et de superbes pages de
lyrisme, les toutes dernières se veulent prestissimes.
Intéressante exécution, même si on eût souhaité plus d'intériorité. Volonté là
encore de se garder à distance de tout romantisme facile ?
Jean-Pierre
Robert.
Anne Queffélec et fils... c'est tout
Satie...

Anne
Queffélec & Gaspard Dehaene / DR
Le troisième concert de 12H30
de l'intégrale Satie à l'auditorium du Musée d'Orsay était confié à Anne Queffélec et à son fils Gapard
Dehaene. Comme à son habitude, la pianiste prend la parole pour introduire le
concert, avec son talent de pédagogue : « Satie, un oxymore humain »,
original certes, mais si attachant, « une solitude entourée de
foule », un musicien qui vit « le goût fou des mots », les
titres si cocasses de ses pièces pour piano en offrant un bel exemple, un homme
pas si sérieux qu'on le pense, pas si satirique qu'on le croit, cultivant
« le ricanement du désespoir ». Il n'y a pas de clé spéciale,
souligne-t-elle, pour apprécier sa musique, contrairement peut-être à quelques
''monuments comme'' Beethoven ou Mozart, Debussy ou Ravel. Il faut simplement
se laisser à écouter. Le programme proposait des morceaux écrits entre 1888 (la
troisième Gymnopédie) et 1920 (La belle excentrique, fantaisie
sérieuse, et son « cancan grandmondain »).
Tour à tour illustrés par le jeune Dehaene qui propose un joli pianisme : Enfantillages pittoresques,
de 1913, Peccadilles importunes, tirées d'une série de pièces brèves
pour les enfants, pour des apprentis pianistes en fait ; puis le cycle des Danses
gothiques (1893), où Satie rapporte le pseudo harcèlement et les tourments
que lui aurait fait subir Suzanne Valadon, sa compagne éphémère (leur union ne
dura pas six mois !). Ce sont des pièces un peu ésotériques, au bord d'une
légère monotonie, où l'on a l'impression de quelque chose qui se fait et se
défait. Anne Queffélec prend place pour un bouquet de
pièces amusantes : Les Préludes flasques pour un chien (1912) qui à eux
quatre ne dépassent pas quatre minutes : puis deux des Pièces froides,
conçues en souvenir d'un hiver plus que rigoureux à Montmartre passé en 1897
par l'auteur dans une minuscule pièce non chauffée, appelée ''le placard'' ». Queffélec en restitue la flexibilité rythmique. Vient la Sonate
bureaucratique (1917), petit chef d'œuvre d'esprit, pièce d'inspiration
néoclassique qui raconte l'histoire minable d'un petit fonctionnaire à manches
de lustrine (allegro), rêvant d'avancement (andante) et s'enhardissant à
l'écoute d'une Sonate de Clementi à penser à son
avenir amoureux (vivace). Queffélec avait prévenu :
toutes ces pièces aux noms comiques, énigmatiques dans leur rendu sonore, sont
aussi difficiles à jouer. Elle les aime et cela se sent. Comme pour ce qui est
du cycle Sports et divertissements, de 1914 : 21 courtes pièces, tels
des instantanés qui installent un climat ou une émotion parfois d'une rare
intensité, des sketchs lilliputiens comme les appelait Cortot. L'originalité le
dispute au vrai-faux ami : « Réveil de la mariée » est bien agité
comme « Bain de mer » ; « Les courses » n'arrivent pas à
l'heure, le « Pique-nique » (sic) est d'une brièveté désarmante, le
« Traineau » déraille, mais « Carnaval » détone ! Les deux
pianistes seront réunis pour deux morceaux à quatre mains, dont le second des Trois
Morceaux en forme de poire, et le susdit « cancan grandmondain »,
façon music hall. Il est presque deux heures de l'après midi et Queffélec annonce qu'il n'est hélas plus possible de faire
des bis : les pièces duettistes sont les bis, lance-t-elle. Une boutade
que n'aurait pas renié
Satie !
Jean-Pierre
Robert.
Pleins feux de musique espagnole

DR
Pour son récital parisien à
Gaveau, Luis Fernando Perez avait programmé les Goyescas
de Granados (1867-1916). En guise de mise en bouche et d'échauffement, il
donne quatre pièces de Chopin et un Debussy. Le Nocturne en do dièse mineur
op. posthume est une belle entrée en matière, on ne
peut plus mélodique, qui ne préjuge pas de ce qui va suivre côté espagnol. Suit
la Ballade N°1 op 23, jouée très détaché et percussif, les derniers
traits en particulier. Les deux Nocturnes op. 27, n° 1 & n° 2 nous
amènent à cette évidence que le mot recouvre une appellation trompeuse, car
chaque pièce raconte une petite histoire, pas spécialement ''nocturne'', en
particulier pour ce qui est de sa partie médiane, de la seconde notamment,
tempétueuse. Perez joue ces deux morceaux avec sagacité. L'isle Joyeuse de Debussy peut paraitre un choix curieux,
sauf à anticiper les déferlements sonores qui vont suivre sous la plume de
Granados. Car il joue la pièce en pleine lumière, dans la manière moderniste de
Pierre-Laurent Aimard c'est à dire aux antipodes d'un
impressionnisme vaporeux ; tout au contraire, les contrastes sont exacerbés et
à la fin, les phrases tumultueuses sonnent comme une volée de cloches
enfiévrées. La seconde partie et le centre névralgique du concert étaient
consacrés aux Goyescas, suite pour piano,
d'Enrique Granados (1911). Perez prend la parole pour en donner quelques clés
de lecture. Excellente chose. Ce n'est, selon lui, pas seulement un des grands
cycles de piano du XX ème siècle, à placer aux côtés de
ceux de Messiaen par exemple ; ce sont des pièces inspirées directement du
Madrid de Francesco Goya et de sa fabuleuse palette de couleurs, et encore ici
autant de ses couleurs vives de la maturité que des tons sombres des peintures
et croquis de la fin. C'est aussi une ambiance virile, celle du
hidalgo espagnol, qui conte une histoire d'amour mettant en scène deux
couples dont le mari ou la femme de l'un lorgne sur l'épouse ou le compagnon de
l'autre. D'un amour impossible donc. C'est encore l'occasion de se souvenir de
la création de l'œuvre, il y a tout juste cent ans, puis de l'opéra du même
nom, à New York en 1916, directement inspiré du cycle pianistique, et qui
connut le succès au point que le président Wilson en félicita personnellement
l'auteur. C'est surtout, souligne Perez, un voyage musical passionnant où la
thématique est très élaborée et donne lieu à des ''thèmes mémoire'', qui
reviennent en boucle, un peu à la manière du Leitmotiv wagnérien. Les sept
parties sont autant de saynètes où s'opposent violence et lyrisme, et surtout
s'expriment tour à tour une manière de galanterie typiquement madrilène (N°1 :
« Les compliments) », l'intimité d'une amour naissant (N° 2 :
« Dialogue à la prison »), l'exaltation de l'aventure amoureuse
défendue, au son d'une danse populaire (N° 3 : « Fandango à la
chandelle »), un hymne à la beauté de la femme (N° 4 « la jeune fille
et le rossignol »), la pièce sans doute la plus connue et la plus jouée,
en dehors des exécutions en cycle intégral, le rossignol étant l'image même de
la musique. « Intermède » forme une transition avant les deux
derniers morceaux : « L'amour et la mort » n'a pas besoin de longues
explications tant le prétexte est évident, et « Sérénade au
spectre », qui fait figure d'Épilogue, nous transporte dans un entre-deux
poétisé tout en offrant un bouquet en réminiscence des divers thèmes
précédemment entendus. Muni de ce viatique, le public est à même de mieux écouter cette musique
fabuleuse. Elle le sera à travers l'interprétation de Luis Fernando Perez, on
ne peut plus haute en couleurs, triomphant d'un pianisme
convoquant les plus grandes difficultés, d'une virtuosité à faire pâlir les
meilleurs morceaux de Rachmaninov, symbole d'une Espagne torturée mais si riche
de rythme et de soleil. Perez se montre démonstratif, contrastant les passages
de jeu secco sans pédale et les moments où l'instrument sonne tel un orgue, ce
piano dont toute l'étendue des registres est sollicitée, par des accords
saccadés où malgré tout perce de temps à autre un lyrisme intense (« La
jeune fille et le rossignol »), par des passages en trilles véhéments,
presque mécaniques, où la tragédie se fait sans rémission (« L'amour et la
mort »), avec sa noria d'arpèges brusqués, ses soudains changements de rythme,
ses croisements de mains. On ne sort pas indemne de pareille lecture. Perez non
plus, qui en est le grand ordonnateur ;
l'un des meilleurs représentants de l'école de piano espagnole aujourd'hui. Il
en a gravé le disque en 2011 chez Mirare (MIR 138).
Jean-Pierre
Robert.
La dernière année ou le Testament de Mozart

©SM/Wolfgang
Lienbacher
Marc Minkowski a concocté un
programme original focalisant sur le Requiem de Mozart qu'il entoure de
pièces empruntées à la dernière année du musicien. Le concert débute ainsi par
l'Adagio et Rondo pour harmonica de verre, flûte, hautbois, alto et
violoncelle K. 617. Mozart l'a écrit à l'occasion du passage à Vienne d'une
virtuose du Glassharmonica, Marianne Kirchgässner. Ce quintette, daté du 23 mai 1791, dernière
de ses œuvres de musique de chambre, est une curiosité, ne serait-ce que par
son achalandage instrumental, mais aussi et surtout par la sonorité éthérée de
l'harmonica de verre, qui émaille la pièce de sons séraphiques, même si fluets.
Dans le vaste vaisseau de la Philharmonie de Paris, la chose est presque
incongrue, une seule toux en salle – et il y en eut bien plus - suffisant à
étouffer l'instrument et ses pairs. Minkowski enchaine avec l'air de Pamina « Ach ich fühl's » de La Flûte
enchantée K. 620, chanté par Chiara Skerath, avec finesse, mais sans réserve de puissance.
Vient alors le Concerto pour clarinette. Ce K. 622, un des plus beaux
fleurons du répertoire de l'instrument, avait pour interprète Nicolas Baldeyrou, ex solo du Mahler Chamber
Orchestra d'Abbado comme de l'ONF du temps de Masur,
et aujourd'hui 1er solo au Philar : un artiste
accompli qui transfigure ce morceau pourtant si rabâché. Il faut dire que
l'orchestre de Minkowski, ses Musiciens du Louvre, est la transparence même,
prenant l'allegro de manière délicate, laissant au soliste un espace divin ; ce
que celui-ci emplit par une sonorité d'une profondeur à couper le souffle,
notamment dans les notes graves détachées ou murmurées à la limite de
l'impalpable, et par un feeling ému pour ces pages emplies de sérénité et d'un
charme indéfinissable. Ces traits sombres, presque voilés, on les retrouve à
l'adagio, d'une grande intensité, tout comme l'ensemble de cette exécution. Le
deuxième thème en particulier respire une humanité déchirante, presque vocale,
le ton chambriste adopté par Baldeyrou se faisant un
régal d'un moment tout de tendresse, sans pathos aucun. Cette dernière
caractéristique pare le finale, enjoué cette fois, au fil de ce génial babil de
la clarinette qu'enjolive un accompagnement discret mais hautement pensé. Une
interprétation d'une musicalité rare. En seconde partie – Minkowski ayant dû
renoncer à « un concert sans entracte », afin de laisser à ses
sponsors assoiffés le plaisir de se rafraichir et de se dégourdir l'esprit –
était donné le Requiem, juste précédé de l'Ouverture de La Clémence
de Titus K. 621. Celle-ci, le chef la prend presto, rapide, presque boulée,
non sans laisser aux inventions thématiques dont Mozart, sur commande pourtant,
truffe ce morceau, loisir de s'exprimer. Du Requiem K 626, il livre une
lecture qui fait foin de toute routine. Dès les premières mesures de l'« Introïtus », on comprend que Minkowski cherche les
intentions, et tel un Nikolaus Harnoncourt - auquel
il avait tenu à rendre hommage en début
de soirée et à dédier le concert à sa mémoire - à faire un sort à chaque
phrase. L'intervention des chœurs se signale d'emblée aussi par sa qualité
d'émission, d'une clarté remarquable et
d'un impact certain ; ce qu'on retrouvera au fil de l'exécution. Lors de la sequentia, le « Dies Irae » tonne, apocalyptique.
Le « Tuba mirum » et son solo de trombone
est proprement effrayant, la basse Yorck Felix Speer délivrant un texte d'une clarté exemplaire de
simplicité. L'exclamation « Rex » est là aussi effrayante, le mot presque
crié de douleur. Plus tard, le « Confutatis »
oppose le chœur d'hommes sur accompagnement des cordes graves aux voix de
femmes toutes de tendresse sur fond de violons assagis ; un superbe effet. La section « Lacrimosa » est prise à un tempo soutenu, parée d'un
magistral crescendo du chœur. Au fil des interventions des solistes, on aura
admiré, outre la basse, le ténor un brin héroïque de Yann Beuron,
le beau mezzo de Helena Rasker et la soprano Chiara Skerath, mieux à l'aise
ici qu'en début de concert. Les morceaux suivants, achevés par le fidèle Süssmayr, sont délivrés avec ferveur : les fugues de
l'« Hostias », la puissance chorale du
« Sanctus », sont enluminées par les chœurs catalans, et le
« Benedictus » d'une douceur infinie. L'« Agnus dei » se
pare de nuances exquises. La séquence finale qui mêle les cors de basset et
bassons et des coups de timbales bien détachés, sonne comme des appels au repos
consolateur. En un mot, une lecture empreinte d'une volonté d'extrême fluidité,
bien différente des aspérités et brusques changements de tempos et de
perspectives d'un Harnoncourt. Une manière bien gallique de jouer Mozart, ce
qui n'omet pas une énergie génératrice de tragique, celle-ci étant enchâssée
dans un continuum qui ne connait pas de ruptures trop saillantes. Il en émane
une vision apaisée. Curieusement, Minkowski modifie la fin du « Lux Aetena » par une page pour sextuor instrumental et
chœur ; pour nul doute boucler la boucle de la calme atmosphère raréfiée du
début du concert. Le fruit de sa ''révision'' de la version Robbins-Landon, elle-même complétant celle de Süssmayr
? Une belle soirée à la gloire du génie de Salzbourg.
Jean-Pierre
Robert.
La Ville morte : entre Bruges et Hollywood
Erich Wolfgang KORNGOLD
: Die tote Stadt. Opéra en trois actes. Livret de Paul Schott
d'après le roman de Georges Rodenbach Bruges-la-Morte. Camilla Nylund, Klaus Florian Vogt, Markus Eiche.
Chœur et Maitrise de Radio France. Orchestre Philharmonique de Radio France, dir. Marzena Diakun.
Version de concert.

Camilla Nylund, Marzena
Diakun & Klaus Florian Vogt / DR
Moment très attendu que cette version de
concert de l'opéra d'Erich Wolfgang Korngold
(1897-1957) donné par l'Orchestre Philharmonique de Radio France au grand
Auditorium avec des solistes de réputation mondiale, habitués des rôles, Klaus
Florian Vogt (Paul) et Camilla Nylund (Marietta). A
la baguette, remplaçant Mikko Franck souffrant, Marzena
Diakun, chef assistante du « Philhar »,
mise à rude épreuve depuis quelques temps, la conduite de la Ville morte n'étant peut être pas
forcément un cadeau… Un opéra rarement donné, aux multiples facettes, post
romantique, expressionniste, vériste, composé en 1920 par un jeune compositeur
prodige d'origine juive, condamné à l'exil quelques années plus tard, qui
terminera sa carrière musicale par l'écriture de musiques de film pour
Hollywood. Un opéra tiré du roman de Georges Rodenbach (1855-1898) Bruges-la-Morte, se déroulant dans une
atmosphère onirique, sur un livret de Paul Schott (pseudonyme du jeune Erich et
de son père Julius, célèbre critique musical viennois) soutenu par une musique
éblouissante, vocale et instrumentale, où l'on peut percevoir les influences de
Wagner, par le développement d'une mélodie continue, et quelques accents pucciniens dans une étrange fusion de la prosodie
germanique et du cantabile italien. Nécessitant un effectif orchestral
important avec force de cuivres et percussions, renforcé par un large chœur
(Chœur et Maitrise de Radio France) et une partition vocale particulièrement
exigeante, on est en droit de se demander si l'Auditorium était vraiment une
salle totalement adaptée, capable de rendre à cette musique toute sa
somptuosité …La suite nous donna hélas raison…Une œuvre à la ligne mélodique
ample et souple, à l'orchestration riche, aux timbres délicats, faisant
alterner de vastes tuttis, des confidences dramatiques, des duos éthérés ou
encore des scènes de comédies, tout cela impliquant une direction d'orchestre
savante et soucieuse des équilibres entre orchestre et chanteurs, ainsi
qu'entre les différents pupitres. Dommage car c'est précisément cet équilibre
qui manqua notamment dans le premier acte où l'orchestre mené sans nuances
effaça les timbres raffinés de l'instrumentation et couvrit les chanteurs les
obligeant à forcer la voix, délaissant ainsi, de façon assez inopportune, la
brumeuse Bruges pour la rutilante Hollywood ! Les choses iront,
heureusement, en s'améliorant aux deux actes suivant nous réservant de
magnifiques moments comme la célèbre chanson de Marietta « Glück das mir verlieb », l'air de Fritz (excellent Markus Eiche) « Mein Sehnen, mein Währen »
ou encore les nombreux duos entre Paul et Marietta du fait de la
complémentarité parfaite des timbres, et enfin le réveil de Paul, comme une
sorte de retour nostalgique à la
vie concluant l'opéra « Die Tote ? Wo ? ». En bref, un opéra magnifique, grand
moment de musique, une interprétation vocale irréprochable et un « Philhar » au sommet de son art. Pour prolonger le
plaisir, citons la version CD de référence, incontournable, conduite par Erich Leinsdorf avec Carol Neblett et
René Kollo, chez RCA (1975).
Patrice Imbaud.
Philip Glass et Dimitri Chostakovitch ou le mariage de la carpe et
du lapin !

Jaap Van Zweden © Marco Borggreve
Soirée très contrastée à la Philharmonie de
Paris sous la baguette du chef néerlandais Jaap Van Zweden, récemment nommé à la direction musicale du New York
Philharmonic,
venu diriger pour deux soirées l'Orchestre de Paris, dans un programme
associant des œuvres de Philip Glass et de Dimitri Chostakovitch. En création
européenne et ouvrant la soirée, le Concerto
pour deux pianos du compositeur américain, interprété par les sœurs Katia
et Marielle Labèque. Philip Glass (*1937), chef de
file du courant musical minimaliste, ne semble jamais avoir autant mérité ce
qualificatif tant nous a semblé indigente cette création… Indigence de la
partie de piano, indigence de l'orchestration pour une œuvre typiquement glassienne au point d'en frôler la caricature. Une
composition datant de 2014-2015, créée en mai 2015 à Los Angeles sous les
doigts des mêmes interprètes et sous la direction de Gustavo Dudamel. Une partition en trois mouvements, sans cadence de
soliste, écrite à l'intention des sœurs Labèque
spécialistes du genre. Un premier mouvement plein d'allant un peu jazzy, mêlant
flux et mélodie, évoluant comme souvent chez ce compositeur vers une mélancolie
quelque peu sirupeuse, un second mouvement très marqué rythmiquement par les
percussions et un troisième et dernier, adagio, se déroulant dans une
atmosphère éthérée, égrenant quelques notes éparses sur un fond orchestral sans
grand intérêt, qui réussit finalement à donner corps au pari de Flaubert, à
savoir de faire une œuvre sur rien... Bref,
un concerto qu'on oubliera vite, mais qui reçut, il faut l'avouer, un accueil favorable du public…Ce qui
finalement est le plus important. Changement d'ambiance pour la deuxième partie
de concert avec la célèbre Symphonie n° 5
de Chostakovitch, composée en pleine période des purges staliniennes en
1937, en remplacement de la Symphonie n°
4 censurée par le compositeur lui-même après les menaces du régime
stalinien émises dans la Pravda, et faisant suite à la création de l'opéra Lady Macbeth de Mzensk,
jugée par les autorités comme un symbole de l'avant gardisme
bourgeois (?)? Dès lors, la Symphonie n°
5 fut interprétée comme une amende honorable du compositeur à une juste
critique…Il n'est pas sûr que cette interprétation soit la bonne, bien
heureusement, quand on connait le double langage et l'ambigüité qui parcourent
en filigrane les œuvres du maitre. Entre la fadeur de l'orchestration glassienne et la richesse de celle de Chostakovitch, le
contraste parut rude, la Cinquième Symphonie permettant à la phalange
parisienne de briller de tout son lustre sous la baguette ferme et précise de Jaap Van Zweden. Comme à son
habitude l'orchestre de Paris fit valoir tous ses pupitres, avec une mention
d'excellence pour les vents (petite harmonie et cors) et pour le violon solo de
Philippe Aïche. D'un point de vue interprétatif, la
lecture choisie par le chef s'inscrivit assurément dans une vision très
occidentale de l'œuvre, dans la lignée de Bernard Haitink,
utilisant des tempi modérés, voire lents (surtout au premier et troisième
mouvement), un phrasé souple et lyrique manquant parfois de corps, alors que
certains, dont nous sommes, auraient préféré une interprétation plus anguleuse,
plus tendue, plus rapide, plus charnelle, en définitive plus russe à l'image de
celle de Kirill Kondrashin
(à retrouver, pour les amateurs, chez Mélodia, dans
l'intégrale des symphonies de Chostakovitch, qui fait référence). Une soirée
donc très contrastée qui se conclut, heureusement par le meilleur !
Patrice Imbaud.
Un opéra sorti de l'ombre : la
Jacquerie de Lalo
La Jacquerie. Opéra en quatre actes d'Edouard
Lalo et Arthur Coquard. Livret d'Edouard Blau et
Simone Arnaud d'après une pièce de Prosper Mérimée. Véronique Gens, Nora Gubisch,
Edgaras Montvidas, Florian Sempey, Alexander Duhamel, Julien Véronèse, Rémy Mathieu.
Orchestre Philharmonique & Chœur de Radio France, dir.
Patrick Davin. Grand Auditorium de la Maison de la
Radio. Version de concert.

© Gallica / BNF
Après avoir récemment écouté La Ville morte de Korngold
et aujourd'hui La Jacquerie de Lalo
et Coquard, deux opéras en version de concert donnés dans le grand Auditorium
de Radio France, une constatation apparait comme une évidence : Cette
salle n'est pas apte à recevoir de grands effectifs orchestraux, ni des opéras,
même en version de concert, du fait d'une acoustique concourant à une mauvaise
répartition du son et à une saturation de l'espace sonore. Ce fait étant acté,
il faut reconnaitre qu'il était méritoire, sinon héroïque de ressortir des
tiroirs cet opéra posthume de Lalo achevé par Coquard. Vénérable rareté, donnée
en juillet 2015 au festival de Radio France à Montpellier, coproduite avec le Palazetto Bru Zane, avec une distribution vocale différente
de celle d'aujourd'hui, à l'exception des deux rôles principaux féminins
(Véronique Gens et Nora Gubisch) et c'est bien là que
le bât blesse… Un opéra rare qui connut une gestation difficile. C'est
probablement pour sa jeune épouse Julie Bernier de Maligny
qu'Edouard Lalo entreprit en 1866 son opéra Fiesque,
opéra qui ne fut jamais représenté mais dont certains passages furent
réutilisés pour le Roi d'Ys (1888) ou
la Jacquerie (1889-1895). Edouard
Lalo mourut brutalement en 1892, laissant son opéra inachevé, limité au premier
acte. Arthur Coquard, élève de César Franck,
termina l'ouvrage (2e, 3e et 4e actes)
pour une création posthume en 1895 à Monte Carlo. Edouard Blau
ne fut pas plus constant abandonnant le livret du 4e acte à Simone
Arnaud…
L'histoire nous conte la révolte des
paysans contre leur seigneur, une jacquerie conduite par un bûcheron
(Guillaume) et le fils (Robert) de la fermière (Jeanne), rébellion sur laquelle
se greffe une relation amoureuse entre la fille du seigneur (Blanche) et
Robert. Un livret simple, concis, bien construit et une dramaturgie efficace,
se terminant inévitablement par la mort. Au plan musical, la différence est
flagrante entre le premier acte et les suivants. Autant l'écriture de Lalo peut
sembler vigoureuse, presque abrupte, à grand renfort de tutti et de fanfares de
cuivres, expliquant que ce soit cet acte inaugural qui pâtit le plus le
l'acoustique discutable et de la direction de Patrick Davin
peu soucieuse des équilibres entre les différents pupitres et de la balance
avec les chanteurs, autant cet opéra tire assurément tout son charme des actes
suivants et notamment des splendides préludes orchestraux s'appuyant sur une
orchestration délicate (petite harmonie et cors) et colorée, s'inscrivant dans
la grande tradition française par son élégance, matinée de wagnérisme par
l'existence de thèmes récurrents et d'une ligne mélodique continu, sans oublier
une vocalité empruntant volontiers à Verdi. Au plan de l'interprétation, le
« Philhar » étincelant et investi ne mérite
aucun reproche, tout comme Véronique Gens, au chant cristallin qui campe une
Jeanne alliant réserve et passion, ou Nora Gubisch à
la vocalité facile, au timbre chaud qui donne corps à une Jeanne d'une
touchante humanité. En revanche les deux rôles principaux masculins, Edgaras Montvidas (Robert) au
timbre acide, à l'émission forcée ou Florian Sempey
(Guillaume) au chant agressif et limité dans les graves, décevront tous les
deux, à l'inverse d'Alexandre Duhamel (le Comte) qui sut donner à son
personnage toute l'autorité et le charisme nécessaire par sa belle voix de
baryton-basse. On regrettera également l'indigence de la mise en situation, la
mauvaise diction des chanteurs masculins, volontiers incompréhensibles, et
l'absence de surtitrage, d'autant plus préjudiciable
à l'œuvre que les livrets n'étaient pas distribués en nombre suffisant dans la
salle, laissant nombre de spectateurs dans une muette et béate interrogation
devant cet opéra méconnu de la plupart…Toutefois on retiendra quelques beaux
moments d'opéra, surtout, comme nous l'avons vu dans les derniers actes, comme
le dialogue entre Jeanne et Robert à l'acte II et tout particulièrement « Vierge, madame et maitresse.. »,
d'une intense et fervente résignation, ou le dialogue de Blanche avec le Chœur
« L'oiselet du joli bocage.. »
ou encore celui mené avec le Comte à l'acte III. Notons également le superbe solo de cor anglais de l'acte IV rappelant Tristan, et le magnifique échange
amoureux entre Robert et Blanche, dernier aveu avant la mort. En bref, un opéra
tout à fait passionnant au plan musical et musicologique, mais une version
parisienne qui n'atteint pas à la beauté et à la réussite de la représentation
de cet été à Montpellier par la moindre qualité de la distribution vocale
masculine.
Patrice Imbaud.
Bon Anniversaire Monsieur Inbal !

Eliahu Inbal © Rikimaru Hotta
Le chef d'orchestre israélien Eliahu Inbal, ancien directeur
musical de la Fenice de Venise et du Konzerthaus de Berlin, menant actuellement une carrière de
chef invité, éminent spécialiste de Bruckner et Mahler, avait choisi de fêter
son 80e anniversaire à la Philharmonie de Paris, à la tête de
l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Bon choix, s'il en est, d'autant
que le programme associait une œuvre de musique contemporaine, musique dont Eliahu Inbal s'est souvent fait
le champion et une grande œuvre symphonique requérant une grande expérience de
la direction d'orchestre. La création française de la Flûte en suite de Jörg Widmann (*1973)
clarinettiste et compositeur allemand, ouvrait donc cette soirée anniversaire
interprétée par le flûtiste Emmanuel Pahud. Une œuvre
de notre temps qui reçut un bon accueil de la part du public, venu nombreux
dans le grand temple parisien de la musique classique. Une composition créée en
première mondiale le 26 mai 2011 par Joshua Smith et l'Orchestre de Cleveland
dirigé par Franz Welser-Möst. Une partition
construite sur le modèle de la suite baroque de danses (quelque peu remaniées
dans le cas présent !) en huit mouvements, suite baroque sur laquelle plane l'ombre
tutélaire de J. S. Bach, comme le dernier mouvement pastichant la Badinerie de la Suite orchestrale n° 2 du Cantor de Leipzig en porte témoignage.
Chaque mouvement donne à la flûte solo une tonalité et une couleur spécifiques
dans un dialogue avec un groupe instrumental particulier de l'orchestre (Flûtes
de l'orchestre, cordes, bois, cuivres, percussions et tutti). Une œuvre très
virtuose, très rythmée, témoignant d'un important travail sur les timbres
(flûte, harpe, célesta) où Emmanuel Pahud, 1ere flûte
solo des Berliner Philharmoniker,
parvint à obtenir des sonorités inouïes par un exceptionnel travail
d'embouchure, simulant parfois le chant diphonique.
Une œuvre comme un lien tendu entre tradition et modernité se terminant par un
clin d'œil fait au vieux maitre de Leipzig avec un très étonnant pastiche de sa
célèbre Badinerie qui fut d'ailleurs
bissée à la demande du public conquis. En deuxième partie de concert, le chef
israélien avait choisi de diriger la Symphonie
n° 9 d'Anton Bruckner (1824-1896). Le compositeur autrichien avait
conscience de la malédiction touchant les 9emes symphonies, Beethoven, Schubert
et bientôt Mahler en seront victimes…Aussi est-ce dans un climat très
particulier que cette symphonie prit naissance, hantée par l'idée de la mort
prochaine, elle fut offerte à Dieu par le maitre de Saint Florian. « Mon œuvre dernière, c'est à dieu que je
l'offre, s'il l'accepte » écrivit-il. Noir pressentiment, son ultime
symphonie demeurera inachevée, se limitant à trois mouvements, se terminant par
un adagio, comme plus tard la 9ème de Mahler. Un tel programme et
une telle dédicace peuvent laisser songeur expliquant que cette œuvre puisse
parfois être conduite avec une
grandiloquence, une emphase et une affectation à mille lieux de la timide,
chaste, humble et pieuse personnalité du compositeur. Eliahu
Inbal ne tomba pas dans ce piège facile, nous
servant, ici, un Bruckner véhément mais sans lourdeur, fervent mais sans
prosélytisme, allégé et puissant, clair dans le phrasé, juste dans le ton, tout
animé de tension, d'adoration et de dévotion. Une interprétation remarquable
d'intelligence et un « Philhar »
resplendissant, une prestation qui fit l'unanimité parmi les musiciens et le
public. L'inévitable « Happy Birthday »,
presque décalé, conclut sur une note amicale cette belle soirée musicale !
Patrice Imbaud.
Florian Noack aux Pianissimes

©Agentur
Florian Noack est
un tout jeune pianiste qui a deux passions. D'abord, les œuvres rares du
répertoire romantique et post romantique : il aime inclure dans ses programmes
des compositeurs comme Medtner, Lyapunov,
Alkan ou Dohnanyi. Son autre passion est de faire des
transcriptions. Son programme était forgé à ce genre de mélange. Un peu
traqueur, le début de sa transcription du Concerto pour 4 claviers BWV 1065 de
Bach flottait un peu, mais il y avait de belles idées et son jeu est assez
remarquable. Les 8 Klavierstücke op.76 de Brahms
sont des pièces assez ennuyeuses si on ne trouve pas le ressort pour les
interpréter. Malgré sa technique irréprochable, Florian Noack
n'a pas trouvé le chemin pour nous faire adhérer à sa proposition. Avec Medtner (Deux Contes Op.48), compositeur très à la
mode en ce moment, et surtout Lyapunov (2 Études
Transcendantes Op.11), Florian Noack était à son
affaire. On sent qu'il aime ce genre de musique. Mais c'est avec ses bis qu'il
nous a conquis en jouant un Prélude de Lyadov et une
étude de Dohnanyi. C'est par son
« tube », une superbe transcription d'un morceau du Lac des
Cygnes, qu'il a terminé son récital sous les acclamations du public. Le
disque de ses transcriptions et paraphrases de Tchaïkovski (Le lac des
cygnes), Rachmaninov (Aleko), Rimsky Korsakov (Shéhérazade) et de Lyadov (Le lac enchanté) est fort beau, original et
inventif (Ars Produktion). Un seul bémol, la pochette
avec son portrait, est très laide ! Ce jeune pianiste à l'avenir très prometteur
(il a été sélectionné pour le Concours Reine
Elisabeth) a plus de charme que ce que nous montre ce mauvais
photographe ! Le très courageux et sympathique label Artalinna
a aussi édité un CD où Florian Noack interprète Medtner et Brahms. La pochette, elle, est superbe, et le
contenu vaut le détour !
Stéphane Loison.
Nicholas Angelich et Laurence Equlibey : Beethoven comme à l'époque ?

Nicholas Angelich DR
Le Concerto n°4 est peut-être le plus
original, le plus déroutant, des cinq concertos de Beethoven. Le piano commence
seul. Comment attaquer ces premières notes ? Mystère ? Il y a dans la
manière de jouer ce concerto comme une sorte d'imprévu, comme si Beethoven
avait sciemment voulu brouiller les cartes. A l'écoute des diverses
interprétations on s'aperçoit de la diversité d'approche des pianistes.
Nicholas Angelich est arrivé sur scène très
décontracté et a attaqué les premières mesures avec assurance. Il est assez
rare de l'entendre jouer sur un pianoforte. Toutes les nuances qu'il peut
apporter sur un piano d'aujourd'hui sont remplacées par l'énergie, la vélocité.
Face aux cordes d'époque et à la direction précise, à l'autorité de Laurence Equilbey, une joyeuse complicité s'est établie entre
pianiste et orchestre qui perdura tout au long des trois mouvements. Oubliées
les versions piano (conventionnel) / orchestre : ici, nous étions dans une
autre dimension. Ce fût le cas également pour l'interprétation de la Troisième
Symphonie « Eroica ». Du fait des
cordes à l'ancienne, « La marcia funebre » sonnait comme une vraie marche de la
Révolution française et dans le scherzo, entendre cette sonorité très
particulière du trio des cors « d'époque », faisait découvrir une
autre facette de cette œuvre si connue. Pour Carlo Maria Giulini,
jouer ainsi les symphonies c'était faire œuvre de musée. Pour d'autres, c'est
un plus marketing, commercial. Georg Solti, un jour,
déclara qu'il faudrait qu'il joue la Cinquième telle que Beethoven
l'écrivit. Peut-être, lors de ce concert à la Philharmonie de Paris, avons-nous
approché au plus près des intentions de Beethoven ? En tout cas vécu une
belle expérience. Ce concert sera diffusé le 29 avril à 14h sur France Musique.
Stéphane Loison.
Une soirée à la la Salle Cortot et ses
divines surprises

Raphaël Sévère ©Bertrand Béchard
Comme l'a expliqué Jérôme Pernoo dans son interview (cf. supra), à la salle Cortot
avec le Centre de Musique de Chambre de Paris, c'est une manière de faire de la
musique de chambre différemment et d'être plus près du public. Du 10 au 26
mars, le Quatuor Ardeo, jeune quatuor plein de
talent, a interprété le Quintette avec clarinette K. 581 de Mozart. Le
soliste était l'exceptionnel jeune musicien Raphaël Sévère. Ce surdoué, qui dès
l'âge de 12 ans était lauréat de nombreux concours internationaux, et est
aujourd'hui demandé dans le monde entier, a joué ce soir et pendant plus d'une
semaine ce quintette. Cela reste la seule pièce de Mozart
pour cette formation.
Cette partition joyeuse et tendre, ces jeunes gens ont su nous en transmettre la finesse et la
profondeur. De sa large palette de ton, Raphaël Sévère l'interprète avec
énergie, douceur, clarté, et des mezza voce ahurissants. Le dialogue avec la
première violoniste Mi-sa Yang, dans le larghetto,
est plein de jeunesse et donne le ton à cette douce cantilène. Grâce à cette
nouvelle façon de programmer, on peut retourner réécouter ou écouter ce
quintette, découvrir des traits qu'on a pas entendus
la première fois et aussi apprécier une interprétation qui n'est pas figée,
comme une pièce de théâtre en direct. C'est bien là ce que propose le Centre de
Musique de Chambre de Paris. Après ce quintette, venait un extrait d'une
composition pour guitare et clarinette de Raphaël Sévère, interprétée par ce
dernier et le guitariste Antoine Morinière. Ces
quelques 10 minutes, dans le cadre de la séquence « Freshly
Composed », proposaient une œuvre dense et
complexe. Encore une bonne initiative ! Le deuxième concert, à 21H30, offrait
le duo des sœurs Nemtanu qui ont interprété quelques
uns des 44 Duos de Bartók avec beaucoup de décontraction, en s'adressant
au public pour en donner des clés de lecture et le nom de chacune des pièce jouées. Puis une jeune femme est venue « faire le
bœuf » avec elles. C'est la jeune et talentueuse pianiste d'origine
coréenne Yedam Kim. Avec Deborah, elles ont interprété
magistralement les Danses Roumaines de Bartók. Sarah est alors revenue
sur scène et toutes les trois ont joué pour cette formation inédite que sont
deux violons et un piano. Elles ont découvert que Dimitri Chostakovitch avait
écrit pour cette improbable formation. Les Cinq pièces pour deux violons et
piano, qui datent vraisemblablement du début de sa production (plusieurs
catalogues des œuvres ne la mentionnent d'ailleurs pas) sont, certes, de peu
d'intérêt musicologique, mais on se laisse aller à ces pseudo rythmes viennois.
Qui ont ravi le public. Lesdites Pièces auraient-elles plu au Camarade
Staline ?
Stéphane
Loison.
David Kadouch dans Satie : le compte n'y
est pas

DR
Malgré tous ses prix, ses concerts avec des
stars, le jeune pianiste David Kadouch n'a pas su
nous réveiller de la torpeur dans laquelle il nous a plongé
dès le début du concert en interprétant la célèbre Gnossienne
n°3. Pendant tout le récital il a joué Satie avec mollesse, affectation,
prétention même. Tous les morceaux avaient la même saveur c'est à dire
sans ! En bis, il a joué un cake-walk sorte de morceau venu de la musique
des afro-américains du sud, ancêtre du ragtime. David Kadouch
n'a sûrement jamais écouté cette musique et ne sait pas ce que veut dire le stride. Oublions Satie par Kadouch.
Ce pianiste doit bien avoir du talent ailleurs pour être autant invité dans les
festivals ! Le public a été poli sans plus à la fin du concert.
Stéphane Loison.
''Dark Concert'' au
Centre de Musique de Chambre

Le Quatuor Ardeo ©C. Doutre
''Dark
concert''....Jérôme Pernoo nous a fait vivre une
expérience passionnante. Car tout le concert s'est déroulé pratiquement dans le
noir. Cette expérience unique s'est faite
sur la base de l'histoire de cette salle à l'acoustique impressionnante, et qui
a été « sublimée » par le système son de la firme Devialet,
un des partenaires du Centre. Jérôme nous a fait voyager dans le temps dans
cette salle qui n'avait pas encore le nom de Cortot, depuis les premières notes
que jouèrent des interprètes mythiques jusqu'à celles que la troupe actuelle du
Centre de Musique de chambre de Paris a fait résonner depuis cette saison. On a
entendu tour à tour des enregistrements du fameux Trio Cortot-Casals-Thibaud
(le Trio opus 97 l'Archiduc de Beethoven) somme s'il était présent, tant la HI FI Devialet était superbe. On enchaîna avec l'impressionnante
jeune pianiste Yedam Kim, dont seul le clavier était
éclairé, et qui a donné la Valse op. 64 n°2 de Chopin et La Campanella de Liszt.
Puis le jeune quatuor Ardeo, dans la pénombre, a interprété le Quatuor op.59 n°3
de Beethoven. Le noir revenu, on réécouta le trio dans une pièce de Haydn, le
Trio « In the Gypsie Style » n° 25. C'est dans le
noir complet, avec une puissance ahurissante, que le trio Alda joua encore un
extrait du Trio N° 2 de Chostakovitch.
Dans une semi-pénombre, on assista à la création par le Quatuor Ardeo et Perrnoo au cello, d'un début de quintette, ''Noctune'',
d'un jeune violoncelliste compositeur de 15 ans, Emile Sécheret, très influencé par l'atmosphère mahlérienne. Et c'est dans
le noir que la soirée s'est terminée avec le fameux Adagietto
de la Cinquième Symphonie de Mahler (enregistrement de Claudio Abbado et
des Berliner Phil). C'est de l'ombre à la lumière que
nous avons participé à ce spectacle très original où direct et enregistrement
se sont mélangés dans une qualité sonore de très haut niveau. Les jeunes
artistes, nous les avions entendus précédemment et nous connaissions déjà leur
qualité. Jérôme Pernoo est toujours prêt à nous surprendre
avec la qualité essentielle qui est la sienne : la générosité ! Vivement
la seconde saison !
Stéphane Loison.
Beethoven et un bœuf de chambre... chez Cortot

Le Quatuor
Hanson / DR
Au violoniste Radicati
qui reprochait à Beethoven que le quatuor op 59 n°1 ne soit pas de la musique, Beethoven avait
répondu : « ce n'est pas pour vous, c'est pour les temps à
venir ». Avec l'interprétation de cette œuvre par le Quatuor Hanson, salle
Cortot, ces temps là sont venus. Il suffit que l'enthousiasme s'empare de la
musique et des musiciens pour que la partie soit gagnée. L'œuvre renaît au
centuple, elle revit. La virtuosité est tellement maîtrisée qu'on l'oublie
aussi vite qu'on est subjugué par l'émotion et les subtilités du jeu (dans
l'adagio par exemple), particulièrement celui du jeune violoniste Anton Hanson
qui donne son nom à l'ensemble et lui insuffle une légèreté, presque un humour
faisant pardonner à Beethoven certaines redites qui pourraient sembler
fastidieuses et hissent l'œuvre au sommet de l'art du quatuor. Après Beethoven, Mozart et le Quintette pour
deux altos K. 516, joué par le même quatuor Hanson et un invité surprise. Selon
le principe du "bœuf" cher aux jazzmen, ils n'ont jamais
répété ensemble. Ce soir Jérôme Pernoo a invité
Michel Michalakakos, professeur d'alto au
Conservatoire, et l'ensemble a été bluffant.
Comme au cinéma, la première prise est souvent
la meilleure parce que la plus spontanée et… la plus vivante.
Jean
François Robin.
Le National Trust
réhabilite Leith Hill Place, la demeure du jeune Ralph
Vaughan Williams

© National Trust
Ralph
Vaughan Williams (1872-1958) est
l'un des plus grands compositeurs du XXe siècle. L'Angleterre lui
rend un riche et bel hommage grâce à la belle mission du National Trust, fondé en 1895, qui a réhabilité, dans le beau comté
du Surrey, Leith Hill Place, sa maison d'enfance dont
l'origine remonte au moins au XVIe siècle. Il y a vécu à partir de
l'âge de deux ans jusqu'au moment de partir étudier à Cambridge University où il fréquentera
notamment le savant Bertrand Russell (1872-1970) et travaillera le contrepoint
avec Charles Wood (1866-1926). Il avait alors vingt ans.
David Owen Norris, dont j'espère que le nom est désormais familier à mes lecteurs, a interprété – avec la profondeur et l'intelligence que nous lui connaissons – la musique de ce Maître, empreinte de poésie, marquée par l'étonnant mystère et la beauté apaisante qui émanent des paysages paradisiaques de l'Angleterre du sud, des Surrey Hills : là où « il y avait un champ infini pour les jeux et l'aventure. » David Owen Norris a joué sur le piano droit, un Broadwood de 1903, que Vaughan Williams avait acheté d'occasion en 1905, un an avant la parution de l'impressionnant English Hymnal pour lequel il a donné toute son âme. C'est en effet sur ce piano qu'il a conçu la partition enchanteresse pour violon, The Lark Ascending (1914), d'après la riche poésie (1881) de George Meredith (1828-1909). Cette musique a le don de nous consoler dans les pires épreuves de la vie.

Gabrielle Gale et David Owen Norris © National Trust
Vaughan
Williams a gardé ce piano qui, telle une source d'inspiration, l'a encore aidé
dans la composition d'autres partitions importantes comme son Piano Concerto en Ut Majeur (1926/31), ses extraordinaires Five Tudor Portraits (1935), sur des textes de John Skelton (ca 1463-1529), ou encore An Oxford Elegy
(1947/49) avec la poésie (1853/65) de Matthew Arnold (1822-1888). Je ne les
cite pas toutes tant elles sont nombreuses. Ce piano historique est désormais
restauré et retrouve, ce faisant, les propres sources du compositeur.

© National Trust
David
Owen Norris a présenté l'instrument dans son nouveau cadre au début du mois de
mars, avec son enthousiasme légendaire qui fait plaisir à voir et, surtout, à
entendre. Je suis très frappé par le contraste complémentaire entre la modestie
de l'instrument, la noblesse de la musique et l'immense maîtrise du pianiste.
Leith Hill Place
appartenait à la famille de la mère de Ralph, illustre en l'occurrence, les
Wedgwood. Josiah Wedgwood III (1795-1880) l'avait acquise en 1847. Sa fille,
Margaret Susan (1842-1937), est revenue y habiter, en 1874, après la mort de
son mari Arthur Vaughan Williams (1834-1875), le père de Ralph, éminent membre
de l'Église anglicane. Un tel environnement sera particulièrement favorable à
l'enfant, autant qu'à l'homme et au compositeur. Son amour pour le folk-song doit à
cette éducation par la nature et la tolérance religieuse et philosophique de
ses proches. N'oublions pas qu'il a fréquenté, au cours de ces jeunes années,
son célèbre et parfois contesté grand-oncle Charles Darwin (1809-1882).
Pour
ce qui concerne ce dernier, j'aimerais citer cette anecdote à propos de
l'influence que le savant a exercé sur le jeune
garçon. Margaret lui répondait au sujet de The
Origin of Species
(1859) : « La Bible dit que Dieu a créé le monde en six jours, Grand-Oncle pense que cela a pris plus de temps, mais il
n'est pas la peine de s'inquiéter pour cela, car c'est aussi merveilleux dans
chacun des cas. » Ceci en dit long sur l'esprit de tolérance et la
capacité imaginative d'une telle éducation. Wonderful !
Toute
sa vie, Vaughan Williams sera un homme simple et cultivé. Il fuira toutes
formes d'intellectualisme, d'abstraction et de snobisme. Cette vie ne sera pas
sans connaître des tragédies comme en témoigne la période de la Première Guerre
Mondiale au cours de laquelle il a été un soldat qui a eu la chance de revenir
au contraire de nombre de ses collègues dont son cher ami George Sainton Kaye Butterworth
(1885-1916).
Dans
une vidéo que je vous invite à regarder sur le site Internet du National Trust, Leith Hill Place, la manager, Gabrielle Gale, nous convie avec
chaleur à retrouver cette enfance joyeuse en ce lieu magique, chargé d'histoire
[http://www.nationaltrust.org.uk/leith-hill-place]. Je serais heureux qu'à l'occasion de cet événement, la
musique de Vaughan Williams soit davantage appréciée en France de même que
celle de David Owen Norris, son héritier.
James Lyon.
***
L'ÉDITION MUSICALE
Les
Éditions Buissonnières. C'est la première fois que
nous recensons ici des partitions venues des Éditions Buissonnières, situées
sur la presqu'ile de Crozon. Ces éditions offrent un visage assez particulier
que nous vous invitons à découvrir sur leur site http://www.editions-buissonnieres.fr/30-musique
En effet, leur production est aussi éclectique qu'originale. On pourra en juger
par les différents ouvrages recensés dans cet article.
FORMATION
MUSICALE
Jean-Marc
DEHAN et Jacques GRINDEL : Voir et entendre : N° 5 W.A. Mozart :
Symphonie n° 40 (K550). 1 – Allegro
molto – 3 Menuetto. N° 13 : A. Borodine : dans les steppes de l'Asie centrale. N°
17 : H Berlioz : Symphonie
fantastique 5° mouvement. N° 19 : J.-S. Bach : Cantate BWV 140 « Wachet
auf, ruft uns die Stimme ». Collection L'éducation musicale. Editions Beauchesne :
180 001, 180 002, 180 003, 180 004.
Beaucoup d'élèves de
collège, de lycée et de conservatoire se souviennent d'avoir découvert avec ces
volumes tout ou partie des grandes œuvres du répertoire. Le principe est
simple : une partition d'une œuvre ou de mouvements d'une œuvre est
intégralement reproduite mais tout est écrit en clé de sol – clé de fa et, pour
les instruments transpositeurs, en notes réelles. Ceci permet à l'élève ou au
mélomane possédant un peu ces deux clés de suivre tout simplement sur la
partition d'orchestre l'audition des œuvres. Les partitions sont en outre
pourvues tout au long d'indications simples concernant les particularités
rythmiques, mélodiques, d'orchestration de tel ou tel passage.
La structure de l'œuvre est également détaillée au fur et à mesure. Ces
remarquables réalisations étaient malheureusement en rupture d'édition. Les voici
de nouveau disponibles, au moins pour quatre d'entre elles. Les dix-sept
volumes de la collection devraient suivre au fur et à mesure : si
l'édition originale a été soigneusement respectée, elle a été légèrement
agrandie, ce qui en permet une meilleure lisibilité. Les nouvelles techniques
de travail d'image ont permis de rendre plus visibles certaines indications.
Enfin, un supplément pédagogique permet de mieux en profiter en donnant des
indications d'utilisation pour la lecture, le rythme, la dictée musicale, le
chant, la culture musicale des élèves (mise en rapport avec d'autres œuvres…)…




Marie-Ange LEURENT : Les proverbes en musique. 21 chansons
pour les enfants. Chanteloup musique : CMP011.
Si nous revenons ce
mois-ci sur ce recueil dont nous avons déjà rendu compte dans la lettre n° 89
de février 2015, c'est pour préciser qu'on peut se procurer ces chansons soit
en recueil simple, soit avec l'accompagnement de piano, soit avec conducteur et
matériel d'orchestre… Nous n'avions pas non plus indiqué le lien YouTube qui permet d'en écouter une partie : https://www.youtube.com/watch?v=9b4DZbHoKxk Puisse cette écoute donner envie de faire
partager ce plaisir à beaucoup d'enfants…

Hélène-Clerc-Murgier – Pauline Warnier : Fables sur de petits airs & des
vaudevilles choisis. Volume 2 –
Réalisé avec le concours de L'ensemble les
Monts du Reuil. Les Editions Buissonnières :
EB -2-260.
Bien que leur modestie les
empêche de faire figurer leur nom sur la couverture, nous les avons fait
figurer en tête de ce recueil car, avec le concours de la compagnie « Les
monts du Reuil », dont la première est la
directrice artistique, elles sont manifestement à l'origine de ce projet dont
nous découvrons ici le second volume. Selon un procédé qui se prolonge jusqu'à
nos jours (les « chansonniers »), on se servait au XVIII° siècle de
mélodies existantes et de préférence bien connues pour mettre en musique des
textes, souvent d'actualité. Ici, il s'agit d'un Recueil de Fables choisies dans le goût de Monsieur de Lafontaine. Ces
réécritures sont portées par des mélodies connues et fort variées. L'édition
nous les présente avec une basse en musette ainsi qu'une basse chiffrée
permettant différentes réalisations. Ajoutons que la clarté de l'édition, la
graphie à la fois d'une parfaite lisibilité et pleine de charme, ainsi que les
vignettes qui illustrent chaque fable font de ce recueil un régal pour les
yeux.

CHANT
Jean-Philippe
RAMEAU : Airs d'opéra. Haute-contre
vol. 2 (Ténor). Coédition Centre de musique baroque de Versailles – Société
Jean-Philippe Rameau. Distribution mondiale : Bärenreiter :
BA9197.
Voici donc un nouveau
volume de cette remarquable publication réalisée par Sylvie Bouissou, Benoît Dratwicki et Julien Dubruque. La
réduction au clavier est de François Saint-Yves. Comme pour les précédents
volumes, on y trouve en français et en anglais une présentation aussi
passionnante qu'exhaustive de ces airs comprenant à la fois l'historique et les
indications d'interprétation. Le tout est parfaitement clair et permet une
interprétation la plus authentique possible que ce soit par la clarté de la
partition que par sa lisibilité. C'est un travail tout à fait remarquable.

Laurent
DROUET, Tim GUILLO : Caboulot. Guinguette
marine. 1 vol. 1 CD. Editions Buissonnières : EB-2-279.
Une ambiance de bistrot de
marins (bretons, mais pas seulement !), voilà ce que nous restitue d'abord
le « projet Caboulot ». Il
se propose deux objectifs : apporter une matière contemporaine à ce genre
musical, et alimenter ainsi le répertoire disponible. Il s'agit en l'occurrence
d'entretenir une vieille tradition qui connait aujourd'hui un renouveau
certain. On s'en convaincra en allant écouter sur YouTube le groupe dont font partie les auteurs https://www.youtube.com/watch?v=TlhuIbalf18
Toutes ces chansons au caractère bien trempé méritent d'être reprises en chœur.
L'ambiance et la qualité sont au rendez-vous. Et on peut toujours chanter avec
le CD qui se déguste… sans modération !

MUSIQUE
CHORALE
Claire
VAZART : C.M. 14/18 pour chœur mixte SATB a capella. Assez
facile. Delatour : DLT2421.
Cette commande de
l'ensemble 20/21 a été créée aux Dialogues
en humanité en 2014 à Lyon. Signalons qu'il s'agit plutôt d'une œuvre à
cinq voix (Soprane, Mezzo, Alto, Ténor et Basse).
Tandis que les voix de
femmes chantent dans un tempo assez lent mais qui en respecte le rythme le Chant du départ harmonisé en choral, les
deux voix d'hommes font entendre une sorte de film de la guerre fait
d'évènements et de paroles de poilus dont la prosodie se calque sur la langue
parlée. L'ensemble a le grand mérite d'être équilibré et d'amener à la
réflexion et non à la dénonciation. Cela donne une sorte de méditation prenante
dans une atmosphère oppressante. Les voix se réunissent enfin pour une
évocation de la sonnerie aux morts. C'est une œuvre de circonstance, certes,
mais dont les qualités musicales sont à la hauteur des évènements évoqués.

ORGUE
Marta GLIOZI & Damien SIMON : L'orgue aux mille saveurs. Volume 1.
Anthologie de pièces pour les premières années au clavier. Volume 2 :
Anthologie de pièces pour claviéristes gourmets. Editions Buissonnières :
EB-2-179 et EB-2-244.
La démarche de cet ouvrage
est très intéressante et vise à former des musiciens et non des « dactylophones » si on peut nous permettre ce
néologisme. Tout est fait pour rendre intelligente l'approche de l'instrument,
le tout de façon souvent humoristique, ce qui n'empêche pas la pertinence des
remarques, bien au contraire. On ne peut qu'applaudir à ce que le début de
l'ouvrage se nomme « De la voix au clavier ». Partant
de « petites chansons connues du patrimoine pour enfants », il
continue par quelques thèmes fondamentaux de Noëls, de chorals luthériens et de
chant grégorien « qui ont si profondément nourri le répertoire pour orgue
à travers les siècles. » Il continue par des « mélodies de nos
régions et d'ailleurs ». Ajoutons que le pédalier est abordé dès le début.
L'ouvrage comporte aussi une section de jeux d'improvisation tout à fait
passionnante. On serait tenté de recopier toute l'introduction. On en trouvera
la substantifique moelle sur le site de l'éditeur. Le deuxième volume est la
suite logique du premier dans le même esprit et dans la même variété de
répertoire. L'ensemble est extrêmement copieux et présenté de façon parfaite.


Jean
GIROUD : Images pour un chemin de
croix. (1944). Sur le texte de Paul Claudel. Illustrations pour orgue. Chanteloup Musique : CMP025.
Voici enfin éditée cette
œuvre d'un musicien élève et ami des plus grands. Composée en symbiose avec le
texte du poète, ces « illustrations mystiques » ont été réalisées
dans une étroite collaboration avec Paul Claudel. Que dire de plus sinon qu'on
peut entendre partiellement ces « Images » sur YouTube
interprétées par Jean Giroud lui-même https://www.youtube.com/watch?v=JglFyQRcooA&list=PLumjj7sttATxEbdspjeDFFIcbv0UVKVGD
et qu'il en existe un CD enregistré par Philippe Brandeis
avec Laurent Terzieff en récitant, au studio SM paru
en février 1999 mais difficile à se procurer. Il faut lire, pour interpréter et
comprendre cette œuvre, le texte de Jean Giroud dont le fac-similé se trouve en
tête de la partition.
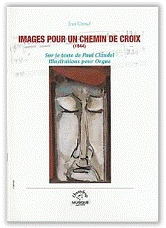
PIANO
Olivier
PENARD : Pièces éparses pour piano. Deuxième
et troisième cycle. Jobert : JJ2210.
Même si ces pièces sont
écrites sans indication de tonalité, on reste cependant dans une atmosphère
post-tonale bien agréable. Les ambiances sont variées, les titres évocateurs.
Il faudrait pouvoir recopier ici le texte de présentation rédigé par l'auteur
et qu'on souhaiterait retrouver dans la partition. L'interprète sentira de
lui-même quelle couleur donner à ces pièces dont l'auteur se réclame à la fois
de Ravel, Honegger, Stravinsky, Dutilleux, John Adams ou encore John Williams.
Bien loin d'etre des pièces pédagogiques, ces courts
tableaux méritent le concert !

Gualterio DAZZI : Quatre miniatures simples pour piano. Dhalmann :
FD0711.
Cette commande du Studio
de Création et de Recherche en Informatique et Musiques Expérimentales est, en
fait, écrite dans un langage atonal (ou post tonal) très agréable et qui
pourra, sans les effrayer, initier les jeunes ou moins jeunes pianistes à des
sonorités pleine de charme. Ces quatre petits tableaux ont chacun leurs
couleurs et leur ambiance propre qu'on se fera un plaisir à découvrir. C'est
d'abord de la belle et bonne musique.

Chilly GONZALES : Re-Introduction Etudes.
24 pièces thématiques pour piano, faciles, éducatives et
récréatives. 1 vol. 1 CD. Co-édition
Gentel Threat Ltd. / Editions Bourgès
R. : EBR525.
Ces études ont été écrites
spécialement à l'intention de tous les « laissés pour compte du
piano » mais qui ont envie de « s'y remettre » mais sans
reprendre les études fastidieuses de leur jeunesse ou un répertoire trop
classique qui leur a parfois laissé un mauvais souvenir… L'auteur, pianiste
canadien de formation classique mais connu surtout dans un autre répertoire,
nous offre un florilège de pièces ayant chacune leur caractère, aussi agréables
pour l'oreille que profitables pour se réapproprier une technique de base et
surtout pour former l'oreille et le goût de l'interprète. Chaque pièce est
accompagnée d'un commentaire de l'auteur permettant d'en comprendre l'esprit et
le but. Le CD, enregistré par l'auteur, offre l'intégralité du recueil dans une
interprétation pleine d'intériorité et qui donne envie… Ajoutons enfin que cette
édition franco-anglaise est intégralement trilingue (anglais, français,
allemand), ce qui constitue un œcuménisme de bon aloi.

VIOLONCELLE
J.S.
BACH : Chorals transcrits pour quatre violoncelles par
Odile Bourin. Lemoine : 29257H.L.
Disons tout de suite que
ces transcriptions sont d'une totale fidélité (sauf la tonalité) à l'original
dont la référence est soigneusement indiquée. On ne peut que se réjouir de ce
travail qui permettra aux « violoncellistes de 7 à 77 ans et ayant 2 à 5
ans de pratique » d'aborder ces œuvres qui demeurent le fondement de toute
culture musicale. Dans ce but, il n'est pas fourni de « parties
séparées ». Chacun des interprètes peut ainsi suivre l'ensemble et mieux
s'en imprégner. Cela permet aussi de mieux saisir la polyphonie et notamment de
rapprocher, comme le conseille Odile Bourin, les
chorals BWV 21 et 270, 67 et 256. Ces transcriptions sont donc à recommander
chaudement.
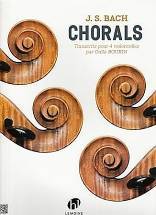
CONTREBASSE
Adrien
POLITI : Tango Fantasìa
3 pour 3 contrebasses.
Lemoine : 29258HL.
Que voilà une bien
réjouissante partition ! Ce compositeur argentin mais qui vit en France,
où il a découvert… le tango, depuis 1986 écrit à la
fois des pièces pédagogiques et de concert tant pour la guitare que pour
différents instruments. Ces tangos pour contrebasse ne sont pas très difficiles
mais ne se limitent certainement pas à un usage pédagogique. Même si le titre
est au singulier, on peut parler de « tangos » au pluriel tant cet
unique tango passe par des phases diverses. L'ensemble a été révisé par Emilie
Postel-Vinay.
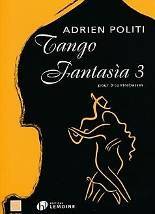
A.
Bazzini : La
ronde des lutins. Scherzo
fantastique, transcription pour contrebasse et piano d'Emilie Postel-Vinay. Chanteloup musique : CMP 30.
Tous les violonistes
connaissent cette œuvre du célèbre violoniste Antonio Bazzini
(1818-1897). La transcrire pour contrebasse est une gageure qu'a relevée la
contrebassiste et chef d'orchestre Emilie Postel-Vinay… Bien sûr, il y a fallu
quelques adaptations ! Mais cela devrait sonner fort agréablement. Inutile
cependant de préciser que ce n'est pas une pièce pour débutant…

FLÛTE
Gualtiero DAZZI : Trio de flûtes. Commande du
Trio d'Argent. Dhalmann : FD0706.
Ces quatre pièces sont un
hommage à quelques personnalités artistiques d'Oaxaca qui rendent dans leurs
tableaux « la dimension rituelle héritée du monde précolombien au travers
d'une omniprésence de la nature. » Il ne s'agit pas de faire de l'exotisme
mais d'évoquer un monde qui est cher au compositeur ainsi qu'au Trio d'Argent.
L'ensemble est effectivement plein de charme et de saveurs à la fois étranges
et familières. Il n'y a pas d'effets spectaculaires mais une musique pleine
d'intériorité y compris dans les passages plus agités. C'est tout simplement
beau.
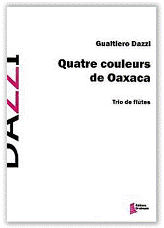
CLARINETTE
Douglas WOODFULL-HARRIS : Classic
Hits pour deux
clarinettes. Collection Ready to play. Bärenreiter : BA10636.
Ces duos sont destinés à
égayer les études du jeune clarinettiste. Les arrangements portent sur des
œuvres très connues de Mozart, Haydn, Gluck, Weber, Beethoven, Mendelssohn,
Schubert, Schumann et Chopin. L'ensemble est sans grande difficulté.
L'accompagnement, prévu plutôt pour le professeur, respecte dans l'ensemble les
harmonies d'origine. Ce pourra être également l'occasion de faire découvrir aux
élèves les œuvres originales et de contribuer ainsi à leur culture musicale.

SAXOPHONE
Jean-Luc
GILLET : Enfoui pour saxophone alto en mib. Moyen.
Delatour : DLT2569.
Il est difficile de donner
un « niveau » à cette pièce. Techniquement assez facile, elle demande
d'abord et avant tout un sens profond de la mélodie, du timbre, des nuances, en
un mot elle demande un musicien. Cette longue mélopée ponctuée de silences et
s'animant seulement pour un court passage est en effet très belle et très
méditative. Ce peut être un moment de grâce dans un concert…On a en plus la
chance de pouvoir en entendre une très belle interprétation sur le site de
l'éditeur (ou YouTube) par Naomi Sato.
C'est à ne pas manquer !
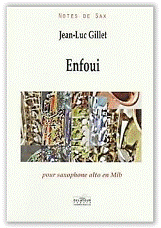
Bruno
GINER : Tactus Perpetuum pour saxophone soprano. Difficile. Delatour : DLT2560.
L'auteur a voulu bâtir
toute sa pièce sur une pulsation perpétuelle à 168 à la noire. Ainsi, même les
passages en valeurs longues sont sous-tendus par l'énergie nécessaire pour
garder ce tempo. Cette pièce est d'abord, comme le dit l'auteur, une pièce de
concert qui « met le soliste en valeur par la virtuosité de certains modes
de jeu et l'engagement physique nécessaire à son exécution ».
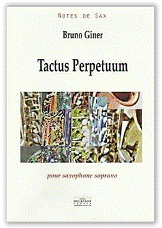
Thierry
ALLA : Inaugural pour saxophone sopranino.
Difficile. Delatour : DLT2573.
L'auteur considère cette
œuvre comme une « ouverture » de son cycle de pièces pour tous les
saxophones. Elle fait appel à la respiration circulaire qui permet de garder
une tension continuelle tout au long du discours. La difficulté tient également
dans le dynamisme qui doit habiter toute l'œuvre, œuvre qui joue un peu le rôle
d'annonceur au début d'un spectacle musical.
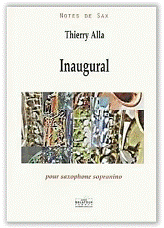
Jacques
LEJEUNE : Fragments gourmands
(d'après Brillat-Savarin) pour saxophoniste récitant et bande son. Assez
difficile. Delatour : DLT2551.
Avant toute exécution, il
sera prudent d'écouter intégralement la deuxième plage du CD joint à la
partition, qui est une audition intégrale de l'œuvre. Précisons aussi tout de
suite que c'est bien le saxophoniste qui est aussi le récitant. Et après,
dégustons ces fragments gourmands qui se terminent par une coda dégustatoire du meilleur effet. Le tout est à consommer
sans modération et avec beaucoup d'humour !
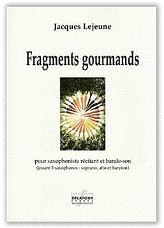
Jean-Christophe
ROSAZ : Seul dans la steppe pour saxophone alto solo. Moyen. Delatour : DLT2564.
Le titre suffit à caractériser
l'œuvre. On pourra lire au dos de la partition ou sur le site de l'éditeur la
description poétique qui a inspiré l'auteur et qui pourra inspirer le musicien
« chaman », à la fois « le témoin, le réceptacle, le créateur et
le transmetteur de ces impressions fugitives […] ». Le tout se termine par
une polyphonie. L'auteur suggère une exécution par cœur permettant un
déplacement dans l'espace ce qui fait voyager le son pour l'oreille de
l'auditeur. L'ambiance créée est envoutante et suggestive.
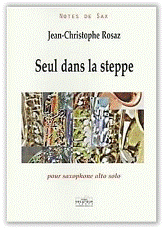
Bernard
COL : 10R2 Ravel : Dix airs de
Ravel arrangés pour deux saxophones
alto. Facile. Delatour : DLT2583.
Nous avons déjà dit dans
notre lettre 100 de février 2016 tout le bien que nous pensions de cette
collection. Après Schubert, voici Ravel : nous y retrouvons les mêmes
qualités de fidélité aux œuvres originales. Le côté « culture
musicale » est bien présent grâce à un tableau situé en fin de volume et
qui donne avec précision l'origine des différentes transcriptions. C'est donc
un travail remarquable à tous points de vue.
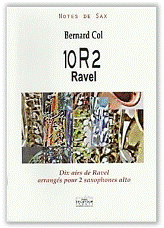
Giordano
MUTO et Philippe VIAN : Dérives pour saxophone alto. 1 vol. 1 CD.
Deuxième cycle. Delatour : DLT2563.
Il s'agit, pour les
créateurs de ce projet de créer une passerelle entre les musiques actuelles et
la musique contemporaine grâce au saxophone. Les œuvres sont donc écrite pour
saxophone et bande son. Les cinq pièces figurent sur le CD d'abord dans leur
réalisation complète puis en « play-back ». Chaque pièce est
présentée avec beaucoup de minutie pour en permettre une réalisation parfaite.
L'ensemble atteint son objectif.

PERCUSSIONS
Jean
FESSARD : Ronde. Timbales. Moyen/difficile. Dhalmann : FD0714.
Prévue pour être
interprétée par deux instrumentistes disposant chacun de quatre timbales, cette
pièce peut cependant être interprétée avec des toms, mais il est préférable de
disposer d'au moins quatre timbales. Le titre se justifie par la structure
couplet-refrain tout à fait traditionnelle. Quant au style, c'est « celui
d'une danse un peu lourde, lointainement « afro » ». L'ensemble
est plein de dynamisme et devrait plaire à ses interprètes.
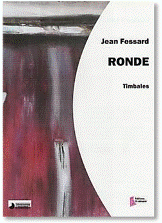
Gilles
MOTET : Jeux de miroirs. Pièce pour quatuor de percussions et
auditeurs-spectateurs. Delatour : DLT2246.
« Quatre
percussionnistes sur scène jouant sur des percussions claviers réels :
deux vibraphones, deux marimbas. Quatre claviers virtuels imaginaires, irréels,
mais présents reliés par les gestes musicaux à l'imaginaire de chaque
spectateur-auditeur. Quatre percussionnistes mimant un ballet de quatre percussionnistes
jouant sur des percussions claviers réelles mais pourtant virtuelles. ».
On ne peut, mieux que l'auteur, décrire cette œuvre dont il est difficile de
parler sans l'avoir vécue comme auditeur-spectateur-cocréateur.
C'est donc à expérimenter.

MUSIQUE
DE CHAMBRE
Gilles
MOTTET : Connexe. Duo pour flûte traversière et saxophone
baryton. Moyen avancé. Delatour : DLT2566.
Voici le commentaire de
l'auteur : « La flûte traversière qui est jouée sans son corps, je
rêve quelle impertinence ! Le saxophone baryton qui est joué sans son
bec, c'est renversant ! Et ce n'est pas tout, je vous le dis. La flûte
traversière est aussi jouée sans son embouchure !
Et pourquoi pas
!!!!!!?? » Il est, dans ces conditions, difficile d'imaginer le résultat.
Raison de plus pour essayer…
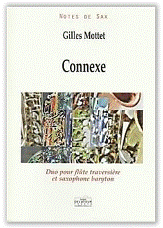
Éric
FISCHER : Constellations
obligatoires pour deux clarinettes
en sib, clarinette basse et quatuor
de saxophones. Assez difficile. Delatour :
DLT2605.
Il est bien difficile de
parler de ces sept courtes pièces sans les avoir entendues. Voici comment
l'auteur nous présente leur genèse : « À l'été 2013, je rendais
visite au plasticien Peter Lowe, alors en résidence à Lagamas,
dans l'Hérault. Il me présentait les ébauches de « Sharp Arp », une série
d'étoiles à 7 branches construites en bois, à partir de toutes les permutations
possibles d'angle droit. Il m'expliqua également son tableau de calcul ayant
servi à son développement.
Je lui proposais alors
d'utiliser la même grille mathématique afin de composer une pièce de musique
qui se mettrait en résonance avec la série d'étoiles. »
Il ne faudra surtout pas
passer les deux premières pages de la partition où figurent les étoiles de
Peter Lowe et l'explication détaillée de son œuvre donnée par l'auteur.
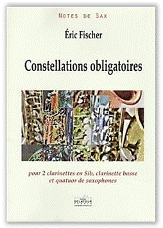
Dominique
DELAHOCHE-LEFEBVRE : Le Ciel des
Carrières pour clarinette, basson,
percussion, trompette en ut, trombone ténor, harpe, violon et contrebasse. Delatour : DLT2646.
Cette commande de
Radio-France de mars 2014 a été créée par l'ensemble 2e2m dans l'émission
d'Anne Montaron « Alla breve »,
sur France-Musique. Cette œuvre évoque le ciel des carrières qui courent sous
Paris et ont servi à construire la ville au XVII° et XVIII° siècle. L'écriture
cherche à créer une atmosphère onirique en jouant sur les timbres et les
emplacements des différents instruments. Le conducteur et le matériel
d'orchestre sont disponibles. Ajoutons que la pièce intègre un nouvel
instrument de percussion, le Vème, Cet instrument, né à la suite d'une
collaboration entre diverses personnes et institutions, permet d'obtenir, nous
dit l'auteur, « des sonorités métalliques graves et profondes. ».
C'est donc, pour bien des raisons, une œuvre à découvrir.
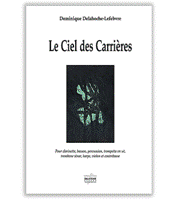
Dominique
DELAHOCHE-LEFEBVRE : Mandala sur le
sable pour quintette à vent. Delatour : DLT2647.
Là encore, il s'agit
d'explorer des sonorités nouvelles, de créer des ambiances sonores. Le
quintette est formé d'une flûte, d'un hautbois, d'une clarinette en si bémol,
d'un cor en fa et d'un basson français (version disponible pour basson
allemand). C'est avec le quintette à vent « Gustatori »,
commanditaire de cette pièce, que l'œuvre a été réalisée. Voici comment
l'auteur décrit son projet : « Le mot Mandala, forme symbolique universelle, renvoie à une notion forte
de permanence, d'intériorité et d'équilibre. Le mot sable désigne un sol par nature instable. Ainsi ai-je imaginé le
tracé d'un mandala sur le sable, probablement appelé à être déformé, voire
effacé par le vent ou la mer ».
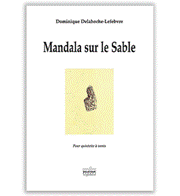
ORATORIO
Eric
LEBRUN – Pierre GRANDRY : La marche
à l'étoile. Oratorio pour Noël. Chœur, soprano solo ou chœur d'enfants,
deux violoncelles et contrebasse, un ou deux orgues ad libitum. Chanteloup musique : CMP012.
Les auteurs nous proposent
ici une œuvre relativement facile à mettre en œuvre d'après un texte original
qui ne manque ni d'humour ni de profondeur. Cette méditation sur la démarche de
l'homme vue à travers celle des mages n'engendre donc pas non plus la
mélancolie mais est au contraire une démarche de confiance et de joie qui se
termine d'ailleurs par un vibrant alléluia. Le tout est écrit dans un langage
simple et sur des mélodies inspirées aussi bien du grégorien que du folklore
populaire de noël, spécialement anglo-saxon. C'est en tout cas une œuvre
exaltante et qui mérite d'être montée.

Daniel
Blackstone.
PIANO
Jean-Pierre
LEGUAY : Sonnantes,
Paris, Le Chant du Monde (www.lechantdumonde.com ), 2015, Réf. PP4962. 28 p.
Ces
quatre pièces pour piano (à 4 mains) — dont les trois premières sont dédiées à
Annie Leguay, la quatrième à Miriam Lopez Ramos et
Jérémie Leguay —, composées entre 2012 et 2014,
nécessitent, pour leur interprétation, d'excellents solfégistes (nombreuses
altérations). Le premier pianiste doit être un bon amateur (traits de
virtuosité et sextolets en triples croches, accords très disjoints) ; le
second peut être moins expérimenté. La coordination entre les deux interprètes
est indispensable, de même que le respect des indications du compositeur :
première pièce « avec allant » ; deuxième pièce « avec tranquillité » ;
troisième pièce « avec vivacité » ; quatrième, « bien
sonore, décidé ». En outre, le compositeur insiste sur l'usage précis de
la pédale. Pédagogues et pianistes apprécieront cet apport de Jean-Pierre Leguay (né en 1939) au répertoire à quatre mains.

CHANT ET ORGUE
André
FLEURY : Psaume
pour les morts de la guerre (pour voix moyenne et orgue), Paris, Le
Chant du Monde (www.lechantdumonde.com ), 1954, Réf. VO 4214. CDM 1995, 4 p.
Composé
en 1954 sur les paroles de Cyril Dubus, cette partition existe aussi en version
pour voix moyenne et orchestre à cordes, réalisée par Bruno Schweyer.
Le texte d'inspiration catholique, très réaliste, exige un débit
syllabique par mouvement de croches ; la mélodie évoluant par mouvements
assez conjoints plane sur des accords avec une longue pédale centrale dans
l'introduction. Ce Psaume se déroule dans les nuances p et pp avec un seul f sur [accepter] « de mourir »
et se termine par l'affirmation « C'est qu'ils croyaient en Vous ».
Son interprétation nécessite surtout une voix souple pour le débit des paroles
et capable de différencier les nuances p,
pp. Cette œuvre d'André Fleury
(1903-1995), brillant représentant de l'école d'orgue française, peut convenir
pour un service religieux ou une commémoration officielle .

Édith
Weber.
***
LE COIN BIBLIOGRAPHIQUE
Jean DURON, Florence GÉTREAU (dir.)
: L'orchestre à
cordes sous Louis XIV. Instruments, répertoires, singularités.
Paris, Éditions VRIN (www.vrin.fr ), Collection MusicologieS,
2015, 468 p. – 29 €.
La musique a
largement contribué au grand prestige de la Cour de Louis XIV (1638-1715) qui
disposait des « Vingt quatre Violons du Roi », des « Petits
violons de la Chambre » et de la présence de compositeurs célèbres :
Henry Du Mont (1610-1684), Jean-Baptiste Lully (1632-1687), Marc-Antoine
Charpentier (1643-1704), Michel-Richard De Lalande (1657-1726), entre autres.
Jean Duron (Centre de Musique Baroque de Versailles) et Florence
Gétreau (CNRS) ont fait appel à une vingtaine de
spécialistes français et étrangers : historiens, organologues,
historiens d'art, musicologues et interprètes. Très bien présenté, ce livre
comprend également de nombreux exemples musicaux, des représentations (en
couleurs) de divers instruments à cordes, des tableaux synoptiques. L'Index, particulièrement copieux,
comporte les noms (antérieurs à 1800) et les titres des œuvres musicales citées
(p. 451-468), par exemple de M.-A. Charpentier et H. Du Mont… L'ouvrage est
structuré en cinq parties : 1. Archives/Théorie
(avec des sources de première main) ; 2. Organologie/Iconographie (avec divers aspects spécifiques :
ensemble, basse de violon, archet, voix médianes) ; 3. Interprétation (particularismes
concernant les divers compositeurs) ; 4. Destinées (évolution ultérieure et esthétique) ; 5. Autres modèles (en dehors de la Cour de
Versailles). Les historiens avides de
sources judicieusement sélectionnées trouveront aussi des renseignements
relatifs aux œuvres interprétées lors de circonstances particulières : Te Deum (Pierre Robert, M.-A.
Charpentier, H. Desmarets) ; Canticum pro pace ;
In obitum augustissimae nec non piissimae Gallorum Reginae lamentum, lamentation chantée pour les obsèques de la
Reine Marie-Thérèse (p. 242). Les interprètes
et chefs disposeront d'extraits de partitions annotées par les compositeurs
et sauront que la tragédie : David
et Jonathas (recopiée par Philidor l'Aîné) a été
restituée par Jean Duron ; des indications sur
la tenue du manche et de l'archet, sur le jeu da braccio en style déambulatoire… Les théoriciens seront informés des
tessitures, des problèmes d'écriture (fausse relation, fa bécarre/ fa dièse),
des pratiques orchestrales, de la disparition de la quinte de violon vers 1718 dans le Motet à grand chœur à l'Académie
royale de Versailles, de l'évolution des effectifs. Les facteurs et luthiers
seront intéressés par les détails concernant la fabrication des archets
baroques. Les amateurs de musique
religieuse connaîtront mieux le répertoire chanté à la Cour (lors des
dévotions quotidiennes de Louis XIV) : Messes, Psaumes, Leçons de
Ténèbres, Motets, Cantiques, Hymnes (Pange lingua),
Magnificat, la pièce à 8 voix : Coecilia Virgo et martyr (p.
244) de M.-A. Charpentier… ou pendant
ses Dîners et Soupers. Les amateurs de
divertissement lyrique bénéficieront de précisions sur les nombreux opéras
et ballets (par exemple de Villeneuve Saint Georges) représentés à l'Opéra et
également à l'Académie du Théâtre des Petits appartements de la Marquise de
Pompadour (p. 383). Les mélomanes et
historiens d'art seront sensibles aux nombreuses illustrations de
circonstance : eaux-fortes, dessins à l'encre de Chine, gouaches ;
instruments (conservés notamment au Musée instrumental de Bruxelles)… À
noter l'eau-forte de Pierre Landry : Bal à la Françoise, avec l'Almanach
royal (1682) représentant Louis XIV dansant en 1682 le Menuet de Strasbourg, peu après son retour d'Alsace rendue à la
France en 1681 (p. 75) ; la liste des opéras de Lully (de 1677 à 1719)
À travers les
activités des « Vingt Quatre Violons du Roi » et des « Petits
violons de la Chambre », ce maître-livre illustre à merveille l'histoire
institutionnelle et musicale, le prestige de Louis XIV et le rayonnement de sa
Cour tant enviés dans les Provinces de son Royaume et à l'étranger.

Édith
Weber.
REVUES
Laurine QUETIN (dir.) : Les querelles
musicales dans les écrits esthétiques et littéraires après 1750, Revue MUSICORUM n°17, (www.revuemusicorum.com ), 2016, 175 p. 29 €.
La Querelle des
Bouffons a fait couler beaucoup d'encre et révélé les démêlés entre les tenants
de la musique italienne et ceux de la musique française. Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778), pro italien, n'a-t-il pas, dans sa Lettre sur la musique française (1753), affirmé : « Les
Français n'ont point de musique et n'en peuvent avoir, ou que, si jamais ils en
ont une, ce sera tant pis pour eux » ? Rappelons que Christoph Willibald Gluck (1714-1787) a, lui aussi, suscité des
polémiques.
Réalisé par Laurine
Quetin, préfacé par Suzel Esquier,
ce numéro 17 de la Revue Musicorum va droit aux
sources, c'est-à-dire aux écrits littéraires et esthétiques après 1750. Huit
auteurs français et étrangers abordent des questions ponctuelles, par exemple
la définition de la Dissonance selon
Rousseau ou encore la discussion relative à ses conceptions du goût et de la
mélodie, mais aussi les réactions de ses contemporains Chastellux,
Framéry et Momigny. Ces
réflexions caractéristiques du Siècle des Lumières ont animé l'Europe et, en
particulier, l'art lyrique. Elles ont porté sur les identités nationales, le
problème de la langue ; elles ont également animé des querelles : de
personnes, des Anciens et des Modernes, des Gluckistes, des Piccinistes…
Les sept études
s'imposent par leurs nombreuses interrogations sur la notion de progrès en
musique, sur les formes (comédies, opéras), sur les engagements des
compositeurs, sans oublier les incidences sur le goût, la société, la notion de
représentation, le tout dans une optique comparative avec un sens solide de la
discussion et de l'argumentation.

Édith Weber.
Georges MIGOT, Bulletin n°29. Haguenau, Les Amis de l'œuvre et de la Pensée de
Georges Migot, (www.georges.migo.info ),
février 2016, 52 p.
Ce Bulletin, paru en 2016, à l'initiative
d'Odile Charles et d'Emmanuel Honegger, marque les 40 ans de la disparition de
Georges Migot. Il fait le point de l'actualité : Fonds de Bibliothèques
(BNF, Royaumont) ; projets de l'Association : nouveau CD en
préparation avec 4 manuscrits inédits ; publications, recensions,
concerts, concours... et, par ailleurs, rappelle le CD : Clairières dans le ciel (Les Musiciens et la Grande Guerre, Vol.
13) paru en 2015 sous le Label Hortus (cf.
rubrique Le bac du disquaire).
L'étude de
Jean-Alain Joubert projette un éclairage neuf sur Georges Migot,
« l'initiateur de lumière », sur les grands axes de sa pensée
esthétique, et met l'accent, entre autres, sur les valeurs éthiques qu'il a
défendues : « respect de la liberté de l'autre ;
fraternité ; noblesse d'esprit ; engagement sans faille et
fidélité ». Pour ces constats, l'auteur s'appuie notamment sur les
témoignages du regretté Marc Honegger, mais aussi sur la correspondance. Les
lecteurs découvriront des écrits autographes (lettres ou petits billets) avec
confidences ou remarques prises sur le vif, définitions, idées, l'état de la
gestation de ses œuvres. Parmi les destinataires, figurent Max Pinchard et
Jacqueline, ou encore Marc Delau, Directeur des
Éditions Ouvrières. À ces témoignages épistolaires, s'ajoutent des
reproductions de bois gravé par Georges Migot (Le Hibou), peintures (Dahlias,
Saint-Jean d'Angély)
et des photos judicieusement sélectionnées.
Outre l'actualité,
avec le recul du temps, ce Bulletin
met l'accent sur les motivations spirituelles de Georges Migot, surtout sa
« spiritualité christique ». Voici donc — quarante ans après la
disparition de Georges Migot — un message post
mortem profondément humain.

Édith Weber.
Antoine Pecqueur : Les
espaces de la musique. 1Vol 24x28 cm, 288 p, 550 illustrations couleurs,
2015, Éditions Parenthèses, collection architectures / Philharmonie de Paris,
36 €.
Les éditions Parenthèses/Philharmonie de
Paris viennent de publier un superbe ouvrage intitulé « Les espaces de la
musique » qui intéressera aussi bien l'architecte que le musicien
praticien ou simplement mélomane. Son auteur, Antoine Pecqueur, journaliste à
la chaîne de télévision Mezzo est aussi musicien, bassoniste se produisant au
sein d'ensembles d'instruments anciens tels que Les Siècles ou la Chambre
philharmonique, ou d'ensembles de musique contemporaine tel que Linea. A première
vue l'ouvrage est extrêmement séduisant, grâce à une typographie claire et
aérée, une iconographie particulièrement soignée. Quant au style, il est enlevé,
précis, et évite le jargon. Mais sa qualité ne s'arrête pas là. En effet c'est
son contenu qui en fait un ouvrage irremplaçable pour longtemps, un guide
précieux pour qui s'intéresse non seulement aux lieux où se fait la musique,
mais aussi à l'évolution des villes où sont implantées salles d'opéras et de
concerts. L'ouvrage est d'autant plus précieux et disons le, incontournable,
que son auteur s'est rendu sur place « tester » les salles, ce qui
explique en partie le temps passé à le concevoir (environ 5 ans). Mais surtout
grâce à son parti pris de juger sur pièce, Antoine Pecqueur nous permet
d'appréhender chaque lieu sous tous ses aspects, aussi bien esthétiques,
acoustiques, de confort, d'insertion dans le contexte urbain.....
L'ouvrage se divise en quelque sorte en
deux parties. Tout d'abord un ensemble de développements d'ordre général, puis
une description détaillée de 30 lieux. Dans un premier temps, donc, Antoine
Pecqueur nous donne une vision de l'évolution de l'architecture des opéras puis
de salles de concerts symphoniques, soulignant le passage de la salle en
« boîte à chaussures » à la salle révolutionnaire dite « en
vignoble », telle la Philharmonie de Berlin conçue par Hans Scharoun. Il ne se contente pas de souligner l'esthétique
du geste architectural ; il s'attache à exposer le sens qu'il faut donner à tel
ou tel parti pris architectural compte tenu de son emplacement dans la cité, de
son mode d'accès, de la manière dont le public est traité – confort des espaces
d'accueil, qualité de l'acoustique, distance avec la scène. S'agissant de
l'implantation dans le tissu urbain, il constate que certains projets ont vu le
jour en périphérie, avec de la part du maître d'ouvrage notamment la volonté de
rechercher un nouveau public. On citera deux exemples : l'auditorium du Parco della Musica
de Renzo Piano, dans le quartier nord de Rome ainsi que la Philharmonie de Jean
Nouvel au nord-est de Paris. Il insiste par ailleurs sur la présence
incontournable à côté de l'architecte et de l'acousticien, du scénographe. Ce
dernier, selon Michel Fayet travaille « à la fois sur l'aspect conceptuel
de la salle, c'est à dire sa forme globale et sur l'aspect technique, en
décrivant tous les équipements nécessaires au lieu ». L'approche générale
des premiers chapitres est donc illustrée par les 30 monographies qui suivent.
Non seulement les thèmes précédemment exposés sont développés mais on peut y
lire en outre une analyse des conditions de travail des personnels ainsi que
des plus ou moins bonnes facilités offertes aux musiciens pour répéter, avec le
constat de l'absence trop fréquente d'une salle de répétition.
Ces 30 monographies constituent l'essentiel
du travail d'Antoine Pecqueur. On peut alors mesurer combien l'investigation
sur site par l'auteur permet des remarques pertinentes grâce aux informations
de première main qu'il a su glaner aussi bien auprès de musiciens que de
maîtres d'œuvre, sans compter que dans certaines salles, il a pu exercer son
métier d'instrumentiste. Chaque salle est illustrée par des clichés superbes,
complétés par la reproduction de plans, ce qui est un exploit quand on sait
combien il est difficile d'obtenir auprès des architectes le droit de les
diffuser. Dans ses propos, Antoine Pecqueur ne s'enferme pas dans la langue de
bois : à côté d'appréciations enthousiastes – elles sont majoritaires - il
n'hésitera pas à avoir la dent dure pour évoquer des échecs, notamment sur le
plan acoustique. Ainsi donne-t-il l'exemple du Palais des Arts de Santiago
Calatrava à Valence qui par ailleurs a vu ses coûts exploser. Cette dérive
d'ordre financier est du reste assez fréquente ; il évoque le problème à
propos du Walt Disney Concert Hall de
Frank Gehry à Los Angeles, du Koncerthuset
de Jean Nouvel à Copenhague ou, dernière en date, de la Philharmonie de
Hambourg de Herzog et de Meuron qui passe de 187
millions d'Euros à 865 millions d'Euros, pour ne donner ici qu'un seul exemple
chiffré. Ajoutons que l'intérêt de l'ouvrage est rehaussé par la présence de
plusieurs entretiens inédits avec Pierre Boulez, Rudy Ricciotti,
Renzo Piano, Santiago Calatrava, Vittorio Gregotti,
Paul Andreu, Christian de Portzamparc, Wolf Prix et
Jacques Herzog. A la fin de la lecture des « Espaces de la musique »,
on est convaincu de la vérité de cette phrase de Renzo Piano publiée dans le
Monde daté du 22 février 2010 : « La musique, aussi immatérielle
qu'elle soit, peut imposer sa densité et son espace. De tous les arts, c'est ce
qu'il y a de plus proche de l'architecture ». Un ouvrage à classer parmi
les indispensables.
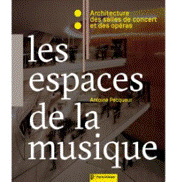
Gilles Ribardière.
***
LE BAC DU DISQUAIRE
Josquin
DESPREZ : Messes Pange lingua ; de beata Virgine. Ensembles Métamorphoses & Biscantor, dir. Maurice Bourbon.
1CD AR RE –SE (www.arre-se.com ): AR 2015-1. TT : 66'26.
Le texte
d'accompagnement — initiative originale du Label AR RE-SE — convie d'abord les
discophiles à un dialogue très imaginatif (daté du 3 janvier 2015) entre le
chef Maurice Bourbon et Josquin :
« Sais-tu que j'ai le même âge que le tien quand tu as composé la [Messe] Pange lingua ? C'est peut-être pourquoi j'y suis si sensible et me
suis tant régalé à la diriger » : c'est ce qui sera d'ailleurs
confirmé à l'audition. Le chef ajoute qu'il « a travaillé avec passion les
tempi et les équivalences quasiment pendant un an » et, plus loin, précise
que, pour le canon à la quinte du Benedictus, « les
chanteurs (y) ont fait preuve d'une stupéfiante maîtrise dans la conduite piano… ». Josquin
Desprez — né à Beaurevoir
vers 1450 et mort à Condé-sur-l'Escaut, le 27 août 1521 —, musicien franco-flamand, tant admiré
par Martin Luther, éminent maître de la Renaissance, est en fait un
« européen avant la lettre ». Il a composé de nombreux Motets et des Messes (parodie, sur cantus firmus, en canon), entre autres.
Dans sa tardive Messe Pange lingua — selon Jacques Barbier —, il reprend la mélodie de l'hymne
éponyme « utilisée comme un fil conducteur dans toutes les sections
de la messe, mais nullement à la manière d'un cantus firmus ». Josquin fait appel au contrepoint note contre note et au
traitement syllabique pour une meilleure intelligibilité du texte notamment
pour les articles du Credo. Quant à
la polyphonie, elle est assez homogène. Bénéficiant d'une remarquable
acoustique, les voix des Ensembles vocaux Métamorphoses et Biscantor ! (quatuor) s'imposent par leur plénitude,
leur justesse, leurs timbres chaleureux. La Messe
de beata Virgine se situant dans la mouvance du culte marial,
exploite les tessitures aiguës (évoquant peut-être le ciel) et repose sur des
mélodies grégoriennes. Josquin spécule sur le nombre
des voix : 2, 4, 5 ; la technique du canon dans le Credo avec, comme le souligne
judicieusement J. Barbier, « l'indication humoristique Le premier va devant puis le devant va derrière » (partie
finale). Le Sanctus et l'Agnus Dei comportent l'indication
« vous jeûnerez les 4 temps ». Excellente paraphrase liturgique.
D'un côté, la Messe Pange lingua
— souvent interprétée de nos jours — frappe
par sa simplicité et son économie de moyens ; de l'autre côté, la Messe de beata Virgine, sans fil conducteur mélodique, est marquée par
une logique plus liturgique que musicale. À tous points de vue (livret avec
dialogue imaginé, excellente analyse, interprétation hors du commun) :
disque à acquérir impérativement.

Édith
Weber.
Johann Sebastian BACH : L'intégrale de l'Œuvre
d'orgue. Vol. 1 : 5 Partitas, 34
Chorals d'Arnstadt. Marie-Ange Leurent, Éric Lebrun, orgue. 2CDs MONTHABOR MUSIC (www.monthabor.com) :CD 250020-1. TT : 77' 09.
Marie-Ange Leurent et Éric Lebrun, poursuivant leur collaboration avec
Monthabor Music, inaugurent « leur »
Intégrale de l'œuvre d'orgue de Jean Sébastien Bach, avec deux disques, l'un
avec des Partitas enregistrées à
l'Orgue Jean-André Silbermann de Soultz
(Haut-Rhin) ; l'autre avec les Chorals
d'Arnstadt interprétés à l'Orgue du même facteur
à l'Abbatiale Saint-Maurice d'Ebersmunster
(Bas-Rhin).
Le premier disque
concerne des œuvres de jeunesse : 5
Partitas sur les chorals suivants : Sei gegrüsset, Jesu gütig (BWV 768),
O Gott, du frommer Gott (BWV 767), Christ, der du bist
der helle Tag (BWV 766), Allein Gott in der Höh sei Ehr (BWV 771) et Ach, was soll ich Sünder
machen ? (BWV 770). D'une manière générale,
Marie-Ange Leurent et Éric Lebrun tirent le meilleur
parti des instruments de J.-A. Silbermann permettant
de différencier les timbres, de bien dégager les thèmes ou cantus firmus et de
mettre en valeur les couleurs spécifiquement baroques. Ces Partitas — que Bach qualifie de « partite diverse sopra… » sur tel ou tel choral — se présentent comme un genre de
divertissement. De leur interprétation de ces œuvres particulièrement
personnalisées par Bach se dégagent aussi bien la tension que l'intériorité. Le
second disque est consacré aux 34 Chorals
d'Arnstadt (où Bach a séjourné entre 1703 et
1707) — ou « Chorals du recueil de Neumeister » — (BWV 714, 742, 719, 957, 1090 à
1119), découverts aux États-Unis en 1985. Les interprètes les ont
judicieusement classés en fonction des temps, circonstances et thèmes
liturgiques : Noël, Nouvel An, Purification, Sainte Cène, Passion,
Pâques ; et de leur finalité théologique : Foi, Confiance en Dieu,
Pénitence, Funérailles, Cantique du soir (et non pas selon la succession des
numéros du Catalogue BWV).
On attend avec une
évidente impatience les deux Volumes : Orgelbüchlein, Clavierübung dritter Teil, à paraître encore en 2016 et, bien sûr,
les suivants jusqu'en 2019… Beau projet, tout à l'honneur des deux organistes
et du Label MONTHABOR. Incontestablement, il retiendra l'attention.

Édith
Weber.
La Maîtrise de Reims chante sa Cathédrale. Annick Massis, soprano. Ensemble Lyrique Champagne
Ardenne et Maîtrise de Reims. Orchestre de l'Opéra de Reims, dir. Sandrine Lebec. 1CD JADE (www.jade-music.net): CD 699 875-2. TT : 61' 50.
Dans la LI de
décembre dernier, la Maîtrise de la Basilique Saint-Rémi de Reims a déjà été
présentée. Rappelons qu'elle a été fondée en 1285, et qu'elle est dirigée par
Sandrine Lebec qui, pour cette réalisation en
l'honneur de la célèbre Cathédrale, a sélectionné, entre autres, des œuvres
très connues telles que le Laudate Dominum de Wolfgang
Amadé Mozart ou encore le Cantique de Racine de Gabriel Fauré, et a le mérite de lancer deux
pièces moins connues : l'Ave Maria
de Georges Garvarentz (1932-1993) et le Pie Jesu
d'Andrew Loyd Webber (1914-1982) et surtout — après
les Christmas Carols de John Rutter (né en 1945), cf.
CD : « La Maîtrise de Reims chante Noël » — son Magnificat chanté avec enthousiasme et
ferveur par les jeunes choristes alternant avec les voix d'hommes et soutenus
par l'orchestre. Tout en reprenant le texte latin liturgique et se terminant
traditionnellement sur le Gloria, J. Rutter a inséré le texte anglais : Of A Rose A Lovely
Rose, sans doute par allusion à Jessé et à un ancien
Christmas Carol (chant de Noël
anglais) remontant au XVe siècle. À noter, entre autres, l'éclatant Quia fecit mihi magna, enlevé énergiquement par l'orchestre et les
voix, ou encore l'Et misericordia
plus intériorisé, le Fecit potentiam,
tonitruant et de caractère dansant ; enfin, le Gloria, solennel et affirmatif, pose un vigoureux point d'orgue. Ce
parcours de musique sacrée, repris en 2015 par les Éditions JADE, a été
enregistré lors du concert public du 23 octobre 2011 avec le concours d'Annick
Massis (Soprano), de l'Orchestre de l'Opéra de Reims, de l'Ensemble Lyrique
Champagne Ardenne et de la Maîtrise de Reims dont les jeunes élèves, associés à
son Chœur d'hommes, manifestent un réel enthousiasme dans l'interprétation d'un
programme aussi diversifié. Ils sont tous placés sous la direction autoritaire
— comme il ressort aussi de la photo jointe à la plaquette — et si compétente
de Sandrine Lebec.

Édith
Weber.
« Dresden Passion ».
Cappella Sagittariana de Dresde, dir.
Norbert Schuster, 2CDs RONDEAU
PRODUCTION (www.rondeau.de) : ROP 612122. TT : 97' 04.
La remarquable
Cappella Sagittariana de Dresde, sous la direction de
Norbert Schuster, de réputation
internationale en raison de ses critères d'interprétation historique, a le
mérite de proposer un programme typiquement local, avec la Passion selon Saint Marc de Marco Giuseppe Peranda.
Ce dernier, né à Macerata vers 1625, mort à Dresde en 1675, a été actif dans
cette ville au riche passé musical, ayant accueilli de nombreux musiciens
italiens. Cette compilation comporte des œuvres polyphoniques contemporaines de Heinrich Schütz situées dans le contexte de la Passion et
quelques répons grégoriens. La
Markus-Passion de Marco Giuseppe Peranda a
longtemps été attribuée à Heinrich Schütz, et Norbert Schuster en a réalisé la
conception originale avec interpolations, conformément à l'ordonnance
liturgique du culte à la Cour de Dresde pour le temps de la Passion et en usage
à l'époque du Prince-Électeur de Saxe, Johann Georg II.
Le disque 1 reprend
le récit de Marc (chapitre 14,
versets 1-72) chanté par l'Évangéliste qui relate les faits. Dès le début, deux
Symphoniae
(I et II), extraites des Sieben Worte Jesu Christ am Kreuz (SWV 478) de Heinrich Schütz sont entrecoupées
par le répons a cappella : Tenebrae factae sunt d'après le Liber Usualis,
par d'autres extraits des Petits Concerts
spirituels (1639), de Symphonies
et de Motets de Sagittarius
et du Concert spirituel de Christoph Bernhard (1628-1692) : Salve mi Jesu
pour soprano et basse continue. Le disque 2 reprend le récit de Marc, chapitre 15, versets 1-47. Il est
entrecoupé par des pièces contemporaines d'Anton Colander
(1590-1621), de Johannes Hermann Schein (1586-1630) et de Samuel Seidel
(1615-1665). Les sources bibliques restent toujours présentes.
Dès le début, les
instrumentistes créent l'atmosphère triste, mélancolique et poignante convenant
à la Passion du Christ, et encore renforcée par la monodie grégorienne évoquant
les Ténèbres. Après la Sinfonia II provenant des Sept Paroles du Christ en croix (SWV 478), le Chœur annonce la Markus-Passion en ces termes : Das Leiden unsres Herrn Jesu
Christi… puis introduit le récit cantillé de
l'Évangéliste, faisant preuve d'une remarquable diction très suggestive. Les
passages polyphoniques interpolés et intériorisés contribuent à la méditation.
Ces mêmes principes sont respectés dans le second disque avec la relation de
l'Évangéliste. La conclusion de la Passion
(pl. 10) est un chant d'action de grâce et de reconnaissance : Dank sei unserm Herrn Jesu
Christo, der uns erlöset hat,
durch sein Leiden, von der Hölle, est chantée
avec expressivité, conviction et dépouillement. Elle est suivie de la Sinfonia VII (SWV 405, extraite des Sinfoniae Sacrae III) : O süsser Jesu Christ
(texte anonyme) de Heinrich Schütz pour deux sopranos, alto, ténor, violons
I et II et basse continue qui, après une introduction instrumentale rappelant
l'atmosphère du début de l'œuvre, pose un émouvant point d'orgue évoquant
l'amour du Christ et s'adressant à ceux qui doivent l'aimer. À écouter
passionnément.

Édith
Weber.
« Clairières
dans le ciel ». Duo Contraste. 1CD
HORTUS (www.editionshortus.com). WW1 Music. HORTUS 713 : TT : 73'
42.
Pour commémorer le
Centenaire de la Première Guerre Mondiale (World
War 1), le Label HORTUS a, dans sa Collection
« Les musiciens et la Grande Guerre », associé au Volume XIII 5
compositeurs français : Pierre Vellones
(1889-1939), Guy Ropartz (1864-1955), Georges Migot (1891-1976), Jacques De La
Presle (1888-1969) et Lili Boulanger (1893-1918) dont les œuvres reflètent tout
particulièrement la mentalité et les réactions des combattants au front et des
compositeurs à l'arrière. Le programme a le mérite de présenter des inédits de
Georges Migot et de Jacques de La Presle, entre autres. Un dessin anonyme à
l'encre de Chine : « On est prié de ne pas chanter » — illustré
par un soldat barbu dont la bouche est cadenacée —, à
lui seul, traduirait déjà l'état d'esprit des Poilus.
La Lettre du front (1916) (paroles :
Marcel Manchez, musique : Pierre Vellones) (pl. 1), adressée au Commandant A. du Boisrouvray, évoque de manière très réaliste l'atmosphère
dans les tranchées, les regrets de la vie ancienne du soldat qui veille et
écrit, « les pieds dans l'eau ». Ce CD se termine par Aux Gonces qui se
débinent (1916), ceux qui, « au sec », ne seront pas
blessés : paroles accusactrices et chantées par
Cyrille Dubois (ténor) avec hargne en fonction des paroles de Marcel Manchez (pl. 29), accompagné en parfaite entente par le
pianiste Tristan Raës.
Guy Ropartz a
choisi Quatre Odelettes (1916) de Henri de Régnier, de caractère lyrique et
descriptif (pl. 2-5) : Un petit
roseau m'a suffi…, avec une introduction au piano qui crée l'atmosphère
quelque peu mystérieuse et si bien rendue par le Duo Contraste. Cette pièce est
suivie de Si tu disais…, Chante si doucement…, Je n'ai rien que trois feuilles d'or… (magnifique début a cappella), tout à fait dans l'esprit de
la mélodie française (équivalent du Lied
allemand) et l'esthétique du début du XXe siècle. Les mélomanes découvriront le
premier enregistrement discographique des Sept
petites images du Japon (pl. 6-12), dédiées à Jane Bathori
et composées en 1917 par Georges Migot d'après le Cycle de Heian (IXe siècle), suscitant d'abord en douceur, puis
plus énergiquement, la tristesse de la séparation et faisant appel à une grande
richesse expressive et un réel pouvoir de suggestion.
Jacques De La
Presle (1888-1969) a mis en musique la Chanson
de la rose (1917) de M.-A. Robert (pl. 13) empreinte de douceur,
d'admiration et de désir, ainsi que le texte de Jean Richepin (pl. 14) : La branche d'acacia (1916) s'adressant à
l'Aimée et se terminant par la phrase : Alors
depuis que je t'aime, dis toi-même combien de jours il y a, résumant
l'atmosphère du poème. Sa mélodie Heureux
ceux qui sont morts pour la terre charnelle (pl. 15) sur le texte de
Charles Péguy et dédiée « à la mémoire de Charles Péguy » (mort en
1914, au tout début de la Guerre), se termine par deux affirmations : Heureux ceux qui sont morts dans une juste
guerre. Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés... Lili Boulanger
(1893-1918) a retenu le poème Clairières
dans le ciel (1914) extrait du
Recueil Tristesses de Francis Jammes
(pl. 16-28), concernant l'amie « descendue au bas de la prairie »
(pl. 16), « gravement gaie » (pl. 17), puis la tristesse et la joie
quand il pense à elle (« Parfois je suis triste », pl. 18) ou encore
la nostalgie (« Demain fera un an… », pl. 28).
Sur le front ou à
l'arrière, ces poètes et musiciens — par leur musique aux accents très humains
et d'un grand raffinement, marquant un aboutissement esthétique — ont livré un
intime et émouvant témoignage d'humanité au cœur de la barbarie. Cyrille Dubois
(ténor) et Tristan Raës (piano), tous deux formés au
CNSM dans la classe de Lied et Mélodie, ont signé une belle illustration
historique et psychologique, conformément à leur affirmation : « La
musique porte au-délà des mots le spleen et la
mélancolie qui prévalaient partout dans le monde au début de ce conflit ».

Édith
Weber.
Pièces pour violon de Serge PROKOFIEV, Igor
STRAVINSKY, Ernest BLOCH, Eugène YSAYE, Fritz KREISLER, Janine ALLANIC,
Bernardo STALMAN. Roberto Sawicki,
violon. 1CD VDE GALLO (www.vdegallo-music.com) : CD1455. TT : 58'37.
Roberto Sawicki — violoniste et chef d'orchestre argentin
contemporain—, né à Buenos Aires, s'est installé en Suisse romande où il a
fondé en 1975 l'Orchestre de Lanci-Genève. Il a
enregistré en 2014 une sélection originale de compositions du XXe siècle pour violon seul. Voici ce qu'il précise
à cet égard : « Lorsque j'ai choisi ces œuvres pour violon seul… mon
intention était de proposer aux mélomanes des œuvres reliées par ce qui
m'apparaît comme leur caractéristique commune : la recherche de
l'essentiel à travers une subtile forme de dépouillement. Ces œuvres exigent de
l'interprète une richesse d'expression, une modulation fine du son, une
intention particulière aux possibilités polyphoniques du violon. Elles
demandent aussi un renoncement aux effets, une quête de vérité pour aller au
plus profond de l'âme de chaque partition. » Ces impératifs sont confirmés par son jeu exceptionnel.
Sept œuvres figurent à son programme : Intrada et Badinerie de Janine Allanic,
interprétées avec fluidité, précision et justesse extrême dans l'aigu. La Sonate op. 115 de Sergueï Prokoviev (1891-1953), composée en 1947, avec humour et
lyrisme, exige une grande virtuosité (con
brio). La Suite n°2 d'Ernest
Bloch (1880-1959), musicien suisse puis citoyen américain, d'abord énergique et
quelque peu angoissante, avec une grande difficulté d'intonation, se fait
ensuite plus tendre, puis méditative. Igor Stravinsky (1882-1971) a, en 1944,
composé une Élégie en sol mineur, en
fait « déploration à la mémoire du premier violon du Quatuor Pro
Arte » ; le style peut surprendre : l'interprétation est
entièrement effectuée avec la sourdine. Ce parcours cosmopolite se poursuit
avec la Sonate op. 27 n°5 du musicien
belge Eugène Ysaÿe (1858-1931), qui évoque l'éveil de
la nature, nécessite des pizzicati énergiques et des notes tenues pianissimo à l'archet. Le Recitativo e scherzo capriccio de Fritz Kreisler
(1875-1962) est caractérisé — selon Pierre de Vargas — par son « mouvement
grave et noble », par une « danse pétillante, dynamique, rebondissante au jeu très affirmé, [qui] tranche avec la
douceur… et le raffinement d'une élégance viennoise ». Enfin, plus proches
de nous, Deux tangos de l'Argentin
Bernardo Stalman (1910-2004) : Lobo estas ?
(Loup, y es-tu ?) et triple Libertad… ? s'inspirant de l'Hymne national de son pays, posent un
intéressant point d'orgue sur cette redoutable Anthologie cosmopolite.

Édith
Weber.
Julien-François
ZBINDEN : Intégrale
des œuvres pour quatuor à cordes. Quatuor Sine Nomine. 1CD VDE GALLO
(www.vdegallo-music.com): CD 1451. TT : 48' 19.
Le Quatuor Sine
Nomine (Lausanne) réunissant Patrick Genet, François Gottraux,
Hans Egidi et Marc Jaermann,
a réalisé l'intégrale des quatuors à cordes de Julien-François Zbinden, né le 11 novembre 1917 à Rolle (Canton de Vaud).
Ce pianiste, compositeur assez autodidacte, a
découvert le jazz à 15 ans, étudié à l'École Normale en 1938, puis débuté une carrière
professionnelle de pianiste de dancings et de variétés, et exercé de nombreuses
activités radiophoniques jusqu'à sa retraite en 1982. Ses œuvres ont été
couronnées par de nombreux Prix. En 1979, il a composé son Quatuor n°1 op. 60 en
trois mouvements : 1. Exorde (de
caractère oratoire), 2. Berceuse plus
intime, dont le thème, comme il le souligne, « est construit sur les
lettres du prénom et du nom du dédicataire roumain [naturalisé suédois] Mircea Saulesco » (orthographe roumaine), 3. Rythme matérialisant « un
vœu de M. Saulesco : un finale de couleur
jazzy, étant donné que le compositeur fut pianiste de jazz
professionnel ». Cette œuvre a été créée en 1979 à Stockholm. Le programme
se poursuit avec Alligun, op. 69 (1983) pour la même formation, dédié à l'épouse de M. Saulesco,
avec des accords violents et dissonants, un fugato
à 4 voix reprenant les accords de l'introduction, puis une brève berceuse terminant joyeusement l'œuvre.
Enfin, le Quatuor n°2 op. 108
(composé en 2011 et créé en 2012), pour formation particulière (deux
violons, alto et violoncelle), très développé, comporte quatre
mouvements : 1. Lento mystérieux,
puis « joyeusement rythmique » 2.
Allegro-Scherzando molto vivo qualifié par le compositeur de
« batifolage d'archets » 3. Adagio dramatique et plus intériorisé,
4. Allegrissimo
réservant de nombreux traquenards techniques. Cette réalisation est tout à
l'honneur du Quatuor Sine Nomine, de réputation internationale et lauréat de
nombreux concours.

Édith Weber.
Apolinary SZELUTO : Songs 1. Aleksandra Kaminska-Rykowska, mezzo-soprano, Laura Sobolewska,
piano. 1CD ACTE PRÉALABLE : AP0338. TT : 42' 09.
Apolinary Szeluto (1884-1966), est né à Saint-Petersbourg
dans une famille de musiciens ; d'abord pianiste dès l'âge de 9 ans, il a
ensuite étudié la composition au Conservatoire de Varsovie auprès de Sygmunt Nokowski (mort en 1905).
Il a été notamment l'ami de Karol Szymanowski. Son œuvre a rencontré un grand
succès. Il a sélectionné, entre autres, sept poèmes d'Adam Mickiewicz, deux de
Julius Slawcki, un de Leon Radziejowski, poètes polonais, et cinq d'après Heinrich
Heine et un d'Oscar Wilde (adaptés en polonais). La plaquette ne donne aucune
traduction des textes chantés par Aleksandra Kaminska-Rykowska
(mezzo-soprano) avec musicalité, tour à tour, avec assurance, finesse et
nuances. Formée en chant par le professeur Wojciech Maciekowski,
diplômée de l'Académie de Musique de Poznan en
chant solo, elle a débuté à la scène,
notamment avec le role de Lucia dans Cavalleria rusticana. Elle
a aussi étudié au Conservatoire Santa Cecilia de Rome et s'est produite comme
soliste à la fois en Pologne, en Europe et aux États-Unis. Musicologue, elle
est titulaire d'un Doctorat portant sur l'héritage de l'art vocal d'Apolinary Szeluto. Elle est
accompagnée et soutenue discrètement au piano par Laura Sobolewska
(piano) qui a étudié le piano à Poznan à l'Académie
Ignacy Jan Paderewski avec le professeur Waldemar Andrzejewski et obtenu de très
nombreuses récompenses internationales. Elle est à la fois concertiste,
musicologue et professeur à l'Académie de musique de Poznan.
Ces mélodies très brèves sont interrompues, à la plage 11, par le Nocturne en Si b Majeur N°1 (op. 54, n°1) auquel l'excellente
pianiste confère toute la nostalgie souhaitée. Ensemble, elles forment équipe
bien soudée au service d'une meilleure connaissance de la musique vocale
polonaise. Édith Weber.

Frédéric CHOPIN, Mieczyslaw KALOWICZ, Karol
SZYMANOWSKI, Roman PALESTER, Witold LUTOSLAWSKI, Andrzej PANUFNIK : SONGS. Bernadeta Sonnleitner, mezzo-soprano,
Jakub Tchorzewski, piano. 1CD ACTE PRÉALABLE
(www.acteprealable.com): AP0337. TT : 66'41.
Cette Anthologie
vocale polonaise, en première mondiale, est réalisée par Bernadeta
Sonnleitner (mezzo-soprano) et Jakub Tchorzewski (piano). Elle permettra, grâce à l'initiative
de Jan Jarnicki, de promouvoir la musique et les
musiciens polonais. Fryderyc
Chopin est représenté par quatre mélodies polonaises (op. 74) plutôt destinées
au salon qu'à la salle de concerts. Mieczyslaw Karlowicz (1876-1909) a composé ses mélodies (op. 3) à la
fin du XIXe siècle. Les mélodies (op. 5) de son contemporain, Karol Szymanowski
(1882-1937), sont plus développées ; il préconise une déclamation
solennelle et utilise des harmonies archaïques et modales. Chanteuse et
pianiste sont à égalité, évoquant des
sentiments très forts émanant des poèmes de Kasprowicz. Les 3 Chants de Roman Palester (1907-1989), datant de 1930, sont une œuvre de
jeunesse ; certaines ont été perdues pendant la guerre, mais ces 3 chants
ont été retrouvés dans les archives ayant appartenu à l'éminente musicologue, Zofia Helman, spécialiste de Palester. Witold Lutoslawski
(1913-1994) est représenté par 5 pièces concernant entre autres la mer, les
cloches d'église. Enfin, Andrzej Panufnik
(1914-1991), appartenant à la même génération, est l'auteur d'une mélodie très
développée : Dreamscape
publiée en 1977, créée par la chanteuse Meriel
Dickinson, sœur du pianiste et compositeur Peter Dickinson, ami de Pafnuknik. La finalité est originale, car le compositeur a
« donné au chanteur la possibilité d'improviser le choix des voyelles et
du phrasé ». La partie de piano est très élaborée. Cette œuvre est aussi
connue pour sa version pour violoncelle et piano. Bernadeta
Sonnleitner, diplômée de l'Académie Chopin de
Varsovie et de l'Universté
de Berne, a enregistré de nombreux CD en Suisse et en Allemagne. Jakub Tchorzewski a rayonné aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis,
au Japon, au Brésil et a réalisé de nombreuses émissions pour les Radios
tchèque, slovaque, suisse, italienne et polonaise. Ils remplissent
admirablement les objectifs d'Acte Préalable.

Édith Weber.
« Swiss Symphony Composers,
vol. 2 » : Aloÿs FORNEROD,
Laurent METTRAUX, Jean BALISSAT, Fabio MAFFEI. Orchestre de la Suisse
italienne, dir. Emmanuel Siffert.
1CD VDE GALLO (www.vdegallo-music.com): CD 1234. TT : 75'15.
Olivier Buttex, toujours soucieux de mieux faire connaître la
musique suisse, a retenu pour le Volume 2, quatre compositeurs et cinq œuvres
interprétées par L'Orchestre de la Suisse italienne (fondé en 1935) sous la
direction avisée d'Emmanuel Siffert, formé à la
direction à Salzbourg par Sandor Végh,
puis en Suisse par Ewald Körner et à Helsinki par Jorma Panula, et qui dirige de
très nombreux orchestres.
Aloÿs Fornerod (1890-1965), après ses études au Conservatoire de
Lausanne, a bénéficié de l'enseignement de Vincent d'Indy (composition), d'Auguste
Sérieyx (contrepoint), puis, à Strasbourg, de Hans
Pfitzner (orchestration). Il est à la
fois conférencier, violoniste, enseignant. D'abord pour piano, Le voyage de Printemps, op. 28 —
orchestré en 1941 et créé par Ernest Ansermet l'année suivante —, est tour à
tour impressionniste, empreint de fraîcheur, coloré, rêveur, enlevé, dansant.
Il est structuré en 5 mouvements un peu à la manière d'une suite. Son 2e Concert pour orchestre de chambre,
composé en 1949 et créé en 1950, également d'esthétique néoclassique, comporte
4 parties : Entrée, Passepied de caractère vivace, Romance intériorisée et Mouvement perpétuel plein d'élan.
Plus proche de
nous, Laurent Mettraux (né en 1970) a étudié au
Conservatoire de Fribourg et à Genève. Il a entre autres bénéficié des conseils
de Klaus Huber, de Luis de Pablo, d'Arvo Pärt et Paul Mefano. Jeune compositeur, il a obtenu des
prix prestigieux et a été honoré pour sa « contribution remarquable à la
vie musicale en Suisse et à l'étranger » où ses œuvres sont largement
diffusées. Sa Symphonie pour orchestre de
chambre n°1, tragique et sombre, accumule les passages polyphoniques
alternant avec des soli instrumentaux reposant sur des mélodies tourmentées.
Elle nécessite une grande maîtrise technique de la part des instrumentistes.
Jean Balissat (1936-2007) a d'abord étudié l'harmonie et le
contrepoint à Lausanne, puis l'orchestration et la direction à Genève. Il est à
la fois corniste, percussionniste, chef d'orchestre et compositeur (pour
orchestre, chœur, brass band, instruments solistes).
Il a aussi enseigné la composition, l'orchestration et l'analyse aux
Conservatoires de Lausanne et de Genève ; il a été, entre autres,
président de l'Association des Compositeurs Suisses. Son Intermezzo pour orchestre de chambre spécule notamment sur l'aigu
des violons et s'inspire de Visions de
Constantin Regamey.
Enfin, Fabio Maffei (né en 1968), après ses études au Conservatoire de
Lausanne et à la Fondation Heinrich Neuhaus, a
travaillé en privé à Neuchâtel avec le compositeur René Gerber. Il est
également l'élève de Chen Liang-Sheng à Genève ainsi
que de Michel Tabachnik (en direction). Premier Prix
du concours (1995) pour jeunes compositeurs organisé par l'Orchestre de chambre
de Lausanne, son œuvre très développée, reprend 10 épisodes du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry.
Elle baigne successivement dans l'inquiétude (plage 12), l'angoisse (pl. 13),
la sobriété et le dépouillement (pl. 14). Les plages 15, 16, 17 évoquent le Roi en une marche pompeuse ; le Buveur avec quelques
« épanchements de sentimentalité exagérée » ; rapidement l'Allumeur de Réverbères, suivi de la Rencontre avec le Serpent (pl. 18)
mettant la clarinette basse en valeur et traduisant une certaine inquiétude,
cédant le pas à l'émotion et la mélancolie avec Le Secret du Renard (pl.19), avec le choral à 4 voix interprété par
les cordes. Pour conclure, le Départ du
Petit Prince (pl. 20) renoue avec l'attente du premier mouvement et avec
quelques réminiscences thématiques. Enfin, pour la dernière page du livre,
L'étoile (pl. 21), Fabio Maffei fait appel à
un ostinato, à des lignes mélodiques expressives. L'ensemble imprégné de
nostalgie se termine dans la lumière. Œuvre originale et particulièrement
attachante.
Cette réalisation
contribuera largement à une meilleure connaissance de la musique suisse du XXe
siècle.

Édith
Weber.
« Swiss Symphony Composers,
vol. 4 »: Aloÿs FORNEROD,
Alphonse ROY, Bernard REICHEL, Laurent METTRAUX. Margarita Jeskina, orgue. Orchestre symphonique de Volgograd, dir. Emmanuel Siffert. 1CD VDE GALLO (www.vdegallo-music.com): CD 1192. TT : 70'23.
Le Volume 4 propose d'autres pages
symphoniques d'Aloÿs Fornerod et de Laurent Mettraux
(présentés dans la recension ci-dessus), et permet également de faire connaître
deux autres compositeurs.
Alphonse Roy, né en
1906, a étudié la flûte, l'harmonie, le contrepoint, l'histoire de la musique
et la pédagogie au Conservatoire de Neuchâtel. Brillant flûtiste, il a été
membre de l'Orchestre de Winterthur et de celui du Kursaal
à Baden, puis à l'Orchestre de la Suisse Romande et également à Lugano, et
c'est à Genève qu'il compose à partir de 1944. Il meurt en 2000. Sa Ballade pour grand orchestre (pl. 2),
créée en 1953 par l'Orchestre de la Suisse Romande sous la direction d'Ernest
Ansermet et, l'année suivante, à Bâle par Hans Münch
à la tête de l'Orchestre symphonique. Dans cette œuvre incisive, spéculant sur
les contrastes dynamiques, le compositeur s'inspire des possibilités
orchestrales typiquement ravéliennes.
Bernard Reichel, né à Neuchâtel en 1901, est à la fois pianiste,
organiste et compositeur ainsi que disciple d'Émile Jaques-Dalcroze. À Paris,
il étudie la composition avec Ernst Levy et se familiarise avec les styles de
Claude Debussy, Maurice Ravel, Albert Roussel, Arthur Honegger… De retour à
Genève, il y enseigne l'harmonie au Conservatoire et occupe plusieurs postes
d'organiste. Il meurt en 1992. Musicien assez indépendant, il est influencé par
le choral, les modes médiévaux, le chant populaire et mise sur l'élargissement
de la tonalité. Ses œuvres religieuses (Chorals, Psaumes, Te Deum, Gloria…) sont
largement diffusées. Sa Pièce symphonique
pour orchestre avec orgue (pl. 3), composée et créée en 1946, est pleine
d'allant, l'orchestre et les percussions occupent une large part. Son
esthétique se veut libre et indépendante.
Prométhée enchaîné d'Aloÿs Fornerod (1890-1965) est une pièce symphonique pour grand
orchestre. Comme le rappelle Jacques Viret, la première exécution a été
enregistrée en 1949 avec le chef Edmond Appia pour un programme radiodiffusé de
l'Orchestre de la Suisse Romande. La création publique a eu lieu le 6
février 1952 à Winterthur et, deux ans après, Carl Schuricht
réalisera un enregistrement pour la Radio du Stuttgart. Cette œuvre très
rythmée, insistante est énergique, puis devient plaintive et lyrique ;
ensuite un changement de tempo « animé » et un thème rapide sont
suivis d'un passage lyrique poignant mais — au lieu du triomphe de Prométhée —
l'accalmie et la résignation s'imposent.
Le disque se
termine avec deux œuvres de Laurent Mettraux (né en
1970) : Ombre, composée entre
1995 et 1998, d'après Edgar Allan Poe, traduit la terreur et l'angoisse avec
des timbres parfois curieux et des nuances extrêmes (ffff). Enfin, dans sa Vision immanente, composée en 1992 et
révisée en 2006, le compositeur fait alterner des passages agités et des
moments apaisés.
L'Orchestre
symphonique de Volgograd (fondé en 1987) et Margarita Jeskina
(orgue), placés sous la direction énergique d'Emmanuel Siffert,
défendent ardemment ces œuvres de musiciens suisses à (re)découvrir.

Édith Weber.
« The high road to Kilkenny ». Chansons et danses gaéliques des XVII ème et XVIII ème siècles. Robert Getchell, ténor. Les Musiciens de Saint-Julien, dir. François Lazarevitch. 1CD
Alpha : Apha 234. TT.: 69'25.
Ce disque nous entraine dans les paysages
et les traditions d'Irlande : « Amour, bardes et mécènes », nous dit
François Lazarevitch (cf. son ITV ci-dessus, à la
rubrique PROPOS PARTAGES ). Des chants et danses
collectés au fil de l'histoire d'un pays soumis à l'occupation anglaise, et
réunis en particulier au XIX ème. Des pages que le
chef dit avoir découvertes il y a une vingtaine d'années et qu'il brûlait de
faire partager. Les compositeurs ont pour nom : Turlough
O'Carolan (1670-1738), le plus célèbre, Thomas Connelan (c.1640/45-1668), ou encore David Murphy (début du
XVII ème). Il y a aussi des Anonymes. Leurs pièces
véhiculent une rythmique à l'amplification irrésistible, gagnant en intensité
sonore à mesure que croît la vitesse, se modifiant aussi au fil du parcours.
Les morceaux présentés ici sont d'abord vocaux, chacun précédé ou suivi d'un
épisode instrumental. Ils sont significatifs d'un « répertoire de poésie
mise en musique extrêmement raffiné et savant » et d'« un répertoire
récréatif de chansons et de danses » (François Lazarevitch).
Ils font la part belle à la flûte et au violon solo. Ainsi de cette chanson
d'amour un brin satirique « Oro mhor a mhoirin » (an.), ou
de « Edward Corcoran » de O' Carolan, une mélodie traduisant les affres de l'émigration
des meilleurs d'entre les irlandais, qui allait affaiblir la culture gaélique :
introduite par la flûte, rejointe par le violon, elle est bien peu joyeuse. La
pièce « Tiana Mhaigh eo (Lord mayo) » de Murphy est un exemple d'éloge
bardique, offrant un mélodisme délicatement balancé.
On y trouve encore des pièces de type berceuse, telle « Do Chuirfinnse Féin Leanbh a Chodlach » /je mettrai mon propre enfant à dormir
(an.), qui appartient à la tradition des chants de protection. On savoure ici
les sortilèges mirifiques de la harpe celtique. Ces pages vocales sont
entrelardées de morceaux instrumentaux qui eux aussi cèlent une verve
bondissante. Ainsi de « Cuckold come out the amery » de John Peacock
(1756-1817), ou cet enchainement de pièces de O' Carolan où l'on remarque le violon orné de la première
« Sir Arthur Shaen ». Ou encore cet autre
dans le registre de la complainte («Soggarh Shamus O'Finn » (an.), que
transfigure la viole de gambe, ou les « Variations » de James Oswald
(1711-1769) et O' Carolan, distinguées par la flûte
de Lazarevitch et le violon de David Greenberg. Dans
l'air du ballad opera
« O'Neill's riding barrack Hill » (an.), la cornemuse apporte une autre
couleur ''locale'' hyper irlandaise. La berceuse « The cunning
young Man » (an.), pour réconforter un enfant
malade, met en avant la flûte là encore. « The high
road to Kilkenny » (an.) est un ''slip jig'',
danse à 9/8, pratiquée par les femmes qui, dit-on, étaient chaussées de ''soft shoes'' ou claquettes sans fer. L'un des sommets de cette
anthologie. Une bien belle aventure que Lazarevitch
et ses musiciens de Saint-Julien nous font partager par une manière entrainante
dans ses harmonies claires et ses rythmiques endiablées voire rageuses. Ce
petit groupe de six instrumentistes, violon, viole de gambe, théorbe (ou
cornemuse), flûte (ou bagppies), harpe et harpe
celtique, déploient des sonorités proprement envoûtantes. La belle faconde et
le timbre angélique du ténor Robert Getchell
illuminent les pièces vocales. A découvrir absolument.

Jean-Pierre Robert.
Jean Sébastien BACH : Concertos Brandebourgeois, BWV 1046-1051. « Afin
que ma joie demeure » d'après la cantate « Hertz und Mund Tat und
Leben » BWV 147. La Simphonie du
Marais, flûte et dir. : Hugo Reyne. 2 CDs Musiques à
la Chabotterie : 605014. TT: 1H41.
Cette nouvelle version des Concertos
Brandebourgeois se veut « à la française », selon son chef Hugo Reyne, avec accent porté sur les vents. Les « Six
Concerts avec plusieurs instruments » sont un des points d'aboutissement
de la floraison concertante chez Bach. On a longtemps glosé sur leur caractère
de ''vrai'' cycle, sur ce qui est une synthèse de la forme du concerto grosso
italien et du concerto de solistes. L'interprétation d'Hugo Reyne
et de ses forces de la Simphonie du Marais offre un
autre éclairage que les versions dites traditionnelles. Encore qu'il serait
passionnant de la comparer à la version pionnière de Nikolaus
Harnoncourt de 1962. Avec une petite vingtaine de musiciens, le plus souvent
réduits à une dizaine, ces lectures apparaissent dégraissées et transparentes.
Car l'instrumentation choisie est ''légère'' pour un résultat chambriste. Les
tempos sont judicieux, et assez modérés lorsqu'il s'agit du ''tempo giusto'', autrement dit laissé à la discrétion du chef.
Surtout Reyne favorise les bois, dont sa propre flûte
à bec. Aucune routine donc, et des lectures sages qui sonnent un peu à l'étroit
eu égard à l'acoustique ''boxy'' du lieu
d'enregistrement live, à Montaigu, non loin du Logis de La Chabotterie,
port d'attache de cet ensemble.
Pour reprendre l'ordre proposé des deux CD
: le concerto N° 5 ou triple concerto pour flûte, clavecin et violon, est en
fait pour clavecin tant celui-ci y tient une place essentielle, comme au
premier mouvement et sa longue cadence (magnifique Yannick Verlet)
ou à l'affetuoso médian confié au seul trio instrumental, lequel est selon Reyne « une déploration en trio d'un père et de ses
deux fils musiciens (Wilhelm-Freideman et Carl-Philipp) esseulés après la perte de leur femme et mère ».
Le Concerto N° 3 pour trois violons, trois altos et trois cellos
se signale ici par son bref adagio, transition confiée aux trois instruments
principaux avec « quelques broderies et motifs du 1er mouvement ». Le
finale allegro est ici un presto bien trottinant, un tantinet bruyant. Pour
deux cors, trois hautbois, basson et violon piccolo, le Premier Concerto est le
seul des six à avoir quatre mouvements, car après les trois habituels, Bach a
ajouté une suite de danses. C'est aussi le concerto dit de la chasse du fait de
ses deux cors. L'interprétation de Reyne est bien
chantante à l'adagio tandis qu'à l'allegro le travail sur la dynamique ne
parvient pas à ôter un sentiment mécanique. La suite de danses vient mieux par
un habile choix de tempos. Avec le Concerto N° 4, de style grosso, on perçoit
une émancipation des solistes, dont les deux flûtes. L'allegro est engagé,
l'andante profond et le presto bien délié, notamment dans le concertino des
trois solistes, flûtes et violon. La couleur qu'apportent les flûtes à bec est
intéressante. Le Sixième concerto, pour 2 altos, 2 gambes, cello
et basse continue (violone et clavecin) est un vrai concerto de solistes.
L'absence des violons introduit une climat sombre.
L'interprétation réfléchie de Reyne en fait un des
points forts de cette version, par exemple à l'allegro final avec son
balancement pas trop appuyé et le tricotage des deux altos créant un climat
sévère. Enfin le Concerto N°2, pour trompette, flûte à bec, hautbois et violon,
distribution insolite, sur le mode du concerto grosso, voit un habile travail
entre le concertino des solistes et le ripieno orchestral. Voilà donc une
version renouvelée d'une œuvre archi enregistrée, à laquelle il manque peu pour figurer dans le peloton de
tête.

Jean-Pierre Robert.
Jean-Marie LECLAIR : Scylla et Gaucus. Opéra en
un prologue et cinq actes. Livret de Albaret,
d'après Les Métamorphoses d'Ovide. Emöke Barah, Anders J. Dahlin, Caroline
Mutel, Virginie Pochon, Marie Lenormand, Frédéric
Caton, Marie-Frédérique Girod, Marina Venant, Sarah Jouffroy, Vincent Laloy,
Pierre-Antoine Chaumien, Jean-Baptiste Dumora. Les
Nouveaux Caractères, dir. Sébastien D'Hérin. 3CDs Alpha : 960. TT.: 50'48+49'55+59'05.
On connait Jean-Marie Leclair (1697-1764)
comme virtuose du violon. Ce « Vivaldi français » a commis quelques
49 sonates pour le violon, une douzaine d'autres pour deux violons, et 12
concertos pour l'instrument. Son unique opéra, Scylla et Glaucus
a été créé à l'Académie royale de Musique en 1746 avec un succès d'estime, dû
sans doute au voisinage des œuvres de Rameau et de Lully. Il sombrera ensuite
dans l'oubli. Une production en sera cependant donnée à l'Opéra de Lyon, sous
la direction de John Eliot Gardiner, dans le années 1970. C'est pourtant une
œuvre passionnante qui mérite d'être redécouverte. L'orchestration est
somptueuse, notamment pour ce qui est de l'écriture pour les cordes, les
violons bien sûr, extrêmement imaginative, mais aussi, ce qui était alors
nouveau, les altos et les basses. Les bois sont pareillement traités avec soin.
L'accompagnement des chœurs est tout aussi remarquable, dépassant la simple
écriture en doublure des voix, permettant à la polyphonie vocale de se déployer
avec un naturel insoupçonné pour l'époque. Les parties purement symphoniques ne
le sont pas moins, comme l'Ouverture, qui fait penser à Haendel, mais avec
cette clarté française si caractéristique, les préludes introduisant chaque
acte, qui laissent entendre des dissonances et des « accidents
harmoniques » (Benoît Dratwicki), ou encore les
divertissements toujours raffinés et originaux. Les récitatifs ne souffrent
aucun maniérisme et les airs sont ingénieux. Surtout on remarque une justesse
de ton dramatique même si le thème subit quelques longueurs, canon en 5 actes oblige : les
amours tragiques de la nymphe Scylla et de Glaucus,
« jeune dieu de la cour de Neptune », contrariés par la magicienne
Circé qui joue un double jeu et sous prétexte d'aider le jeune homme dans son
entreprise amoureuse, s'en éprend, et bien sûr se vengera de voir l'autre femme
lui être préférée. Les choses tourneront mal : Scylla sera ravie à son amant
après s'être mirée dans le eaux d'une fontaine
enchantée tandis que l'Etna crache flammes et cendres, puis engloutie dans les
flots du détroit de Sicile pour se trouver transformée en rocher au dessus du
gouffre de Charybde. C'est ainsi que ledit rocher devint l'écueil que l'on sait
afin que « Pour le malheur de l'univers, Et Charybde et Scylla soient la
terreur des mers ».
La présente version est d'une beauté
musicale à couper le souffle. Grâce d'abord à la direction de Sébastien D'Hérin, autre exemple de ces jeunes talents directement en
phase avec cet idiome. L'intuition est là pour trouver le ton juste, forger les
contrastes : la tendre inclination amoureuse chez les deux protagonistes, la
passion rentrée de Circé. Pour amener les transitions aussi. La manière est
vive, voire adroitement boulée (entracte ou finale du II). Faire saillir les
détails instrumentaux émaillant la partition semble être un plaisir gourmand :
broderies des cordes qui ont un ''ressort'' étonnant, travail sur les
percussions, etc... Le continuo est subtilement
pensé. L'art de négocier l'effet dramatique aussi, qu'il soit placide (arrivée
de Circé, à la scène 4 du III) ou terrible (fusées furieuses de l'orchestre
lors du changement de situation à la fin de l'opéra pour décrire les monstres
qui entourent Scylla). Les divertissements sont purs joyaux, telle la Loure du III,
joliment scandée, et la Gavotte respirant allègrement, ou encore Les Tambourins
(V), d'une vivacité communicative. Les instrumentistes des Nouveaux Caractères
répondent avec un engagement qui ne se dément pas, les cordes en particulier
qui ont une élasticité étonnante : ainsi des divers airs du IV agrémentés de
subtiles percussions. Les trois rôles principaux sont tenus avec panache.
Anders J. Dahlin, Glaucus,
offre un timbre clair de ténor, expressif dans l'articulation, insistant sur le
côté lyrique du rôle, avec un passage plus marqué dramatiquement à l'acte IV
lors du duo avec Circé. Un bel achèvement. La Scylla de Emöke
Barath, beau soprano extrêmement ductile dans les
envolées aiguës, livre une diction irréprochable et excelle à restituer les
enjolivements de cette partie qu'elle dote d'une épaisseur dramatique
bienvenue. La Circé de Caroline Mutel n'est jamais
caricaturale. La présence vocale apporte une dimension charnue au personnage,
ce qui confère à l'air de vengeance de l'acte V un poids irrésistible lors
d'une scène cruciale où tout bascule dans l'infernal. Tous les autres rôles
sont parfaitement défendus. Une éclatante réussite.

Jean-Pierre Robert.
« Haydn
concertos ». Joseph HAYDN : concerto pour violon Hob. VIIa:4. Concerto pour cor, Hob. VIId: 3. Concertos pour
clavier Hob. XVIII:4 & XVIII:11. Symphonie ''La
Poule'' Hob. I:83. Fantasia Hob.
XVII:4. XVII:4. Concerto pour violon et clavecin Hob.
XVIII:6. Riccardo
Minasi, violon, Johannes Hinterholzer, cor, Maxim Emelyanychev, clavecin. Il Pomo d'Oro, dir. Riccardo Minasi
& Maxim Emelyanychev. 2CDs Erato : 0825646052042. TT: 56'42+68'55.
Les concertos constituent un corpus moins
connu au sein de l'immense production de Joseph Haydn. Celui-ci n'y cherche pas
la brillance, encore moins la virtuosité. La plupart sont des œuvres écrites
pour des commanditaires, notamment la cour d'Esterháza
et les solistes de son orchestre. Aussi ces pièces peuvent-elles sembler moins
séduisantes que celles de Mozart ou que les symphonies du ''Papa Haydn''
lui-même. Mais elles sont pourvues d'élégance et de la richesse d'invention
dont fait toujours montre le musicien. Elles sont bâties sur le schéma du concerto baroque, en
trois mouvements, rapide-lent-rapide. Le concerto de violon Hob.
VIIa:4 offre un allegro
agréable doté d'une belle cadence, un adagio un peu austère et un finale
nerveux, que Riccardo Minasi, qui dirige de son
violon, pare de son talent. Écrit en 1762, le concerto pour cor, à l'intention
de Joseph Leutgeb (pour qui Mozart composera aussi et
aura des mots peu amènes), requiert une technique habile car il visite souvent
la tessiture aiguë de l'instrument (1er et 3ème mouvements, ce dernier doté
d'une cadence pétaradante) et des notes graves impressionnantes (dans l'adagio
de type romance). Les concertos pour clavier sont de la même veine : Le
concerto Hob. XVIII:4, joué ici au clavecin, comme à
la création en 1770, est de facture très classique mais pourvu de quelques
audaces au finale, un rondo presto enlevé, avec
des traits répétés fébrilement dans la partie soliste. L'adagio a une
allure rêveuse, où l'on peut admirer le jeu raffiné de Maxim
Emelyanychev. L'autre concerto pour clavier qu'il
donne, le Hob. XVIII:11, de 1780, est plus exigeant.
C'est un des plus connus de Haydn, très prisé des pianistes. On les comprend
car son vivace initial déploie cette verve qui séduit d'emblée dans sa
rythmique entrainante. Le clavecin apporte une légèreté bienvenue, tricotant
dans le développement et la cadence. De sa délicate inspiration, l'adagio exhale
un chaud lyrisme. Emelyanychev est royal. Comme au
finale exubérant, un rondo all'Ungarese, pour
beaucoup dans la réputation de la pièce, peu résistible dans ce qu'en fait le
claveciniste russe et à la direction. Le double concerto pour violon et clavecin
(1766), le seul qui ait subsisté, est moins inventif peut-être que les autres
concertos. Il n'en est pas moins intéressant dans le dialogue des deux
instruments tantôt unis tantôt en répons, ou chacun tenant la corde. En
particulier à l'adagio qui, entamé comme le prélude instrumental à une aria de
concert, va être enluminé de la touche de chacun des deux solistes. Il dégage
un lyrisme sans fard et la cadence, attendue, est une sorte de conversation
intime. Un presto pimpant conclut. Les deux solistes sont parfaits et la
direction de Emelyanychev
est là encore des plus adroites.
L'exécution de la symphonie N0° 83, dite
« La Poule » est de nouveau l'occasion d'apprécier le flair de la
direction de celui-ci et le raffinement des musiciens d'Il Pomo
d'Oro. Cette deuxième symphonie de la série des six
dites « Parisiennes », écrites pour le Concert de la Loge Olympique,
offre bien des félicités. Et invite à l'humour en coin comme sait le distiller
Haydn. A l'allegro spiritoso – où est imité le le caquètement de la gallinacée au hautbois et soulignement
des cordes - le chef privilégie un tempo
tendu et souligne les cors. On admire le piqué des cordes de l'ensemble
italien. L'andante libère son originalité : contrastes dynamiques, ici poussés
loin, les fameux bouts de phrases joués de plus en plus piano, à la limite du
murmure, oppositions de tempo, manière suave de faire chanter l'orchestre.
Voilà un chef qui a à dire. Le menuet est autre chose que simplement gracieux
et son trio en forme de refrain tranche fort joliment. Un vivace follement
allègre conclut la symphonie, presque boulé. Mais cela est irrésistible et
magistral de la part des bois.

Jean-Pierre Robert.
Wolfgang Amadé
MOZART : Marche K. 335. Sérénade K. 320 « Posthorn».
Symphonie K. 385 « Haffner ».
Concentus Musicus Wien, dir. Nikolaus Harnoncourt. 1CD
Sony: 888837220682. TT. :
L'annonce de la disparition de Nikolaus Harnoncourt marque cruellement le vide que laisse
un penseur de la musique, un fondateur du renouveau du baroque ,« Père spirituel
de la première, deuxième puis troisième génération » (Marx Minkowski), et
un interprète hors pair et singulier. Le programme de ce CD, l'un de ses
derniers, consacré à Mozart, en est un exemple parfait. Le prétexte en est la
sérénade dite « du Cor du postillon », K. 320, écrite en 1779. Une de
ces « Finalmuik », destinées à fêter la
fin de l'année universitaire à Salzbourg, qui donnait lieu à procession à
travers la ville, du Palais Mirabell à la vieille
ville en franchisant la Salzach, au son de musiques conçues par conséquent pour
le plein air. Précédée de la marche K. 335 qui en est comme l'émanation, le
divertimento K. 320 signale une exécution typique du maestro autrichien,
extrêmement ''accidentée''. Le maestoso initial est pris très lent et le ''con spirito'' sera très nuancé dans ses diverses séquences : du
triomphal au détail pianissimo, du lent hiératique au vivace alerte, le tout
agrémenté d'une certaine rudesse rustique, qui cependant n'affecte pas les
crescendos pris de très loin pour permettre une très large amplification. Le
premier menuetto est pris pompeux avec ses passages
en arpèges piano. Le trio, pour flûte et basson, vient en complète rupture,
très lent. Du ''concertante'', andante graciozo, pour
six bois solistes (deux flûtes, deux hautbois et deux bassons), sur
accompagnement des cordes et des cors, Harnoncourt souligne la suavité par une
battue plutôt ample. La cadence finale est, dans ces conditions, on ne peut
plus éthérée, sorte de conversation choisie. La reprise se fait après un
silence marqué. Le rondo s'enchaine dans la même veine concertante, prolongeant
les conciliabules. Harnoncourt prend son temps, laissant à chaque instrument ou
groupes d'instruments loisir de s'exprimer avec la finesse qu'on connait aux
musiciens du Concentus Musicus
Wien (les hautbois en particulier, au timbre piquant, typiquement viennois). Ce
qui ne va pas sans des effets de surprise où le mouvement soudain s'emballe ou
révèle quelque joliesse. L'andantino est lourd de sens, grave, parsemé de cris de
désespérance introduits par les appels des cors. Le deuxième menuet fait alors
contraste, chacun des deux trios décochant là encore une surprise : le 1er au flautino, pimpant, le second avec le cor de postillon que
Harnoncourt détache de l'accompagnement des cordes. Le finale libère les
forces. C'est un presto, qui chez le chef est un allegro rapide, bien senti, se
concluant par un accord sec. Une interprétation qui nous sort de nos habitudes
d'écoute aisées. La Symphonie « Haffner »
K. 385 connait une lecture pareillement pensée. L'entame de l'allegro con spirito est fière, introduisant le mouvement « qui
doit être joué avec beaucoup de fougue », dit Mozart, avec son thème en
forme de marche. Harnoncourt fait sonner
grandiose ses musiciens et contraste en dynamique (grands accords forte, cordes
très piano). Le développement déploie une grande énergie. L'andante délicat ne
cherche pas quelque vaine séduction dans le traitement des cordes et le discret
discours des bois. Il ne se dépare pas d'un sérieux de bon aloi et d'une
finesse instrumentale remarquable, culminant dans des crescendos imaginatifs. Nikolaus Harnoncourt aborde le menuet avec une poigne
rustique, marquant les accents, soulignant en cela le tempétueux de l'écriture
mozartienne. Le trio apporte
l'adoucissement dramaturgique. Débuté dans un murmure, le finale laisse
éclater toute sa verve, que les auto citations de L'Enlèvement au sérail rendent si
amusante. Et cela chemine volontariste, en particulier pour ce qui est des
timbales. La coda libère une force inouïe. Là encore une vision hors des
sentiers connus. Revigorant.

Jean-Pierre Robert.
« Schola Aeterna. Chants à la Vierge ». Pièces de César
FRANCK, Paul LADMIRAULT, Paul BERTHIER, Joseph-Guy ROPARTZ, Jehan ALAIN.
Ensemble Vocal de Lausanne, dir. Michel Corboz. 1CD Mirare : MIR262. TT.
77'.
Le programme de ce disque original présente
trois générations de musiciens influencés de près ou de loin par le mouvement scholiste. La Schola Cantorum,
fondée à l'initiative de Charles Bordes, initia un mouvement qui puisant aux
sources du plain-chant et des polyphonies du XVI ème
siècle, entendait promouvoir le renouveau de la musique liturgique chrétienne
aussi bien par l'écriture que par l'enseignement. Il suscita les passions car
« ce conservatoire libre » n'était pas au goût de tous, des tenants
du ''vrai'' Conservatoire notamment. Michel Corboz a
choisi de réunir plusieurs musiciens concernés de près ou de loin par ce
mouvement. A commencer par le « père » César Franck dont sont donnés
quelques grands Offertoires pour orgue, chœur et petit effectif instrumental.
Et bien sûr le « Panis Angelicus »
( 1872), dans les deux versions, pour soprano et pour
ténor, à l'incroyable succès, peut-être en raison de son solo de violoncelle.
Plus intéressants sont le « Domine non secundum »
(1865), d'une contrition résignée, l'« Ave Maria » (1880), voué lui
aussi à la célébrité, ou « Quae est ista », avec ténor solo et surtout accompagnement de
harpe aux étonnantes modulations ; ou encore « Dextera Domini », belle
illustration du motet sacré de la période de la Restauration, à la solennelle
déclamation. Disciple de Fauré, Paul Ladmirault
(1877-1944) est le chantre du renouveau du régionalisme en musique, en
l'occurrence de la langue bretonne : Quelques vieux Cantiques Bretons signalent
la simplicité de la composition, par exemple en forme de douce prière
(« Sainte Anne, bonne mère » ou « Le Paradis »).
L'accompagnement soit de l'orgue soit de l'harmonium montre un suprême
dépouillement. Paul Berthier (1884-1953), musicien, juriste et créateur des
Petits Chanteurs à la croix de bois, est un des vrais héritiers de la Schola
dont il applique les principes en matière d'écriture pour une nouvelle musique
religieuse : référence à la polyphonie des XV et XVI èmes,
alliée à une belle audace harmonique (sombres harmonies de l'Offertoire de
la Toussaint, raffinement de l'écriture de « Ave Maria stella » ou de « Tantum
ergo »). Joseph-Guy Ropartz (1864-1955) est représenté ici par sa Messe
brève en l'honneur de Sainte Anne (1922) : modes cycliques franckistes, mélodisme et transparence s'inscrivent dans la démarche scholiste. Composée de quatre numéros, elle exhale une
douce ferveur par une écriture vocale là encore simple, expressive, avec le
soutien du seul orgue. Jehan Alain (1911-1940) est un plus lointain héritier.
Sa Messe modale (1938) réfère à la modalité grégorienne.
L'instrumentation pour flûte et quatuor à cordes offre un archaïsme envoûtant.
Inachevée, elle sera complétée (Benedictus) par Olivier et Maris-Claire
Alain. Le recueillement imprègne l'interprétation de toutes ces pièces.
L'économie des moyens privilégiée par Michel Corboz -
un effectif restreint (ou le seul orgue) en soutien - vient à l'appui d'une
volonté de traiter le chœur dans la plus grande sobriété et avec de douces
couleurs. Un sens visionnaire aussi.

Jean-Pierre Robert.
Benjamin GODARD : Mélodies, dont Six Fables de La
Fontaine, op. 17 et Nouvelles Chansons du vieux temps, op. 24. Tassis Christoyanis, baryton,
Jeff Cohen, piano. 1CD Aparté : AP123. TT.: 72'.
Benjamin Godard (1849-1895), qui grâce à
l'action du Palazzetto Bru Zane Centre de musique
romantique française, sort de son purgatoire, a écrit quelques 162 mélodies
durant les 30 années de sa carrière, le plaçant dans les premiers compositeurs
de son temps pour ce genre, après Massenet et avant Gounod. Il commet ses
premières pages, un jet de 30, en 1867,
et livrera ses ultimes opus en 1893. L'oubli dans lequel est tombée cette
production est injuste car comme le soulignait en 1880 un chroniqueur, il y a
là des « pages exquises où la pensée circule tantôt profonde, tantôt
gracieuse, comme dans toutes les œuvres que signe ce jeune et déjà célèbre
compositeur ». Ses mélodies dévoilent des orientations littéraires
intéressantes puisque puisées pour beaucoup chez Victor Hugo, mais aussi La
Fontaine, Baudelaire ou Théophile Gautier, et bien sûr des poètes de l'époque
tels que Velnac ou Claris
de Florian. Sauf à la toute fin, Godard restera attaché à la forme strophique
de la romance, au raffinement de la
ligne vocale directement calquée sur la prosodie, sollicitant souvent le
registre haut du baryton, voire des contrées presque ténorisantes. On remarque
l'importance de la partie de piano écrite avec un soin particulier conférant à
plus d'une pièce une saveur originale : le discours instrumental complète et
élargit le propos littéraire et dépasse le simple accompagnement. Le choix
opéré par les présents interprètes est judicieux car significatif des diverses
périodes du musicien. Des premiers morceaux, on entend des mélodies attachantes
comme « Les adieux du berger » op. 29 N° 5, tiré du recueil Les
Pastorales, des années 1869-1876, livrant une passion simple, ou
« Elle », op. 7 N° 10, là où le mélodisme
épouse le texte de près. Le cycle des Six Fables de La Fontaine op. 17
propose de vrais saynètes théâtrales, suivant là aussi
avec doigté le texte du fabuliste. Ces pièces ont été choisies par Godard parmi
les sujets animaliers, à l'exception de la première « La Laitière et le Pot au
lait ». On savoure dans ce morceau l'amusant clapotis du piano ponctuant
de traits comiques la morale de la fable de Perrette, et tout
une dramaturgie au fil du déroulement de l'histoire. Dans « La Cigale et
la Fourmi », le piano imite l'insecte et le dialogue des deux
protagonistes est on ne peut plus sarcastique. Pour « Le Coche et la
Mouche », le musicien imagine une marche pesante dont la survenance de la
mouche sonne comme la rupture, et les divers épisodes sont négociés avec
ironie. Avec « Le Renard et les Raisins », c'est un peu sur le ton de
''l'air de ne pas y toucher'' ; comme pour « Le Renard et le Corbeau » et
son style de ballade. L'accompagnement diablement allège de « Le Rat de
ville et le Rat des champs » est encore une merveille se style. Les
Nouvelles Chansons du vieux temps op. 24 présentent une autre facette où
Godard prend prétexte de textes archaïques pour écrire une musique volontiers
datée, façon XVIII ème, surfant sur l'engouement de l'époque pour l'ancien. Les
pièces sont strophiques avec refrain. Un choix de mélodies tardives complète le
panorama : « Printemps » op 113 de 1889, « L'invitation au
voyage » op 114, écrite bien après la célèbre version de Duparc,
intéressante dans sa veine mélodique aisée, mais ici de structure ternaire, sur
le modèle de Lied. « Message » op 147, Victor Hugo encore, offre
cette curiosité d'omettre le refrain
« Là, tout n'est qu'ordre et beauté... » Tassi
Chistoyannis, au fil des albums concoctés avec le Palazetto Bru Zane (après celui consacré à Félicien David
et cet autre aux mélodies de Lalo), s'affirme comme le serviteur de choix de ce
répertoire. Outre la beauté intrinsèque du timbre de baryton, la clarté
exceptionnelle de la diction est un sujet d'émerveillement. Comme l'empathie
avec ces pièces crie l'évidence, là où il faut fuir l'emphase. Le piano de Jeff
Cohen et délicat et souvent spirituel. Leur plus beau fleuron à ce jour. More please !

Jean-Pierre Robert.
Nikolaï MEDTNER : Sonate
en la mineur « Reminiscenza », op.
38 N°1. Sonate en sol mineur op. 22. Sergueï
RACHMANINOV : Variations sur un thème de Chopin,
op. 22. Alexander Paley,
piano. 1CD La Musica : LMU 005. TT.: 77'39.
Belle idée de rapprocher les « deux
frères en Art » (Michel Fleury) que sont Nikolaï Medtner
(1879-1951) et Sergueï Rachmaninov (1873-1943), pianistes virtuoses qui ont
écrit magnifiquement pour leur instrument. Formés tous deux au Conservatoire de
Moscou par Sergueï Taneïev, leur destin devait cependant diverger sur le chemin
de l'exil : Rachmaninov connut le succès que l'on sait aux États-Unis et mena
une brillante carrière internationale. Medtner se
fixa en Angleterre où il ne rencontra pas pareil succès et mena une vie
laborieuse, aidé par son collègue et compatriote. Ce dernier écrivit 14 sonates
pour piano qui chacune raconte une histoire dramatique. Son style narratif très
personnel fait une large place à une rythmique très complexe. La conception
organique de chaque pièce fait que tout procède d'une cellule unique et se
développe dans une stricte cohésion. Ainsi, la sonate op. 38 N°1 « Reminiscenza » comporte trois parties enchainées
illustrant, semble-t-il, la Russie d'une Belle époque balayée par la Révolution
tandis que se fait jour une lueur d'espoir. L'exposition du thème lyrique
conduit à une section emplie de dissonances puis à un développement véhiculant
des accents angoissés et un discours austère avant un retour du lyrisme
initial. La sonate N° 5 op. 22 (1910) est elle aussi d'un seul tenant. Elle
s'ouvre par une introduction tonitruante pour une séquence fortement tendue
faite de grands accords en aplats alternant avec des plages de lyrisme discret
quoique sévère. On passe ensuite à une section extrêmement syncopée et à une
autre de nouveau fortement tendue avec des cascades de notes détachées et des
accords plaqués. La coda pousse le paroxysme encore plus loin, chaque main
semblant lutter avec l'autre, un trait typique de l'écriture pianistique de Medtner. Les Variations sur un thème de Chopin,
op.22 (1903) de Serge Rachmaninov mènent dans un tout autre territoire. Le
thème issu du Prélude en ut mineur op. 28 N° 20 de Chopin est suivi de 22
variations. Celles-ci se développent dans un luxe de couleurs inouï, le thème
étant tourné dans tous les sens et avec un traitement virtuose dont le
compositeur a le secret. Les contrastes abondent et l'interprète les souligne,
en particulier les déferlements sonores qui ressemblent aux cloches du Kremlin
ou aux Dies Irae. Le moldave Alexander Paley offre un
pianisme ne lésinant pas sur un jeu percussif avec
force pédale, et la résonance de son Steinway fait penser à un orgue.

Jean-Pierre Robert.
« Paris joyeux
et triste ». Igor STRAVINSKY: Concerto
« Dumbarton Oaks » (transcription
pour deux pianos de l'auteur). Concerto pour deux
pianos solos. Erik SATIE : Socrate,
drame tiré des Dialogues de Platon (transcription pour deux pianos de
John Cage). Cinéma. Entracte symphonique
du ballet Relâche (transcription pour piano à quatre mains de Darius
Milhaud). Alexei Lubimov,
Slava Poprugin, pianos. 1CD Alpha : Alpha 230. TT.:
77'30.
Le pourquoi de ce disque ? Illustrer le
Paris des années 20/30, un Paris joyeux et triste vu par deux provocateurs,
Igor Stravinsky et Erik Satie car « les mêmes qualités et passions
réunissent les deux compositeurs dans un même élan, dans lequel Diaghilev les a mis avec bonheur : le
théâtre », remarque Alexei Lubimov.
Et l'illustrer au piano, l'instrument riche et polyvalent par excellence. Autre
idée force : impossible de jouer ces œuvres autrement que sur des instruments
de l'époque, un Pleyel de 1920, un Gaveau de 1906 et un Bechtein
de 1909. Alexei Lubimov a
conçu un programme original mêlant des pièces de deux musiciens. Le Concerto
« Dumbarton Oaks » (1938) est ici donné
dans la transcription pour deux pianos de Stravisnky
lui-même ; qui est en fait la version d'origine, l'orchestration n'étant venue
qu'après sur le modèle et la dimension des concertos Brandebourgeois.
Jouée sur un Pleyel de 1920 et un Gaveau de 1906, aux sonorités si différentes,
l'œuvre prend une allure résolument moderniste : rythme endiablé percussif du
tempo giusto, ragtime volubile de l'allegretto, et
rythme déjanté du con moto et de son développement
tout en contrastes, annonçant quelques tournures du Rakes'
Progress. Socrate de Satie (1919), ''drame symphonique basé sur les
Dialogues de Platon'' (1919) est donné ici dans la transcription pour deux pianos réalisée par
John Cage (1944, 1968). Ses trois parties traitent : « Le portrait de
Socrate » offrant une « musique », tout le contraire de l'énergie
stravinskienne, car la sérénité est imperturbable ; « Les bords de l'Ilissus » ou la conversation de Socrate avec Phèdre,
là encore d'un calme sérieux, où l'on décèle un style d'échange ; enfin
« La mort de Socrate » libérant un certain hiératisme mais aussi une
idée de bonté, celle exprimée par le philosophe à l'heure de la fin. On y
perçoit aussi l'écume du discours aux disciples réunis autour du maître, ses
beaux moments de douceur, ses accès de joie, la résignation aussi,
l'affirmation véhémente ou l'abandon, alors que la fin sonne comme un glas.
Musique objective, certes, mais loin d'être détachée, en phase avec son
contexte littéraire. Le Concerto pour deux pianos solo de Stravinsky
(1935) est de plus vastes dimensions que le concerto précédent, et de style
néoclassique. Le con moto est de stricte forme sonate
et ses notes répétées introduisent un sentiment de fébrilité. Les traits en
fusées laissent place à des répits de brève durée. Les duettistes Lubimov et Poprugin sont d'une
folle agilité, maitrisant ces rythmes si changeants. Le « Notturno », adagietto,
invente d'autres rythmes avec des trilles rageurs et sa façon de marche,
typique chez Stravinsky. Le discours musarde de chaque côté avec moult
enjolivements. « Quatro varazioni »
forme le sujet du mouvement suivant : clair dialogue des deux protagonistes,
empoignades furieuses, guirlande de pirouettes sur des rythmes asymétriques et
un crescendo puissant, enfin manière plus sévère dans la dernière séquence. Le
finale « Preludio e fuga »
démontre l'inventivité d'écriture dont le compositeur russe a le secret, le
mouvement se développant en vitesse et en intensité. L'interprétation d'Alexei Lubimov et de Slava Poprugin est époustouflante. Cinéma de Satie,
extrait du ballet Relâche (1924) est joué dans la transcription pour
piano à quatre mains que Darius Milhaud a réalisée en
1925, en hommage à son ami récemment disparu. La pièce est jouée sur un piano Bechtein de 1909, préparé par Lubimov
: quelque chose de mécanique tout à fait intéressant, dégageant une couleur
presque orchestrale eu égard au dur martèlement des cordes et autres effets de
bruitage. On entend presque fugitivement du Stravinsky dans cette atmosphère
débridée de kermesse. Les diverses séquences sont adroitement combinées, tel le
roulement de marche funèbre ponctuée de ce qui ressemble à de la percussion. Ou
à travers toutes autres inspirations plus ou moins cocasses et leur rythmique
affolée. Lubimov et Poprugin
nous passionnent et leurs instruments ne le sont pas pour peu. Un must.

Jean-Pierre
Robert.
Johann
Caspar Ferdinand
FISCHER : Uranie.
Elisabeth Joyé, clavecin & orgue. 1 CD
Encelade : ECL 1402. TT : 66'44.
Voilà encore un merveilleux opus proposé
par le label Encelade, grand défenseur de la musique baroque. Un album d'une
rare qualité musicale tant dans le choix des œuvres que dans l'interprétation
que nous en donne Elisabeth Joyé, au clavecin comme à l'orgue. On connait peu
de chose sur le compositeur Johann Caspar Ferdinand
Fischer, né en Bohême en 1656, il fut nommé maitre de chapelle de la cour de
Saxe-Brandebourg et entra au service du margrave de Bade-Bade
dont il rejoignit la résidence princière de Rastatt en 1715, il y restera
maitre de chapelle jusqu'à sa mort en 1746. Son œuvre apparait considérable,
tant en volume (musique profane pour clavier, musique religieuse, œuvres
orchestrales et opéras aujourd'hui perdus…) que par les influences musicales
françaises et allemandes dont il parvient à faire la synthèse dans le style
germanique, enfin par le rôle de précurseur qu'il jouera dans la recherche sur
la manière de bien « tempérer »
l'accord des instruments à clavier, précédant en cela J. S. Bach. Les
œuvres présentées dans cet enregistrement sont empruntées à quatre volumes. Le Musicalischer Parnassus (Clio,
Calliope, Melpomène, Thalia, Erato, Euterpe, Terpsichore, Polymnie et Uranie)
dont l'album tire son nom, composé vers 1736, est un recueil pour clavecin
regroupant neuf suites de danse dans le goût français, chacune dédiée à une
muse du Parnasse. Également dans la
tradition française, composé en 1696 pour la princesse Françoise Sibylle
Auguste, épouse du margrave, en est-il du Musicalische Blumen-Büschlein.
Composées vers 1700, pour l'orgue, Blumen Strauss et Ariadne Musica relèvent plus du style germanique
proposant plusieurs cycles de Préludes et Fugues, témoignant de la science
contrapuntique de Fischer. Un magnifique programme où Elisabeth Joyé nous éblouit par sa manière si chantante et si
élégante de toucher le clavecin et l'orgue. Une découverte à ne pas manquer et
un véritable coup de cœur !

Patrice Imbaud.
« Voyage
mélodique ». Pièces de Franz SCHUBERT, Felix
MENDELSSOHN, Frédéric CHOPIN, robert SCHUMANN. Serge RACHMANINOV,
Georges GERSHWIN. Vittorio Forte, piano. 1 CD LYRINX :
LYR 2296. TT : 64'53.
Un disque qui chante et qui nous enchante
que ce dernier enregistrement discographique du pianiste italien Vittorio Forte
pour le label Lyrinx. Un pianiste qui se fait rare
sur les scènes françaises, que nous avons eu le plaisir d'entendre récemment à
l'Institut Goethe de Paris dans le cadre de la série « Classique en
Suites » où il présentait dans un court récital son nouvel album intitulé
« Voyage mélodique » quatrième CD d'une discographie unanimement
reconnue par la critique et le public. Un disque d'une grande humanité, comme
un vibrant hommage aux compositeurs, aux poètes et aux transcripteurs de génie
que sont Franz Liszt et Earl Wild. Rien à jeter dans cet enregistrement habité
de bout en bout d'une intense poésie, une interprétation qui sonne constamment
juste, sans maniérisme, que ce soit dans Schubert ( Frühlingsglaube, Auf dem wasser zu
singen, Gretchen am Spinnrade, Die Forelle) dans
Mendelssohn (Auf Flügeln des Gesanges, Reiselied, Suleika) dans Chopin (Mädchen Wunsch, Meine Freunden). Ou encore dans Schumann (Frühlingsnacht, Widmung),
dans des transcriptions de Liszt qui, loin de la paraphrase, reste ici au plus
près du texte pour l'enrichir en restant toujours dans l'esprit de l'œuvre pour
la magnifier dans la forme comme dans son contenu émotionnel. Earl Wild, quant
à lui, transcrit avec une science digne du maitre les œuvres de Rachmaninov (Oh Cease thy Singing, Midsummer
Nights, Vocalise) et de Gershwin (Summertime, The Man I Love, Embraceable
You). Des œuvres toutes célébrissimes qui jalonnent un voyage intime, une
confession où le pianiste se livre avec une sincérité désarmante. Une émotion
intense mais sans pathos parcourt ce disque pour un moment de partage avec
l'auditeur dans une communion fervente. On se réjouit, en outre, de la belle
sonorité du Steinway, bien différente de la sonorité trop mate du Blüthner du Goethe Institut. Un grand moment de piano, du
grand art ! Succès assuré ! Un pianiste à ne pas manquer.

Patrice Imbaud.
Béla
BARTÓK. 44 Duos pour deux
violons. Sarah & Deborah Nemtanu,
violons. 1 CD Decca : 478 8959. TT : 48'11.
Ces 44 duos pour deux violons furent
composés en 1931 par Béla Bartók, sur la demande d'Erich Dolfein,
éminent pédagogue qui préparait alors une méthode de violon se focalisant sur
le jeu en duo. Un corpus à visée didactique regroupant en quatre cahiers,
quarante quatre miniatures, véritables haïkus musicaux, s'appuyant sur des
chants et danses folkloriques empruntés aux différents pays d'Europe orientale,
Hongrie, Roumanie, Slovaquie, Serbie, Ruthénie, Ukraine et même lointaine Arabie…
Mais qu'on ne s'y trompe pas, il s'agit là, comme souvent chez Bartók, d'une
musique d'une étonnante modernité où se mêlent le document ethnomusicologique
et l'invention créatrice comme en témoignent l'éventail des sonorités, la
richesse du langage harmonique, les dissonances nombreuses et les rythmes non
conventionnels. Un langage donc spécifiquement bartokien conçu pour libérer
l'imagination musicale de l'élève et, aujourd'hui, celle de l'auditeur… Bon
sang ne saurait mentir, l'interprétation des sœurs Nemtanu,
d'origine roumaine, habituées à jouer ensemble ces duos depuis leur petite
enfance, ne souffre ici d'aucun reproche, dépassant le cadre pédagogique pour
donner à cette musique toute ses capacités d'évocation et de mémoire, sa
poésie, ainsi que ses couleurs vives ou diaphanes, cet accent un peu
Mitteleuropa, qui participent de leur envoûtement. Superbe !

Patrice Imbaud.
Philip
GLASS. Glassworlds 1, 2 et 3.
Nicolas Horvath, piano. 3 CDs Grand Piano : GP 677, GP 690, GP 691.
TT : 79' + 83'25 + 77 '04.
Une actualité débordante semble concerner
le compositeur américain Philip Glass en ce début d'année 2016, la création
française de son Concerto pour deux
pianos par les sœurs Katia et Marielle Labèque à
la Philharmonie de Paris (Voir la recension de ce concert dans la rubrique
« l'Oeil Ecoute ») et la sortie sous le
label Grand Piano du troisième volume d'un corpus regroupant des œuvres pour
piano solo, originales et transcriptions, interprétées par le talentueux
pianiste Nicolas Horvath. Reconnu comme un compositeur contemporain majeur chef
de file, avec Steve Reich et Terry Riley, du courant musical dit minimaliste,
Philip Glass, né en 1937 est un des fondateurs de la musique minimaliste
répétitive dont il semble s'être éloigné ces dernières années, depuis Music in Twelve
Parts (1974), pour revenir dans une mouvance plus classique inspirée des
grands maîtres. Son catalogue très impressionnant comprend nombre d'opéras,
symphonies, concertos, musique de films, des œuvres pour solistes et musique de
chambre. Compte-tenu des nombreuses et très variées influences, classiques,
musique indienne et modern jazz, accumulées au long des années par le
compositeur, il est difficile de donner une origine univoque au courant
minimaliste. Il semble trouver ses sources chez Schoenberg d'après Glass
lui-même, mais s'oppose au dodécaphonisme. En réaction contre l'abstraction
sérielle, il constitue plutôt un genre intermédiaire entre les styles savants
et les productions de masse qui conduiront plus tard vers la « house
music » et autres supports musicaux
servant à l'auto excitation artificielle et frénétique des « ravers ». Le caractère léger du minimalisme, malgré
l'habileté du compositeur a souvent été critiqué pour son impossibilité à
atteindre le génie de la grande variation romantique ou post romantique, car
peut-être la nature même, plus logique, de la musique répétitive ferme t-elle la porte à une certaine altérité intuitive reconnue
comme créatrice… Une probable impasse dont l'évolution du compositeur porte témoignage.
Le principe compositionnel est celui de « structures répétitives avec des
relations de hauteurs très réduites, un ferme battement de croches et un niveau
statique-dynamique » aboutissant à une écoute qui n'anticipe ni ne mémorise,
mais qui vit dans l'immédiateté. Au-delà de ces considérations musicologiques,
sans doute un peu vaines, et de la place qu'il faut accorder à cette musique
particulière dans la grande histoire de la Musique, peut être faut-il
simplement goûter le plaisir et la beauté ressenties à l'écoute de ces trois
albums, un peu comme un « voyage à
travers une œuvre qui ne laisse pas indifférent, une impression nocturne de
flotter sur des eaux tranquilles d'un lac, sous un ciel étoilé… »
(Nicolas Horvath).
![]()

Philip Glass
/ DR
Le premier album proposé par Nicolas
Horvath, Glassworlds 1, nous donne à
entendre des œuvres originales et des transcriptions d'opéras. Opening (1981)
exemple de ce qui pourrait être dénommé le style classique de Glass,
emblématique du compositeur. La Suite
d'Orphée pour piano (2000), dans une transcription de Paul Barnes, est
extraite de l'opéra Orphée, premier
volet de la trilogie Cocteau du compositeur (Orphée, La Belle et la Bête et
Les Enfants terribles) et comprend plusieurs mouvements aux climats différents,
rappelant pour certains Satie et le ragtime, mêlés de lyrisme, de douleur
menaçante, de visions cauchemardesques,
d'amour impossible, de mélodies éthérées pour d'autres…Dreaming Awake (2003) marie l'atmosphère d'Opening et la
virtuosité des Études pour piano
qu'on retrouvera en intégralité dans le
deuxième album. Enfin How Now (1968) conclut ce premier disque dans une ambiance
hypnotique. Si certains esprits critiques se plairont à souligner la faiblesse
compositionnelle de ces pièces, nul ne pourra mettre en doute la magie de
l'interprétation de Nicolas Horvath qui nous avait déjà séduit
avec son dernier enregistrement lisztien. Rigueur dans la progression
rythmique, virtuosité et délicatesse du toucher, poésie de la ligne tout y est
pour affirmer haut et fort la profonde affinité existant entre le pianiste et
le compositeur américain. Une merveilleuse façon d'entrer dans le monde si
particulier de Philip Glass.

Le deuxième album est consacré en totalité
aux Études pour piano, vingt études
réparties en deux livres, composées entre 1991 et 2012. Des études témoignant
de la singularité de la composition glassienne,
mâtinée d'un lyrisme et d'un romantisme parfois un peu sirupeux, mais
témoignant de l'évolution musicale du compositeur américain sur une période de
vingt ans. Deux livres de dix études chacun aux accents autobiographiques où le
piano constitue le médium favori entre Philip Glass et son public, dans une
sorte de confession intimiste. Un cycle polymorphe, véritable climax dans les
compositions pour piano solo de Glass. Une musique peut-être un peu facilement
accrocheuse dont on ne peut, toutefois, nier le charme, la poésie, la capacité
de séduction et le plaisir d'écoute où se mêlent intimement mélodie et flux.
Nicolas Horvath, éminent spécialiste de Glass, donna la première création
mondiale de l'intégrale de ce cycle à Carnegie Hall en janvier 2015, un
marathon pianistique, une expérience sans doute unique que l'on retrouve dans
cet enregistrement enchainant les vingt études dans un flux continu nous
plongeant dans le monde mouvant et tourmenté du compositeur américain. Un cycle reconnu comme une des pages les plus belles et les
plus inventives de Glass, « premier
corpus où je convie pleinement le monde des pianistes dans le mien »
déclare le compositeur….

Le troisième album de ce début d'intégrale
des œuvres pour piano solo de Philip Glass entreprise par le pianiste Nicolas
Horvath est intitulé Metamorphosis. Métamorphose, un maître mot dans
l'univers compositionnel de Philip Glass, comme dans celui du pianiste puisque
s'appliquant à la composition comme à l'interprétation, changement de forme et
de structure si important que l'être ou la chose qui en est l'objet n'est plus
reconnaissable. Un procédé bien connu en musique utilisé comme fil directeur dans cet enregistrement. Un
programme comme un « melting pot », un
retour dans le temps remontant jusqu'aux années de formation du compositeur à
la Juilliard School. Metamorphosis (1988) constitue indiscutablement un
tout, même si les différentes sections n'ont pas été composées dans le même
but. The Olympian
(1984), pièce écrite initialement pour fanfare à l'occasion des JO de Los
Angeles, est une sorte de chant à la gloire de la fraternité des hommes. La Trilogy Sonata nous
propose des transcriptions pour piano de Paul Barnes (2000) de trois opéras de
la trilogie des portraits (Einstein, Gandhi et Pharaon Akhenaton) de Glass (Einstein on the Beach, Satyagraha et Akhnaten). Coda (1980), issue de The Late, Greay Johny Ace, s'élève comme une complainte élégiaque
à la mémoire du chanteur Johny Ace, de John Kennedy et de John Lennon. Two Pages (1968) et Secret solo (1977) traduisent l'influence de la musique indienne et
de Ravi Shankar dans la musique de Philip Glass, tandis que la Piano
Sonatina n° 2 (1959) clôt ce superbe album sur un
aperçu surprenant du « Glass avant
Glass ».
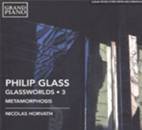
En bref, et quoi qu'on puisse penser de la
valeur musicale en soi des compositions de Philip Glass, et au-delà de la
musique minimaliste, voilà assurément trois albums admirables, magnifiés par
l'éblouissante interprétation de Nicolas Horvath. Un challenge pianistique qui
nous ouvre dans des conditions optimales le monde sonore si particulier du
compositeur américain. A découvrir absolument !
Patrice Imbaud.
« Sérénade ». Œuvres de Paul HINDEMITH, Ernst TOCH, Darius MILHAUD, Igor STRAVINSKY,
Jacques DE LA PRESLE. Quatuor Calidore. 1 CD HORTUS 714. Collection « Les Musiciens
et la Grande Guerre. Vol XIV ». TT : 66'50.
En cette année 2016 célébrant le centenaire
de la bataille de Verdun, le label Hortus poursuit
son ambitieuse et passionnante collection consacré aux « Musiciens et la
Grande Guerre » avec la parution récente de trois nouveaux volumes.
Formidable collection qui nous permettra d'écouter de 2014 à 2018 pas moins de
30 albums portant témoignage musical de ce que fut le vécu de ces musiciens
touchés de prés ou de loin par les horreurs de la Grande Guerre. Une anthologie
sonore sans précédent d'œuvres composées pendant le conflit, sur le front ou à
l'arrière de celui-ci, avant ou après l'Armistice, des œuvres et des musiciens
connus, d'autres moins, des compositions parfois inédites, un très beau
corpus comme une base patrimoniale
diversifiée et cohérente offrant un panorama représentatif de la création
musicale des nations impliquées dans le conflit.
Ce volume Sérénade, regroupe des compositions pour quatuor à cordes. Le
grandiose et très moderne Quatuor à
cordes N ° 4 de Paul Hindemith, violent et sarcastique, expressionniste par
sa sauvagerie et ses dissonances, mais aussi lyrique par sa ligne mélodique
centrale, une œuvre ambiguë mêlant une âpre désolation à une insouciance
parfois enfantine. Les Trois pièces
de Stravinsky rompent radicalement le caractère dialogique du
quatuor, homophoniques ou totalement indépendantes, leur structure
s'appuyant sur la répétitivité des motifs. La Suite en sol pour quatuor de Jacques de la Presles, élégante,
simple et émouvante, très française dans sa facture, parait d'autant plus
surprenante qu'elle fut écrite sous les bombes. La Sérénade pour 2 violons et alto d'Ernst Toch
est une œuvre inconnue d'un compositeur inconnu qui fut plus tard condamné à
l'exil par le régime nazi, « le plus radicalement oublié du monde
entier ». Aussi faut-il en apprécier, ici, l'enregistrement attestant de
sa science compositionnelle très contrastée associant un lyrisme bucolique
exalté et une étrange dislocation tonale. Enfin le Quatuor n° 4 de Darius
Milhaud est surtout marqué par la polytonalité de son écriture, la désolation
et l'urgence de son climat. Un disque magnifique dans sa conception, une
interprétation superbe et habitée du quatuor américain Calidore
dans sa réalisation ! Indispensable !

Patrice Imbaud.
« A nos
morts ignorés ».
Compositions de Georges ANTOINE, Lili &
Nadia BOULANGER, André CAPLET, Claude DEBUSSY, Reynaldo
HAHN, Fernand HALPHEN, Ivo GURNEY, Albert ROUSSEL, Rudi STEPHAN. Marc Mauillon, baryton, Anne Le Bozec,
piano. 1 CD HORTUS 715. Collection « Les Musiciens et la Grande Guerre.
Vol XV ». TT : 76'26.
Le label Hortus
confie de nouveau, après le Vol IV, au
duo constitué par Marc Mauillon et Anne Le Bozec, la charge de nous interpréter ces douloureuses
mélodies de la Grande Guerre. Ce qui
frappe d'emblée, dès la première écoute, est la justesse de ton de cette
interprétation, sincère, sans grandiloquence, sans dramatisme excessif, où
affleure parfois une certaine solennité respectueuse. Un album qui tire tout
son intérêt de la diversité des climats sous tendus par ces mélodies pour
l'essentiel françaises, mais aussi anglaises, allemandes ou belges, dans un
œcuménisme aujourd'hui plutôt rassurant. La prestation vocale du baryton Marc Mauillon est tout à fait digne d'éloges par la qualité de
sa diction, sa projection et sa facilité vocales capables de s'adapter aux
différentes prosodies, son timbre clair et l'exactitude de son interprétation,
parfaitement soutenue par le piano d'Anne Le Bozec.
Des mélodies traitant de l'amour, de la séparation et de la mort, qui seront
pour beaucoup une découverte, revêtues ici d'un éclairage particulier fait le
plus souvent d'une indicible nostalgie, d'une intense détresse, mais aussi
parfois d'une touche d'humour bien venu. Déprimés, s'abstenir !

Patrice Imbaud.
« Verdun,
feuillets de guerre ». Chants de Gabriel PIERNÉ,
Paul LADMIRAULT. Jacques DE LA PRESLES, Henry FÉVRIER, Reynaldo
HAHN, André CAPLET, Pierre VELLONES, Alfred BRUNEAU, Jacques PILLOIS, Vincent
SCOTTO, Fernand HALPHEN. Françoise Masset, soprano,
Anne Le Bozec, piano. 1 CD HORTUS 716. Collection
« Les Musiciens et la Grande Guerre. Vol XVI ». TT : 67'56.
Si Anne Le Bozec
reste l'indiscutable pianiste de cette très belle collection initiée depuis
2014 par le label Hortus, Françoise Masset, soprano, après avoir récemment chanté Verlaine pour
ce même label (Les Donneurs de sérénades.
HORTUS 124) prête aujourd'hui sa voix à l'interprétation de ces mélodies
françaises tout particulièrement centrées sur la bataille de Verdun dont on
célèbre cette année le centenaire. Un florilège de mélodies dont nombre encore
inédites au disque, composées le plus souvent sur le front, qui constituent le
reflet sonore et affectif de cet épisode crucial de la première guerre
mondiale. Là encore différents climats, patriotique, populaire, élégant,
savant, humoristique, angoissé, nostalgique ou désolé, en fonction des
compositeurs et des poètes, parfaitement rendus par l'admirable interprétation
de Françoise Masset. Diction claire et vocalité
facile, justesse de ton, accompagnement pianistique superlatif, riche en
couleurs, tout concourt à faire de cet album un magnifique hommage aux
combattants et aux musiciens de la Grande Guerre, un disque qui complètera,
peut-être de façon plus variée et moins
pesante, le précédent opus de Marc Mauillon. Une
superbe manière d'entretenir la mémoire…Probablement le plus bel album de cette
collection
.

Patrice Imbaud.
« Amerikas ! »
Ensemble Percu Duo. Philippe Limoge, vibraphone &
Damien Petitjean, marimba. 1 CD Polymnie : POL
204114. TT : 60'.
Un disque pour le moins insolite, qui
mélange les genres, combine et exalte
les sonorités dans un détonant duo entre vibraphone et marimba. Un album non
dénué de charme qui déclenchera assurément des réactions et avis partagés…Un
programme associant des œuvres célèbres comme West Side Story de Bernstein et Porgy and Bess de
Gershwin et d'autres moins connues comme Levante d'Osvaldo Golijov
(compositeur argentin, d'origine juive, né en 1960), Gamelocity de David P. Jones (compositeur
américain, né en 1958) Vals Venezolano de Paquito D'Rivera (clarinettiste et
saxophoniste cubain, né en 1948) spécialiste du Latin jazz. Un enregistrement
qui regroupe des transcriptions et une œuvre originale (Gamelocity) dont l'intérêt tient
surtout à l'important travail sur les timbres instrumentaux, à la complicité
éprouvée des musiciens et au choix judicieux des œuvres nous proposant un
voyage aux Amériques aux accents de jazz, de salsa et de grands classiques dont
les refrains sont dans toutes les mémoires…Une invitation au voyage, une
curiosité, à écouter assurément ! On regrettera toutefois l'absence de
livret tant la connaissance peut parfois enrichir l'écoute…

Patrice Imbaud.
« Bel canto amore mio ».
Ouvertures de Vincenzo BELLINI, Gaetano DONIZETTI, Giacomo MEYERBEER, Saverio MERCADANTE, Gioachino
ROSSINI. Orchestre national d'Île-de -France, dir.
Enrique Mazzola. 1CD NoMadMusic
: TT.: 57'.
« Ce que je préfère à l'Opéra, c'est
le lustre ». Baudelaire n'omettait jamais dans ses écrits d'adopter la
posture iconoclaste, ironique, provocatrice, moderne somme toute, en révolte
constante contre la pensée unique du Second Empire autoritaire et bourgeois. De
même, qu'on a le droit dans Wagner de préférer l'orchestre aux voix (quand ce
n'est pas Margaret Price qui chante Isolde), on peut retrouver le chant dans
les trouvailles orchestrales des maîtres du bel
canto italien. Le pari réussi de Enrique Mazzola,
quant à lui, et de l'Orchestre national d'Île-de-France dont il est directeur
musical depuis 2012, est de rendre hommage au bel canto italien à travers un enregistrement symphonique,
rassemblant des « tubes » de l'ouverture d'opéra italien (Le Barbier de Séville ou Tancrède de Rossini, Les Capulets et les Montaigus
de Bellini, Don Pasquale
de Donizetti) et des perles rares (Roberto
Devereux de Donizetti, Ugo Comte de Paris de Donizetti, Marguerite d'Anjou de Meyerbeer,
compositeur allemand mais qui a toute sa place au cœur du bel canto italien, Emma d'Antiochia de
Mercadante).
Pas de voix humaine donc, mais celle, tout
aussi chantante, des solistes de l'ONDIF réunis au pays du bel canto, en très grande forme (tempi, équilibres, style),
entraînés par le dynamisme et l'enthousiasme qui caractérisent le jeune chef
italien. L'ouverture est en quelque sorte le résumé de l'action. Elle donne le
ton. Elle ouvre aux grands thèmes de l'opéra. « L'enregistrement est un
recueil d'ouvertures car c'est le vrai moment de rencontre entre l'opéra et
l'orchestre symphonique ; il n'y a pas de voix. C'est un moment important
de l'action, l'instant où le compositeur prépare le public au drame ou à la
comédie qui va se dérouler sous ses yeux », écrit le chef dans le livret
du CD.
Visuellement, pendant ces quelques minutes
d'écoute, de temps ramassé, condensé, contracté, on peut admirer, à l'instar de
Baudelaire, le lustre, les cariatides (quand on est dans une salle à
l'italienne), le rideau (quand c'est celui de l'Opéra de Paris ou des opéras
traditionnels de région, de l'Opéra Comique, du Châtelet…). C'est souvent
préférable pour l'imagination et le rêve, aux quelques bribes de ballet ou de
pantomime souvent décevantes ajoutées artificiellement par le metteur en scène.
C'est en effet un des rares moments de liberté visuelle pour
l'auditeur-spectateur.
On retrouve dans l'interprétation de Mazzola cette liberté retrouvée, au-delà des versions
d'anthologie (Abbado pour Rossini notamment) et des enregistrements
d'ouvertures un peu trop policées (Karajan). Ici, comme le demande le chef (on
salue la dernière plage du CD consacré à quelques minutes de répétition du Barbier de Séville où le « buon umore » de travail et la parfaite entente entre le
chef et les musiciens sont palpables), on trouve le juste équilibre, la limite,
entre le « style noble » et le caractère de « banda » (fanfare) populaire si
typique de ces ouvertures, qui doivent être pour tout public (savant ou
populaire) une « captatio benevolenziae » saisissante pour tenir celui-ci en
haleine plusieurs heures durant. Le chef n'édulcore pas les batteries qui nous
rapprochent de la fosse d'orchestre et transcrit de façon assez magique
l'acoustique de la salle à l'italienne où le son se répand du parterre aux
galeries et aux loges. On apprécie les passages de franche affirmation des
percussions et de l'harmonie, qui nous évoquent le superbe « Fratelli d'Italia »,
un des plus beaux hymnes nationaux, car le plus opératique.

Jérôme Bloch.
***
MUSIQUE ET CINEMA
ENTRETIEN
Christophe
La Pinta : « J'aime les mélanges électriques »
Dans son studio à Montmartre, assis sur un
fauteuil de l'ancien et mythique Olympia, entouré des affiches de « La
Chance de ma Vie », « Prêt à Tout » de Nicolas Cuche, « Sans Laisser de Trace » de Grégoire
Vigneron… j'ai écouté Christophe La Pinta parler de ses rapports entre musique
et image d'une manière très décontractée…moteur !

DR
Alors
l'actualité !
Beaucoup des séries télé, une série
médicale sur F2 qui s'appelle « Nina ». C'est la deuxième saison,
c'est une série un peu girly, pour les filles, qui
marche plutôt bien. J'avais déjà composé la musique pour la première saison, du
générique début à la fin.
Pour les séries,
avez-vous assez de temps pour écrire ?
Non, pas assez. On a vingt jours pour
écrire trente minutes de musique ! On a intérêt à être équipé et trouver
rapidement un thème, une couleur musicale, une illustration ; c'est une bonne
école pour souvent faire le pompier sur un long métrage !
Comment
êtes-vous arrivé sur cette série ? On vous connaissait déjà à la télé ?
Laurence
Bachman, la productrice, me connaissait.
Et comment
vous-avait-elle connu ?
Je l'ai connue quand elle travaillait chez
Ellipse, la boîte de canal Plus. J'avais fait une série qui s'appelait
« Sauvetage », une série avec des hélicoptères qui sauvaient des
gens…
Vous avez
énormément travaillé pour la télévision !
Beaucoup,
beaucoup…
Est-ce par ce biais
que vous êtes entré dans la musique pour l'image ?
Oui, par la télévision, par Jacques Malaterre qui m'a repéré et qui m'a donné ma chance sur des
petits films pour Marin Karmitz. On avait fait des
modules, pour les Droits de l'Homme.
Et Jacques Malaterre, comment l'aviez connu ?
Par un mixeur. En fait, lorsque je suis
arrivé à Paris, j'ai galéré comme tout le monde, je voulais faire
principalement de la musique de film, je viens de la musique de théâtre
universitaire. Il y avait une émission qui s'appelait Fréquence Star à l'époque
et Dieudonné y était interviewé. Il faisait ses sketches avec Semoun, et il disait « j'ai envie de travailler avec
des jeunes, je monte une boîte, j'ai envie de faire des tas de trucs ». Je
lui ai envoyé une cassette de la musique que j'avais écrite pour une série
américaine « New York Police Blues ». J'avais gagné un concours, je
suis parti travailler à Los Angeles avec Mike Post, le compositeur de
« Magnum », « Agence Tous Risques », etc..etc, J'ai
appris mon métier avec lui. En revenant en France je pensais que cela
m'aiderait, mais tout le monde s'en foutait, sauf Dieudonné, et il m'a demandé
de faire les covers des musiques pour la vidéo d'un
spectacle qu'il avait joué avec Elie, « Élie et Dieudonné en garde à vue ». J'ai fait
cela en dix jours, dans un petit studio et c'est là que j'ai rencontré le
mixeur Ludovic Maucui qui travaillait avec Jacques Malaterre. Jacques, je l'ai harcelé et on a fait cette
série, puis d'autres séries comme « Boulevard du Palais ».
Faire de la télé en France
n'est-ce pas antinomique avec le cinéma ?
Les gens du cinéma n'aiment effectivement pas les
compositeurs de la télé. Mon agent a eu beaucoup de mal à me vendre auprès des
producteurs de films ! J'avais une étiquette collée, j'avais les mains
sales en quelque sorte ! C'est comme les comédiens. Quand des producteurs
de cinéma ont bien voulu écouter ma musique, c'était que de la musique de
télé ! Comme si composer de la musique c'était différent ! Il y a
plus de moyens au cinéma, mais on écrit de la même manière. Je me suis très
vite équipé pour avoir un son assez large pour faire des musiques avec une plus
grande ampleur, mais il a fallu se battre pour simplement participer aux appels
d'offre ! Encore aujourd'hui on me reproche d'avoir fait beaucoup de
téléfilms. Je leur réponds : « si vous m'appelez, c'est que ma
musique vous plaît, non ! Et vous me proposez un tarif qui est celui d'un
téléfilm !»
Il a toujours autant de problèmes
pour la rémunération de la musique ?
C'est catastrophique ! C'est la misère totale,
il n'y a pas d'argent ! Ce un truc qui ne les
intéresse pas. La France ce n'est pas la culture de la musique, ce sont les
belles lettres, des bons mots, des auteurs. Le troisième auteur du film, le
compositeur, n'est pas considéré, c'est affligeant !
Quelle a été la musique qui a
déclenché votre carrière ?
Le déclencheur a été la série « David Nolande » créée par Joël Houssin, le renouveau du fantastique sur
F2, et avec un réalisateur qui s'appelle Nicolas
Cuche. Moi, je me suis beaucoup amusé à composer la musique parce que nous étions totalement
libres. Il fallait inventer, passer de la musique classique à l'électronique,
avec des climats originaux. Il n'y avait pas de place pour ce genre de
composition dans les autres téléfilms, ou des séries. Il y avait de longues
plages de musiques, elles pouvaient exister. Tout d'un coup les gens se sont
mis à écouter ma musique, et j'ai eu beaucoup de propositions. Cela a été un
déclencheur émotionnel, la musique était mixée convenablement.
Quels sont vos contacts avec les
réalisateurs avec qui vous avez travaillé ?
Les réalisateurs viennent vous voir parce qu'ils
ont entendu des musiques, parce qu'ils ont suivi votre évolution. Un bon
réalisateur c'est celui qui va aimer votre style, et qui va oser dire
« j'ai entendu ce que tu fais, ce n'est pas ce que je cherche, mais par
contre je sais que tu sais composer ». Les réalisateurs qui pensent
entendre ce qu'ils veulent dans vos précédentes musiques, çà n'a aucun intérêt.
Mieux vaut ne pas travailler avec eux. Faire des covers
de ses propres musiques c'est totalement idiot !
Vous avez
composé dans tous les styles, de la comédie au mélo en passant par le
fantastique et le polar : est-ce que vous écrivez-tout ou avez-vous des
arrangeurs ?
J'écris tout, directement sur l'ordinateur, comme
une partition, puis ensuite j'ajoute des sons que j'arrange moi-même. Et selon
les budgets on enregistre des vrais instruments. Quand je fais des cordes, des
orchestrations, je fais appel à Cyrille Aufort.
Avez-vous travaillé avec lui en
duo ?
Oui, une fois sur un film où c'était très
compliqué. J'ai écrit le thème et il a fait l'arrangement et l'orchestration,
c'était une co-signature !
Êtes -vous du genre ''thème et
variations'', puis à assaisonner de nappes électroniques ?
J'aime les mélanges électriques, faire entrer les
instruments de manière rythmique, les sortir de leur tempérament, pour les
mettre dans un milieu urbain, trouver des timbres un peu particulier. Comme
Thomas Newman par exemple, qui va mettre une flûte indienne sur la musique de « Revolutionary
Road » (Les Noces Rebelles) le film avec di Caprio.
Cela fonctionne bien, même si on peut se demander ce que cela vient faire
là ! J'aime les mélanges, et l'électronique nous permet de les faire.
Vous aimez les musiques de films,
alors quand vous étiez môme qu'écoutiez-vous ?
On
avait le vinyle d' « Il Était une Fois dans l'Ouest », la
pochette était intrigante avec cet arc de cercle, la cloche et le pendu.
J'étais impressionné et bien sûr je n'avais pas vu le film. J'adorais la
musique avec les guitares électriques, les codes et l'harmonica.
Aviez-vous un orchestre lorsque
vous étiez jeune homme ?
Oui, un orchestre de variétés, j'étais batteur,
j'ai fait en même temps mes études au conservatoire en classe de percussion.
Pendant longtemps j'ai joué dans des orchestres de rock, de variétés.
C'était une bonne école ?
Oui, il fallait aller vite, apprendre le morceau de
l'été pour faire un cover. On va dans des endroits où
les gens vous attendent depuis des mois pour les faire danser...
Vous n'êtes pas parisien ?
Non, je
suis de Toulon où j'ai fait le conservatoire, puis ensuite à Nice.
Alors,
« L'Affaire SK1 », qui est sorti dernièrement, a été important pour vous? Comment Frédéric Tellier vous a-t-il
trouvé ?
Par son ex petite amie qui jouait dans « David
Nolande ». Il cherchait un compositeur pour une
série qui s'appelle « Un flic » et on s'est rencontré, et ça a bien
marché. Il vient de la télé et a été le directeur artistique d'Olivier Marchal.
Il s'est passionné pour cette histoire parce qu'il a eu une amie qui a été
concernée par cette affaire. On a fait les « Hommes de l'Ombre » pour
F2 avec Nathalie Baye. Il est musicien et il a fait des propositions concrètes
sur un ou deux thèmes, c'est pourquoi on a cosigné la musique.
Que vous a-t-il demandé de
particulier ?
C'est une histoire vraie, avec Guy Georges en
prison et les familles des victimes toujours présentes. Je me suis documenté,
j'ai lu des livres, vu des documentaires. Frédéric a été très proche des flics
qui ont participé à cette affaire ; c'est un univers qu'il connaît bien. A
partir de là on est entré dans cette histoire par la porte de l'affectif. Ce
sont des gens qui ont été meurtris par cette histoire.
Sur le CD qui a été édité chez Crystal Records
on peut lire ce qu'a écrit Frédéric Tellier : « Nous souhaitons
dédier cette musique aux victimes, Pascale, Cathy, Elsa, Agnès, Hélène, Magali,
Estelle, ainsi qu'à leurs familles. Que cette musique les accompagne de la
douceur de ses notes et de l'émotion de nos pensées »
Oui Frédéric ne voulait pas trahir la mémoire des
filles assassinées, ni magnifier les flics qui ont travaillé pendant 7 ans. Les
familles lui on fait confiance et il a pu mettre les vraies noms des jeunes
filles. Pour moi, quand j'ai vu le premier montage, j'ai été très ému et j'ai
dit à Fred : je ne vois pas où tu peux mettre de la musique. Je lui ai demandé
de venir pendant deux semaines au studio pour qu'on travaille ensemble, pour ne
pas mettre une note de trop, et j'ai fait les arrangements des thèmes qu'il
avait joués au piano.
Souvent
dans ce genre de film on met du jazz. C'est une musique souvent associée au
film policier, au film noir. Vous, vous m'avez dit hors enregistrement que vous
n'aimez pas cette musique. Pouvez-vous m'en dire un peu plus ?
Cela ne m'aurait pas effleuré un instant ! Il
y a très peu de réalisateur de quarante ans qui aiment cette
musique ! Je ne supporte que le
jazz vocal. J'aime Miles Davis parce qu'il y a quelque chose de très moderne.
J'aime son évolution électrique jusqu'au rap. Ce n'est pas ma culture, alors
que j'étais entouré à Toulon de jazzmen. Je n'ai pas été un batteur de jazz.
J'aime Eric Truffaz, Brahim Maalouf, ils font évoluer
cette musique qui semblait être morte ! Pierre Adenot, Jean-Michel
Bernard, eux sont des compositeurs jazzmen. Je peux tout composer sauf du
jazz !
Je peux
vous dire que c'est à cause de la musique que je suis allé voir le film ! Avez–vous une réflexion sur le fait de mettre en conserve
la musique de film ?
J'aime bien, ça laisse une trace. Dans ce CD on a
remonté, remixé, la musique pour que cela soit ''écoutable'', on a essayé de ne
pas mettre des musiques de 40 secondes. On entend la musique telle quelle car
souvent on ne l'entend pas totalement dans le film.
Le prochain film ?
C'est une
comédie mais on n'en parlera pas.
Est-ce difficile d'écrire pour
une comédie ?
C'est très complexe : on peut tomber dans la
musique sautillante. Il faut trouver des orchestrations un peu nouvelles, Cosma avait trouvé le ton juste. Raymond Lefèvre avec les
Gendarmes avait trouvé aussi un style.
Bon, alors on vous souhaite une
carrière à la Cosma !




Propos recueillis par Stéphane Loison.
On les aimés!
Henri
Dutilleux et le cinéma
« Voir un très bon film me nourrit,
m'exalte comme la lecture d'un grand livre. Aussi, je m'intéresse au mécanisme
de la construction, de la forme adoptée »
Henri Dutilleux (1916-2015) a très peu
composé pour le cinéma mais pour des grands films classiques : La Fille
du diable, Henri Decoin, 1945 ; Le Café du
cadran, 1947 ; Le Crime des justes, Jean Gehret,
1950 ; Six heures à perdre, Alex Joffé, 1947 ;
L'Amour d'une femme, Jean Grémillon, 1953.
Un extrait de la Première Symphonie a
été utilisé dans « Sous le soleil de Satan », de Maurice
Pialat 1987. Il aurait tant aimé qu'on lui fasse des propositions de
composition pour l'image...


Gérard Calvi ou le dernier pied
de nez d'un Branquignol
« Branquignol », « Ah Les Belles Bacchantes », « La
belle Américaine », « Allez France ! », « La Cité de
l'Indicible Peur », « Le Petit Baigneur », « Le Viager… »,
les dessins animés d'Astérix, le générique de Monsieur
Cinéma, …il a participé à toutes les comédies déjantées de Dhéry,
de Tchernia, de Goscinny, de Mocky, apportant avec
son style de composition entraînant une jubilation supplémentaire aux images complétement loufoques de ces grands de la comédie à la
française !
Son nom : Grégoire Élie Krettly ! Mais c'est
sous son pseudonyme qu'il est plus connu : Gérard Calvi ! Il a écrit
de la musique sérieuse – en 1945 il est grand prix de Rome de composition - , des opérettes, de la variété, des chansons (plus de 300
pour Sinatra, Piaf, Minnelli…), pour le théâtre, le cinéma, la télévision. Il
arrivait à écrire une musique burlesque d'une manière très étudiée, instillant
un humour incroyable, des gags musicaux à « effets ». Son style était
inimitable, on le reconnaissait entre tous.
C'est au conservatoire, rue de Madrid, qu'il a fait la connaissance de
Robert Dhéry, car musique et
« déclamation » étaient mélangées, enfin presque, car, à la cantine,
chaque « corps de métier », ne se mélangeait pas. Dhéry un jour a créé la table de la mixité où musiciens,
compositeurs, comédiens, se sont mélangés. C'est ainsi qu'il a annoncé à Calvi
qu'il écrirait la musique pour tous ses spectacles et ses films ! Il
ajouta qu'il mettrait au point un style que l'on ne connaissait pas en France.
C'est sept ans plus tard, en 1941, que naissait le premier spectacle
Branquignol, influencé par le non sens américain, la poésie de l'absurde !
C'étaient les précurseurs du Café de la Gare ! Hélas on ne trouve pas sa
musique en CD, à part quelques Astérix. Il y a 20 ans, Auvidis
avait sorti une compile des films Dhéry/Calvi qu'on
peut encore trouver à des prix prohibitifs sur Amazon ou Priceminister.
Le 20 février 2015, Gérard Calvi est allé rejoindre les Branquignols (Dhéry, Brosset, Carette, de
Funès, Lefebvre, Carnet, Maillan, Serrault, Dax, Duvaleix, Legras, Rollis, Caccia, Tornade, Poivre,
Olaf, Gabriello).


https://www.youtube.com/watch?v=tjdtvwO9o50
Stéphane Loison.
BO en CDs
LES
VOLETS CLOS. Réalisateur : Jean-Claude Brialy.
Compositeur : Paul Misraki. 1Cd MusicBoxRecords /MBR-087
Les Volets clos est le deuxième
film réalisé par Jean-Claude Brialy et relate la vie
d'une maison close bretonne dans les années 30. Pour ce long métrage qui est
une sorte d'hommage à Jean Renoir, Brialy s'entoure
d'une troupe de comédiennes au charisme indéniable (Ginette Leclerc, Suzanne
Flon…), et d'un compositeur qui fut l'une des figures marquantes de
l'entre-deux guerres : Paul Misraki. À 64 ans, Misraki renoue avec le succès grâce à ce film et à son tube
Les Volets clos, interprété par Nicoletta, sur des paroles
de Remo Forlani. Le reste de la partition est à la
fois gaie et nostalgique et comprend de nombreuses – et délicieuses – musiques
de source festives et, à l'occasion, exotiques. Cette légèreté trouve son point
d'orgue à travers la chanson À deux, interprétée par toute la troupe.
Ici Misraki s'auto-pastiche,
et se replonge pleinement dans ses années de gloire, en convoquant le fantôme
de Ray Ventura et ses collégiens.

https://www.youtube.com/watch?v=qTOk0T1Rugc
LUCKY LUKE; Compositeur : Claude Bolling;
&CD MusicBoxRecords : MBR-086
À
l'occasion du 70ème anniversaire du personnage de Lucky Luke, créé par Morris et René Goscinny, Music Box Records
présente dans un luxueux triple album l'intégralité des bandes originales des
films d'animation composées et dirigées par Claude Bolling
: Daisy Town (1971), La Ballade des Dalton (1978) et Lucky Luke, la 2ème série télévisée diffusée en 1990 sur FR3. Morris trace les contours d'un
cowboy qui « tire plus vite que son ombre », peu bavard, redresseur
de torts et très agile à manier le revolver. Une galerie de personnages
typiques complète les aventures nonchalantes de cet homme de l'Ouest américain.
Morris et Goscinny vont faire bénéficier Lucky Luke d'un esprit sans cesse en éveil dans les bandes dessinées,
se traduisant par des gags à multiples facettes dont vont se délecter les
Dalton et le chien Rantanplan, glorifiant la bêtise sans méchanceté. Goscinny,
admirateur de Disney et créateur infatigable d'Astérix, d'Iznogoud ou du Petit Nicolas, rêve de dessin animé. Après avoir travaillé avec les
studios Belvision, il crée son propre studio de
production (Studios Idéfix) et décide, avec Morris,
de donner vie aux personnages de bandes dessinées adulés par les enfants et les
plus grands. Pour la réalisation des films d'animation, Morris et Goscinny
s'associent avec le journaliste-animateur-producteur Pierre Tchernia.
Ambassadeur de Walt Disney pour le petit écran français, Tchernia
dirige la troupe de joyeux lurons qui font parler le cowboy flegmatique et tout
le petit monde qui l'entoure. La musique n'est pas en reste. Elle est même l'un
des éléments fondamentaux sur lequel repose tout le rythme du dessin animé.
Claude Bolling intègre l'aventure en offrant d'emblée
le fameux « I'm a Poor
Lonesome Cowboy », ballade indissociable du
maître de Jolly Jumper. Il met en musique les deux
films d'animation de Lucky Luke ainsi que la 2ème série télévisée. L'illustration musicale
des Lucky Luke est l'occasion pour Claude Bolling d'employer un large éventail de couleurs musicales
: clin d'œil au western américain, au western spaghetti, des thèmes jazz, tijuana, blue-grass, des chansons
de saloon avec piano bastringue, des thèmes écrits dans l'esprit du Count Basie
Orchestra. Une palette musicale riche et variée, indissociable à l'univers de
Lucky Luke et menée de main de maître par Claude Bolling
!

EAST
PUNK MEMORIES. Réalisatrice :
Lucile Chaufour. Musique compilation de groupes punk hongrois. 1CD Danger
Records : DR 013
Constitué d'archives Super 8,
d'interviews et de vues de Budapest, le film East Punk Memories s'articule autour de la parole de douze anciens punks.
A la fin des années 80, ils exprimaient leur colère contre le régime et
attendaient avec espoir le changement du système.
Vingt ans plus
tard, que sont-ils devenus ? Résurgence du nationalisme, sauvagerie du
capitalisme,
confusion des visions politiques de la droite et de la gauche,
comment
vivent-ils la crise actuelle ? La
bande son est faite des musiques de ces groupes punk tels que Eta, QSS, CPG, Kretens, Aurora, Modells. Ce film
est un témoignage passionnant sur ces jeunes gens qui osaient par leurs
musiques défier le pouvoir communiste en place. Si on aime cette musique, c'est
en vinyle qu'on pourra l'entendre. La traduction de ces chansons hongroises est
intéressante et il est indispensable de lire les textes qui sont d'une rare
violence. Ce disque est un beau témoignage d'un passé révolu !

BATMAN V SUPERMAN Dawn of Justice. Réalisateur :Zack
Znider.Compositeur : Hans Zimmer
– Junkie XL. 1CD Sony Classical : 88875183652
Après
les événements dans Man Of Steel, Metropolis
a été rasée et Superman est le personnage le plus controversé du monde. Bien
que pour certains, il est encore un symbole d'espoir, d'autres le considèrent
comme une menace pour l'humanité et réclament justice pour le chaos déchaîné
sur Terre. Pour Bruce Wayne/ Batman le justicier de Gotham City est clairement
un danger pour la société. Il craint les effets d'un tel pouvoir sans contrôle
sur le sort du monde et décide de porter son masque et son costume pour
s'opposer à lui, tandis qu'une nouvelle menace met en danger l'humanité. Zack Znider, c'était le réalisateur génial de Dawn of The Dead, 300, Watchmen,
Zucker Punch avec les musiques fantastiques de
Tyler Bates. Puis vint Superman-Man Of Steel, un mauvais film, avec une mauvaise musique de
Hans Zimmer, mais avec un bon acteur, Henri Cavill. Ici Warner, la même production, a pris les
deux compositeurs les plus dans le vent : Zimmer,
l'homme des Batman et Junkie Xl, l'homme de Mad Max -
curieusement le compositeur de la suite peu réussie de 300 et non réalisée par Znider -. Alors Zimmer V Junkie
XL ? De temps en temps on retrouve la patte de Zimmer
des Batman et des mix électro de
Junkie Xl (dont c'est le job) de Mad Max. On ne peut pas dire que cette musique soit originale, c'est
du remix de ce qu'on a entendu dans les films précités. A l'écoute, le CD n'a
aucun intérêt même pour ceux qui aiment la musique électro acoustique. Dans le
film, cette musique est la boursouflure intégrale qui accompagne des effets
digitaux, des cascades. Tout n'est qu'effets. En avant les drums comme dans Mad Max ! Rien de bien nouveau dans ce
cinéma et dans ces compositions. Il commence à lasser sérieusement. Mais tant
qu'il rapportera, il emplira les écrans et cette musique au mètre s'en portera
d'autant mieux. Zimmer V Junkie Xl
c'est l'auditeur qui est perdant !

https://www.youtube.com/watch?v=8QLj5bC93OY
CONCUSSION
(Seul Contre Tous). Réalisateur :
Peter Landesman.Compositeur : James Newton
Howard. 1CD Sony Classical : 88875173802
Le
Dr Bennet Omalu, un neuropathologiste
de médecine légale, a mené un combat digne de David contre Goliath : il fut le
premier à découvrir l'encéphalopathie traumatique chronique, une affection
cérébrale liée à la pratique du sport chez les joueurs professionnels, et s'est
démené pour révéler son existence contre ceux que cela gênait. La croisade d'Omalu l'opposa dangereusement à l'une des institutions les
plus puissantes du monde…Voilà un film comme les américains adorent, une
histoire vraie mise en scène proprement avec Will Smith très inégal mais avec
un rôle taillé sur mesure, pour son retour à l'écran après quelques daubes, et
avant Suicide Squad, une aventure de Super héros. La
composition de James Newton Howard et elle aussi inégale. Il flirte de temps en
temps avec ses années passées chez Zimmer dans le
style électro acoustique, et certaines plages nous donnent des affections
cérébrales non voulues ! Les plages plus calmes (« The Head as a Weapon – Bennet and Prema – Marry Me – Hello Little
One »…) sont les bienvenues et montrent que ce compositeur a des
ressources. « Concussion End Titles » est
un joli thème joué avec une belle présence du violoncelle. Le CD se termine
avec « In the Darkness », une jolie mélodie
écrite et chantée par Lisbeth Scott qui a participé à de très nombreux films.
Un CD agréable à écouter comme il en est de voir le film.

https://www.youtube.com/watch?v=mRrY7SVT5e4&index=19&list=PLN7k5mBxvt7ZrwxZohwaIJClclfCNDl2S
KUNG
FU PANDA 3. Réalisateur :
Jennifer Yuh
et Alessandro Carloni. Compositeur :
Hans Zimmer.
Troisième volet produit par Dream Works, avec des gags, des aventures épiques comme il
se doit dans ce genre de dessin animé.
Po avait toujours cru son père panda disparu, mais le voilà qui réapparaît !
Enfin réunis, père et fils vont voyager jusqu'au village secret des pandas. Ils
y feront la connaissance de certains de leurs semblables, tous plus déjantés
les uns que les autres. Mais lorsque le maléfique Kaï
décide de s'attaquer aux plus grands maîtres du kung-fu à travers toute la
Chine, Po va devoir réussir l'impossible : transformer une horde de pandas
maladroits et rigolards en experts des arts martiaux, les redoutables Kung Fu
Pandas ! Hans Zimmer a abandonné pour ce genre de
film son style de musique boum badaboum. On est dans le registre du Roi Lion,
on pourrait s'y méprendre sur certains morceaux (The Panda Village). Il y a des
thèmes harmonieux qui flirtent avec la musique chinoise. Il y a même de la
musique sentimentale. Le CD offre deux chansons : « Try »
interprété par Patrick Brasca avec Jay Chow, et « Kung Fu Fighting » joué par The Vamps. Des artistes asiatiques
de renom sont venus participer à cette musique : le pianiste Lang Lang, le violoncelliste Jiang Wang.

https://www.youtube.com/watch?v=10601n0Y84w&list=PLeNErtgP0mU8IBTKkb1uMThNMFKnYPKQ8
SUNSET
SONG. Réalisateur :
Terence Davis. Compositeur : Gast Waltzing. 1CD Milan 399 783 2
Pour ce flamboyant mélo campagnard qui se
passe avant et pendant la guerre de 14, Gast Waltzing a écrit une belle partition nostalgique où les
instruments en solo tiennent une part importante (violoncelle, violon,
hautbois). C'est une musique au parfum écossais. On connaît mal les
compositions de Gast Waltzing
bien qu'il en ait écrit plus de 150. Milan a eu la bonne idée de l'avoir
éditée. Sur le CD il y a peu de musique qui a été entendue dans le film (il y
en a peu), mais on peut apprécier ce qu'il avait composé et qui n'a pas été
utilisé. On peut réentendre la triste mélodie « Wayfaring
Stranger » interprétée par Jennifer John. Voilà
une musique délicate très agréable et qui rappelle ce terrible drame qu'est
Sunset Song.

Stéphane Loison.
***
LA VIE DE L’EDUCATION MUSICALE
Si vous souhaitez promouvoir
votre activité, votre programme éditorial ou votre saison musicale dans L’éducation musicale, dans notre Lettre
d’information ou sur notre site Internet, n’hésitez pas à me contacter au 01 53
10 08 18 pour connaître les tarifs publicitaires.
|
Les projets d’articles sont à envoyer à redaction@leducation-musicale.com
Les livres et les CDs sont à envoyer à la rédaction de l’Education
musicale : 7 cité du Cardinal Lemoine 75005 Paris
Le site de l’Education Musicale
La librairie de L’éducation
musicale
Baccalauréat 2016. Épreuve de musique LIVRET DU CANDIDAT
192 pages Consulter le sommaire en cliquant ici |
| 1.STOCKHAUSEN JE SUIS LES SONS | ||
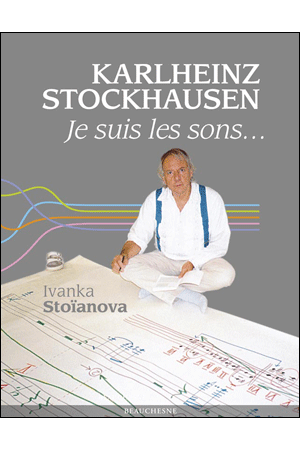 |
Ce livre, que le compositeur souhaitait publier dans sa maison d’édition à Kürten, se propose de présenter les orientations principales de la recherche de Karlheinz Stockhausen (1928-2007) à travers ses œuvres, couvrant sa vie et ouvrant un accès direct à ses écrits. Divers domaines investis par le plus grand inventeur de musique de la seconde moitié du xxe siècle sont abordés : composition de soi à travers les matériaux nouveaux ; découvertes formelles et structures du temps ; musique spatiale ; métaphore lumineuse ; musique scénique ; l’hommage au féminin de l’opéra Montag aus Licht ; Wagner, Stockhausen et le Gesamtkunstwerk, œuvre d’art total. Les témoignages des femmes qui l’ont accompagné dressent un portrait vif et saisissant de l’homme, artiste génial qui aimait plus que tout la musique et la recherche compositionnelle au nom du progrès de l’être humain...(suite)
|
|
| 2. ANALYSES MUSICALES VIIIè SIECLE - Tome 1 | ||
 |
BACH Cantate BWV 104 Actus tragicus : Gérard Denizeau Toccata ré mineur : Jean Maillard Cantate BWV 4: Isabelle Rouard Passacaille et fugue : Jean-Jacques Prévost Passion saint Matthieu : Janine Delahaye Phœbus et Pan : Marianne Massin Concerto 4 clavecins : Jean-Marie Thil La Grand Messe : Philippe A. Autexier Les Magnificat : Jean Sichler Variations Goldberg : Laetitia Trouvé Plan Offrande Musicale : Jacques Chailley
COUPERIN
Les barricades mystérieuses : Gérard Denizeau Apothéose Corelli : Francine Maillard Apothéose de Lully : Francine Maillard
HAENDEL
Dixit Dominus : Sabine Bérard Israël
en Egypte : Alice Gabeaud
Ode à Sainte Cécile : Jacques Michon L’alleluia du Messie : René Kopff
Musique feu d’artifice : Jean-Marie Thill |
|
| 3. LE NOUVEL OPERA | ||
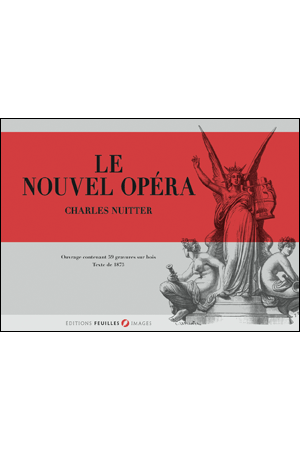 |
Publié l'année même de son ouverture, cet ouvrage raconte avec beaucoup de précisions la conception et la construction du célèbre bâtiment. |
|
| 4. LEOS JANACEK, JEAN SIBELIUS, RALPH VAUGHN WILLIAMS - UN CHEMINEMENT COMMUN VERS LES SOURCES | ||
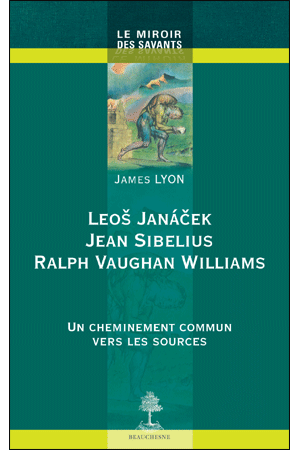 |
Pour la première fois, le Tchèque Leoš Janácek (1854-1928), le Finlandais Jean Sibelius (1865-1957) et l'Anglais Ralph Vaughan Williams (1872-1958) sont mis en perspective dans le même ouvrage. En effet, ces trois compositeurs - chacun avec sa personnalité bien affirmée - ont tissé des liens avec les sources orales du chant entonné par le peuple. L'étude commune et conjointe de leurs itinéraires s'est avérée stimulante tant les répertoires mélodiques de leurs mondes sonores est d'une richesse émouvante. Les trois hommes ont vécu pratiquement à la même époque.
|
|
| 5. LA RECHERCHE HYMNOLOGIQUE | ||
 |
En plein essor à l'étranger, particulièrement en Allemagne, l'hymnologie n'a pourtant pas encore acquis ses titres de noblesse en France. |
|
| 6. JOHANN SEBASTIAN BACH - CHORALS | ||
 |
Ce guide s’adresse aux musicologues, hymnologues, organistes, chefs de chœur, discophiles, mélomanes ainsi qu’aux théologiens et aux prédicateurs, soucieux de retourner aux sources des textes poétiques et des mélodies de chorals, si largement exploités par Jean-Sébastien Bach, afin de les situer dans leurs divers contextes historique, psychologique, religieux, sociologique et surtout théologique. |
|
| 7. LES 43 CHANTS DE MARTIN LUTHER | ||
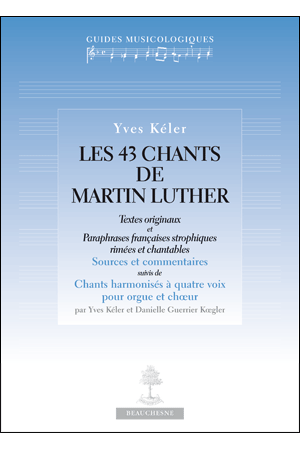 |
Cet ouvrage regroupe pour la première fois les 43 chorals de Martin Luther accompagnés de leurs paraphrases françaises strophiques, vérifiées. Ces textes, enfin en accord avec les intentions de Luther, sont chantables sur les mélodies traditionnelles bien connues. |
|
| 8. LES AVATARS DU PIANO | ||
 |
Mozart aurait-il été heureux de disposer d'un Steinway de 2010 ? L'aurait-il préféré à ses pianofortes ? Et Chopin, entre un piano ro- mantique et un piano moderne, qu'aurait-il choisi ?
Entre la puissance du piano d'aujourd'hui et les nuances perdues des pianos d'hier, où irait le cœur des uns et des autres ?
Personne ne le saura jamais. Mais une chose est sûre : ni Mozart, ni les autres compositeurs du passé n'auraient composé leurs œuvres de la même façon si leur instrument avait été différent, s'il avait été celui d'aujourd'hui.
Mais en quoi était-il si différent ? En quoi influence-t-il l'écriture du compositeur ? Le piano moderne standardisé, comporte-t-il les qualités de tous les pianos anciens ? Est-ce un bien ? Est-ce un mal ? Qui a raison, des tenants des uns et des tenants des autres ? Et est-ce que ces questions ont un sens ?
Un voyage à travers les âges du piano, à travers ses qualités gagnées et perdues, à travers ses métamorphoses, voilà à quoi convie ce livre polémique conçu par un des fervents amoureux de cet instrument magique. |
|
| 9. CHARLES DICKENS, LA MUSIQUE ET LA VIE ARTISTIQUE A LONDRES A L'EPOQUE VICTORIENNE | ||
|
|
Au travers du récit que James Lyon nous fait de l’existence de Dickens, il apparaît bien vite que l’écrivain se doublait d’un précieux défenseur des arts et de la musique. Rares sont pourtant ses écrits musicographiques ; c’est au travers des références musicales qui entrent dans ses livres que l’on constate la grande culture musicale de l’écrivain. Il se profilera d’ailleurs de plus en plus comme le défenseur d’une musique authentiquement anglaise, forte de cette tradition évoquée plus haut. Et s’il ne fallait qu’un seul témoignage enthousiaste pour décrire la grandeur musicale de l’Angleterre, il suffit de lire le témoignage de Berlioz (suite). | |
Les analyses musicales de L'Education Musicale